
Agrandissement : Illustration 1
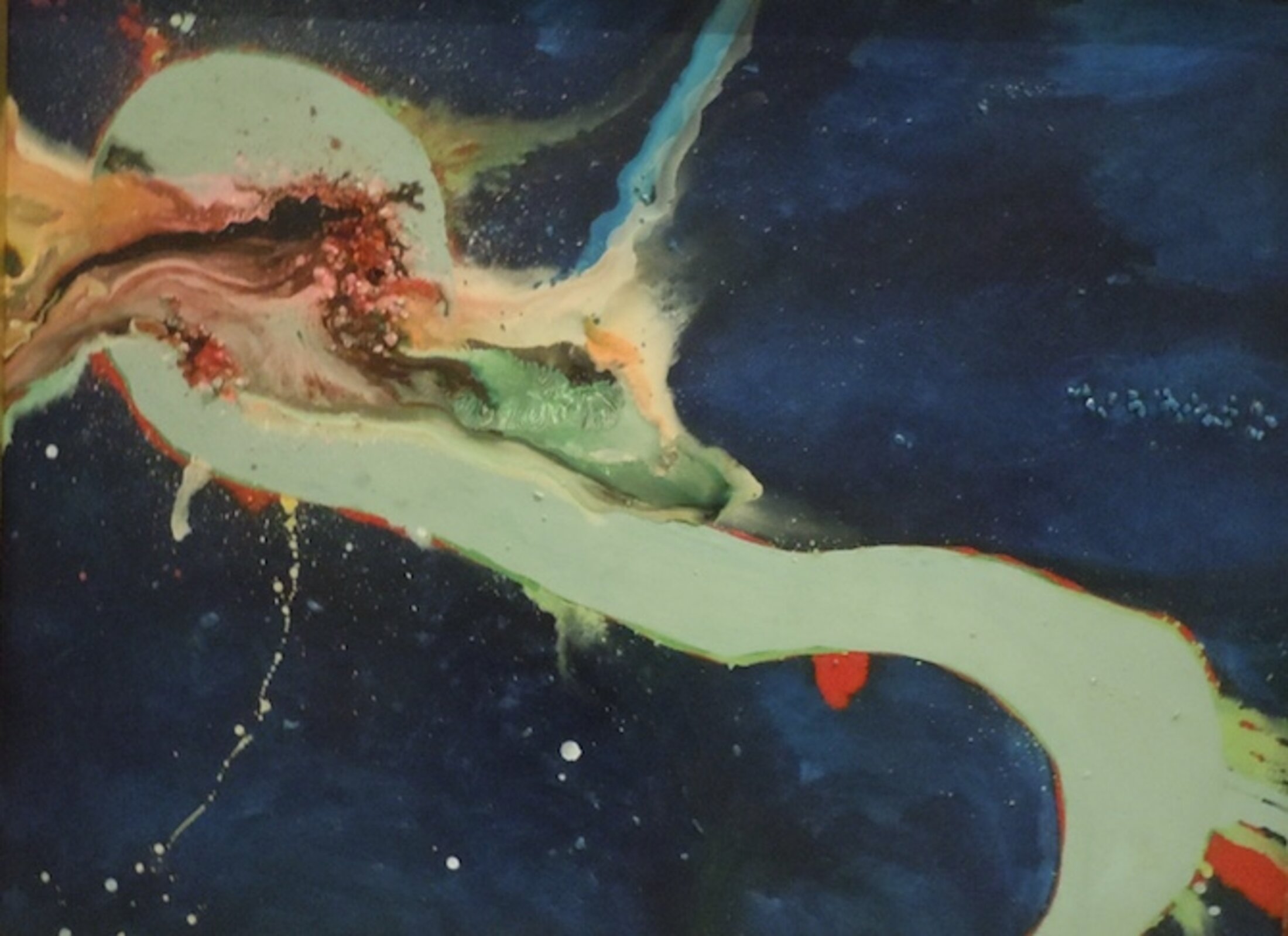
L’ARCHÉOLOGIE MENTALE DE L’OCCIDENT
À quoi sert la philosophie ?
Perplexité
Depuis toujours je me demande ce qu’est la philosophie, à quoi elle sert, comment elle fonctionne, quelle est sa place dans notre système de pensée...?? J’étais perplexe car je ne trouve jamais de réponses dans la philosophie, quand je veux trouver des réponses, et j’en trouve, je laisse la philosophie de côté. Mais alors à quoi sert-elle ?
C’est le type de pensée et sa dynamique qui m’étaient incompréhensibles : personnellement, je pense pour agir, pour me situer dans le monde, pour le comprendre et pour m’y comporter d’une manière qui soit viable en interaction avec mes semblables : chez moi, le penser détermine l’agir. Or, lorsque des philosophes interviennent dans les débats d’actualités, je n’observe jamais que leur pensée ait la moindre utilité dans une perspective d’action, leurs réflexions ne sont jamais opératoires. Pourtant, lorsqu’on réfléchit aux problèmes de notre temps, c’est bien parce que nous avons besoin d’agir pour leur trouver des solutions... Toujours la même perplexité : quel est l’utilité de cette inutilité ?
À quoi sert une pensée... qui ne sert à rien ? Pourquoi alors interviennent-ils si leurs contributions sont inutiles ? J’ai eu confirmation de cette problématique par une citation de Raphaël Enthoven :
« Le succès de la philosophie repose sur un malentendu, on attend de la philosophie qu’elle apporte des réponses, alors qu’elle sert à entretenir le doute »
Là, je suis d’accord. Mais son interprétation est tout de même insuffisante, la philosophie a nécessairement une fonction beaucoup plus large, elle est très ancienne, elle a une longue histoire, une dynamique, un processus de développement, qui imprègnent tous les aspects de notre culture... Et les philosophes ont une prétention bien plus importante.
Heinz Wismann
C’est le livre d’un philologue, Heinz Wismann, qui m’a fait comprendre la place et le rôle de la philosophie, non par les thèmes philosophiques eux-mêmes, mais par son histoire, par son origine, par sa genèse, son développement, par la manière dont elle a développé ses thèmes... et ainsi j’ai pu comprendre son rapport aux autres disciplines, intellectuelles, artistiques et scientifiques. Dans son livre : « Penser entre les langues », Heinz Wismann développe l’analyse et l’interprétation dynamique de la pensée occidentale à partir de son origine grecque.
Mentalité
De la lecture de ce livre, je retire d’abord une impression de cohérence logique et dynamique de l’ensemble de notre pensée occidentale, et au-delà, de notre sensibilité ; car avant même de penser, nous sommes déjà conditionnés dans notre appréhension des choses, du monde, du réel. Et c’est ce conditionnement, historique, que Heinz Wismann met en scène, à la fois dans l’époque historique où il s’exprime, s’invente, mais aussi dans ses prolongements fondamentaux sur lesquels s’établissent les nouveaux concepts, les nouvelles identités, les nouvelles découvertes, les nouvelles synthèses...
Il nous offre un panorama de la genèse de notre pensée et de notre sensibilité, il montre tous les développements par lesquels notre perception du monde, du réel, est déterminé par ces fondements originels, aussi bien dans ces aspects culturels, que religieux, artistiques, scientifiques, mentaux.
- Oui voilà : ce qu’il nous décrit-là, dans son origine, sa genèse, sa logique dynamique et son développement, c’est toute notre mentalité occidentale.
Pour prendre la mesure de la réalité de cette mentalité, il faut la comparer à d’autres ; comparer notre façon de penser, de ressentir, d’appréhender le réel du monde, et d’y répondre, avec d’autres mentalités d’autres civilisations, d’autres cultures.
Personnellement, je ne saurais décrire notre mentalité occidentale, et le livre de Heinz Wismann l’exprime bien, dans toute son ampleur, dans toutes ses composantes ; enfin, peut-être pas toutes, mais en tous cas, il nous livre la dynamique de notre rapport au réel, comment tout au long de notre histoire commune et de nos histoires particulières, nous avons perçu le monde, comment nous nous le sommes représenté, comment nous l’avons formulé, et comment nous nous sommes appuyés sur ces représentations pour établir de nouvelles réalités concrètes, de nouvelles règles, à partir de nouveaux concepts...
La philosophie, un délire raisonnant
Je rappelle mon interrogation : « à quoi sert la philosophie... qui ne sert à rien ? » Heinz Wismann nous montre d’où elle démarre, sur quelles bases, et comment elle se développe, selon quelle logique...
Le point de départ de la philosophie, c’est le mythe, les récits mythiques, grecs ; la philosophie ne remonte pas plus avant. Ce qu’il y a avant le mythe n’est pas pris en compte par la philosophie, c’est à dire, comment on a créé ces mythes, pourquoi, comment, que recèlent-ils de quelle réalité précédente ? Rien. La philosophie ne recherche pas cette origine, c’est à dire qu’elle ne recherche pas les fondements de sa propre réalité. Et pour moi, ce point de départ mythique est problématique ; je n’ai jamais compris pourquoi on prenait au sérieux ces fables, ces racontars, je ne comprenais pas pourquoi on leur accordait le moindre crédit, pour moi, un mythe, « ce n’est pas vrai », je n’ai jamais accordé la moindre valeur à cette mythologie, ni à aucune autre, parce que ce n’est pas vrai. Alors pourquoi accepte-t-on de raisonner à partir des mythes, au lieu de chercher ce qu’il y a derrière, de chercher quelle réalité concrète cache ces mythes ? Je comprends bien qu’au départ on n’ait pas eu le recul nécessaire pour remettre en cause cette base de départ, mais depuis qu’on relativise cette origine, la philosophie continue d’interpréter les récits mythiques pour essayer de leur faire produire un sens, et toujours sans remettre en question la validité de ce point de départ.
Par exemple Œdipe, dont le parricide et l’inceste maternel sont commentés sans discussion, sans critique, prenant cette accusation pour fait avéré : « quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage » ; de la même manière on accuse Œdipe de parricide et d’avoir couché avec sa mère pour justifier son meurtre, son sacrifice. Le parricide et l’inceste maternel sont des stéréotypes persécuteurs que l’on retrouve partout : lorsqu’on veut justifier le meurtre de quelqu’un, on dit qu’il a tué son père et qu’il a couché avec sa mère. Œdipe est un sacrifié, comme Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, on sait qu’il est un sacrifié. Œdipe, on ne le sait pas - parce que ce sont ses persécuteurs qui racontent son histoire. Tandis que ce sont ses adeptes qui racontent l’histoire de Jésus-Christ. Que resterait-il de Jésus-Christ si son histoire était racontée par ses persécuteurs ? Pauvre Œdipe, et jusqu’à un certain Sigmund F. qui fait de ce mensonge la base d’un syndrome psychologique !
Le mythe est le récit mensonger des persécuteurs, pas seulement erroné, mensonger. Et la pensée philosophique ne revient jamais sur ce mensonge originel.
- « À l’origine s’opposent deux puissances qui peuvent se définir par l’affirmation de la différence radicale (Terre issue de Chaos) et par l’affirmation de l’identité absolue (Ciel, issu de Terre et s’identifiant comme un double parfait)... la puissance originaire de la Béance (Chaos) se perpétue dans l’action d’Éros... le couple Terre-Ciel... l’étreinte étouffante d’Ouranos... Cronos creusant sa cavité pour mutiler son père... Terre prépare sa revanche... sous l’instigation de Gaia... l’affrontement entre Cronos et Ouranos se répète entre Zeus et Cronos... pour arrêter la démesure des Titans, Zeus reçoit le concours des Cent-Bras et des Cyclopes..., puis Titan, Prométhée… »
Pour certains, l’Un est l’eau, ou bien le feu, ou l’air, ou la Terre... et puis ce sont des atomes, et ces atomes sont des idées...
Au départ, la pensée est un délire, mais un délire qui raisonne, et qui à force de raisonner, structure la pensée en se rationalisant, mais toujours délirante. Ce n’est pas étonnant : il fallait bien que la pensée démarre de quelque manière, et au départ, elle ne pouvait être rationnelle, elle était donc délirante.
Pour comparer, la pensée chinoise s’est constituée par l’exégèse de la divination, au départ tout aussi délirante ; pour leurs pratiques divinatoires, les chinois utilisaient des carapaces de tortues qu’ils jetaient dans le feu qui provoquait des craquelures sur leur carapace ; ils interprétaient ces craquelures, ces craquelures sur lesquelles les chinois ont calqué leurs idéogrammes : en même temps que la pensée, l’écriture chinoise est issue des pratiques divinatoires...
Que la pensée, philosophique donc, ait été délirante au départ ne me choque pas, mais de ce départ est issu un développement toujours plus sophistiqué qui ne remet jamais en question ce délire originel, il en est le prolongement. Que les premiers philosophes délirent en « émergeant » une pensée balbutiante, d’accord. Mais que leurs successeurs prolongent et développent ce délire, c’est beaucoup plus contestable.
D’autant plus que beaucoup d’entre-eux sont soit de préjugé, soit de mauvaise foi. Par exemple Platon, qui écrit le Timée qui est la récapitulation de l’œuvre des philosophes antérieurs, sauf certains tel Démocrite, parce qu’il dit le contraire de ce qu’il affirme lui-même. Autrement dit, Platon est un tricheur. Et puis, Platon avait un préjugé favorable au Même, qui pour lui est le Bien, contre l’Autre, qui pour lui est le mal, et il a utilisé toute sa puissance intellectuelle à bâtir le triomphe de son préjugé.
De même, Heidegger a mis toute son intelligence, toute son énergie à justifier son obsession, son préjugé, d’ailleurs toujours le même que celui de Platon, le Même qui serait le Bien, le Juste, le Vrai, contre l’Autre méprisable, falsifiant les contributions des Anciens pour leur faire dire ce qu’il pensait obsessionnellement lui-même ; le nazisme a politiquement mis en œuvre le système qui en découle, avec le succès que l’on sait.
Ainsi, l’obsession du « Même » d’Heidegger est la même que celle des présocratiques 2500 ans plus tôt : en 2500 ans, les philosophes n’ont pas avancé d’un pouce, ils en sont au même point, malgré toute leur réflexion mise en œuvre, toute leur intelligence, leur virtuosité.
- La philosophie me fait l’effet d’un vélo d’appartement : on pédale, on pédale (on pense, on pense), mais on reste toujours à la même place. Et en plus, les philosophes s’imaginent que leurs idées mènent le monde, le déterminent : c’est comme si en pédalant sur un vélo d’appartement installé dans un train, on s’imaginait faire avancer le train.
Non, le réel de la vie et du monde, c’est plutôt comme un vrai vélo : à chaque coup de pédale, à chaque tour de roue, on n’est plus au même endroit, ni au même moment ; le temps et l’espace se conjuguant dans un continuum qui s’impose.
Ce n’est pas la philosophie qui a réfuté Heidegger, c’est l’histoire. C’est à dire la réalité, l’expérience commune vécue par un ensemble de gens.
Logique cohérente et dynamique de la pensée occidentale
Lorsqu’on suit les descriptions et les analyses que Heinz Wismann fait de la pensée philosophique depuis son commencement, on est émerveillé de sa puissance, de sa finesse, de sa cohérence, s’articulant dans tous les développements à la fois mentaux, spirituels, intellectuels et culturels, sociaux, scientifiques, économiques, matériels... C’est si extraordinaire qu’on en arrive à se demander comment les autres civilisations qui n’ont pas la chance de posséder une telle pensée, ont bien pu se développer... ??
Heinz Wismann est dans son domaine, philosophique, et il « lit » le monde à travers son prisme philosophique. Il fait ressortir toutes les implications, articulations, de tous les concepts mis en œuvre tout au long de l’histoire, à toutes les époques. La cohérence dynamique de l’Occident est magnifique. De l’Un immanent grec, à l’Un transcendant, monothéiste, juif et chrétien, le « bricolage » conceptuel chrétien à partir des conceptions grecque et juive, l’invention de l’individualité, en passant par le développement de l’art, des sciences, mathématiques et physique, puis dans la Réforme et la Contre-Réforme, puis l’humanisme, la pensée scientifique, et jusqu’au nazisme... tout semble découler et être déterminé par la puissance de la dynamique de cette pensée philosophique occidentale.
Sans prétendre expressément que cette logique dynamique de la pensée occidentale détermine le réel historique de ces sociétés occidentales, c’est tout de même ce qui découle de sa présentation et de ses analyses. Il me semble que c’est ce qu’il pense implicitement.
---------------------------------------------------------------
La vision des historiens - L’avènement de l’occident
Les historiens qui scrutent les sociétés du passé n’observent pas que ces caractères philosophiques aient déterminé les sociétés en évolution et en mutation. Essayons d’avoir une vision d’ensemble, et comparons.
C’est l’Occident qui a mené le développement le plus élevé sur les plans à la fois, intellectuel, philosophique, humaniste, juridique, politique, social et économique sur la base de cette pensée d’origine gréco-romano-judéo-chrétienne. Pourtant, l’Occident n’était pas le seul à disposer de cette origine ; l’Orient chrétien, l’Église orthodoxe, l’Empire d’Orient, avaient les mêmes origines, et sans doute avaient une meilleure connaissance de la Grèce Antique que l’Occident. Et c’est l’Empire arabe musulman qui a transmis aux Occidentaux les textes grecs dont ils avaient perdu la mémoire, s’ils l’avaient jamais eu. Comment se fait-il qu’ils n’aient pas eu le même développement ? Ils sont en retard sur l’Occident sur tous les plans.
- En l’An 1000, des trois Empires, celui d’Occident est le plus faible, le plus pauvre et le moins savant. Et depuis, c’est l’Occident qui s’est développé au point de dominer le monde entier, et les deux autres qui ont périclité…
Les historiens situe le commencement du développement particulier de l’Occident au IVe siècle aussitôt après la chute de l’Empire Romain, Dans le désordre qui a suivi l’effondrement de cet Empire Romain, l’Église a été la seule institution en état de fonctionnement permanent. L’Église de Rome, catholique, d’Occident.
Ils observent plusieurs faits :
- 1 L’organisation sociale non impériale assurée par l’Église, est une particularité absolue de l’Occident chrétien, et qui a ainsi fondé l’unité culturelle de l’Occident.
- 2 La « déparentalisation » du social. Dans les sociétés européennes anciennes (et dans beaucoup de sociétés non occidentales actuelles), la valeur sociale des personnes est fondamentalement et visiblement déterminée par leur position au sein de l'ensemble des rapports de parenté de leur société. Les rapports de parenté s'imposent à tous et à chacun. En Occident au Moyen-Age, un long processus d'évolution sociale relativise les rapports de parenté et les soumet à des logiques sociales extérieures : peu à peu, les rapports de parenté ne sont plus « primo-structurants ».
- 3 La disqualification de la parenté charnelle, remplacée par la parenté spirituelle. L'Église a mis en pratique cette "déparentalisation" au niveau de son recrutement. L'Église latine se constitue précisément au Moyen-Age en une institution explicitement fondée sur la marginalisation des rapports de parenté charnelle : célibat et chasteté, excluant par principe toute filiation interne au clergé. L'Eglise prend le contrôle de l'alliance matrimoniale, impose le nom de baptême. Aucune généalogie en dehors du cercle royal, culte des ancêtres remplacé par le culte des saints et en faveur des morts en général, sont un recul de la pertinence sociale de la filiation. C'est le prêtre qui au moment du baptême, fait de l'enfant une véritable personne, alors qu'en Grèce et à Rome c'était le père charnel qui le faisait. L'Église s'est donc appropriée les fonctions de socialisation dévolues antérieurement aux rapports de parenté. En disqualifiant la parentèle, elle a valorisé le "noyau familial": l'Église a donc institué la famille nucléaire. La cellule conjugale ainsi constituée est fondée sur l'isolement de certains rapports de parenté et leur condensation autour d'un foyer commun. Ce qui sous-tend la cellule conjugale qui était une cellule de production, c'est la co-résidence.
- 4 La société médiévale devient une société sans ancêtres. C’est le mariage chrétien qui a structuré la société médiévale sur une base non parentale.
C’est donc bien que l’effort clérical pour définir un certain exercice de la parenté a eu une efficacité particulière.
- Si le XIe siècle constitue un tournant, c'est parce que l'Église est en mesure alors, d'imposer de façon hégémonique son interprétation des textes sacrés, et donc de contrôler le social. L'Église, organisée fondamentalement de manière « déparentalisée », est dirigée par une aristocratie ecclésiastique, qui se recrute de manière déparentalisée. De ce fait, ce recrutement déparentalisé de l'Église devient le signe de la supériorité sociale. C'est donc par son encadrement des rapports de parenté charnels et par l'élaboration d'une corrélation entre primauté sociale et non-parentalité, que l'Église aboutit à disqualifier socialement la parenté charnelle au sein de la société occidentale.
- 5 La spatialisation du social - Le spatial s'est substitué au parental : pour situer socialement une personne, on tend de plus en plus à la localiser : elle est de tel endroit, plutôt qu’elle est de telle famille.
- 6 L'enracinement du social. Les descendants (des ancêtres détenteurs originels des pouvoirs) se transforment en héritiers. C'est un élément essentiel du processus de spatialisation/déparentalisation. Les personnes, leur naissance, leur mariage, leur succession, sont fondamentalement soumis aux impératifs de préservation et de transmission du patrimoine, qui s'imposent aux personnes : ce n'est plus l'héritier qui hérite de la terre, c'est la terre qui en hérite. Le pouvoir s'enracine, d'une domination personnelle itinérante, on passe à une domination spatiale. Se généralisent alors les communautés d'habitants, villages, bourgs, villes...
- 7 Le rapport social de base : habiter. Alors qu'auparavant, on appartenait à une famille, à un maître. Fondamentalement, habiter signifie être de quelque part, avoir des voisins, produire quelque part. C'est parce que les habitants pouvaient désormais avoir le sentiment d'avoir en commun un certain espace, qu'une nouvelle cohésion sociale a pu émerger à mesure que s'affaiblissait la cohésion globale fondée sur les rapports de parenté. L'intervention de l'Église dans la spatialisation est plus difficile à discerner.
La paroisse se distingue des communautés d’habitants : les communautés d'habitants n'ont pas de centre, d'où l'enjeu crucial du cimetière qui est un lieu essentiel dans la sociabilité et dans la constitution sociale de la communauté en tant que telle : avec la main-mise paroissiale sur le cimetière, réservé aux seules activités funéraires, le curé devient, au plus tard au XIIIème siècle, l'intermédiaire obligé des relations entre les vivants et les morts. C'est par ce biais que l'excommunication, qui n'entraîne pas le bannissement, vaut exclusion de la communauté, car l'excommunié est exclu du cimetière commun. Mais les communautés d'habitants avaient des limites territoriales, alors que les paroisses ont un centre mais pas de limites : les deux conceptions se rapprocheront puisqu'à la Révolution, les communes seront calquées sur les paroisses. La spatialisation du social a eu pour effet le développement de l'esprit de clocher.
La spatialisation est le processus social à la fois inverse et complémentaire de celui de la déparentalisation, le développement de chacun accentue l'autre, et donc contribue à la dynamique de l'ensemble.
La spatialisation est ce qui distingue radicalement le principe communautaire occidental des autres formes que l'on rencontre ailleurs ou auparavant. De même que la déparentalisation signe la spécificité occidentale.
- 8 L'invention du salariat, de l'idéal égalitariste et démocratique. L'adjectif « occidental » ne signifie en aucun cas européen ou blanc, mais renvoie à mode d'organisation sociale dans lequel les rapports de parenté sont secondaires. Il est occidental parce que c'est l'Église d'Occident qui l'a inventé (certaines sociétés d'Asie ont fait de même), mais surtout l'a généralisé.
C'est la domination interne (dominants sur dominés occidentaux) qui est plus performante, et qui a entraîné la domination externe des Occidentaux sur le reste de la planète.
L'organisation productive agricole ou artisanale, en ville ou au village a deux niveaux :
1 la famille, le « feu », la maison où le chef de feu organise l'usage de la force de travail (épouse enfants domestiques) et en assure la répartition du fruit ;
2 la communauté d'habitants (dispersion des parcelles, vaine pâture, etc...
Par ailleurs, les rapports entre enfants sont soumis aux exigences de reproduction de l'unité d'exploitation, qui engendre célibat, âge au mariage tardif, émigration des cadets... Ce système se généralisant, le "jeune" dispose de façon autonome de sa force de travail, dans lequel chacun des membres du foyer peut avoir un patron particulier.
L'avènement du salariat en tant que rapport de production dominant à partir du XVIIIème siècle présuppose la propriété de soi, à savoir la liberté de sa force de travail. Le salariat ne peut se développer que dans une population dont les membres sont libres de disposer de leur force de travail, ce qui exclut les systèmes serviles, mais aussi les systèmes de parenté. Mais la liberté de la force de travail ne peut aboutir au salariat que si elle est libre de ses mouvements.
Le double processus déparentalisation et spatialisation a conduit à la croissance matérielle de l'Occident, mais cette richesse n'est jamais en soi la garantie du succès : tout dépend de la capacité d'analyse du nécessaire, du possible, de l'inutile et du néfaste... donc de l'existence durable de compétences.
Ce qui est devenu le mode principal de légitimation d'accès au pouvoir, ce sont les compétences. Ce qui a deux conséquences majeures : 1 l'idéal égalitariste et démocratique. 2 ceux qui accèdent au pouvoir sont tendanciellement les plus instruits et les plus informés. Cela signifie que ces sociétés sont tendanciellement dirigées par les plus savants.
- 9 L'Église a été le laboratoire de la méritocratie. Les évêques, de l'époque mérovingienne d'abord, considéraient que la connaissance des lettres était désormais le seul garant de la domination sociale. Ce sont eux qui, à l'époque carolingienne, mettent en place une culture latine entièrement contrôlée par le clergé, avec des lieux d'entretien et de diffusion, écoles monastiques et cathédrales. C'est encore le clergé qui peuple les universités à partir de leur fondation (en 1200 environ) soumises à la tutelle pontificale, qui par leur mode de fonctionnement, font émerger les plus brillants. Ce sont tendanciellement les plus compétents qui forment le haut clergé, les conciles qui fixent les normes religieuses et sociales, les entourages princiers et royaux. Le niveau intellectuel du clergé s'accroît de manière continue, et l'Église est de plus en plus dirigée par des savants, et même par les plus savants. Si l'Église est parvenue à assurer sa position dominante, ce n'est pas parce que les hommes du Moyen-Age étaient très croyants, mais parce que les clercs étaient les plus savants. La reproduction de la domination du clergé est fondée sur une ponction continue sur le monde laïc, comme les États-Unis actuellement ponctionnent systématiquement le capital intellectuel mondial, ce qui leur permet de reproduire leur avance scientifique. Il reste beaucoup à en dire, beaucoup à en découvrir : par exemple, jusqu'à quel point l'Église savait-elle ce qu'elle faisait ? ... La recherche continue...
- La société médiévale, quoique radicalement distincte, n'est pas l'inverse de la société contemporaine, mais bien plutôt sa matrice.
- J’ai pris le soin de rendre compte en détail des travaux des historiens-médiévistes pour cette observation remarquable : les données philosophiques fondamentales et magnifiques exposées par Heinz Wismann n’entrent pour aucune part dans l’avènement, la construction ni le développement de l’Occident. Aucune.
À écouter les philosophes, on croirait que leurs concepts déterminent le monde réel, on voit bien là qu’il n’en est rien. Ce qui apparaît déterminant dans la construction et l’évolution de la réalité du monde, c’est la nature du système social, c’est à dire la manière dont les sociétés organisent leurs relations sociales, leurs rapports sociaux, comment elles les structurent, sur quelles bases légitimes, donc selon quels droits, quels statuts. La structure politique elle-même n’est pas déterminante, elle découle seulement du système social.
Avènement de l’humanisme
Les données fondamentales philosophiques héritées de la Grèce Antique, du Judaïsme, puis du Christianisme, sont tout aussi présentes dans l’Empire d’Orient qu’en Occident : or, c’est en Occident seulement que ce sont d’abord nés et développés la pensée scientifique, l’humanisme, la démocratie, le système économique capitaliste, dont le développement a assuré, pour un temps, la domination de la planète... et dont le modèle constitue la base du développement du reste du monde.
Parmi les caractéristiques les plus emblématiques de l’Occident moderne il y a son humanisme et sa démocratie. Heinz Wismann nous apprend que l’humanisme vient, dans sa dénomination même, de « humanitas », qui étaient des textes d’auteurs grecs-orthodoxes (après la prise de Constantinople par les Ottomans), et que l’on appelaient « humanitas » parce qu’ils étaient écrits par des humains, ils n’étaient donc pas une « parole révélée », c’est à dire qu’ils n’étaient pas une parole divine : la première caractéristique de l’humanisme, c’est qu’il est non-divin. Mais puisque ces textes n’étaient pas divins, s’est posée la question de savoir comment les interpréter (pour les textes divins on savait). S’est ouverte alors pour la première fois, la possibilité, et même la nécessité de critiquer les textes, c’est à dire d’en explorer, d’en produire le sens. Alors que jusque-là on était obligé de rester conforme à l’idée qu’on se faisait du monde dans la tradition religieuse, on a pu commencer à penser le monde en critiquant, analysant, interprétant, des textes humains. Ainsi l’Occident a commencé à devenir auto-créateur : la dynamique intellectuelle était lancée.
On a vu que l’origine de cette pensée humaniste est grecque-orthodoxe, elle vient donc de l’Église d’Orient, de l’Empire d’Orient ; au départ, c’est une pensée chrétienne-orientale : qu’en ont-ils fait ? Rien. L’Orient chrétien invente une pensée dont il ne sait rien faire, tandis que l’Occident, chrétien lui aussi, va progressivement en établir sa base juridique et politique. L’humanisme n’est donc pas, en lui-même, la base du développement.
Lorsque l’humanisme atteint l’Occident, celui-ci a un millénaire de développement social derrière lui : la pensée humaniste vient donc s’appliquer à une société en évolution et en mutation. Cette mutation est constituée de l’émancipation progressive des individus à l’égard de leur famille ; cette émancipation produit une autonomisation des individus, une dés-appartenance en quelque sorte. Or l’appartenance apporte une légitimité, en se dés-appartenant, les individus perdent cette légitimité, mais en y gagnant une liberté à l’égard de leur famille. L’humanisme arrive à point nommé pour apporter à ces individus émancipés, une légitimité qu’ils sont en train de perdre en se dés-appartenant de leur famille. À partir de ce moment-là, l’humanisme va progressivement construire la légitimité des individus autonomes, par le droit. Le développement de ce droit, des individus émancipés, aboutira après plusieurs siècles d’évolution, aux Droits de l’Homme et du Citoyen. Les valeurs humanistes ont pu s’appliquer en Occident parce que les sujets sociaux auxquels elles pouvaient s’adresser, existaient : les individus autonomes à l’égard de leur famille. Ceci explique aussi pourquoi, ces valeurs humanistes n’ont pas pu s’établir en Orient : l’évolution sociale n’ayant pas eu lieu, les « sujets sociaux » susceptibles d’en être bénéficiaires n’existaient pas en Orient. Sans objets, ou plutôt sans sujets, l’humanisme n’a pas pu s’y établir.
On voit ainsi que l’humanisme n’a pas été le déterminant de l’Occident moderne, mais qu’il a été la formulation, la mise en forme, la structuration sociale juridique et politique de cette évolution sociale fondamentale. Et tant que cette évolution sociale n’avait pas eu lieu, les valeurs humanistes ne pouvaient s’établir. De même, elles n’ont pu s’établir en Orient chrétien, ni ailleurs, parce cette évolution sociale d’émancipation des individus à l’égard de leur famille n’avait pas eu lieu.
De la féodalité à la royauté, royauté absolue, puis la République
Nous voici donc en 1500 à peu près, et la structuration humaniste de la société se met en place, en même temps que l’évolution sociale se poursuit. Sur le plan politique, c’est la royauté qui évolue elle-aussi : de la féodalité vers la Royauté Absolue. Après la Royauté Absolue, vers quoi la royauté aurait-elle pu évoluer ? On ne voit pas bien. Il me semble qu’elle était dans une impasse, l’Absolutisme a « fini » la royauté.
Pendant ce temps la société évoluait toujours vers plus d’émancipation des individus, alors que le système politique, la royauté, représentait un ordre social de plus en plus archaïque, et de plus en plus dépassé, et dans une forme qui ne pouvait évoluer. Cette incapacité à évoluer a sclérosé le système politique, en même temps qu’il ne représentait plus la société dans sa structuration émergente. À mon avis, il y a eu comme un effet de ciseaux, entre le système politique qui mourrait dans l’impasse dans laquelle il s’était fourvoyé, et la société se restructurant sur la base d’individus autonomes : à moment donné, le système politique à bout de souffle a été incapable de représenter la société émergente qui exigeait une représentation qui lui corresponde. Ça a été la Révolution Française, la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, l’instauration de la République et de la démocratie. Et bien sûr, le changement de système politique ne peut se faire sans heurt, il ne se saborde pas lui-même, il est renversé malgré lui ; les résistances sont plus ou moins grandes, selon la force des formes sociales qu’il représente encore. Mais finalement la représentation de la nouvelle structuration sociale s’impose, et le pays, l’État, se réorganisent sur cette nouvelle base.
Mais à l’inverse, instaurer la démocratie dans un pays sans que les individus ne se soient émancipés de leur famille est une gageure, car il lui manquera la base sociale qui pourrait lui assurer sa pérennité.
- La démocratie repose sur une société individualiste. Et cet individualisme est une structuration sociale, qui ne doit rien à l’ « individualité » inventée par la philosophie grecque de l’Un.
Les antiquisants contestent que notre démocratie moderne doit issue de l’Antiquité grecque ou romaine.
La force du capitalisme, c’est le salariat !
L’Occident s’est révélé d’une capacité productive extraordinaire qui lui a permis de distancer tous ses concurrents. On pense d’emblée que c’est le capitalisme qui a assuré ce succès. Pourtant, le capitalisme existait aussi ailleurs, et avant, aurait-il inventé quelque chose à cette époque-là que les autres civilisations n’auraient pas eu ? Non, le capitalisme n’a rien inventé, ni en Occident, ni ailleurs.
Non, l’invention c’est le salariat, qui découle de la déparentalisation imposée par l’Église d’Occident, et qui obligeait les membres d’une famille à préserver le patrimoine, à le transmettre, et qui donc obligeait ceux qui n’en héritaient pas à chercher ailleurs leur subsistance et par voie de conséquence, leur socialisation, donc individualisée. C’est cette invention - le salariat - que le capitalisme occidental a pu exploiter, à la différence des autres capitalismes des autres civilisations : c’est le salariat qui a donné au capitalisme occidental sa supériorité sur les autres civilisations.
L’invention de ce système social performant, a dû permettre une meilleure utilisation, et une meilleure coordination du travail dans tous les domaines, tant dans la production aussi bien matérielle qu’intellectuelle, que dans la recherche scientifique. Il ne suffit pas de faire des découvertes scientifiques, de bâtir de nouvelles théories, il faut encore les mettre en œuvre. Et c’est là, dans ce système social qui articule les relations sociales d’une manière plus fluide grâce à l’autonomie des individus salariés, que l’ensemble de la production humaine trouve une meilleure efficacité.
Aujourd’hui encore, c’est le système social qu’il faut réformer pour le mettre en adéquation avec la socialité que nous avons acquise ; la structuration sociale existante n’est plus en phase avec notre nouvelle manière d’être en société : nous sommes socialement plus individualisés, nous avons besoin de structures sociales qui nous apportent la sécurité sociale dans cette individualisation, alors que cette sécurité est encore très grégaire, et lorsqu’on est exclu d’un groupe (entreprise, famille) on perd la sécurité qui y était afférente. C’est l’assurance d’être secouru individuellement qui crée le sentiment de sécurité collective : il faudrait réformer le système social, en l’occurrence le salariat, pour qu’il soit en mesure d’assurer cette sécurité à tout individu, même sans appartenance. Au lieu de cela, les politiques, de tous bords, continuent à privilégier l’économie, à chercher à créer des emplois par la croissance... dans un monde où la planète ne supporte plus cette croissance. Absurde !
La philosophie est une introspection
La philosophie n’a aucun effet sur le réel, elle est seulement une introspection, ce n’est pas négligeable, mais il ne faut pas lui accorder plus de vertu qu’elle n’a. Par exemple on a célébré les philosophes qui ont précédé la Révolution Française, comme s’ils avaient créé, inventé, bâti, fondé les bases du régime démocratique qui allait advenir. Je le conteste : ce qu’ont fait ces philosophes, ça a été de formuler les conditions de la nouvelle « socialité », c’est à dire, la nouvelle manière d’être en société qui émergeait par l’évolution de cette société elle-même et non par la soi-disant œuvre des philosophes. Les philosophes n’ont été que les « illustrateurs », les formulateurs, du changement social et politique en cours. Mais comme cette formulation est concomitante à l’évolution de la société, les philosophes s’imaginent en être les décideurs ; la philosophie n’est pas le moteur du monde, elle n’est que la « mouche du coche ».
Les totalitarismes par exemple n’ont pas pour cause les idées de tel ou tel philosophe, mais une incapacité fondamentale, viscérale d’une partie de la population à accepter l’avènement de la nouvelle socialité. À mon avis, c’est l’égalité qu’instaure l’individualisme qu’ils ne supportent pas. Il faut se rendre compte que cette égalité-individualiste subvertit radicalement l’ordre hiérarchique, inégalitaire antérieur. C’est une nouvelle légitimité qui subvertit l’ancienne. Si l’on suit le déroulement des évènements : on a d’abord la Révolution qui instaure cette égalité-individualiste (avec beaucoup d’exceptions, les femmes au premier chef), sur cet élan on abolit l’esclavage. Puis on le rétablit. Tout au long du XIXe siècle, l’inégalité est réintroduite sous l’aspect racial, puis la colonisation la conforte à l’égard des colonisés : manifestement cette égalité ne passe pas. Puis le suffrage universel, principe égalitaire individualiste démocratique essentiel, est instauré, la même année que l’abolition définitive de l’esclavage (1848), et c’est ce suffrage universel qui n’est pas accepté, et jusqu’à l’extrême-gauche.
En réaction, c’est le communisme d’abord qui s’instaure qui accepte l’égalité, mais pas individualiste : l’égalité dans un tout où les individus n’ont pas d’autonomie, alors que cette égalité avait été conquise par l’individualisation-émancipation ; dans le communisme, l’individu autonome n’est pas à la base de la société, au contraire cet individu est contre-révolutionnaire.
Ensuite, c’est le fascisme dont une part provient aussi de l’extrême-gauche, qui refuse l’égalité individualiste, qui tente de créer une société fusionnelle, violente, contrainte, avec des corps sociaux embrigadés, contrôlés, verrouillés, où la violence sert à obtenir le sentiment d’une appartenance forte, et à repousser la dispersion des individualités autonomes, libres. La liberté apparaît aux fascistes comme un facteur de division, dispersion, désagrégation, ce qui leur donne un sentiment de décadence, de déréliction, auxquels ils réagissent par la violence fusionnelle, la culture d’un corps social fusionné, hiérarchique, avec un chef qui fait tenir cet ensemble debout. On voit bien que c’est le couple individualiste-égalité qui sape l’identité d’appartenance antérieure, et contre lequel s’exerce la réaction fasciste.
Le nazisme enfin, prône l’inégalité sur tous les plans, raciale bien-sûr, culturelle, antisémite, la judéité conçue comme une race. Il rajoute aux autres totalitarismes la dimension persécutrice qui n’apparaissait pas trop chez les autres. Il conçoit son identité dans une race-culture-allemande-aryenne-supérieure, qui doit régner et commander aux autres sous-cultures-races-nationalités, allant jusqu’à la tentative d’extermination.
Les philosophes, écrivains, intellectuels, qui ont soutenu, soit ces idéologies, soit les idéologies contraires, ne les ont pas créées ni suscitées, ils ont justes été leurs interprètes au moment où elles été ressenties par les populations à ce moment de l’évolution sociale. La philosophie ne détermine aucun réel, elle exprime seulement la socialité, c’est à dire la manière d’être, dans une société, à moment donné.
Le réel est social, et le social est relationnel
La philosophie ne détermine pas le réel du monde, car le réel est social, et le social est relationnel. Ce qui n’est pas social n’est pas réel, il peut être imaginaire ou illusoire.
Seul le social est réel, parce que toute pensée, toute construction mentale ne peut exister que par la relation aux autres, le rapport aux autres : le réel de chacun, et donc de tous, ne peut s’acquérir que dans la relation aux autres, par la relation aux autres. Sans la relation aux autres, l’individu ne peut être conçu, ni naître, ni construire sa personnalité, sa pensée ; sans la relation aux autres, il ne peut pas Être, ni Même, ni Autre.
- Ce qui est essentiel à l’humain, c’est la relation qui est à la fois le lien et la frontière entre soi et les autres. Ce qui confirme chacun en soi, c’est la relation à l’autre.
En dehors de cette relation à l’autre, il reste l’imaginaire, l’illusion, le fantasme qui sont des manières de se penser soi-même, mais qui ne peuvent prendre réalité que dans la relation aux autres. Pour qu’il puisse y avoir relation, il faut être distinct, il faut donc qu’il y ait délimitation entre soi et les autres : d’où la nécessité d’établir les règles de ces rapports sociaux, avec des statuts, des rôles, des fonctions... ce qui donne un - système social - plus ou moins productif, plus ou moins efficace.
Le monde entier devient occidental
Le monde entier devient occidental par son système social, que tous les pays qui veulent se développer sont obligés d’adopter. Mais tous ces pays « occidentaux par le système social », ne le sont pas par leur mentalité : ils gardent la mentalité de leur culture, de leur système de pensée, comme nous, occidentaux d’origine, nous gardons la nôtre ; c’est cette mentalité qu’expose si bien Heinz Wismann. Cette mentalité qu’il expose n’est pas celle de ceux qui se développent, Japonais, Chinois, Indiens, Africains, Arabes... et pourtant ils s’emparent des instruments de notre développement occidental, capitalisme, recherche et pensée scientifiques, technologies... avec le même succès que nous : ce qui signifie que la mentalité n’est pas en cause. Je pense même qu’elle n’est même pas en cause chez nous, il est possible qu’elle ait seulement accompagné le développement social.
- La grande invention du Moyen-Âge occidental, c’est le salariat, et c’est le développement de ce salariat qui produit l’avènement de l’individualisme : puis, c’est cet individualisme salarial qui constitue la supériorité productive dans tous les domaines économiques ou intellectuels...
C’est cet individualisme salarial que tous les pays adoptent pour se développer ; mais en gardant bien-sûr leurs propres mentalités.
Ceci nous permet de comprendre la nature de la mondialisation en cours :
La mondialisation se réalise sur la base du modèle de développement occidental, c’est à dire que ce modèle occidental s’universalise en se généralisant. Mais ce qui s’universalise n’est pas la mentalité occidentale, philosophique, humaniste, mais son système social.
C’est ainsi que grâce à Heinz Wismann, dont je vous recommande encore une fois la lecture de son livre Penser entre les langues, j’ai enfin pu comprendre la place et la fonction de la philosophie dans notre système de pensée, ainsi que l’articulation entre les différents systèmes, qui animent la vie des sociétés et des civilisations et du monde.
La philosophie a son importance propre, mais il ne faut pas lui demander d’expliquer le monde, et par conséquent, il est inutile de l’interroger pour envisager les réformes nécessaires pour le rendre plus harmonieux.
- Penser entre les langues - Heinz Wismann - Albin Michel - 2012
Jean-Pierre Bernajuzan



