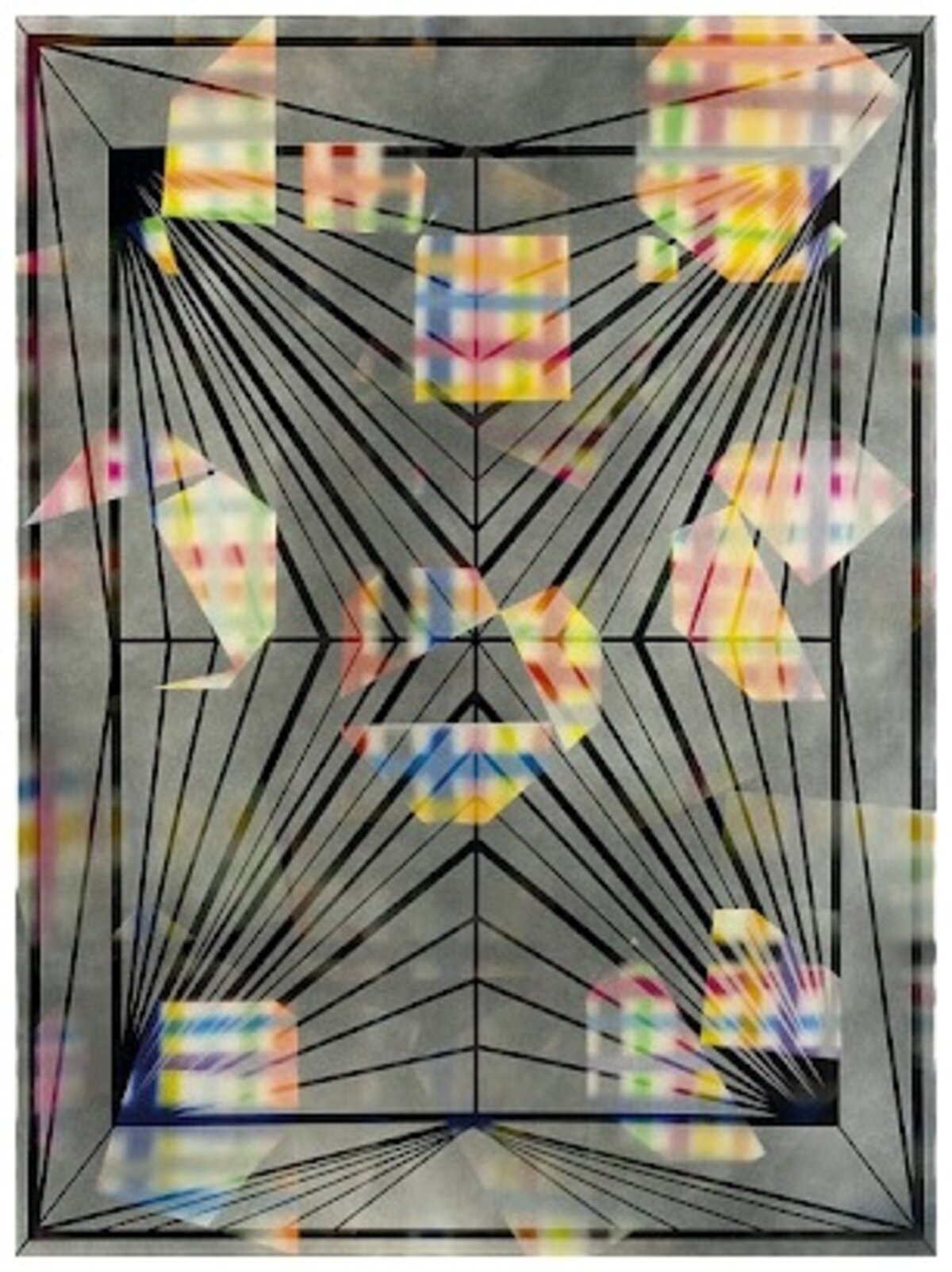
Il y a une dizaine d’années j’ai publié une série d’articles dans les Chroniques d’Abonnés du monde.fr, aujourd’hui disparues. Je les avais ensuite rassemblés sur le thème de la dynamique démocratique pour en souligner la « logique dynamique » qui la porte tout au long de l’histoire de notre société occidentale en particulier.
En ces temps de blocage démocratique, tant au niveau national qu’en général, je m’en vais reprendre ces articles en les prolongeant des analyses que j’ai publiées plus tard, en n’oubliant pas que la démocratie est un processus qui évolue sans cesse, elle n’est pas un « donné » absolu ni parfait. Et je terminerai en faisant le point sur la situation actuelle et par une projection vers une possible relance de cette démocratie dans son processus évolutif.
Premier article : Une politique nécessite-t-elle d’être vraie pour être efficace ?
La dynamique démocratique - 1 -
- Politique : rapport de la vérité à l'efficacité
Avant-propos
J'ai puisé les éléments de cette introduction dans le livre de Pierre Rosanvallon "La légitimité démocratique" paru au Seuil.
- C'est l'exigence d'unanimité qui a sous-tendu l'idéal démocratique.
La vision holiste de cette unanimité est très ancienne, dès le monde antique, elle sert à assurer la cohésion du groupe.
L'Église des premiers siècles s'inscrit dans cette culture antique de la participation-unanimité.
Le monde chrétien contribue à acclimater et valoriser tout un vocabulaire de la délibération et de la participation. C'est sous la plume de Cyprien évêque de Carthage, qu'on trouve le premier terme de "suffrage universel", au 3ème siècle, pour qualifier l'accord de la communauté.
C'est dans les couvents que la notion de majorité a émergé, pour prendre en compte les divergences et éviter les scissions, toujours dans la perspective du maintien de l'unité.
L'Église finit par reconnaître la validité technique du principe majoritaire simple. - A la Révolution, c'est encore l'unanimité qui, philosophiquement, continue de réguler l'organisation des communautés chrétiennes.
En 1789 Sieyés, par un appel à la fiction, considère la majorité comme un équivalent de l'unanimité.
Comme l'unanimité est impossible à obtenir quand les participants sont très nombreux, il faut se contenter de la pluralité.
L'avènement du suffrage universel baigne dans la culture de l'unanimité.
La notion de minorité est ressentie comme une anomalie dans l'univers démocratique, passagère ou pathologique.
A la fin du 19ème siècle, en Europe, la légitimité durable des conflits d'intérêts, et des partis politiques, peine encore à se faire admettre.
La règle de l'unanimité n'a jamais permis de mettre en œuvre "la bonne politique".
Aujourd'hui, un résultat électoral qui s'approche de l'unanimité est considéré non-démocratique.
Quel retournement !!
Le régime démocratique s'est développé dans l'aveuglement de sa propre nature, dans une longue suite de désenchantements.
-----------------------------
Pour ma part, c'est une parole de Michel Rocard qui a déclenché ma réflexion.
Quand il était Premier ministre, il y avait eu des élections ; et pendant ces élections, des violences. A un journaliste qui l'interrogeait, il a répondu: "Vous savez bien que les campagnes électorales ne sont pas...", j'ai oublié le mot : ne sont pas... démocratiques ??!!
La phrase de Rocard m'a fait prendre conscience de l'ambiguïté de l'expression démocratique.
Ma conception de la démocratie à ce moment-là était celle-ci :
- "Le système démocratique est un système de recherche collective de la vérité, et de maîtrise de la violence; de recherche collective de la vérité, - par - la maîtrise de la violence."
Rocard me fait prendre conscience que la phase de la campagne électorale (violente, démagogique, mensongère, passionnée...) est en contradiction avec ce que le système démocratique va obtenir.
Or, il n'a pas de démocratie sans campagne électorale. La passion électorale témoigne de l'intérêt du peuple qui vote.
C'est l'opposition, la contradiction, mais en même temps, l'articulation, entre l'irrationalité électorale et la rationalité de la décision démocratique qui m'intriguaient.
Les développements qui suivent ont démarré là...
1 - Une politique, nécessite-t-elle d'être « vraie » pour être efficace ?
Ou bien, une politique peut-elle être efficace sans être « vraie » ?
Comment établir cette vérité ?
Bien sûr on dira qu'en démocratie, c'est le peuple qui décide et, si ça lui convient, ça suffit.
Si ça ne lui convient pas, il change.
Oui bien sûr il peut changer, mais si en définitive, à force, si le système démocratique était moins efficace que d'autres systèmes politiques, alors il disparaîtrait au profit d'autres systèmes plus performants : parce que au bout du compte, on n'acceptera pas de vivre moins bien que d'autres. On n'est pas maso !
- Oui mais justement sur le long terme, c'est précisément le système démocratique qui est le plus performant.
Les autres systèmes, dictatures, despotismes éclairés, peuvent faire illusion quelque temps, mais au bout d'un moment la société renâcle, la corruption sape le développement et le système se bloque.
Tandis que la démocratie permet la régénération et l'adaptation permanente.
Qu'est ce que la vérité ? - La vérité sert à appréhender le réel.
Quand on se trompe, quand on s'illusionne, quand on ment ou quand on croit, le réel nous échappe, et l'on demeure impuissant.
Lorsque l'on construit un pont, un bâtiment, on a besoin de connaître la vérité de la résistance des matériaux, sinon ils risquent de s'effondrer. Lorsqu'on crée un nouveau médicament on essaie d'établir la vérité de son efficacité en dehors de toute auto-suggestion. Il s'agit là de vérité scientifique qui relève d'une démarche et d'une méthode spécifique, et toujours remises en question.
C'est l'efficacité d'une politique qui atteste de sa vérité.
En démocratie, les décisions sont prises au suffrage universel, à la majorité électorale : quel est donc le rapport entre une majorité électorale et la vérité ?
Peut-on décider de la vérité à la majorité ?
Non ! La vérité ne se décide pas.
On recherche la vérité, on la vérifie, on la démontre, on la prouve, on la reconnaît ou on la refuse, mais on ne la décide pas. Jamais !
Pourtant, la prise en compte des désirs de la majorité des citoyens permet d'ajuster les politiques à ces désirs, elle permet de les faire correspondre à la réalité sociale et économique, politique et culturelle, globalement. Elles permet à ces politiques d'être plus précises, plus adaptées, plus exactes.., c'est à dire plus vraies.
Donc, l'expression majoritaire des désirs en permet la prise en compte et la satisfaction, elle permettrait donc de déterminer la vérité - relative - d'une politique ?
Impossible : la vérité ne se décide pas !
La majorité est fluctuante.
Une majorité peut s'affirmer pour une politique, puis pour une autre opposée ; et l'on sait bien, et les politiques le savent mieux que quiconque, que ces majorités ne s'établissent pas en fonction du fond de la question, mais au contraire pour les raisons les plus basses, et même les plus inavouables.
Plus exactement, le déplacement des voix qui permet le changement de majorité concerne les électeurs dont l'opinion n'est pas très sûre, et qui sont très sensibles à l'air du temps, aux propositions démagogiques.
Ce sont donc les électeurs « incertains » qui font la décision démocratique.
Dans tous les domaines : scientifique, technique, artistique, professionnel... l'efficacité nécessite la qualification des acteurs/décideurs.
En démocratie, c'est au contraire sur le suffrage universel que repose l'efficacité de la décision politique.
Le suffrage universel accorde la même valeur à la voix de l'électeur le plus ignorant qu'à celle de l'électeur le plus qualifié.
Au contraire, si on limitait la participation électorale aux seuls électeurs qualifiés, le système démocratique perdrait son efficacité, et au sens commun contemporain, cesserait d'être démocratique.
L'efficacité du système démocratique est réduite par la non-participation électorale et politique de certaines catégories de la population, qui sont précisément parmi les moins qualifiées.
- C'est donc bien de la décision des « ignorants » que le système démocratique tire son efficacité, supérieure à celle de tous les autres systèmes politiques.
On peut voter autant que l'on voudra : on ne décidera jamais de la vérité à la majorité !
Et pourtant on a besoin de cette vérité.
Et pourtant c'est ce système-là, paradoxalement, dans lequel ce sont les "incertains" et les « ignorants » qui font la décision démocratique, qui a l'efficacité la plus systématique.
Quelle est la logique du système ? Parce qu'il y en a forcément une !
Quel est le principe d'efficacité du système démocratique ?
à suivre...
Jean-Pierre Bernajuzan



