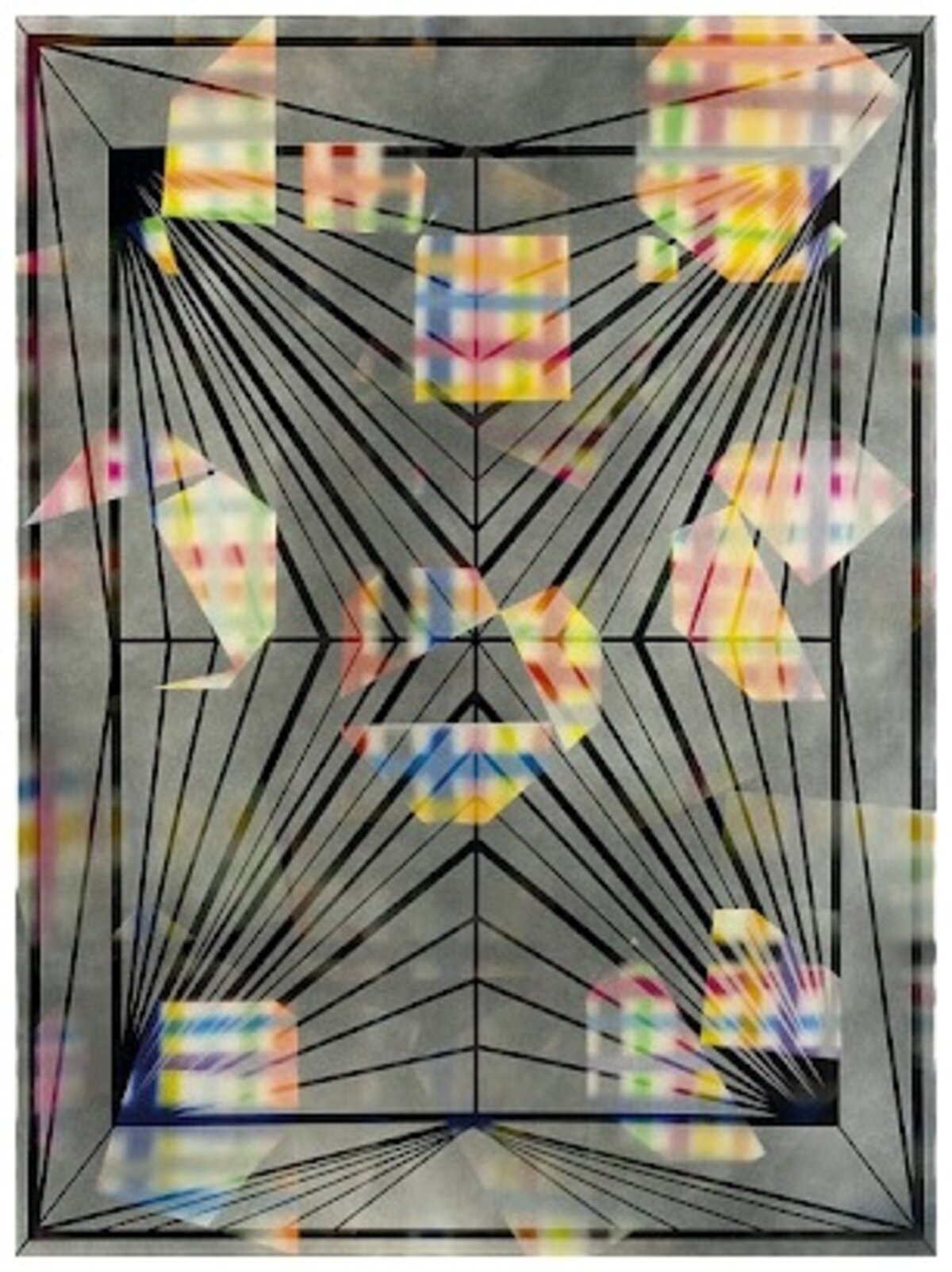
LA DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE - 2 -
Résumé de l’article précédent :
De l’unanimité antique, nous sommes passés à la majorité qui la représente. Puis au XXe siècle la légitimité durable de la minorité, des conflits d’intérêts et des partis politiques s’est instaurée… Le régime démocratique s’est développé dans l’aveuglement de sa propre nature, et dans une longue suite de désenchantements.
La vérité sert à appréhender le réel. C’est l’efficacité de la politique qui atteste de cette vérité. Or la vérité ne peut pas être décidée, ni à la majorité, ni autrement. La majorité qui emporte la décision démocratique est un arbitraire, donc non-vrai, elle s’obtient après une campagne électorale, par le déplacements des voix des électeurs incertains et les plus ignorants.
Et pourtant, c’est ce système-là qui est le plus efficace, qui prend donc les décisions les plus vraies…
2 - Avons nous politiquement raison, lorsque nous sommes électoralement majoritaires ?
- Avoir raison : c'est dire ce qui est exact, juste. Avoir raison, c'est dire la vérité.
La majorité est fluctuante.
Une majorité peut s'affirmer pour une politique, puis pour une autre opposée ; et l'on sait bien que ces majorités ne s'établissent pas en fonction du fond de la question, mais au contraire pour les raisons les plus basses, les plus superficielles. C'est le déplacement des voix des électeurs les plus incertains qui produit le changement de majorité.
Une majorité électorale est obtenue par l'addition d'opinions diverses, appuyées sur des raisonnements divers, voire opposés, et même contradictoires :
- La majorité électorale est un arbitraire.
Donc la majorité n'a pas raison.
L'arbitraire est une non-vérité.
Donc la majorité ne dit pas la vérité.
L'arbitraire s'oppose à la vérité.
Pour atteindre la vérité il faut sortir de l'arbitraire,
Et pourtant : L'arbitraire majoritaire est le fondement de la démocratie.
Mais cet arbitraire majoritaire existe dans toutes les sociétés non-démocratiques, il est même sans doute le plus universel des caractères fondamentaux de ces sociétés : un lynchage, un pogrom sont des arbitraires majoritaires.
Et l'on voit bien à l'expérience et avec le recul, que la démocratie nous y fait échapper...
Nous voyons que cet arbitraire majoritaire démocratique, nous fait échapper à ces arbitraires majoritaires non-démocratiques.
- L'arbitraire s'oppose à la vérité.
L'arbitraire majoritaire démocratique y conduit... relativement.
Pourquoi ? Comment ?
La recherche collective de la vérité, et la maîtrise de la violence collective sont liées
- Le système démocratique est un système de - recherche - collective de la vérité, et de maîtrise de la violence collective; de recherche collective de la vérité - par - la maîtrise de la violence.
La base de ce système est le suffrage universel, qui donne une valeur égale à tous les électeurs, et qui est secret. C'est donc un système qui permet de prendre en compte - à égalité - les opinions réelles des électeurs, même les plus socialement inavouables, puisqu'elles s'expriment secrètement.
Premier élément de vérité qui constitue pour les élus, la base sur laquelle ils auront à travailler.
Le scrutin est précédé d'une campagne électorale, pendant laquelle se déchaînent les passions, où s'expriment les revendications les plus contradictoires, dans la plus grande violence.
Cette caractéristique du système démocratique est remarquable et paradoxale.
Pour parvenir à maîtriser notre violence collective, et à une vérité, certes relative et provisoire, nous passons par cette phase qui en est l'exact contraire : violence verbale, mauvaise foi, mensonges tous azimuts, démagogie, arbitraires de toutes sortes, promesses mensongères, etc.. Il faut observer que cette violence est ritualisée et symbolique, avec quelques débordements de violence physique... juste assez pour signifier ce qui est symbolisé.
Nous savons bien qu'il ne faut pas prendre les propos électoraux tout à fait au sérieux.
C'est là le premier des modes d'action efficace du système démocratique.
La symbolisation de la violence
- La symbolisation permet d'exprimer cette violence sans destruction, sans meurtre physique, sans guerre civile, c'est à dire en faisant semblant.
À force de faire semblant d'être violent, l'expression de la violence physique réelle devient de plus en plus illégitime, d'autant plus qu'on se rend compte que l'expression symbolique de cette violence permet de faire des choix politiques, au contraire de la violence physique réelle.
- À quoi sert la violence ? A imposer des arbitraires.
Le système démocratique propose l'arbitraire majoritaire.
L'avantage de l'arbitraire majoritaire démocratique est que la violence de cet arbitraire est symbolique, c'est à dire qu'elle n'est pas physiquement réelle, à la différence de l'autre.
Et ça change tout !
La mort politique démocratique n'étant pas physique, elle n'est pas physiquement réelle, elle n'est que provisoire: on peut donc accepter de "mourir" un moment, pour peut-être renaître politiquement plus tard.
On n'est donc plus obligé de se battre jusqu'à la mort, on peut laisser l'adversaire gagner. Une autre fois sera peut-être notre tour.
Car la régularité des consultations électorales est une base essentielle de ce système, on ne vote pas une fois pour toutes.
Le pouvoir politique n'est exercé par le vainqueur qu'entre 2 scrutins électoraux.
Cette régularité fait que les politiques mises en œuvre ne le sont que provisoirement, comme des expériences auxquelles on peut mettre fin aux élections suivantes.
Le jusqu'au-boutisme violent devient donc inutile, puisque sans objet. Et la violence collective est ainsi maîtrisée.
à suivre…
Jean-Pierre Bernajuzan



