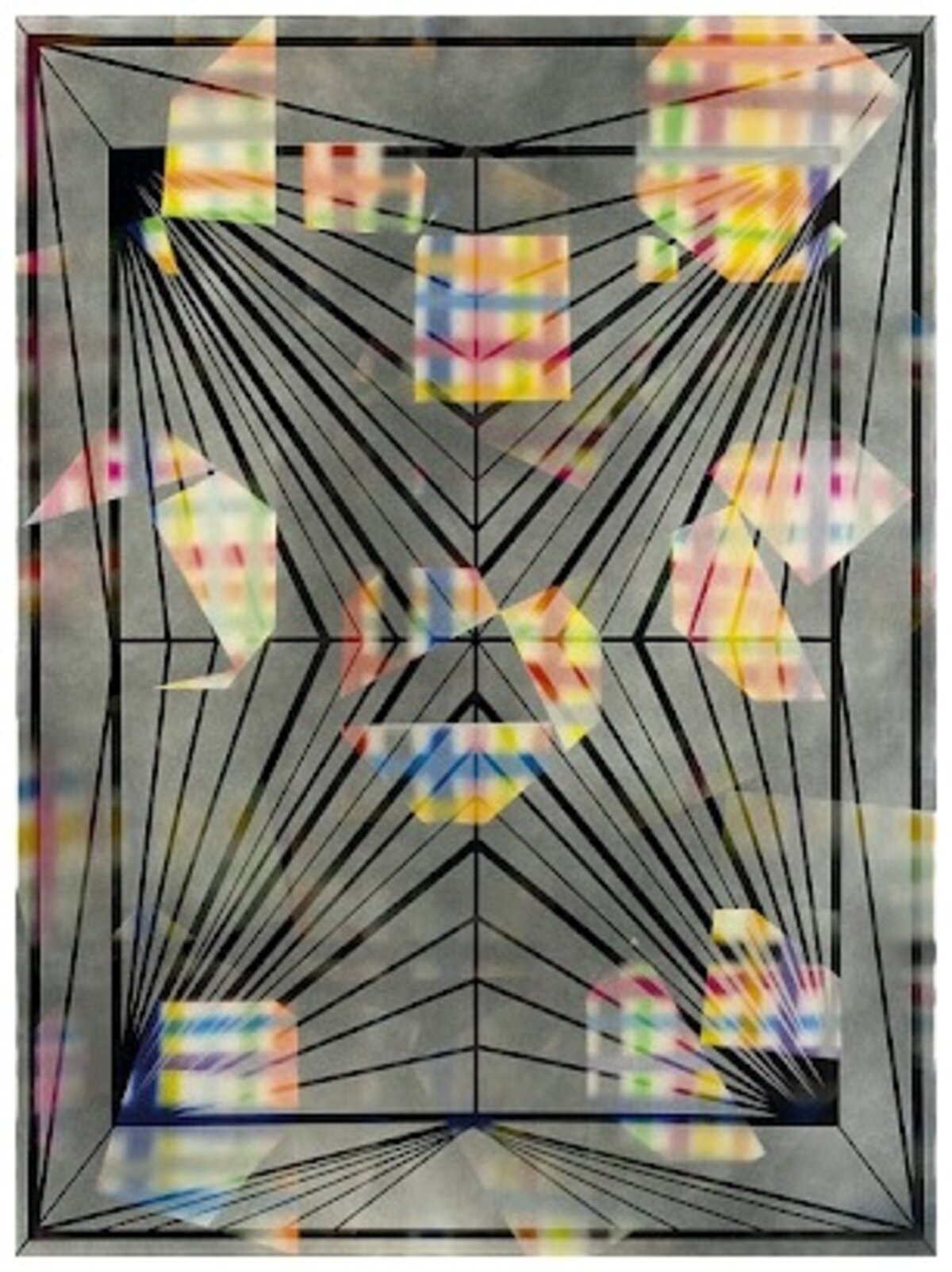
LA DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE - 3 -
Beaucoup de lecteurs ne comprennent pas ce que j’entends par « vérité » démocratique. Avant de continuer, il me faut l’expliquer : Lorsqu’on vote, on fait des choix : un choix peut être juste ou erroné : donc, vrai ou faux. S’il ne pouvait être juste ou erroné, vrai ou faux, il n’y aurait pas de choix, donc pas de vote. Le régime soviétique a démontré qu’il était faux, parce qu’il a été incapable de prendre en compte la réalité, ce qui s’est traduit par un effondrement économique et social. C’est son inefficacité qui a démontré sa fausseté. Bien d’autres systèmes et politiques s’éliminent parce qu’ils n’apportent pas de solution. Mais ces vérités ou faussetés s’établissent par rapport aux autres systèmes politiques, donc par comparaison, et en concurrence. Elles sont donc relatives.
Résumé des articles précédents :
De l’unanimité antique, à la majorité qui la représente, puis au XXe siècle la légitimation de la minorité et des partis politiques, le régime démocratique s’est développé dans l’aveuglement de sa propre nature, et dans une longue suite de désenchantements.
C’est l’efficacité de la politique qui atteste de sa vérité. Or cette vérité ne peut pas être décidée, ni à la majorité ni autrement. La majorité électorale est arbitraire, quelle qu’elle soit. Elle ne dit donc pas la vérité. Et pourtant, c’est ce système-là qui est le plus efficace.
La violence de la campagne électorale est symbolique. C’est par cette symbolisation que la violence est maîtrisée : la violence symbolique n’étant pas physiquement réelle, la mort démocratique n’est pas réelle non plus. Le pouvoir démocratique n’est exercé par le vainqueur qu’entre deux scrutins électoraux. Le jusqu’au-boutisme violent devient donc inutile, puisque sans objet. Et la violence collective est ainsi maîtrisée, la prise des décisions va pouvoir être rationalisée.
3 - La politique c'est comme l'andouillette, ça doit sentir la merde, mais pas trop
Être démocrate consiste à accepter de se soumettre à « l'arbitraire majoritaire démocratique ».
Le système majoritaire a cette vertu de nécessiter de rassembler plusieurs arbitraires minoritaires pour arriver à constituer cette majorité. Il contribue ainsi à unifier la société qui le pratique et à créer une identité commune.
Pendant la campagne électorale, les candidats tâchent de capter les illusions, les mensonges, les préjugés, les arbitraires des citoyens/électeurs pour obtenir leurs votes. Pour cela, ils leur font les promesses qu'ils attendent. (Il paraît que les psychiatres considèrent les hommes politiques comme des menteurs professionnels)
- Pourquoi mentent-ils ? Pour se faire élire.
S'ils ne mentent pas, que se passe-t-il ? Ils ne sont pas élus.
Mais alors qu'a-t-on à faire de leur vérité, s'ils n'exercent pas le pouvoir ?!
C'est là, la double injonction contradictoire de l'élu politique :
- d'une part, il doit dire les mensonges que ses électeurs attendent, pour se faire élire.
- d'autre part une fois élu, il doit mettre en œuvre une politique qui satisfasse l'ensemble des électeurs, et pas seulement les siens,
- tout en faisant semblant de tenir ses promesses, pour que ses électeurs puissent prendre la responsabilité de cette politique menée en leur nom.
En effet, les électeurs ne leur pardonneraient pas de mener le pays à la catastrophe, sous prétexte de tenir les promesses qu'ils leur ont faites.
Les mensonges des politiques ne sont pas les leurs, mais ceux de leurs électeurs.
S'ils devaient dire la vérité pour se faire élire, ils la diraient. Mais s'ils la disent, on ne les élit pas ! D'ailleurs, entre toutes les promesses mensongères qui nous sont faites, chacun choisit celles par lesquelles il veut être trompé : droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, centre, extrême centre...
Nous ne sommes pas obligés d'être dupes !
Le rôle de la démagogie électorale
Par la démagogie électorale, les candidats récoltent tous les désirs illusoires, arbitraires des électeurs pour ensuite, les confronter à la réalité de la possibilité de la mise en œuvre de ces politiques.
Le vote est un choix individuel dans le secret de l'isoloir.
- Mais ce qui compte dans un scrutin électoral, c'est la somme des voix, et non la raison individuelle : que l'on ait voté pour un candidat, pour telle raison ou pour la raison inverse, cela revient au même.
Le point de vue individuel, rationnel, ne peut pas être pris en compte, c'est impossible.
Ne peut être pris en compte que l'addition, la somme des votes :
Dans une élection, la raison rationnelle de chacun n'est pas prise en compte.
C'est l'arbitraire de la quantité, de la somme, de l'addition, qui est pris en compte.
Le pouvoir démocratique émane donc de cet arbitraire.
Les électeurs subissent les conséquences de leurs choix.
Au fur et à mesure des échéances électorales, ils cherchent à échapper aux arbitraires qu'ils se sont imposés eux-mêmes par leurs votes, et renoncent à leurs illusions, parce qu'ils ne veulent plus en supporter les conséquences.
Ainsi, le système démocratique est un système de désillusionnement, de renoncement aux arbitraires collectifs.
- La vérité démocratique, relative et provisoire, n'est donc pas « décidée ».
Elle est ce qui demeure après nos renoncements.
Exemple : en 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir a permis la mise en œuvre de son programme, et a ainsi permis de vérifier l'inanité du socialisme... Ce qui n'empêche pas les socialistes d'œuvrer pour plus de justice sociale.
Mais l'épreuve du réel a éliminé la solution "socialiste".
En 2007, on avait noté l'effort des électeurs de ne pas s'en laisser conter, ils ne voulaient pas être dupes des promesses électorales des candidats. Résultat, on a élu Sarkozy qui est en train de faire la démonstration que sa politique ne tient pas la route, qu'elle est fausse : Vraisemblablement, la « solution sarkoziste » sera éliminée. Le progrès continue...
Autre exemple : au premier tour de la présidentielle le 21 avril 2002, nous n'avons pas promu Le Pen, mais par hasard, par le jeu de l'éparpillement des voix, il s'est trouvé en seconde position, - arbitrairement -.
Surpris, nous avons alors voté au second tour à 82% contre lui.
Et c'est Chirac qui a bénéficié de « l'envers positif », du vote anti-Le Pen.
Le seul vote actif, déterminé, presque unanime, est le vote contre l'extrême droite, avec une faible abstention. Et c'est un vote négatif.
- Les élus politiques sont des éboueurs. Ils vont chercher le préjugé, l'illusion, l'arbitraire, autrement dit, la « merde » de notre société, et ils la recyclent en la confrontant à l'épreuve du réel. Alors oui, la politique pue. Si elle ne pue pas, cela signifie qu'elle n'a pas de prise sur le réel, qu'elle est inutile. Comme une station d'épuration qui recyclerait de l'eau potable...
Mais ce sont eux, les politiques, qui font le travail. Et non les spécialistes, ni les scientifiques, ni les intellectuels, ni les philosophes ou moralistes, ni les journalistes, ni les humanitaires, ni les juristes...
- L'approche idéaliste de la démocratie est illusoire et mensongère, les politiques qui la pratiquent le savent bien, eux.
Si nous prétendons construire la société positivement, par le "bien", par les « bonnes » valeurs... que deviennent le « mal », les préjugés, l'arbitraire, la haine... Qu'en fait-on ? Où les met-on ? Sous le tapis ?
Si nous ne traitons pas ce mal, il demeure irrésolu, morbide.
Non ! Le génie de la démocratie consiste à prendre en compte tous ces éléments négatifs pendant la campagne électorale, puis à essayer de les traiter par des solutions... aléatoires, dont la plupart seront abandonnées.
Finalement certaines demeureront, auxquelles nous seront attachés. Alors ne stigmatisons pas trop les politiques, nous avons besoin d'eux...
Nous les accusons de nos propres fautes... Et c'est en s'en chargeant à notre place, qu'ils portent l'évolution de notre société... en notre nom.
à suivre…
Jean-Pierre Bernajuzan



