
Agrandissement : Illustration 1
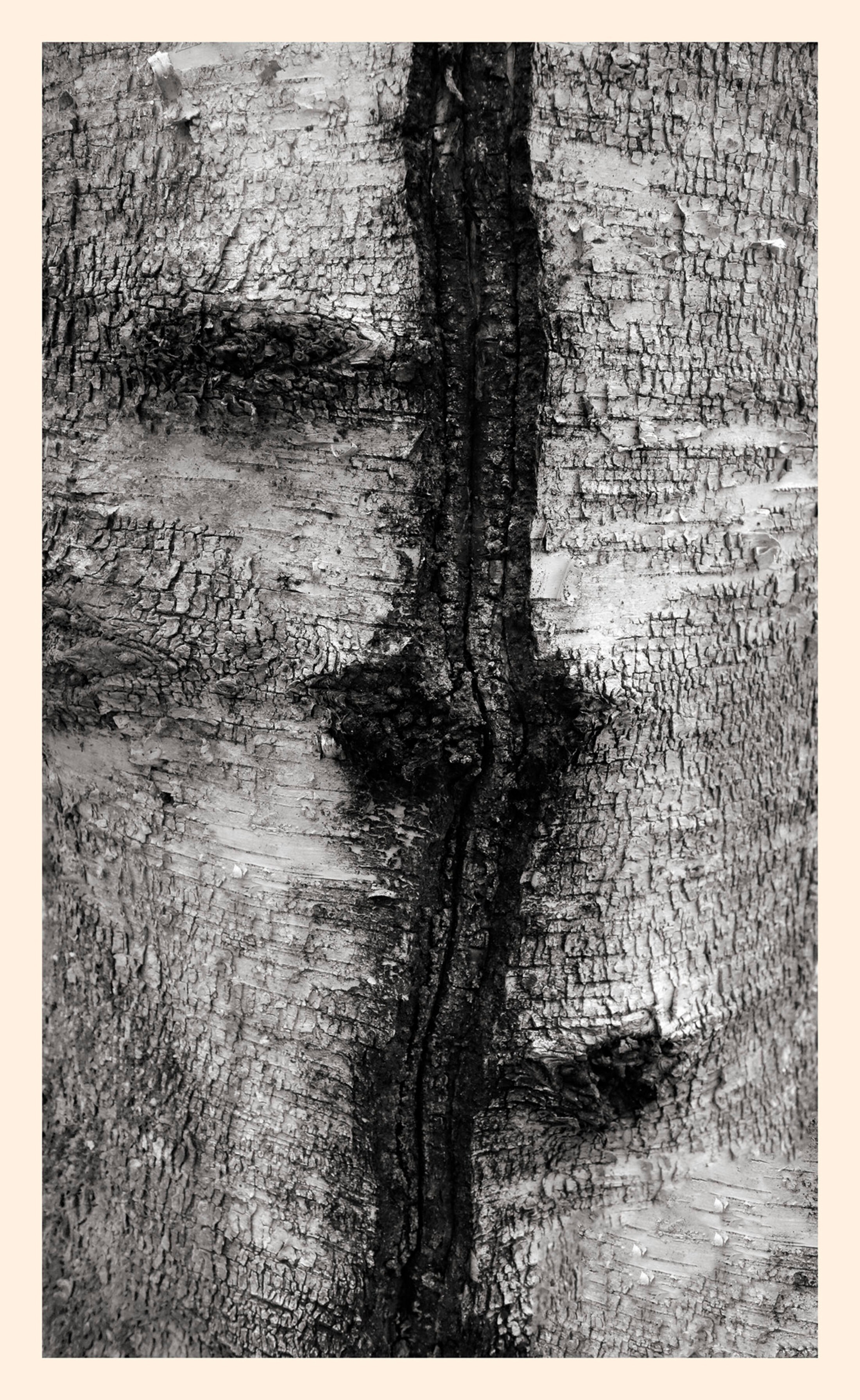
Cet article est motivé par la lecture du livre dirigé par Pierre Grosser « HISTOIRE MONDIALE DES RELATIONS INTERNATIONALES de 1900 à nos jours » dans la collection Bouquins.
Deux guerres mondiales
L’Histoire des deux guerres mondiales m’a été racontée, d’abord à l’école, puis dans les médias et essais, comme motivées par le nationalisme et justifiées par diverses idéologies. J’avais donc en tête ces deux raisons fondamentales, nationalisme et idéologies. Or, c’est tout autre chose que ce livre décrit : c’est une volonté exprimant un « désir d’empire », et justifiée par une idéologie nationaliste.
Un empire suppose la domination d’autres pays qu’il soumet, autrement dit, la création et le développement d’un empire suppose la colonisation. L’idée que chaque pays a droit à son indépendance, même s’il est petit ou faible, n’avait pas encore cours. C’est donc l’idée de colonisation, moralement acceptable à l’époque, qui sous-tendait la volonté impérialiste, en plus de la nécessité d’être assez puissant pour résister à ses rivaux.
L’idée impériale et colonisatrice était très ancienne. Ces conquêtes de domination suscitent la confrontation avec les autres empires, et avec le développement des technologies guerrières l’affrontement entre rivaux prendra une dimension cataclysmique. Les deux guerres mondiales ont donc été motivées par la rivalité entre diverses puissances suffisamment fortes pour avoir la prétention de se partager le monde. Les autres pays moins puissants n’avaient d’autre faculté que de se soumettre ou de rallier à l’une ou l’autre d’entre elles selon l’intérêt qu’ils pouvaient y trouver. Les deux guerres mondiales ont eu lieu entre puissances désireuses de se partager le monde : il était donc logique qu’elles aient été mondiales.
Chaque puissance soutenait sa volonté d’empire par son nationalisme. L’empire était donc considéré comme un moyen de renforcer la nation. À cette époque-là, au moins pour les nouveaux candidats, la volition d’empire reposait sur l’idée d’extension de l’État-nation conçue comme un agrandissement, en taille et en puissance, dans un mouvement collectif qui faisait que chaque État-nation était en rivalité avec les autres : il apparaît à chacun qu’il doit relever le gant, sinon il serait condamné à être dominé et à demeurer une puissance de seconde zone. Ainsi, davantage que la colonisation qui n’est qu’un moyen de réalisation, c’est la rivalité entre États qui est le moteur du désir d’empire. Et le nationalisme est l’idéologie qui soutient le désir de puissance de ces États-nations.
Nationalités et nations
L’empire domine un ensemble de peuples avec des langues et mœurs multiples, et de territoires dont certains n’ont jamais été indépendants. Dans le cadre impérial, le pouvoir central est lointain, le pouvoir local est conçu comme un trait d’union entre les populations locales et le pouvoir central.
Mais, à moment donné, ces nationalités aspirent à devenir des « nations ». Les populations de ces nationalités veulent accéder à leur indépendance étatique. Pourquoi ?
Selon mon analyse de l’évolution de nos sociétés occidentales, c’est le remplacement de la socialisation grégaire par la socialisation individualiste qui en est le moteur : c’est-à-dire que cette socialisation individualiste exige de plus en plus des individus qu’ils se vivent en tant tels, et non plus en tant que membres d’une nationalité ou membres d’un groupe.
Pendant des siècles, les individus acceptaient, exigeaient même d’appartenir à une communauté, tribu, ethnie, clan, peuple, etc, mais au fur et à mesure que la légitimité individuelle générale progressait par la socialisation individualiste, ces individus exigeaient de vivre dans une société qui les reconnaissent individuellement dans un État spécifique. C’est ce désir individualiste qui a détruit les empires de l’intérieur, les obligeant à la contrainte et à la répression. Au bout d’un moment, les empires explosent.
Ces manifestations de rupture sont d’habitude très violentes, car non seulement les individus se séparent de l’empire commun, mais ils se séparent aussi des individus des autres nationalités pour se distinguer d’eux : c’est une démarche de séparation/rejet, on se rejette pour se séparer, d’où les « épurations ethniques ». C’est une démarche très profonde car ces individus divers pouvaient être mariés entre eux, la séparation/rejet a donc lieu aussi au sein des familles. Et les séquelles psycho-politico-sociales en sont durables. La pacification identitaire collective de ces individus prendra beaucoup du temps.
Les empires sont grégaires tandis que les nations sont individualistes
Les empires sont structurés par la socialisation grégaire, tandis que les nations le sont par la socialisation individualiste. La socialisation individualiste est advenue en Occident, initiée pratiquement depuis l’origine de ses sociétés occidentales au IVe siècle. Le processus débute sur les vestiges serviles antiques, puis se développe de plus en plus fermement en affirmant son caractère individualiste qui légitime de plus en plus ses individus.
Les sociétés évoluent entre progrès et conservatisme : les progrès s’insèrent progressivement dans les mœurs des sociétés présentes, donc avec leurs mœurs passées qui s’étioleront progressivement au profit des mœurs nouvelles. Cette évolution sociale profite aux individus aux dépens des structures grégaires. Mais ces structures grégaires avaient leurs privilégiés qui tâchent de les défendre : ce sont les conservateurs. Les bénéficiaires des progrès individualistes affectent de nombreux habitants qui les défendent et favorisent à leur tour de nouveaux privilégiés qui tâcheront de conserver ces nouveaux progrès individualistes.
Le collectif est issu de l’individualisme
Dans la socialisation grégaire, c’est l’appartenance au groupe qui prime, c’est elle qui donne son statut et sa place dans la société à chaque individu. Au contraire, dans la socialisation individualiste, c’est l’individu qui prime, il devient la base de la société en lieu et place du groupe. Ça change tout, mais très progressivement car ceci se passe continûment, sans révolution, dans une évolution permanente.
La notion de collectif ne peut pas exister dans la socialisation grégaire, car alors l’ensemble est grégaire, pas collectif. La notion de collectif ne peut advenir qu’à partir de la socialisation individualiste : c’est là qu’il peut commencer à exister parce qu’il comprend l’ensemble de la société, tandis que dans la socialisation grégaire la société était composée de groupes distincts les uns des autres, chacun ne représentant pas l’ensemble de la société. Le collectif s’oppose au grégaire, pas à l’individuel. C’est l’individualisme qui crée le collectif jusqu’à l’État-nation.
Être à sa place ou être soi
La société grégaire est hiérarchique, la société individualiste est égalitaire. Dans une société grégaire, le premier souci de chacun est « d’être à sa place », la société grégaire assigne chacun à une place plus ou moins haut dans la hiérarchie sociale. Être dans la société grégaire, c’est être à sa place. Tandis que dans la société individualiste, être, c’est être soi, individuellement soi. Être à sa place ou être soi est la différence fondamentale entre la socialisation grégaire et la socialisation individualiste.
On remarquera que toutes nos lois sont fondées sur l’individu, sur la légitimité de l’individu, sauf les familles chargées de l’élevage et de la protection de leurs enfants, mais sous la surveillance de la loi individualiste ; les groupes en tant que tels n’ont aucun droit. C’est un renversement total par rapport à l’Ancien-Régime où les groupes hiérarchisés avaient la prééminence.
Il ne faut pas oublier que la subversion de la socialisation grégaire par la socialisation individualiste s’est déroulée durant des siècles, il s’agit bien d’une révolution, mais qui s’est faite au-jour-le-jour, dans une inconscience permanente : ce n’est qu’après coup que les progrès individualistes ont été revendiqués ; et les révolutions, républicaines en particulier, n’ont pas eu une influence déterminante : l’évolution a été la même dans les monarchies européennes.
La centralisation monarchique collectivise le peuple aux dépens des seigneurs locaux
Avant d’être des États-nations, les États rassemblaient des populations de diverses origines qui coexistaient en acquérant des mœurs et mentalités approchantes qui puissent leur donner un même sentiment d’appartenance. C’était déjà un mouvement de rassemblement qui a pu créer une nation de nature collective. En Europe en particulier, la centralisation monarchique a amoindri les pouvoirs locaux, les sujets royaux en appelaient à la justice du roi contre leurs seigneurs féodaux, le pouvoir royal étant plus lointain que celui de seigneurs, ils le craignaient moins. Le roi représente l’unité de la nation et donc le collectif du « peuple national », contre le grégarisme des seigneurs.
La nation est un rassemblement, qui s’oppose au peuple qui se prétend originel
Les « nationalistes » déclarent souvent défendre la souveraineté du peuple. Or, la nation et le peuple sont deux entités qui n’ont pas les mêmes fondements : dans l’imaginaire commun, le peuple est « originel », et cette origine est mythique plutôt que réelle ; tandis que la nation est une construction politique qui s’effectue par le rassemblement de populations d’origines diverses : la nation n’est pas originelle.
L’origine et le rassemblement représentent deux légitimations opposées : l’origine défend la légitimation du fondement premier (vrai ou faux peu importe) ou l’intervention humaine n’apparaît pas, tandis que le rassemblement défend la légitimation de l’intervention humaine fondatrice. Ces deux conceptions opposées de la légitimité, donc de la souveraineté, sont amalgamées par les nationalistes : ils utilisent l’origine pour se légitimer, mais c’est le rassemblement de la nation qui produit la puissance. La nation est composée de nombreux peuples originels aujourd’hui disparus, les nationalistes les rassemblent en un seul, ce qui est une falsification. Les peuples ne sont pas rassemblés, c’est la nation qui l’est.
La légitimation originelle est tournée vers le passé, ce qui explique l’attitude des réactionnaires, tandis que celle du rassemblement est tournée vers l’avenir.
Mais ces nationalistes utilisent peuple et nation essentiellement pour refuser de nouveaux entrants dans la communauté nationale : en tant que peuple ce pourrait être défendable, ça ne l’est pas en tant que nation qui est déjà un rassemblement : pourquoi refuser d’autres entrants alors la nation s’est déjà fondée ainsi ?
On voit là comment l’amalgame peuple/nation leur est utile : le refus de l’autre n’étant pas légitime au nom de la nation, ils l’activent au nom du peuple.
Le peuple est fusionnel, la nation est relationnelle
Deux conceptions sont à l’œuvre : dans la légitimation par l’origine les relations entre individus ne sont pas prises en compte, comme si elles n’existaient pas, le peuple est considéré « fusionné ». La fusion évite et empêche la relation. Mais pour la nation qui est un rassemblement, c’est la relation qui est fondatrice. En fait dans le réel, c’est toujours la relation qui est fondatrice. L’origine du peuple sans relation est un fantasme dont on a fait un mythe qu’on se raconte pour se légitimer.
Mais dans le refus de l’autre, c’est bien le refus de relation que l’on exprime.
Le passage du grégarisme à l’individualisme cause un grand traumatisme, inévitable
C’est par la relation qu’existe toute vie. La vie humaine a commencé par petits groupes, puis structurée en de plus grands ensembles, le développement des individus est devenu crucial pour celui des sociétés. L’individualisme est advenu en Occident en premier lieu par une structuration sociale et non par les idées.
Pendant des dizaines de millénaires les humains ont vécu sous l’ordre grégaire hiérarchique, avec tous leurs paramètres ; avec l’avènement de la socialisation individualiste, ces paramètres deviennent contreproductifs, il faut apprendre à vivre ensemble dans des sociétés hétérogènes de manière individualiste qui, seule, respecte les individus. C’est un très grand bouleversement qui secoue toutes les sociétés du monde. Tous les repères de la vie en société grégaire sont devenus caducs, il nous faut en inventer d’autres.
Beaucoup sont tentés de retourner en arrière, c’est une illusion qui aggrave la situation. C’est un fait que l’on observe systématiquement, lorsqu’on est en difficulté on se retourne vers le passé, comme si le passé était la réponse, alors qu’il est justement la non-réponse, précisément parce qu’il est le passé.
On n’a pas d’autre choix qu’aller de l’avant, donc vers l’avenir et dans la et les relations.
L’individualisme, c’est-à-dire la prééminence des individus sur les groupes dans la société n’est pas une réalité nouvelle, son processus a commencé dès l’origine des sociétés occidentales au IVe siècle. Nous apercevons aujourd’hui ses derniers acquits, mais demain ils continueront encore. Mais nous voyons bien, actuellement, que des forces réactionnaires tentent encore une fois de revenir en arrière, en ce qui concerne au moins le respect de chacun qui est la base légitime de l’individualisme.
Jean-Pierre Bernajuzan



