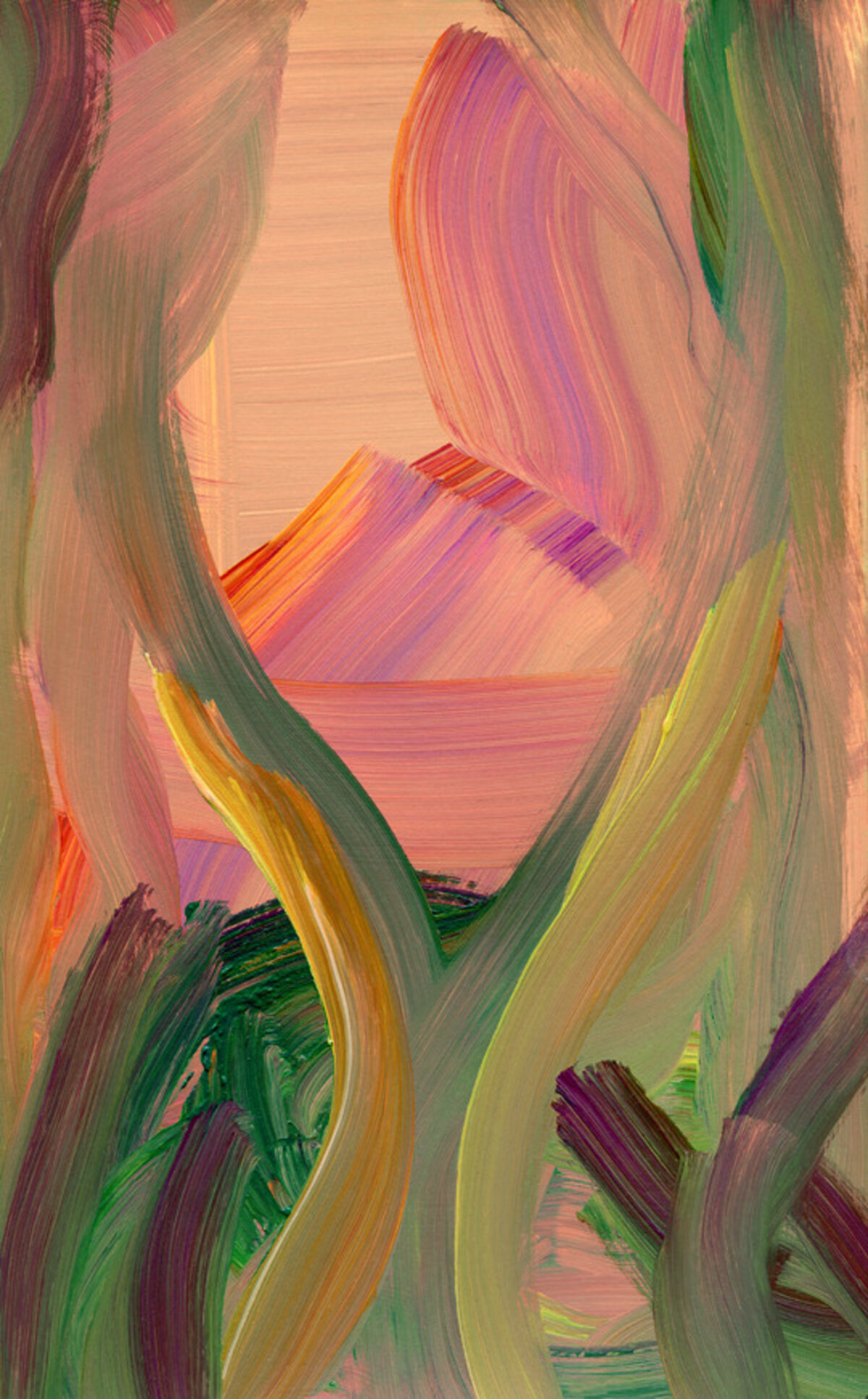
Agrandissement : Illustration 1
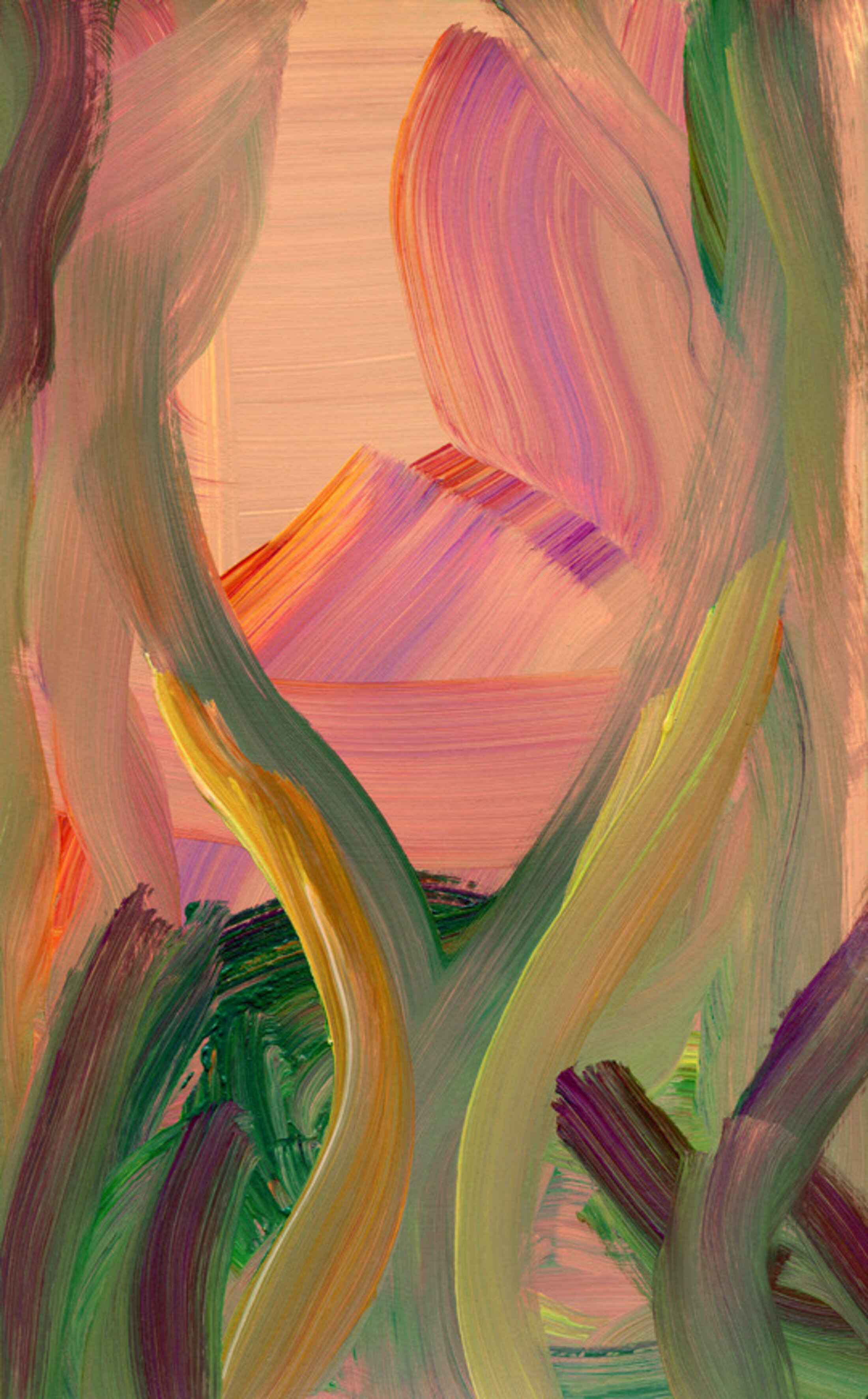
.
C’est la lecture du livre de Laurence Engel - Que peut la culture ? Bartillat 2017 - qui m’a fait prendre conscience que je ne prenais pas la culture comme moyen d’action, sans doute parce que je n’entrevoyais pas comment je pourrais m’y prendre.
La culture est essentielle, mais comment et pourquoi ? On peut dire que tout le monde est cultivé, ne serait-ce que de la culture de sa famille, de son milieu. Je n’identifie pas la culture à l’érudition.
Pour ma part, je considère qu’être cultivé consiste à être capable de faire la relation entre divers univers, divers milieux, diverses cultures, au lieu d’être enfermé dans les siens. C’est-à-dire de faire le lien qui permet de vivre ensemble avec d’autres qui n’ont pas les mêmes cultures, habitudes, mœurs, coutumes. Être cultivé consiste à être ouvert aux autres, à leur manière d’être. Cela suppose d’avoir un minimum de connaissances individuelles et collectives de soi et des autres pour pouvoir faire le lien, d’avoir assez de connaissances générales pour nous situer dans le monde, dans le temps et dans l’espace, situer nos relations, nos façons de penser… Cette façon d’être cultivé amène à relativiser sa propre culture sans la renier ni la minimiser.
La culture sert à vivre ensemble. C’est la culture qui exprime le mieux l’identité de chacun à la fois individuelle et collective, intégrée et partagée : la culture est elle-même lien, identité et lien, identité dans le lien.
Chaque fois que des difficultés sociales apparaissent, elles provoquent un retour vers des comportements grégaires de repli entre soi et contre les autres. C’est un réflexe qui vient de notre origine animale où le groupe devait se défendre contre les autres, la xénophobie en étant l’expression universelle positive. La haine de l’autre n’est pas la cause de la xénophobie, elle en est la conséquence. Le seul fait de se grégariser implique le rejet de l’autre, et pour justifier ce rejet on le hait.
Depuis la fin des Trente Glorieuses, l’individualisme est devenu exclusif et les minorités issues de l’immigration d’origines culturelles différentes deviennent de plus en plus visibles et exigent de l’être parce qu’elles revendiquent l’« égalité individualiste-démocratique-républicaine » que nous sommes incapables de mettre en œuvre, ce qui provoque chez certains d’entre eux une tentation de repli vers leur origine culturelle fantasmée ; repli qui provoque à son tour une crainte et un rejet de la part de la population native de culture chrétienne, ce qui entrave l’intégration et aggrave la difficulté du vivre ensemble.
Étant donné l’individualisation et l’hétérogénéisation accrues de notre société, il faut agir directement et profondément dans la perception et l’échange de nos identités pour contrer la tentation du repli, cette action est précisément culturelle.
Socialisation culturelle
La culture est au fondement de la socialisation, dans les sociétés traditionnelles et homogènes elle la conduit naturellement dès la naissance. Dans notre société individualiste et hétérogène, cela ne va plus de soi.
D’une part, l’individualisme renouvelant constamment la socialisation, il implique une adaptation que les parents ne possèdent pas toujours, d’une génération à l’autre les codes changent. Les parents s’en sortent relativement bien tant que les enfants sont tout petits, mais dès qu’ils se socialisent hors du foyer familial, ils apprennent d’autres codes que ceux de leurs parents.
D’autre part, s’y ajoute la difficulté supplémentaire de l’origine étrangère des parents confrontés à la culture native dominante, la socialisation de leurs enfants s’en trouve compliquée par le décalage entre la culture familiale et celle de la majorité dominante.
Les difficultés accumulées dans l’enfance explosent à l’adolescence où les jeunes commencent à se projeter vers leur vie adulte : les contradictions de socialisation de cet âge sont encore plus grandes pour les enfants d’immigrés que pour les autres car, si les codes diffèrent entre générations, ils diffèrent plus encore pour les enfants d’immigrés puisque leurs parents viennent d’une autre culture. Faire la synthèse entre tous ces apports différents pour établir son identité n’est pas une mince affaire.
Où agir, quand et comment ?
Il serait judicieux d’agir culturellement en dehors de l’Éducation Nationale pour lui apporter ce plus qu’elle est incapable de mettre en œuvre elle-même. Il faut que cela se réalise en dehors de l’école parce que l’école est déjà engagée dans la projection de la position sociale des enfants et de leurs familles, elle n’est plus neutre, elle n’est plus perçue neutre, elle contrôle les élèves dans leur progression scolaire : telle qu’elle travaille dans la mission qui lui est confiée, c’est l’école qui conduit l’échec de l’intégration, c’est elle qui fait le travail pour ce résultat. Le ressentiment de certaines minorités à son égard par l’espoir déçu qu’elles avaient pu mettre en elle ne lui permet plus de faire l’exercice libre de l’ouverture d’esprit aux autres, sans contrôle, sans notes, juste l’ouverture qui émancipe.
Il faut travailler auprès des enfants avant qu’ils deviennent adolescents et qu’ils soient confrontés à l’impératif de leur intégration sociale. Le « travail culturel » consisterait à faire sortir les enfants et les jeunes de l’entre-soi de leur milieu social, de les faire échanger et partager avec d’autres enfants et jeunes d’autres milieux sociaux et culturels en leur apprenant tout ce que les cultures ont chacune inventé et souvent partagé malgré les clivages actuels. Il s’agirait de construire la liberté apaisée de l’identité individuelle par rapport aux appartenances auxquelles chacun est attaché, car les haines, violences, méfiances, hostilités traduisent une identité apeurée, enchaînée à des appartenances protectrices par peur des autres.
C’est pourquoi il ne faut pas la soumettre à des organisations qui ont des objectifs à atteindre comme l’Éducation Nationale, l’identité et ses interrogations doivent rester libres, sans objectif ni jugement, car elle repose sur la vérité de soi dans son rapport aux autres. Et la vérité ne peut être contrainte, elle doit rester libre pour être vérité, elle doit échapper à tout impératif autre qu’elle-même.
Ce projet rejoindrait l’« Éducation populaire » plutôt que l’Éducation Nationale qui a une charge de mission déjà trop lourde. Conçu et activé en dehors d’elle, il l’aiderait à accomplir ses propres tâches en élargissant le champ de vision des enfants et adolescents qui permettrait un rapport aux autres plus apaisé.
Éducation populaire, c’est-à-dire éducation sociale plutôt qu’étatique, socialisation plutôt que formation, ouverture d’esprit plutôt qu’emmagasinement de connaissances. Ce serait un tout autre cadre d’action et d’éducation, social, associatif, ouvert, non-scolaire, sans notes et sans contrôle des enfants pour leur laisser leur liberté, en collaboration avec les associations qui travaillent dans le secteur ou bien en inventer d’autres selon les besoins.
La tutelle de l’Éducation populaire serait le Ministère de la Culture lié aux arts, et non celui de l’Éducation Nationale liée aux savoirs. Même si l’un et l’autre se rejoignent, la priorité est ainsi mise sur l’ouverture d’esprit.
En concevant l’action culturelle en dehors de l’Éducation Nationale, j’ai conscience de me distinguer de la plupart des penseurs sur la question. Il y a en effet un aspect de l’éducation des enfants qui n’est pas abordé franchement dans sa conception : c’est celui de la liberté des enfants dans le processus éducatif.
Alors que nous sommes une société et un État démocratiques supposés garantir notre liberté, nous pratiquons très largement l’éducation sur le mode obligatoire et contraint dont les résultats ne sont pas probants, surtout pour les catégories sociales populaires. C’est que nous oublions que la meilleure façon d’apprendre des enfants, c’est qu’ils soient volontaires au lieu d’être contraints. Pour obtenir de bons résultats scolaires, on mise plutôt sur le talent des enseignants plutôt que sur la motivation des enfants.
Soumise à la tutelle des politiques, l’Éducation Nationale doit se conformer à leurs exigences : en conséquence, elle note, sélectionne, punit pour essayer d’atteindre ses objectifs. Les enseignants savent bien que c’est par la motivation des enfants qu’ils peuvent les obtenir, mais les outils dont ils disposent sont principalement ceux de la contrainte, et de nombreux élèves décrochent.
Je ne pense pas que l’EN soit le bon lieu pour activer la motivation des enfants. Par contre, en les motivant à l’extérieur l’EN pourrait en bénéficier, précisément parce qu’elle ne viendrait pas d’elle.
Le problème de fond est celui de l’absence de pratique démocratique des politiques à l’égard des citoyens, c’est l’arbitraire de gouvernement qu’ils conçoivent comme seul mode valable qui leur donne tout pouvoir.
Jean-Pierre Bernajuzan



