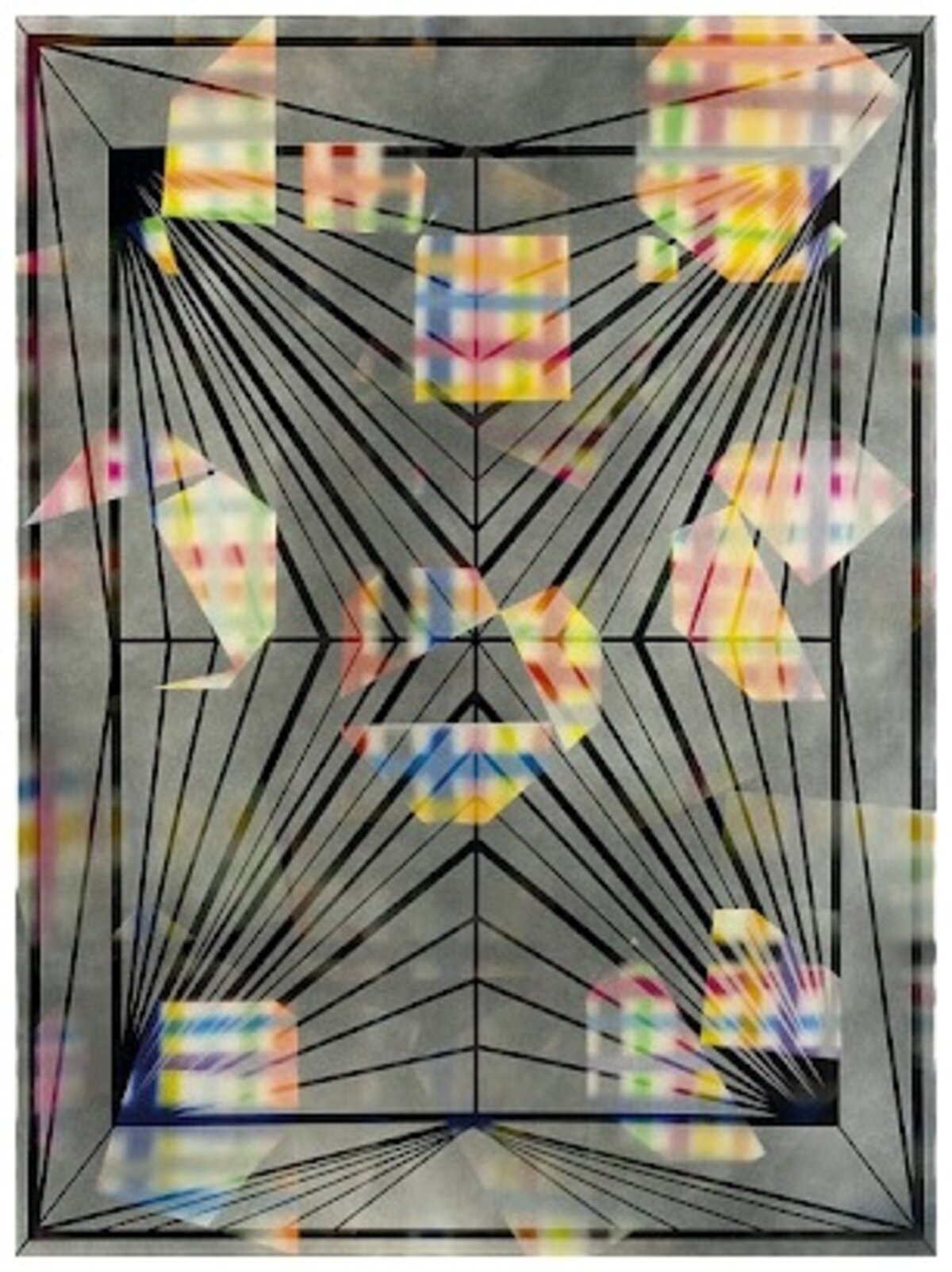
LA DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE - 5 -
L’incompréhension persiste. J’analyse que la décision électorale démocratique ne peut pas être rationnelle, elle est donc arbitraire. Mais bien qu’arbitraire, elle est quand même la plus efficace. On pourrait choisir d’autres arbitraires, par exemple le tirage au sort : certains le préconisent. Mais alors, il n’y aurait plus de choix, plus de confrontation avec le réel, plus de vérification de l’inefficacité, seul le hasard gouvernerait. Ce serait très insécurisant parce qu’on aurait le sentiment de ne pas avoir de prise sur notre vie. Certes la décision électorale démocratique est irrationnelle, mais la démocratie ne se réduit pas à la période électorale…
- Résumé des articles précédents :
De l’unanimité antique, à la majorité qui la représente, puis au XXe siècle la légitimation de la minorité et des partis politiques, le régime démocratique s’est développé dans l’aveuglement de sa propre nature, et dans une longue suite de désenchantements. C’est l’efficacité de la politique qui atteste de sa vérité. Or cette vérité ne peut pas être décidée, ni à la majorité ni autrement. La majorité électorale est arbitraire, quelle qu’elle soit. Elle ne dit donc pas la vérité.
Et pourtant, c’est ce système-là qui est le plus efficace. Être démocrate consiste à accepter de se soumettre à l’arbitraire majoritaire démocratique. La violence de la campagne électorale est symbolique, c’est par cette symbolisation que la violence est maîtrisée. La violence symbolique n’étant pas physiquement réelle, la mort démocratique n’est réelle non plus. Le pouvoir démocratique n’est exercé par le vainqueur qu’entre deux scrutins électoraux, le jusqu’au-boutisme violent devient donc inutile et la violence collective ainsi maîtrisée, la prise des décisions va pouvoir être rationalisée. Pendant la campagne électorale, les candidats prennent en compte l’arbitraire, les préjugés des électeurs, par la démagogie, pour ensuite, les confronter au réel possible.
Les mensonges des politiques ne sont pas les leurs, mais ceux de leurs électeurs. Ainsi, la démocratie est un système de désillusionnement. La vérité démocratique, relative et provisoire, n’est donc pas décidée. Elle est ce qui demeure après nos renoncements. Nous nous abstenons parce que nous n’arrivons plus à croire, à nous faire des illusions. Nous allons vers l’avenir à reculons, nous y allons négativement, plutôt que positivement.
En démocratie, c’est le plus démagogue qui gagne l’élection. La démocratie est le pire des systèmes politiques, à l’exclusion de tous les autres, elle est le pire des systèmes parce qu’elle va chercher le pire de la société pour le traiter, alors que les autres systèmes ne vont pas le chercher parce qu’ils seraient incapables de le traiter, ce serait très dangereux pour eux, ils le tiennent donc à distance ; à l’exclusion de tous les autres, parce que la démocratie, elle, traite et résout le problème…
5 - La démocratie est représentative, ou elle n'est pas !
En 1995, Jacques Delors a renoncé à être candidat à l'élection présidentielle « parce qu'il aurait été obligé de mentir aux Français ».
Il est bien gentil Jacques Delors, il laisse le sale boulot aux autres, et lui, le chevalier blanc, il « fait » la vérité.
Pour qu'il puisse mener son action politique, il a bien fallu que d'autres, Mitterrand en l'occurrence, gagnent les élections - démagogiquement -, pour pouvoir lui confier, à lui, les responsabilités politiques qu'il a exercé.
En démocratie, l'action politique "s'arme" pendant les élections, pendant la campagne électorale.
Pour exercer le pouvoir démocratique, il faut d'abord être capable de gagner les élections, forcément démagogiquement, puis gouverner efficacement, c'est-à-dire rationnellement.
Dans le premier temps, on prend en compte l'arbitraire collectif par la démagogie, pendant la campagne électorale, et dans le deuxième temps, on met en œuvre une politique rationnelle.
La contradiction entre les 2 temps doit être assumée et maîtrisée.
Les personnalités politiques sont plus ou moins douées pour le premier temps ou pour le second :
- Mitterrand et Chirac étaient plutôt doués pour le premier.
- Mendès-France, Barre, Delors, plutôt pour le second.
La Ve république permettait que les premiers gagnent les élections et confient le gouvernement aux seconds ; « permettait », parce que la dérive sarkozienne présidentialiste a rassemblé les 2 temps et les 2 fonctions, dans la seule forme démagogique.
C'est la démocratie représentative qui permet d'aller chercher les illusions, les préjugés et les arbitraires des électeurs, pour les confronter au "possible" inventé par leurs représentants élus, tels des médiateurs.
- La démocratie directe ne confronte pas l'arbitraire au réel rationnel, au contraire, elle applique cet arbitraire sur le réel.
Avec la démocratie directe, on ne sort pas de l'arbitraire collectif. La votation suisse contre les minarets en est un exemple récent.
Avec le référendum non-plus, on n'en sort pas. Il piège le peuple dans ses choix électoraux.
Le choix référendaire doit être conforme aux choix de la démocratie représentative. Sinon, le peuple prend 2 décisions contradictoires qui bloquent la dynamique démocratique. Au contraire de la démocratie représentative, qui lui permet de changer d'avis tout en en faisant porter la responsabilité aux élus qu'il a changés. Avec le référendum, il faudrait que le peuple se vire lui-même pour changer d'avis : impossible !
Quand le peuple change de majorité, il change d'avis, il se dédit, mais sans le reconnaître.
Conclusion : le référendum est anti-démocratique.
Le choix des élus, et leur changement permet cette recherche incertaine, aléatoire de la solution - provisoire - qui convient. C'est la médiation des élus qui permet le passage de l'illusion arbitraire, au réel rationnel.
La démocratie est représentative, ou elle n'est pas !
Et sans démagogie électorale, elle ne servirait à rien.
L'essentiel de la démarche démocratique, consiste à prendre en compte l'arbitraire collectif, pour le neutraliser.
La vérité rationnelle n'est que secondaire, chronologiquement secondaire.
La vérité rationnelle ne peut être qu'un résultat, elle ne peut pas être une décision volontaire : la vérité ne se décide pas !
- L'expression collective, et la vérité, sont antinomiques. La vérité ne peut pas relever du collectif, du peuple. Elle est du ressort de l'individu. Le peuple ne dit jamais la vérité : donc le peuple a toujours tort.
- Il a tort, mais il est souverain.
Il faut qu'il soit souverain, parce qu'il a tort !
La vérité ne peut pas être décidée à la majorité ; ce qui peut être décidé à la majorité, c'est l'arbitraire, c'est à dire le « non-vrai », l'illusion, le mensonge. Ce sont ces arbitraires qui vont être confrontés au réel possible, et qui seront « subis » par les électeurs eux-mêmes, puisqu'ils les auront décidés. Comme ils ne sont pas collectivement masochistes, les électeurs abandonneront progressivement ces arbitraires qui les font souffrir...
Pourquoi faudrait-il forcément décider d'un arbitraire ? Mais comment faire autrement ? On ne peut pas connaître la vérité a priori, et il faut bien qu'en attendant le pays soit dirigé, quelle qu'en soit la politique...
Mais surtout, la prise en compte de ces arbitraires permet de les traiter, tandis que si on ne les traite pas, ils travaillent la société, la pourrissent, jusqu'à l'explosion. Le système démocratique fonctionne comme une station d'épuration, ou comme un rein. « élections : piège à cons », élections piège à connerie, élections piège à arbitraires...
- Le résultat d'un scrutin électoral, quel qu'il soit, est toujours un arbitraire. D'ailleurs, si l'opposition ne le pensait pas, elle ne pourrait pas s'opposer. Être démocrate consiste à accepter de se soumettre à l'arbitraire de la majorité démocratique. Celui qui ne l'accepte pas n'est pas démocrate.
Cet arbitraire majoritaire librement consenti permet d'échapper à la violence qui serait nécessaire pour imposer un autre arbitraire, non majoritaire, non démocratique.
à suivre…
Jean-Pierre Bernajuzan



