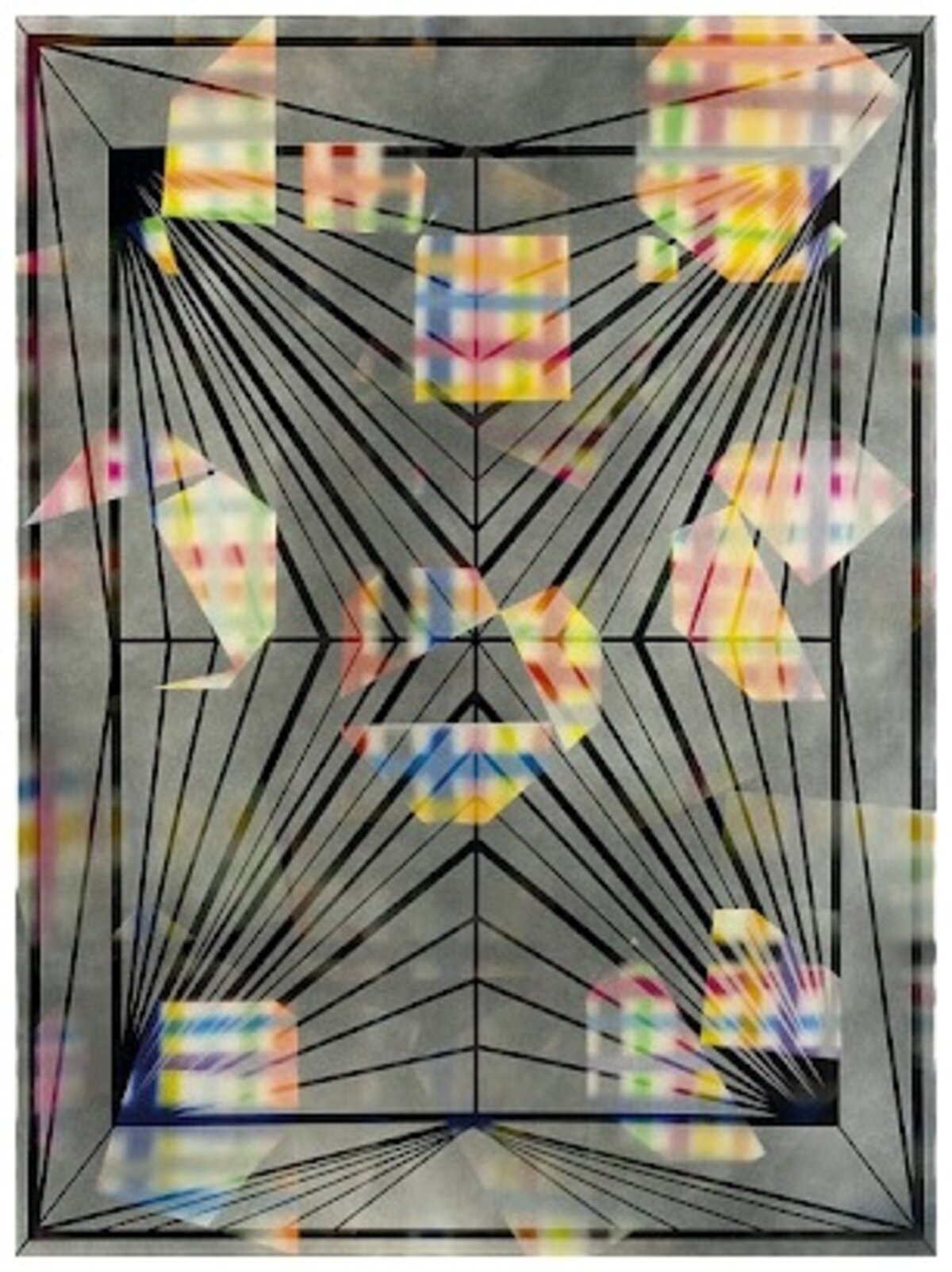
LA DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE
Avertissement
Cette série d’articles publiée il y a 10 ans est datée, les références sont anciennes et les temps ont changé, il semble que le type de ce cycle démocratique soit arrivé à son terme. En fait ils ont évolué : nous sommes aujourd’hui dans une autre phase du développement des sociétés et donc de la démocratie, que je vais décrire maintenant.
Reprenons depuis le début : comment la société occidentale humaniste individualiste et démocratique a-t-elle démarré et comment s’est-elle construite ? (j'ai publié cet article ici le 1/10/2018)
Comment « l'Église de Rome » a bâti l'Occident...
Pour comprendre comment l’Église a déterminé la société actuelle, il faut distinguer son action réelle, sociale, de la justification idéologique qu’elle se donne. Elle suscite deux types de préjugés : celui des chrétiens croyants qui adhèrent à cette justification idéologique, et celui des anticléricaux qui la contestent. Mais ils sont complices pour ne pas aller voir ce qu’il en a été concrètement.
Les chercheurs médiévistes travaillent. L’un d’eux, Joseph Morsel a publié sur internet : L’Histoire (du Moyen-Age) est un sport de combat.
Notre Occident se repère à son développement individuel, économique, social, scientifique, sa démocratie, ses Droits de l’Homme… Joseph Morsel et ses collègues proposent une analyse passionnante de ce développement.
L’aventure commence dès IVe siècle à la chute de l’Empire Romain.
A ce moment-là, quand le pouvoir est devenu vacant, l’Église, seule institution en état de marche, s’est demandée comment assurer sa domination sur ce chaos...
- Par le savoir.
D’après eux en l’an 1000, l’essentiel du travail de construction de la base de notre société occidentale aurait été accompli. L’hégémonie occidentale serait moins liée à des aspects technologiques, qu’à une organisation sociale à l’efficacité particulière, une meilleure productivité sociale dont dériverait la suite.
- C’est cette productivité sociale qui est à l’origine de la domination occidentale.
Alors qu’à la fin de l’Empire Romain, l’Occident latin était le moins dynamique face aux autres, alors que les hommes concernés n’étaient ni plus intelligents, ni plus forts, ni plus nombreux, ils sont pourtant parvenus à dominer pour un temps la planète.
Cet Occident n’est, ni un espace, ni un être collectif, ni une culture.
- C’est un système de domination, c’est à dire un ensemble de rapports sociaux, qu’on appelle système social.
Ce système social s’est institué progressivement sur une base très hétérogène, et l’homogénéité occidentale actuelle est le résultat de cette institution. Il n’y a aucune prédestination.
C’est au XIe siècle que ces évolutions deviennent visibles.
Les médiévistes reprennent les observations de Max Weber, il en ressort :
- Que l’organisation sociale non impériale assurée par l’Église constitue une particularité absolue de l’Occident chrétien, qui aurait fondé l’unité culturelle de l’Occident.
- La « déparentalisation » du social.
Dans les sociétés anciennes européennes, la valeur sociale des personnes était déterminée par leur position au sein de l’ensemble des rapports de parenté de leur société, qui s’imposent à tous et à chacun. En Occident, au Moyen-Age, un long processus d’évolution relativise ces rapports de parenté qui ne seront plus primo-structurants. - La disqualification de la parenté charnelle, remplacée par la parenté spirituelle.
L’Église a mis cette « déparentalisation » en œuvre au niveau de son recrutement.
L’Église latine se constitue précisément au Moyen-Age en une institution explicitement fondée sur la marginalisation des rapports de parenté charnelle :
– Célibat et chasteté, excluant par principe toute filiation interne au clergé.
– L’Église prend le contrôle de l’alliance matrimoniale, impose le nom de baptême.
– Aucune généalogie en dehors du cercle royal.
– Culte des ancêtres remplacé par le culte des saints, et en faveur des morts en général, est un recul de la pertinence sociale de la filiation.
– C’est le prêtre qui au moment du baptême fait de l’enfant une personne. Alors qu’en Grèce et à Rome, c’est le père charnel qui le faisait.
L’Église s’est donc approprié les fonctions de socialisation dévolues antérieurement aux rapports de parenté.
– En disqualifiant la parentèle, elle a valorisé le noyau familial : elle a donc institué la famille nucléaire. - La société médiévale devient une société sans ancêtres, la commémoration des défunts est assurée collectivement; les morts ne sont donc plus des morts des familles, mais des communautés d’habitants (monuments aux morts).
- C’est le mariage chrétien qui a structuré la société médiévale sur une base non parentale.
L’appartenance parentale n’est plus le fondement de l’appartenance sociale.
Avec le baptême des enfants et le mariage chrétien, on passe d’un schéma biblique qui disqualifie la parenté charnelle, à la définition de normes pratiques qui mettent les clercs en position dominante.
C’est à ce niveau de production de normes que se joue la particularité de l’Occident latin, puisqu’il partageait avec Byzance les mêmes textes sacrés qui n’y ont pas abouti aux mêmes résultats sociaux.
C’est donc bien que l’effort clérical pour définir un certain exercice de la parenté a eu une efficacité particulière.
Le XIe siècle constitue un tournant parce que l’Église est en mesure alors d’imposer son interprétation hégémonique des textes sacrés, et donc de contrôler le social.
Déparentalisée, l’Église est dirigée par une aristocratie ecclésiastique qui se recrute de manière déparentalisée.
De ce fait, le recrutement déparentalisé devient le signe de la supériorité sociale. - Le spatial se substitue au parental.
Pour situer une personne, on tend de plus en plus à la localiser : elle est de tel endroit, plutôt que de telle famille. Les bourgeois du Roi deviennent les bourgeois de Paris…
Le « de » noble est le résultat de cette spatialisation du social.
Dans la période précédente, c’est la personne qui donnait le nom au lieu.
Désormais c’est le lieu qui donne son nom à ceux qui le détiennent.
Le Roi régnait sur des personnes, il règne dorénavant sur un espace. - L’enracinement du social.
Les descendants se transforment en héritiers.
C’est un élément essentiel du processus spatialisation/déparentalisation.
Les personnes, leur naissance, leur mariage, leur succession, sont fondamentalement soumis aux impératifs de préservation et de transmission du patrimoine, qui s’imposent aux personnes.
Ce n’est plus le descendant qui hérite de la terre, c’est la terre qui hérite de l’héritier.
Le pouvoir s’enracine, d’une domination itinérante, on passe à une domination spatiale.
Se généralisent alors les communautés d’habitants, villages, bourgs, villes… - Le rapport social de base : habiter.
Alors qu’auparavant on appartenait à une famille, à un maître, fondamentalement, habiter signifie être de quelque part, avoir des voisins, produire quelque part.
C’est parce les habitants pouvaient désormais avoir le sentiment d’avoir en commun un certain espace, qu’une nouvelle cohésion sociale a pu émerger à mesure que s’affaiblissait celle fondée sur les rapports de parenté.
La spatialisation est ce qui distingue radicalement le principe communautaire occidental des autres formes que l’on rencontre ailleurs ou auparavant.
De même que la déparentalisation signe la spécificité occidentale…
L’adjectif « occidental » ne signifie en aucun cas européen ou blanc, mais renvoie à un mode d’organisation sociale dans lequel les rapports de parenté sont secondaires.
C’est la domination interne (dominants sur dominés occidentaux) qui est plus performante, et qui a entraîné la domination externe des occidentaux sur le reste de la planète.
L’organisation productive agricole ou artisanale, en ville ou au village, a 2 niveaux : 1 La famille, le feu, la maison où le chef de feu organise l’usage de la force de travail (épouse, enfants, domestiques) et en assure la répartition du fruit. 2 La communauté d’habitants: dispersion des parcelles, vaine pâture…
Par ailleurs, les enfants sont soumis aux exigences de reproduction de l’unité d’exploitation, qui engendre le célibat, âge au mariage tardif, émigration des cadets.
Ce système se généralisant, le jeune dispose de façon autonome de sa force de travail, dans lequel chacun des membres du foyer peut avoir un patron particulier. - C’est l’avènement du salariat.
Dominant à partir du XVIIIe siècle, il présuppose la propriété de soi, à savoir la liberté de sa force de travail.
Le salariat ne peut se développer que dans une population dont les membres sont libres de disposer de leur force de travail, ce qui exclut les systèmes serviles, et aussi les systèmes de parenté.
Mais la liberté de la force de travail ne peut aboutir au salariat que si elle est libre de ses mouvements.
L’enracinement qu’a constitué la spatialisation n’a pas signifié l’immobilisation, mais l’encadrement de la circulation de la population: circulation des bons ouvriers, répression des vagants.
Le double processus de déparentalisation et de spatialisation a conduit à la croissance matérielle de l’Occident.
Mais cette richesse n’est jamais en soi la garantie du succès, tout dépend de la capacité d’analyse : du possible, de l’inutile et du néfaste… donc de l’existence durable de compétences.
Ce qui est devenu le mode principal d’accès au pouvoir, ce sont les compétences.
Ce qui a eu 2 conséquences majeures : 1 L’idéal démocratique. 2 Cela signifie que ceux qui accèdent au pouvoir sont tendanciellement les plus instruits et les plus informés, que ces sociétés sont tendanciellement dirigées par les plus savants. - L’Église a été le laboratoire de la méritocratie.
Dès l’époque mérovingienne le clergé met en place et contrôle une culture latine, peuple les écoles, universités dès leur fondation, soumises à la tutelle pontificale, qui font émerger les plus brillants.
Les plus compétents forment le haut clergé, les conciles, les entourages princiers et royaux.
- La société médiévale, quoique radicalement distincte, n’est pas l’inverse de la société contemporaine, mais bien plutôt sa matrice.
– Analyses et interprétations –
Dès la fin de l’Empire Romain au IVe siècle, dans l’Europe en proie aux invasions barbares, l’Église est la seule institution permanente en état de fonctionnement, sur tout le territoire.
À ce moment-là, elle est devenue la seule qui détienne le savoir.
Alors que les autres instances de pouvoir divisaient le territoire, l’Église en a assuré l’unité.
Par son savoir, dans le chaos post-romain d’invasions, de lutte pour le pouvoir, de croyances et coutumes diverses, elle a été la puissance permanente, rationalisante.
Par sa compétence l’Église a accompagné le pouvoir politique, qu’elle a aussi influencé de son idéologie évangélique.
L’Évangile a été déterminant parce qu’il était le seul texte sacré par lequel l’Église légitimait son pouvoir.
Dès le IVe siècle, c’est elle qui a produit le savoir, qui l’a enseigné, diffusé. Pendant au moins un millénaire, c’est elle qui a assuré l’instruction de l’élite et l’édification des peuples.
Elle a créé les écoles, les universités dont les clercs étaient les premiers élèves et étudiants. La structure ecclésiale a été la première instance de recherche.
La pensée scientifique est née de cette instance ; les premiers scientifiques étaient des religieux qui, au début, pensaient dans le cadre de leur foi et qui, de générations en générations, s’en émancipaient.
La méthode scientifique consiste en une critique et une remise en question systématique des savoirs déjà connus. La pensée scientifique s’est donc « attaquée » à la base sur laquelle elle s’exerçait, c’est à dire l’ensemble des croyances, représentations dont la superstructure était la foi chrétienne.
Il est donc logique qu’elle se soit heurtée à l’Église, alors même que c’est elle qui l’avait initiée.
Lorsqu’on revendique aujourd’hui le caractère chrétien de notre civilisation, c’est le résultat de ce travail de sape de l’idéologie chrétienne que l’on revendique.
- Il apparaît que le fondement de l’efficacité de l’influence de l’Église de Rome a été la « déparentalisation », exprimée d’abord en interne par le célibat des prêtres.
- La société médiévale sans ancêtres constitue une rupture radicale de la légitimation sociale : auparavant l'origine constituait la légitimité fondamentale de chacun, c'est à dire légitimité basée sur le passé. Désormais la légitimité se construit vers l'avenir par la méritocratie. Une société sans ancêtres nous libère du passé...
L’Église justifie ce célibat par des considérations religieuses.
Mais ce qui compte vraiment, c’est l’efficacité de la productivité sociale qui en est découlée.
Cette déparentalisation a libéré les individus de leur appartenance familiale, a donné à chacun la propriété de soi, de sa force de travail :
- Ce qui a produit le salariat.
Elle a produit la légitimité de l’individu, de son autonomie.
De cette légitimité autonome découle l’égalité des individus entre-eux, parce que libérés de l’allégeance familiale.
- Ainsi, le mariage d’amour comme la laïcité, ne proviennent pas de l’histoire des idées, mais de l’évolution des structures sociales dont le salariat est l’expression centrale. Auparavant, c’était les familles qui mariaient leurs enfants.
Le souci de soi a renvoyé au souci des autres, et d’abord à celui des enfants.
Pour que les parents puissent commencer à se soucier de leurs enfants, il fallait qu’il aient une valeur propre ; le sentiment de cette valeur propre découlant du sentiment de leur propre valeur autonome.
Reconnaître la valeur propre des enfants, reproduit le sentiment de la valeur des individus.
La reconnaissance de la valeur des individus implique celle de leur égalité.
- L’individualisation découle donc de cette déparentalisation.
La méritocratie républicaine est héritée de l’Église, contre l’Ancien-Régime.
De cette égalité individuelle a pu émerger la liberté démocratique.
Aucune recherche historique n’a jamais établi l’influence de la pensée grecque. Ce préjugé idéologique a été contesté dès 1930 par Marc Bloch, et abandonné après 1945 par Adorno, Duby, Le Goff, Le Roy Ladurie, Geremeck… excusez du peu !
70 ans après, certains ne l’ont toujours pas enregistré.
La déparentalisation sur laquelle est fondée notre civilisation, s’oppose radicalement aux structures sociales grecques ou romaines, comme à toutes autres…
- « Pour l’instant, seule la civilisation chrétienne construit le monde. Pour l’instant. »
L’idée de choisir cette phrase en exergue m’est venue en entendant Jean-Paul Fitoussi dire à la radio que l’élection d’Obama allait enfin permettre d’éradiquer le racisme (je l'ai changée depuis)…
La civilisation chrétienne (j’aurais dû ajouter occidentale) est la seule encore à bâtir son avenir par la critique systématique de son réel présent et passé.
Elle critique sa persécution, son esclavage, son racisme, son colonialisme, ses préjugés, et elle se construit en les abandonnant : l’arbitraire du passé est son matériau de construction.
Pourtant ces arbitraires sont présents dans les autres civilisations, mais ils ne les abandonnent que sous l’influence de l’Occident-chrétien.
Tous les pays de monde, l’Afrique, la Chine, l’Inde… se développent en adoptant le « système social » occidental.
- L’Occident s’auto-transforme, et en fait profiter le reste du monde.
Il faut espérer que les autres civilisations nous rejoignent, pour faire bénéficier le monde de la critique de leur passé...
Jean-Pierre Bernajuzan



