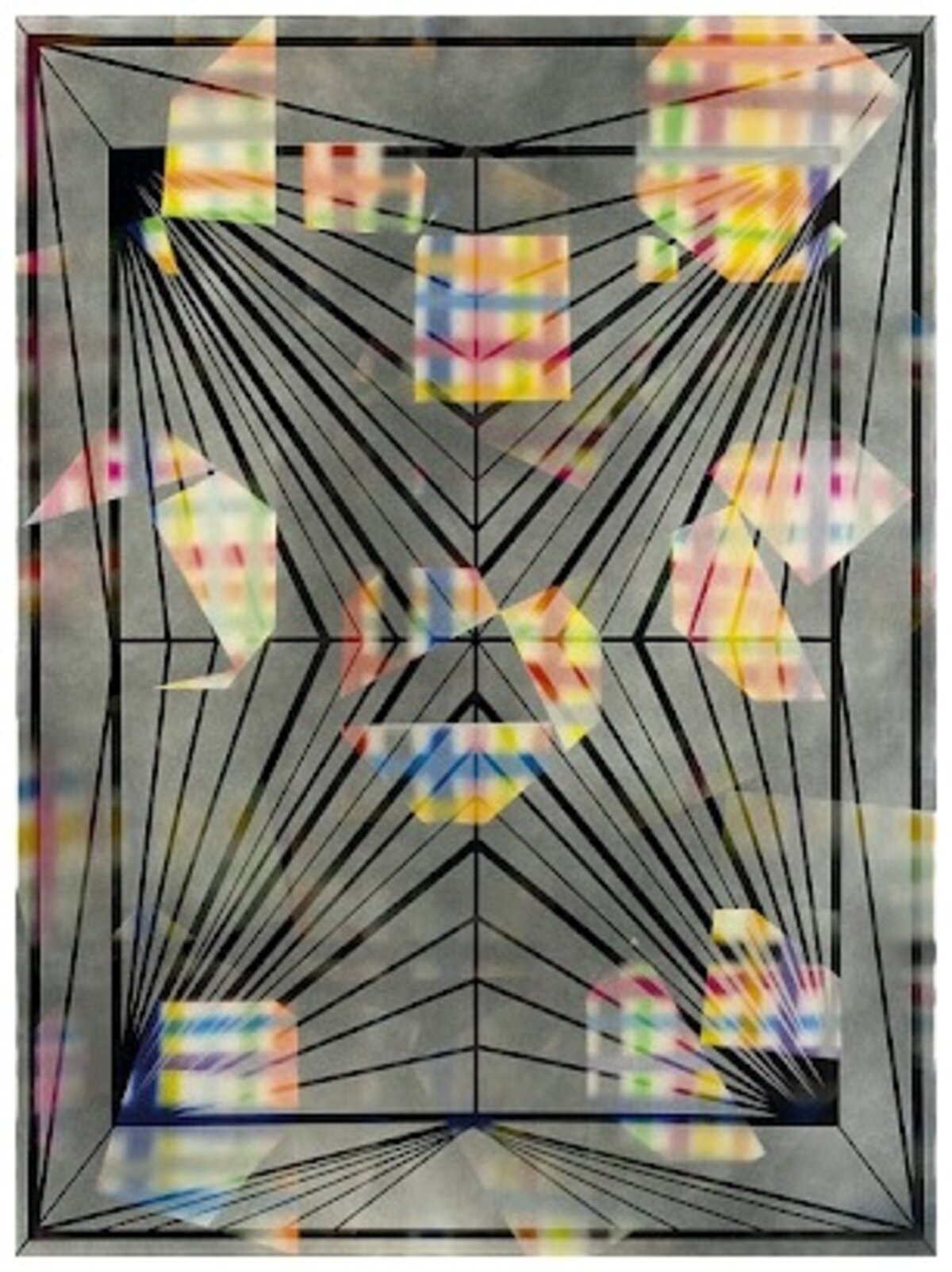
LA DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE
La société occidentale s’est donc structurée sous l’égide de l’Église catholique par la « déparentalisation » du social qui a disqualifié la parenté charnelle, ce qui a aboli le culte des ancêtres (remplacé par le culte des saints) la société médiévale devient une société sans ancêtres, aucune généalogie en dehors du cercle royal, c’est le prêtre au moment du baptême qui fait de l’enfant une personne, alors qu’autrefois c’était le père charnel qui le faisait, en disqualifiant la parentèle l’Église a valorisé le noyau familial et institué la famille nucléaire.
Alors qu’autrefois on appartenait à un maître ou à une famille, habiter devient le rapport social de base ; habiter signifie être de quelque part, avoir des voisins, produire quelque part : une nouvelle cohésion sociale a pu apparaître au fur et à mesure que s’affaiblissait celle fondée sur les rapports de parenté.
La nécessité de préserver l’unité d’exploitation sur laquelle vivait la famille a obligé les cadets à émigrer et trouver du travail ailleurs : ce qui a produit l’avènement du salariat qui est devenu dominant au XVIIIe siècle, avant la révolution industrielle et la Révolution française.
Mais au départ, comment cela s’est-il passé ?
Le « système paysan » serait-il la structure fondatrice de la modernité occidentale ?
En lisant récemment L’identité de la France de Fernand Braudel, j’ai été très étonné d’y découvrir qu’il considérait que l’esclavage y était massif très tardivement, jusqu’aux VIIIe ou IXe siècles, pratiquement jusqu’en l’an mille ! Je n’avais pas appris cette vision de la réalité de l’époque, je n’avais pas entendu d’autres historiens la relater : Charlemagne régnait-il sur un peuple d’esclave ?
Bien-sûr l’Empire Romain était esclavagiste. L’esclavage était-il une pratique impériale, ou bien était-il généralisé dans tous les régimes politiques et tous les peuples de l’époque ? Fernand Braudel suppute que l’essentiel de la production agricole était produite dans des « villae», des latifundiums, d’une très grande surface (1000 à 2000 ha), avec une main-d’œuvre esclave, assez semblables finalement aux exploitations esclavagistes du Nouveau Monde. Après la chute de l’Empire cela continue, les monastères prenant le relais. Il parle aussi de «colons», «de paysans libres», puis de serfs, tout en disant que ce sont des distinctions arbitraires, car ils étaient tous sous domination et exploitation sévères et contrôlées, et dépendants. Sous les Mérovingiens et les Carolingiens le tiers de la population aurait été esclave. Ces conditions d’existence ont suscité des contestations, des résistances, des «jacqueries» qui n’ont de tous temps, jamais réussi à subvertir l’ordre établi. À partir du 8-9° siècle, le système évolue vers le servage, car l’esclavage était peu productif et usait très vite les hommes. Le serf était plus productif car il était plus libre. Le servage a donc été un progrès pour les esclaves, mais en même temps une régression pour les paysans libres.
Mais la question qui se pose, c’est comment est-on sorti de ce système servile, car on en est sorti. Comment est-on passé de ce système servile à ce qui est progressivement devenu notre société occidentale, au bout du compte humaniste et démocratique ? Car, à partir des mêmes prémisses, l’Occident a eu un développement différent des autres : le moment crucial et déterminant a été celui de la mutation du système servile vers un autre système...
- D’abord, ce n’est pas le régime politique qui détermine ou non l’esclavage, puisqu'il a existé aussi bien sous l’empire que sous la royauté ou sous la république, aussi bien chez les Romains qu’aux États-Unis qui étaient une république démocratique et humaniste. Le servage a disparu assez tôt en Occident alors qu’il est resté institutionnel en Russie jusqu’en 1861.
C'est l'Église catholique qui a créé la société occidentale
La société occidentale s’est constituée sous l’action délibérée de l’Église catholique qui avait un objectif propre : remplacer la filiation charnelle par une filiation spirituelle, selon la lecture qu’elle faisait des Saintes Écritures. Disons-le tout de suite, elle a échoué à obtenir cette filiation spirituelle. Mais son action obstinée, pendant des siècles, a produit un résultat tangible.
Dans toutes les sociétés archaïques, la valeur des individus était déterminée par leur position au sein de l'ensemble des rapports de parenté de leur société, qui s'imposent à tous et à chacun. En Occident, au Moyen-Âge, un long processus d'évolution relativise ces rapports de parenté qui ne seront plus primo-structurants.
La déparentalisation du social
C’est la disqualification de la parenté charnelle, remplacée par la parenté spirituelle.
L'Église a mis cette "déparentalisation" en œuvre au niveau de son recrutement ; l'Église latine se constitue précisément au Moyen-Age en une institution explicitement fondée sur la marginalisation des rapports de parenté charnelle ; célibat et chasteté excluant par principe toute filiation interne au clergé ; l'Église prend le contrôle de l'alliance matrimoniale, impose le nom de baptême ; aucune généalogie en dehors du cercle royal, culte des ancêtres remplacé par le culte des saints et en faveur des morts en général est un recul de la pertinence sociale de la filiation. C'est le prêtre qui au moment du baptême fait de l'enfant une personne, alors qu'en Grèce et à Rome c'est le père charnel qui le faisait. L'Église s'est donc appropriée les fonctions de socialisation dévolues antérieurement aux rapports de parenté. En disqualifiant la parentèle, elle a valorisé le noyau familial, elle a donc institué la famille nucléaire.
La société médiévale devient une société sans ancêtres, la commémoration des défunts est assurée collectivement, les morts ne sont donc plus des morts des familles mais des communautés d'habitants. C'est le mariage chrétien qui a structuré la société médiévale sur une base non parentale. L'appartenance parentale n'est plus le fondement de l'appartenance sociale.
Le spatial se substitue au parental
Pour situer une personne, on tend de plus en plus à la localiser : elle est de tel endroit, plutôt que de telle famille. Les bourgeois du Roi deviennent les bourgeois de Paris... Le de noble est le résultat de cette spatialisation du social. Dans la période précédente, c'est la personne qui donnait le nom au lieu. Désormais c'est le lieu qui donne son nom à ceux qui le détiennent. Le Roi régnait sur des personnes, il règne dorénavant sur un espace.
L'enracinement du social
Les descendants se transforment en héritiers. C'est un élément essentiel du processus spatialisation/déparentalisation. Les personnes, leur naissance, leur mariage, leur succession, sont fondamentalement soumis aux impératifs de préservation et de transmission du patrimoine, qui s'imposent aux personnes. Ce n'est plus le descendant qui hérite de la terre, c'est la terre qui hérite de l'héritier. Le pouvoir s'enracine, d'une domination itinérante, on passe à une domination spatiale. Se généralisent alors les communautés d'habitants, villages, bourgs, villes...
Le rapport social de base : habiter
Alors qu'auparavant on appartenait à une famille ou à un maître, fondamentalement, habiter signifie être de quelque part, avoir des voisins, produire quelque part. C'est parce les habitants pouvaient désormais avoir le sentiment d'avoir en commun un certain espace, qu'une nouvelle cohésion sociale a pu émerger à mesure que s'affaiblissait celle fondée sur les rapports de parenté. La spatialisation est ce qui distingue radicalement le principe communautaire occidental des autres formes que l'on rencontre ailleurs ou auparavant. De même que la déparentalisation signe la spécificité occidentale.
L'organisation productive agricole ou artisanale, en ville ou au village, a deux niveaux :
1 La famille, le feu, la maison où le chef de feu organise l'usage de la force de travail (épouse, enfants, domestiques) et en assure la répartition du fruit.
2 La communauté d'habitants : dispersion des parcelles, vaine pâture... Par ailleurs, les enfants sont soumis aux exigences de reproduction de l'unité d'exploitation, qui engendre le célibat, âge au mariage tardif, émigration des cadets. Ce système se généralisant, le jeune dispose de façon autonome de sa force de travail, dans lequel chacun des membres du foyer peut avoir un patron particulier.
L'avènement du salariat
Dominant à partir du 18°siècle, il présuppose la propriété de soi, à savoir la liberté de sa force de travail. Le salariat ne peut se développer que dans une population dont les membres sont libres de disposer de leur force de travail, ce qui exclut les systèmes serviles, et aussi les systèmes de parenté.
Mais la liberté de la force de travail ne peut aboutir au salariat que si elle est libre de ses mouvements. L'enracinement qu'a constitué la spatialisation n'a pas signifié l'immobilisation, mais l'encadrement de la circulation de la population : circulation des bons ouvriers, répression des vagants.
Ce qui fait dire à Joseph Morsel, historien médiéviste de qui je tire ces informations (1) :
- «La société médiévale, quoique radicalement distincte, n'est pas l'inverse de la société contemporaine, mais bien plutôt sa matrice.»
L’avènement du « système paysan »
D’abord, ces nouvelles structures sociales-économiques concernent l’essentiel de la population de l’époque, la production agricole représentant l’essentiel de l’économie et les artisans étant eux-mêmes paysans aussi ; donc l’ensemble de la population sauf la noblesse.
À la différence des esclaves et des serfs, les paysans sont autonomes, dominés mais autonomes. Et ils le sont grâce à la socialisation spatiale que la déparentalisation a introduite.
Cette socialisation spatiale exigeant la constitution d’abord, puis la préservation et la transmission d’un patrimoine, elle a exigé le départ des enfants qui sont devenus salariés ailleurs. Ce faisant, ils s’émancipent de la cellule familiale originelle, ils se socialisent en dehors d’elle. Progressivement, ils constituent la société moderne occidentale.
- Cette émancipation sociale à l’égard de leur famille les fait échapper à la hiérarchie grégaire familiale, ce qui les individualise, et cette individualisation devient progressivement la socialisation dominante. La société devient individualiste, c’est à dire qu’au contraire de la société de parenté où les individus tenaient leur légitimité de leur appartenance familiale, ils deviennent légitimes par eux-mêmes, sans appartenance.
Les différentes philosophies viendront ensuite confirmer cette légitimité, l’humanisme d’abord (d’origine orientale) puis les Lumières qui formuleront les attendus de cette légitimité ; l’humanisme devient un droit, le droit humaniste qui est en fait un droit individualiste, le droit qui exprime la légitimité des individus sans qu’ils aient besoin d’une appartenance. La société se construit et se structure progressivement sur cette base individualiste, ce qui aboutira au bout de siècles d’évolution continue à la société démocratique.
- Dans cette perspective, c’est l’évolution et la transformation sociale qui ont suscité l’évolution et la mutation politique et non l’inverse comme on le pense souvent, ce n’est pas non plus la philosophie qui a été déterminante.
Et dans cette évolution sociale, c’est l’avènement de l’individualisme qui a constitué la base du régime démocratique : il fallait que les individus soient libres, donc émancipés, et égaux en droit. Cette égalité a été produite par l’émancipation à l’égard des groupes familiaux qui, eux, étaient hiérarchiques, donc inégaux. C’est donc l’égalité individualiste qui constitue la base de la démocratie.
- J’insiste sur cet aspect car il nous éclaire sur la manière dont on peut obtenir la démocratisation de pays qui ne l’ont pas encore atteinte. Aujourd’hui, de nombreux pays ont des difficultés extrêmes à évoluer vers le régime démocratique qui leur permettrait pourtant d’être en mesure de résoudre leurs problèmes. Ces pays sont le plus souvent encore structurés sur une base parentale comme les tribus par exemple : au lieu de mettre l’accent sur l’aspect politique ou philosophique de la démocratie, on ferait mieux de considérer et de favoriser d’abord l’évolution sociale vers l’individualisation, pour ensuite permettre la structuration démocratique.
Pour autant, est-ce que c’est ce système paysan qui a été l’animateur de la modernité occidentale ? Non.
Le monde paysan a fourni continument des «individus» à la société moderne occidentale en construction, tout en restant lui-même dans un état d’archaïsme par rapport à cette société moderne, mais il a été le support indispensable à cette évolution, il n’existait lui-même tel qu’il était, que dans ce rapport de fournisseur. Le monde paysan est toujours resté dans une position d’archaïsme par rapport à la société en devenir, mais tout en étant son support indispensable, tandis que la noblesse par exemple, était et est toujours restée un archaïsme, finalement détruit par la modernité.
- Le monde paysan a suscité la société moderne occidentale par l’émancipation continue de ses enfants vers elle, à force, elle est devenue l’unique, et le monde paysan s’est fondu, évaporé en elle, jusqu’à disparaître.
Depuis cinquante ans, le monde paysan a disparu et le monde agricole et rural fait désormais partie de cette société unique d’ «individus et de semblables», à part entière.
- En définitive, ce qu’on appelle modernité, c’est l’individualisme, qui est d’abord une structuration sociale, par lequel tout est advenu et sans lequel rien n’aurait pu advenir.
Jean-Pierre Bernajuzan
à suivre...



