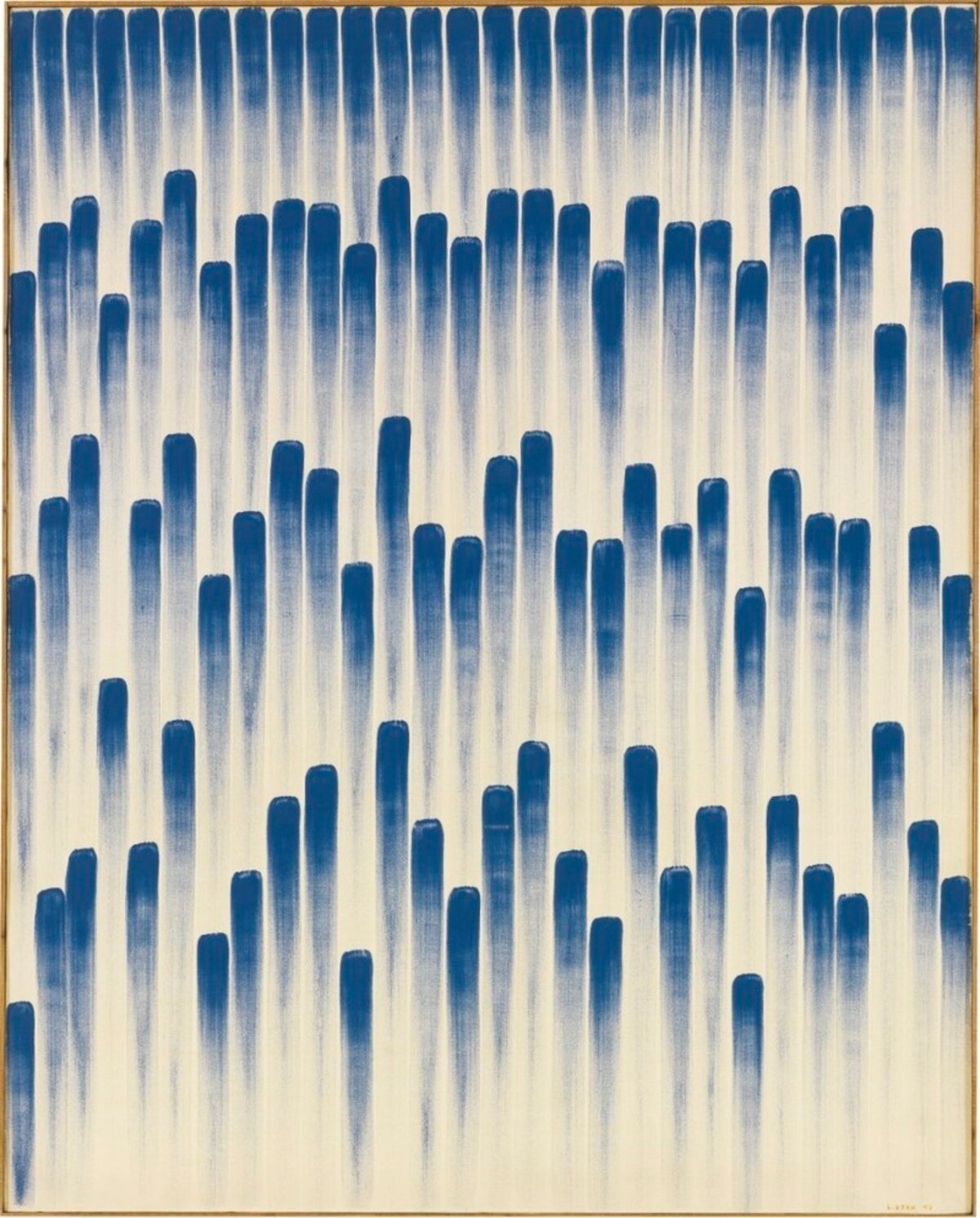
Agrandissement : Illustration 1
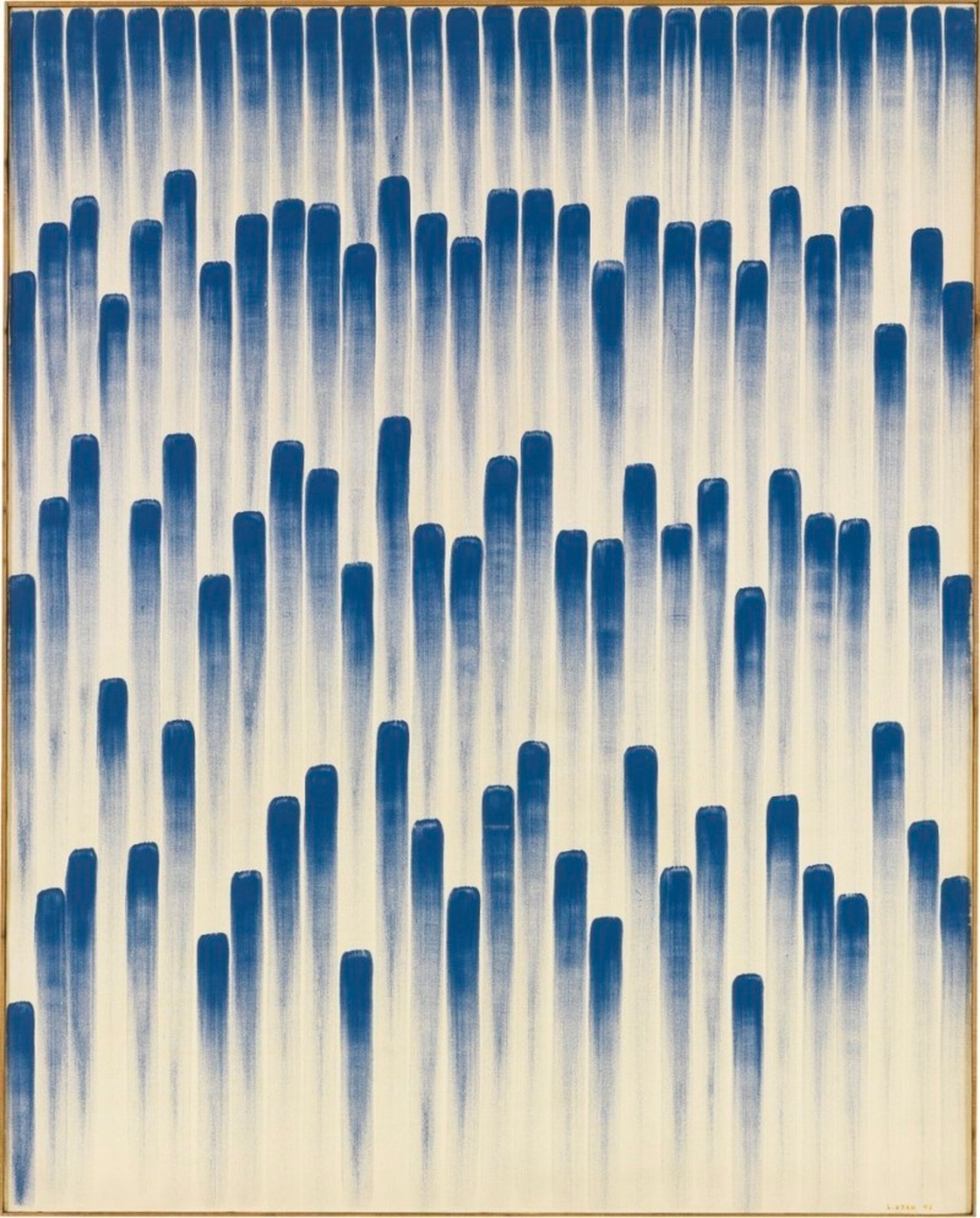
Le mariage de raison est d’abord une association matrimoniale, il est donc un mariage d’intérêt, les sentiments et les désirs ne font que suivre, au contraire des mariages d’amour où ils précèdent l’union, prétendument du moins.
Pour que l’union fonctionne et soit durable il faut que chacun des époux aient un rôle bien défini en correspondance avec celui de leur partenaire, même si ces rôles évoluent. Ceci vaut pour tous les types d’union. Mais pour qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle spécifique, il faut que la « logique dynamique » de leur personnalité soit respectée, et reconnue par leur partenaire, réciproquement. J’entends par « logique dynamique de leur personnalité » la façon que chacun a de se déterminer et de fonctionner, et qui le fait se tenir debout dans sa vie. C’est une donnée fondamentale de l’équilibre d’une personne qui doit être absolument respectée, à la fois pour chaque personne, pour le couple et donc pour la famille.
Malheureusement, il arrive souvent que ces différentes logiques dynamiques personnelles perturbent le partenaire qui, de fait et inconsciemment le plus souvent, la refuse : dans ce cas l’avenir du couple est compromis.
Dans le mariage d’amour les sentiments et les désirs précèdent l’union, l’intérêt suit. Mais le respect de la logique dynamique de chacun doit tout autant être respectée pour l’union d’amour puisse être durable. Et la notion d’amour jette un voile qui opacifie les relations entre les partenaires : en effet, toute les relations entre les époux vont être mesurées à l’aune de l’amour, alors que le plus important est le respect de l’autre dans sa logique dynamique, qui passe ainsi inaperçu.
La base de la viabilité de l’union, c’est le respect, pas l’amour. Sur la base du respect entre les époux, les sentiments et les désirs peuvent s’épanouir et s’éclater (dans tous les sens du terme), car la solidité de l’union reposera sur le respect ; mais sans respect, l’union éclatera.
J’insiste, quand je parle de respect, il ne s’agit pas seulement d’être attentionné et de garder les bonnes apparences éventuellement trompeuses, il s’agit bien de reconnaître l’autre dans sa logique dynamique qui lui permet de tenir debout et de vivre sa vie selon cette logique dynamique. Et il arrive, souvent peut-être, que les partenaires ne peuvent pas se reconnaître, parce que cela remet trop en question leur propre logique dynamique, que cela soit réciproque ou pas. Ce qui signifie que chaque personne devrait avoir atteint un degré suffisant d’équilibre autonome pour pouvoir espérer construire une union durable avec un partenaire. Nous sommes nombreux à ne pas l’avoir atteint… Et le mariage d’amour n’est pas a priori le plus durable.
Pour revenir à mes parents, leurs logiques dynamiques respectives étaient très différentes et même opposées.
Mon père était mégalomane, paranoïaque et violent, il ne pensait jamais qu’à lui-même. C’est ma mère qui nous assumait, qui assurait notre éducation, toujours soucieuse de nous plus que d’elle-même, avec toutefois un a priori pour les institutions religieuses qui étaient pour elle un bien - en soi. Nous, ses enfants très nombreux, étions d’un avis différent.
Si mon père était fier d’avoir conquis ma mère, je me suis longtemps demandé pourquoi ma mère l’avait choisi, lui ? Même si elle n’avait pas deviné sa personnalité profonde, elle avait trouvé en lui quelque chose qui répondait à son désir, forcément. Mais quoi ?
J’ai finalement trouvé : ma mère était issue d’une famille relativement aisée, mais très conformiste, timorée, et de notre avis d’enfants issus de ce couple, assez ennuyeuse : je pense qu’en épousant mon père, ma mère a choisi l’aventure. Elle a été servie. Alors que j’avais pensé jusque-là que notre ouverture d’esprit venait sans doute de la mégalomanie de mon père, j’en suis venu à penser qu’elle est plutôt issue de l’esprit d’aventure de ma mère.
Mon père était violent, et jusqu’à récemment, j’avais pensé que nous avions tous été traités de la même manière. Or, si j’ai reçu de très nombreuses raclées, pour mes sœurs ça n’a pas été le cas, et pour mes frères seul mon frère aîné était concerné : il ne m’a jamais dit que son père l’avait battu. Je découvre que je suis le seul à avoir été battu, pourquoi moi ?
C’est mon père lui-même qui m’avait donné la réponse quelques années après que j’avais quitté la maison familiale : « Tu étais indépendant ! », comme si c’était une tare. Eh bien oui, j’étais indépendant et pas seulement à l’égard de mon père, ça ne dérangeait pas ma mère que je le sois… En fait, étant indépendant, mon père ne pouvait pas disposer de moi à sa guise, alors dans sa rage impuissante, il me battait. Il a fini par me mettre à la porte, comme mon frère aîné d’ailleurs qui, lui, n’était pas indépendant dans son jeune âge.
Donc, la logique dynamique de mon père était de ne penser qu’à lui-même et de disposer de nous : comme ça lui était impossible, il était en colère permanente, nous accusant d’être responsables de son malheur (paranoïa). Il avait le sentiment qu’on profitait de lui quand on ne travaillait pas pour lui, j’ai donc cessé de jouer dès l’âge de 10 ans parce que je devais travailler, même si l’efficacité de mon travail était dérisoire.
Ma mère supportait cette situation stoïquement, à mon avis parce qu’elle avait choisi mon père et qu’elle supportait les conséquences de son choix. Je dois préciser que mon père n’était violent qu’à l’égard des enfants, pas à l’égard de sa femme, qui lui en imposait.
Ma mère supportait cette ambiance de violence et de haine, totalement contraire à sa morale, parce que c’était son choix : mais nous ses enfants, on les a subies sans les avoir choisies. Manifestement, cela ne lui a pas posé de problème. Il aurait fallu qu’elle divorce pour assurer notre sécurité physique et affective, mais dans son idéologie de croyante c’était inconcevable, elle ne l’a sans doute jamais imaginé. La logique dynamique de ma mère était de s’occuper de nous, ce qu’elle faisait très bien, en assurant et respectant notre indépendance, mais dans le cadre étroit de son idéologie religieuse qui, elle, ne nous respectait pas. Souvent je me suis dit combien nous aurions pu être heureux sans mon père, j’ai le sentiment que ma mère nous a abandonné à sa violence et sa haine.
Dans l’exemple de mes parents, la logique dynamique en construction des enfants n’était pas respectée, sauf partiellement par ma mère ; d’où l’on voit que ce respect des parents entre-eux a une influence sur le sort de leurs enfants.
Heureusement que les parents ne sont pas les seuls à intervenir, la société évolue aussi et vient soutenir l’évolution des parents, mais surtout celle des enfants qui se trouvent de plain-pied avec elle.
C’était une époque, mon père était loin d’être le seul père à avoir ce comportement, le plus souvent à la campagne les enfants étaient une force de travail dont les parents disposaient à leur guise. On a changé d’époque, heureusement ; il y a pourtant des gens qui regrettent le passé, ce passé ?
Jean-Pierre Bernajuzan
PS : J'ajoute que le respect que l'on accorde à son partenaire constitue une reconnaissance qui lui rajoute une légitimité ; au contraire, le non respect constitue une non-reconnaissance et donc une illégitimité qui pèsent sur la relation entre les époux.
JPB



