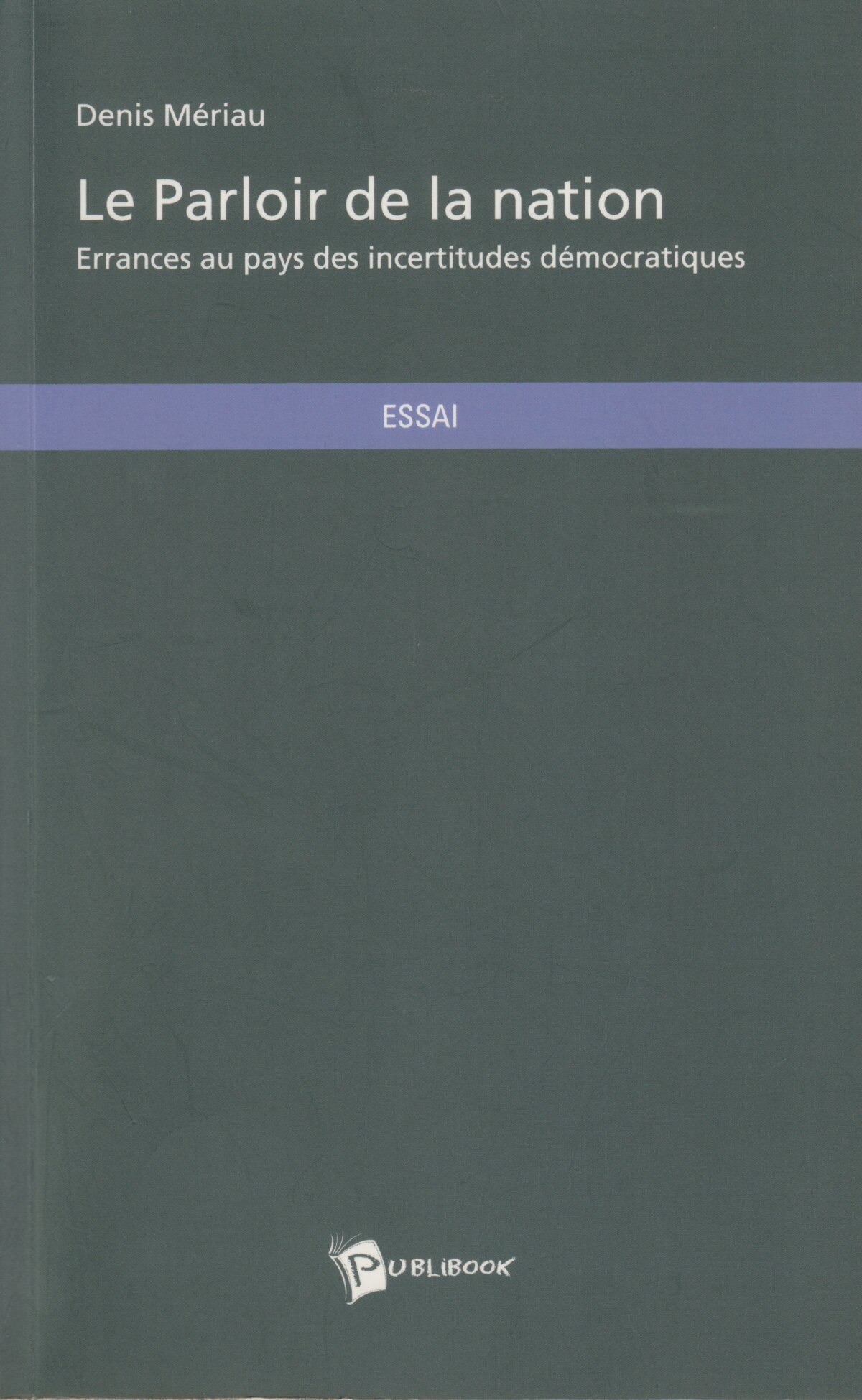
Agrandissement : Illustration 1
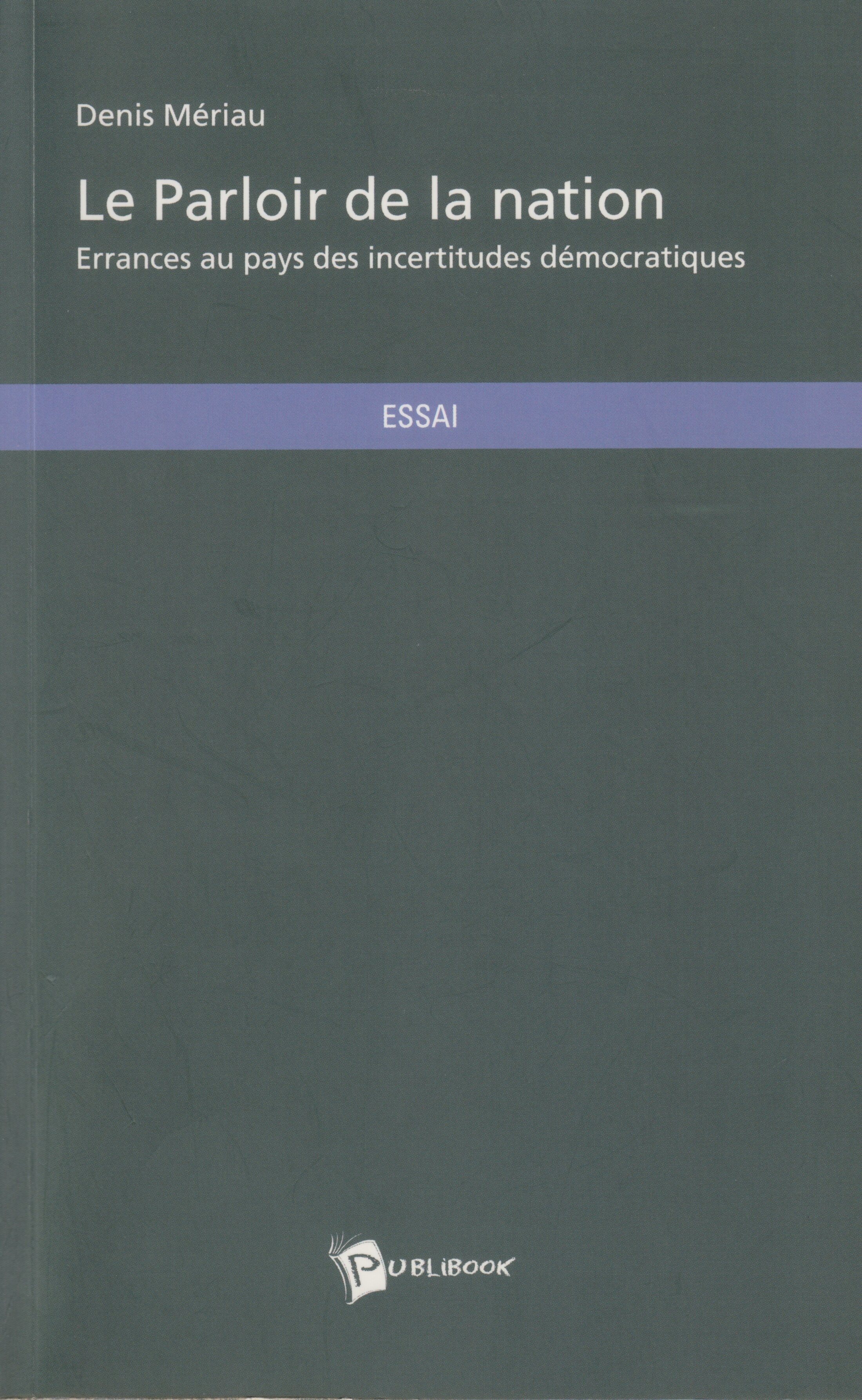
LA DYNAMIQUE DÉMOCRATIQUE
Dans les sociétés démocratiques, le Parlement joue un rôle essentiel, lequel fondamentalement ?
Le Parloir de la nation
« Le Parloir de la nation » est un livre de Denis Mériau.
C’est un livre passionnant qui montre comment la parole des députés construit la nation et notre identité nationale, en votant les lois, en les ajustant, en les formulant, en leur donnant leur sens. Comment, à partir de nos mensonges, de nos peurs, de nos désidérata, nos mesquineries, bref, de nos votes, comment faire du lien ? Comment faire de l’un ? Comment faire exister la nation ?
Tel est l’enjeu du débat, l’objet même du débat ; tel est l’enjeu, l’objet même de la démocratie. Alors, il ne faudra pas s’étonner si les mots des députés nous disent de la démocratie qu’elle est incertitude, inachèvement. Qu’elle est une quête, comme une épreuve. Une tentative. Une tentation…
Paroles, paroles, paroles !
Ce sont ici paroles de député(e)s. Ce sont paroles des années 2002 et 2003 glanées dans les 18 000 pages du compte rendu intégral des débats, tel qu’il est publié dans les Journaux officiels « débats ». Ce sont des « paroles poétiques échappées du texte ». Paroles qui disent la loi - et la nation - en train de se faire. Qui disent l’exigence et la difficulté du « vivre ensemble ». Ce sont des paroles anonymées, ce qui l’intéresse n’est pas de savoir qui dit quoi, mais de savoir que cela a été dit dans l’hémicycle et reproduit au compte rendu.
- Ce sont des paroles désassemblées et réassemblées par ses soins, avec pour seule idée de donner sens à ce « discours gisant », de faire entendre la « petite musique » de l’Assemblée - qui est aussi « petite musique » de la nation. De dire l’en-deçà et l’au-delà du débat - qui sont aussi l’en-deçà et l’au-delà de la démocratie, et même, l’en-deçà et l’au-delà de notre vote à venir.
Le « sens » n’est pas forcément la « cohérence ». L’univers politique n’est pas un univers rationnel, ou du moins, n’est pas que rationnel. Il fait appel à de multiples ressources, à de multiples ressorts dont certains échappent à notre conscience de citoyen.
À défaut de cohérence, l’auteur invite le lecteur à une « co-errance », à l’instar des chevaliers infidèles condamner à « errer » sans fin dans la prison dorée du « Val sans retour », nous essaierons de nombreux chemins - des cent et des uns.
« Les mots savent de nous choses que nous ne savons pas d’eux ». Aussi l’auteur s’attache à ce qu’il y a « derrière » les mots. Qu’est-ce qu’ils disent, les mots des députés ? Qu’est-ce qu’ils disent que nous ne savons pas ?
Ils disent qu’on les a posés là pour qu’ils donnent corps, forme, force, vie, et chair à la loi ; mais que le sens en question n’est pas forcément celui que l’on croit - celui que nous inculqué les experts, celui auquel nous sommes habitués, ou résignés.
- Le « sens en question »… Non seulement le sens est « en » question ; mais il « est » question ; il est « la » question : comment, partant de nos vils mensonges, nos peurs, nos désidérata, nos mesquineries, comment faire du lien ? Comment faire de l’un ? Bref, comment faire exister la nation ?
Tel est l’enjeu, l’objet même du débat ; tel est l’enjeu, l’objet même de la démocratie. Alors, il ne faudra pas s’étonner si les mots des députés nous disent que de la démocratie qu’elle est incertitude, inachèvement. Qu’elle est comme une quête, comme un épreuve. Une tentative. Une tentation - la tentation de poser le sac et de croire que « ça y est », que « à ce coup » « on y est arrivés », que « à ce coup, on est arrivés » !
- L’auteur ne dit pas que l’Assemblée est seule à produire du lien ; il ne dit pas qu’elle le tout de la démocratie. Et il s’est demandé ce qu’il adviendrait de la loi si elle ne passait pas par le tamis - parfois grossier, parfois grinçant - de l’Assemblée. Il s’est demandé ce qu’il adviendrait de la nation si ces hommes de chair et d’os - que nous avons élus, mis à part, pour nous représenter en un temps, en un lieu, où nous ne pourrions siéger, en multitude, à tout moment - refusaient de faire Assemblée, refusaient d’être envers et contre tout, l’Assemblée… « l’Assemblée quand même ».
Alors il s’est dit « Bonjour l’ennui ! ». Pas seulement l’ennui qui résulterait de l’absence de débat et se traduirait par un manque d’intérêt du citoyen ; mais un ennui bien plus profond - un « ennui démocratique » - qui ferait de nous des intermittents de la citoyenneté, des pourvoyeurs de voix, des plantes supports sur lesquelles on grefferait des programmes tout faits. Bref, tout l’inverse de la démocratie.
21 errances
En 21 courts chapitres, l’auteur propose une série de concepts, de notions et de thèmes qui lui permettent d’analyser et de décrire le fonctionnement et la finalité de l’Assemblée Nationale, dans son rapport aux citoyens, au pays, au peuple.
- Il parle de « Tiers-absent » ou tiers pour désigner l’ensemble des citoyens, certes absents, mais présents par l’intermédiaire des représentants qu’ils ont élus ; il parle du chemin long et tortueux qui va de la demande du tiers à la loi ; de la « légitimité » de ce qui sera inscrit dans la loi, c’est à dire ce qui est conforme à l’ « intérêt général »… mais où est donc l’intérêt général ? ; il entrouvre la « boite à outils » qui va servir à donner forme à la loi ; la mise en forme de la loi qui s’apparente au jeu télévisé : « Des chiffres et des lettres » ; il est dit que pour avancer, il faut accepter de mettre une jambe en déséquilibre, il invente le « point delta » pour dire le point d’équilibre que doit atteindre la loi…
- Il amène le lecteur à se demander pourquoi, le plus souvent, il obéit à une loi qu’il juge imparfaite et que (pour certains du moins) il n’a pas voulue : parce que « « la loi, c’est la loi ! » ; parce que (ou dans la mesure où) elle est « juste » et « équilibrée » ; parce que, si nous obéissons à la loi, bien qu’absents au débat, nous sommes partie prenante à ladite loi par l’intermédiaire de nos représentants ; où il explique que la loi « se nourrit » du « sacro-saint terrain » et que la raison d’être du débat est de dire l’ « ici et maintenant » de la nation…
- Où il est dit qu’il y a une contradiction à vouloir à la fois faire une loi « durable » - inscrite dans le temps long - et répondre aux exigences de l’ « ici et maintenant » ; où il est dit que le député tente de dépasser symboliquement la contradiction entre le « temps long » et l’ « immédiateté » ; où, après avoir dit que la loi doit « faire sens », l’auteur s’interroge sur ce qui est susceptible de faire sens : l’ « idéologie » ?… les « valeurs » ?… le « bon sens » ? ; où l’on s’interrogera sur sur ce qui fait l’ « esprit » de la loi et où le lecteur se rendra compte qu’il y a dans la loi - et dans le débat - quelque chose qui dépasse le rationnel ; où, pour tenter de dire l’humaine aventure qui consiste, pour le citoyen, à vouloir s’occuper des affaires de la cité sans en référer à Dieu ou à un roi, il sera question de l’ « absurde » et de la « prison dorée » du « Val sans retour »…
- Où il est question du lien électeur/élu (qui est, disent les députés, un « lien direct », un « lien de confiance »… et de multiples autres formes du lien ; où il sera expliqué que le lien n’est pas seulement mis en question (par les évènements tels que le « 21 avril »)… mais qu’il faut le considérer comme étant « la » question de la démocratie : comment faire de l’un avec du multiple et du divers ? ; où il est dit que, si l’on veut transformer l’ « agglomérat » de citoyens individualistes et dépressifs en un « corps » de citoyens solidaires et éclairés, cela relève de l’ « alchimie »… encore faut-il trouver l’ élixir » (ou la « pierre philosophale ») !
- Où l’on s’interroge sur la ou les façons de faire exister ce corps solidaire qu’est la nation et quand il est dit que seul le débat peut permettre de construire un véritable « sens commun » ; où il est dit que le « groupe Assemblée » est une mise en scène, une figure, et en même temps, une garantie du « vivre ensemble ».
- Où il est dit, pour terminer (et justifier le titre de l’ouvrage !) que l’ Assemblée est le « parloir de la nation » : si la parole s’affadit, avec quoi la parlera-t-on ?
Le Parlement est une « fonction de parole »
- Denis Mériau, par son analyse et la mise en scène littéraire de son analyse, « montre » le fonctionnement du Parlement. Il le montre par les mots que prononcent les députés. Au lieu de s’occuper des prises de positions politiques de chacun, il s’attache à décrire l’action et le débat de l’Assemblée dans son fonctionnement fondamental, avant que les choix politiques et idéologiques de chacun et de tous ne viennent déterminer tel ou tel choix, telle ou telle décision, telle ou telle loi…
À travers la « confection » de la loi, c’est la prise en compte de tout ce qui fait la vie du pays, des gens, des citoyens, des territoires… qui est formulé, taillé, ajusté, pour en faire des lois qui règleront notre vie commune, qui diront notre manière de vivre, notre manière d’être, notre manière d’être commune, partagée par de-delà nos singularités ; et c’est ce partage commun qui nous donne le sentiment d’être Français.
Ce que nous révèle Denis Mériau, c’est que c’est cette parole des députés qui dit notre identité nationale commune, qui l’élabore, la construit. Ce qu’il nous révèle, c’est que c’est par la parole que nous existons en tant que « corps collectif » ; et bien au-delà des opinions-convictions politico-idéologiques, qui, finalement, sont bien secondaires.
L’ « Un » de la nation
« Faire nation », c’est être un. C’est être un à partir de notre multitude d’individualités divergentes et contradictoires. Et le travail de parole des députés pour faire la loi « tisse » la multiplicité de nos votes singuliers pour en faire l’ « un commun ». Ils tissent les mots de nos opinions, les cisèlent, les ajustent, les comptent, pour en faire la toile, la trame de notre identité.
Ainsi, il montre que la nation, que l’identité nationale, sont une construction de sens, et le sens s’exprime par les mots : la nation, l’identité nationale sont un sens construit par les mots.
L’identité nationale n’est donc pas préalable à cette construction permanente par les mots de la parole des députés, elle n’est pas donnée d’avance par la naissance ou par tout autre moyen ; elle est construite au jour le jour par la parole de nos représentants ; il montre que la fonction représentante est essentielle pour produire la nation et l’identité nationale.
- Imaginons que nous supprimions l’Assemblée Nationale : comment alors nous existerions-nous en tant que nation ? Sans la parole de nos représentants ? Sans nos représentants élus, la nation, la notion de nation disparaîtrait !
- Et cette approche, cette analyse, montrent la différence entre la nation et… l’ethnie, la tribu, le peuple, la famille : toutes ces entités n’ont pas besoin d’être dites pour exister, au contraire de la nation.
- Cette démonstration va à l’encontre de la conception de la démocratie qui préconise la démocratie directe. Car la démocratie directe recèle le postulat que les identités et le savoir du peuple, de la nation… sont déjà constitués, et que les décisions peuvent être prises directement par le « peuple », sans discussions, sans mises au point, sans ajustement, sans élaboration, sans construction, sans intermédiaires et sans représentants donc.
Certains allant même jusqu’à l’idée de supprimer le « choix électoral » en tirant les élus au sort : ce serait « plus » démocratique ! Elle démontre que la parole délibérative des « représentants » construit cette identité nationale commune, elle illustre l’illusion de la démocratie directe.
L’ « un » se construit par le lien
Le plus souvent on utilise le mot « lien, lien social » pour exprimer une convivialité, une solidarité, un liant entre des choses préexistantes ; choses qui n’auraient pas besoin de liens pour être, pour être ensemble, pour vivre ensemble.
- L’auteur démontre ici que l’ « un » national, la nation quoi, ne préexiste pas au lien par lequel elle est. C’est le lien qui la produit. Le lien ne consiste donc pas à mettre de l’huile dans les rouages, mais à produire l’ « un collectif » qu’est la nation.
Or, le lien est une relation, d’altérité donc
- Le lien construit l’un. Oui mais ce lien est un rapport à l’autre, une relation à l’autre. C’est à dire qu’en fin de compte, le moteur de la construction de la nation et de l’identité nationale c’est l’altérité : c’est par la relation à l’autre, aux autres, que l’on construit l’identité commune.
Alors que l’on apprécie d’habitude l’altérité comme une « qualité » morale ou sociale qui « agrémenterait » le vivre ensemble, la convivialité… Or, l’altérité, la relation d’altérité, apparaît ici comme l’élément fondamental, basique, de l’ « être collectif », de l’ « être national ». Ce qui contredit Heidegger : l’ « être » se crée dans le rapport à l’autre, c’est par l’autre que l’être se fait, que l’être s’est. Je regrette que cet aspect de l’altérité dans le lien et donc dans la construction de l’ « un » ne soit pas plus explicite dans le livre, il est implicite et pas assez explicite.
En définitive, la nation est altère, ou elle n’est pas !
Conclusion : achetez son livre !
Denis Mériau s’intéresse au monde et au système dans lequel il vit, à la démocratie qui le construit. Il essaie de le comprendre au-delà des péripéties politiciennes et idéologiques, dans son fonctionnement même ; il essaie de comprendre en quoi il nous est essentiel malgré toutes les turpitudes que l’on peut reprocher aux politiques, comme aux individus et aux peuples d’ailleurs.
Achetez son livre, numérique ou papier, diffusez-le, partagez-le. Il est magnifique !
Jean-Pierre Bernajuzan
Voici les références de son livre :

Agrandissement : Illustration 2
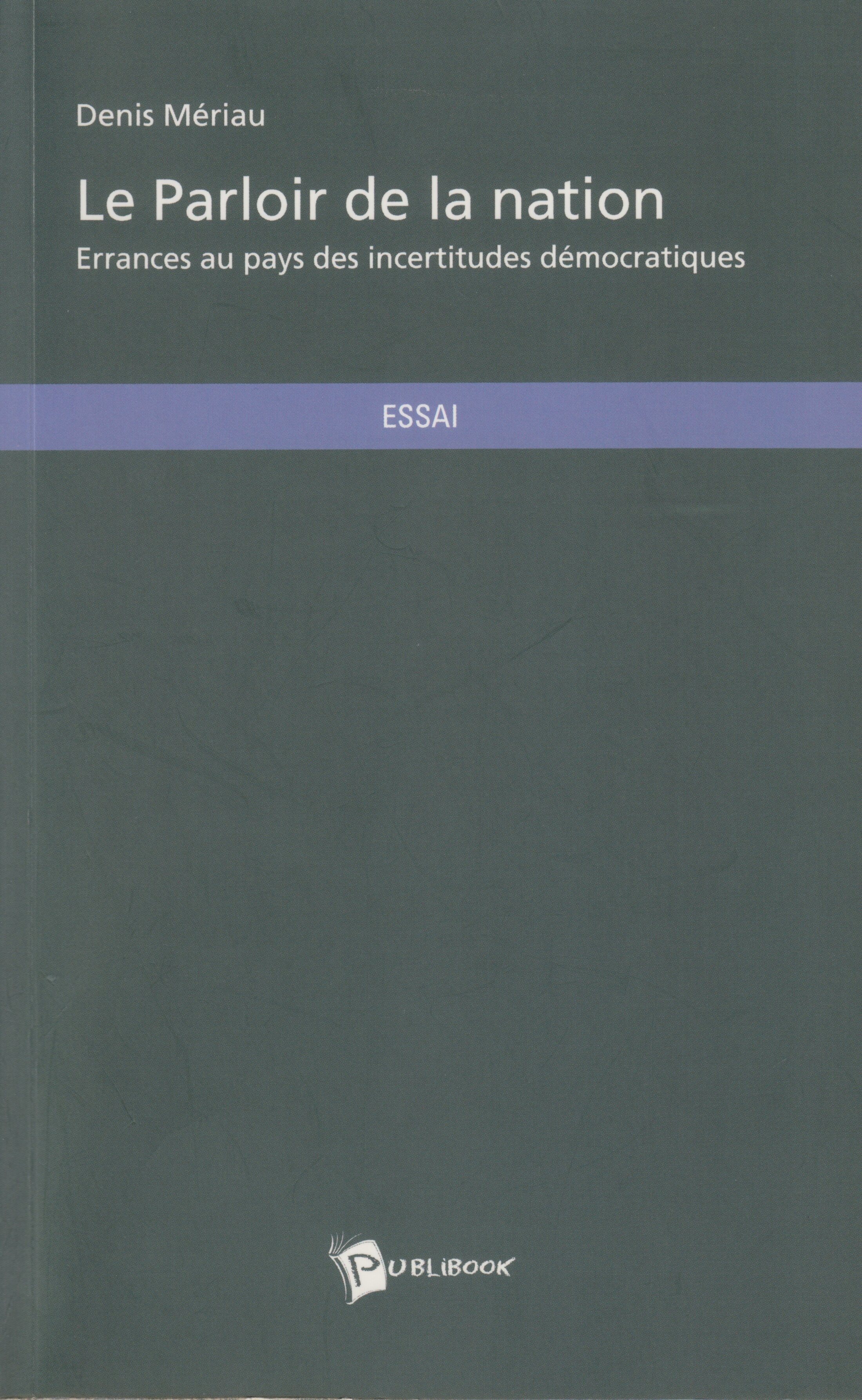
LE PARLOIR DE LA NATION est une réflexion sur la démocratie à partir du texte même des débats de l'Assemblée nationale (2002-2003).
Comment se procurer le livre ?
Plusieurs versions numériques du PARLOIR DE LA NATION sont disponibles ( au prix de 9,99 euros ) sur chapitre.com / fnac.com / leslibraires.fr
*version PDF (pour lire sur un ordinateur ou une tablette)
+ fichier EPUB ( pour lire sur une liseuse )
+ streaming ( pour lire directement sur un site sans avoir besoin de télécharger).
Il est également possible de commander un exemplaire papier ( au prix de 19,95 euros ) sur les mêmes sites ou directement chez l’éditeur : https://www.publibook.com/le-parloir-de-la-nation.html/
Jean-Pierre Bernajuzan
à suivre...



