C’est fait ! Evo Morales peut à nouveau poser sa candidature aux élections présidentielles de 2019. Le Tribunal constitutionnel lui en a donné le droit le 28 novembre. Et un nouveau corps de hauts magistrats a été élu dimanche dernier, 3 décembre.
L’appareil judiciaire est quasiment transformé en annexe du pouvoir exécutif. Sur les 26 magistrats titulaires élus[1] du Tribunal supremo de justicia et du Tribunal Constitucional, quinze ont déjà exercé une fonction dans le gouvernement d’Evo Morales : deux anciens vice-ministres et des chefs de cabinet ou d’unités ministérielles ; des postes occupés par des personnes de confiance du président et de son entourage immédiat[2]. Tandis que sur ce total, onze seulement ont appartenu précédemment au système judiciaire.
C’est une démonstration de force par laquelle le pouvoir exécutif a montré qu’il pouvait faire ce que bon lui chante dans les années à venir. Aucune institution nationale n’est en mesure de freiner ses décisions.
Quelques mots sur les élections. Plus de 6,4 millions de boliviens ont été appelés à voter pour élire les magistrats des principales instances judiciaires du pays. Seuls des magistrats sélectionnés par le parlement national contrôlé par le MAS ont obtenu le droit de se présenter au scrutin national pour occuper les charges des tribunaux suivants : Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental et Consejo de la Magistratura. Les électeurs n’avaient d’autre choix que de voter pour eux, voter nul ou blanc, ou s’abstenir. Et par conséquent, ces élections ont pris l’allure d’un plébiscite.
Selon les déclarations de la présidente du Tribunal suprême électoral (TSE), Katia Uriona, au lendemain du vote, 78% des électeurs ont voté, soit un peu moins qu’en 2011 où ils représentaient 79,7% de l’électorat. Autrement dit, 22% se sont abstenus dans un pays où le vote est obligatoire[3]. Selon les résultats (provisoires) divulgués lundi matin, 66% des électeurs (en moyenne, puisque les modes électoraux étaient différents selon les tribunaux) ont voté nul ou blanc, et 34% des votes sont valides. Le pourcentage des bulletins nuls est supérieur de 10% à celui des précédentes élections judiciaires de 2011, et il a même augmenté dans les zones rurales éloignées des centres urbains[4]. Dans les départements de Santa Cruz et de La Paz, il approche 60%.
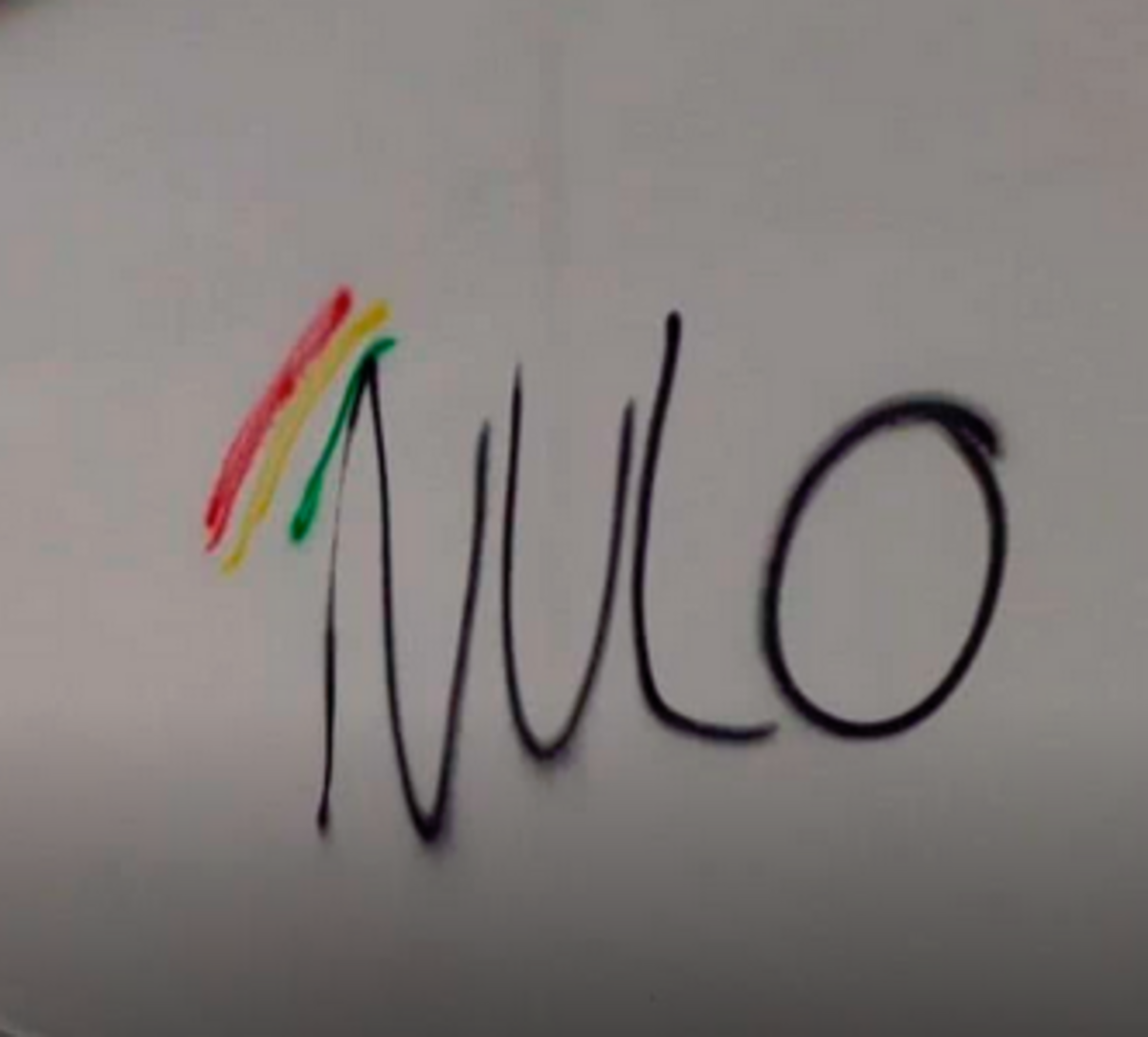
Et maintenant ? Quel va être le cours des évènements? Morales sait très bien qu’il a perdu du terrain et qu’une réélection dans les conditions d’une compétition régulière serait loin d’être assurée. Tant les sondages que le vote de dimanche et les manifestations de rue des opposants à cette parodie d’élection le montre. Comme le dit Carlos Valverde[5], il peut donc repousser la date de la prochaine échéance, ou changer les règles du scrutin, ou même en finir avec le système démocratique actuel qui reconnait l’existence de la majorité et de minorités , pour le remplacer par « une démocratie communale» où les décisions seraient prises par consensus, et donc sans tenir compte des minorités, comme il semblait en rêver dans un discours récent[6]. Il suffit que le parlement rédige la loi et l’adopte, puis que le Tribunal constitutionnel l’avalise. « Cela peut paraître fou. Mais il n’est pas stupide d’en faire l’hypothèse »[7].
Humberto Vacaflor avance, quant à lui, un autre scénario: transformer le parlement en Assemblée constituante afin de gagner du temps pour mettre en place les réformes qu’il souhaite, et de la sorte continuer à diriger le pays; une solution recommandée par ses conseillers cubains, déjà mise en oeuvre au Venezuela avec succès[8].
Quoiqu’il en soit, il est maintenant certain qu’Evo Morales et les siens utiliseront tous les pouvoirs, toutes les ruses ou artifices, et la force s’il le faut, pour se maintenir à la tête de la Bolivie le plus longtemps possible.
*
Ces deux coups portés à la démocratie bolivienne ont suscité l’indignation de nombreux commentateurs. J’ai choisi de traduire la chronique de Francesco Zaratti, un physicien, professeur d’université et essayiste, qui publie ses chroniques dans le quotidien Página Siete[9]. Mais il est évident que j’aurais pu (et dû) en traduire d’autres. Je recommande celle de l’ancien président Carlos D. Mesa Gisbert, Camino al totalitarismo, publiée le 3 décembre[10]. Et dans un autre genre, celle de Carlos Hugo Molina, publiée hier : Las elecciones más largas de la historia[11].
Le livre de l'infamie
Le mot « fama » (réputation) vient étymologiquement de « dire ». Ainsi est « réputé » (famoso) quelqu’un dont « on parle », généralement en bien. L’homme réputé est bon, honorable — toutes vertus dont l’enfant hérite de ses père et mère.
Cependant, le monde moderne tend à valoriser la notoriété (fama) sous une forme bien différente de celle du passé. Comme le suggèrent certaines paraboles de Jésus, la (bonne) réputation était jadis recherchée, et la diffamation était considérée comme un délit. L’infamie, ou perte de la réputation, entraînait la honte pour toute la famille. Aujourd’hui, il y aurait moins de délits si on accordait plus d'importance aux répercussions que l’infamie entraîne dans l’entourage familial de ceux qui s'abandonnent aux circuits de la corruption et du narcotrafic.
José Luis Borges a écrit une Histoire universelle de l’infamie à laquelle il manque un chapitre sur la Bolivie où figureraient tous ceux qui méritent bien d’être qualifiés d'infâmes. Historiquement, la justice en Bolivie a eu beaucoup à voir avec l’infamie. Comme Gonzalo Mendieta l’a rappelé la semaine dernière dans ces colonnes, le processus aboutissant à l'élection des magistrats s’est déroulé sous le signe de l’infamie depuis ses origines [1].
Infâme fut l’attitude des consultants espagnols, issus de la bande populiste de Podemos, qui sont venus expérimenter, comme aux jours les plus obscurs du colonialisme, un système d’élection des magistrats qui n’existe nulle part au monde. En Équateur, ça n’a pas marché, mais ici, hélas oui, grâce à la collaboration de « felipillos »[2] locaux, […], et le soutien de valets de l’Assemblée législative qui, sans se soucier des conséquences, ont diligemment appliqué la recette de ces consultants bien payés. Et comme une fois ne suffisait pas, ils ont recommencé cette année à manipuler une opération condamnée à l’échec […].
D'une telle infamie ne pouvait surgir que des magistrats sans honneur, qui n'ont guère tardé à montrer leur « savoir-faire professionnel » en instruisant des procès bâclés et en devenant eux-mêmes l’objet d’une cinquantaine de poursuites judiciaires. Le comble a été atteint par une sentence qu’ils ont récemment prononcée[4], fondée sur « le droit humain préférentiel », une sentence si absurde selon la jurisprudence internationale, qu’on se demande comment on a pu arriver à une telle aberration de la logique, des mœurs et de la justice, y compris dans le contexte ignominieux que je viens de décrire.
Dans ce cas, l'infamie vient de ce qu’ils blessent à mort la démocratie bolivienne dont le rétablissement, c’est certain, ne leur a rien coûté. Mais ce n'est pas le cas de millions de Boliviens qui ont dû l'arracher à des militaires qui, aujourd’hui, peu soucieux de leur honneur, se félicitent de bénéficier, entre autres jouets, d'un immeuble volé à l’Empire et de décrets d’exception qui leur permettront de dépenser sans contrôle en dépit des dénonciations pour corruption dont ils sont l'objet.
Mais ils ne sont pas les seuls. Le passage de la ligne rouge entre démocratie et dictature devrait poser problème à l’élite (gente decente ) qui a été séduite par les masques populistes du régime. D’anciens recteurs et professeurs d’université ont jeté l’infamie sur les collaborateurs de ceux-là même qui ont rogné l’autonomie. Ils doivent maintenant choisir : être conséquents avec leurs principes, comme beaucoup de ceux qui ont pris leurs distances à temps, ou bien entrer dans la liste des infâmes.
Pour finir, reconnaissons que l’honneur, la parole donnée et le souci de la postérité ne suscitent guère le respect aujourd’hui. Alors, que faire avec les infâmes. ? Il faut les inscrire dans le livre national de l’infamie pour perpétuer leur mémoire, suivre ce que deviennent leurs « 30 deniers de Judas »[5], et maintenir très haut un rejet social tel que même les lunettes les plus obscures n’arriveront à l’occulter.
Samedi 2 décembre 2017
Francesco Zaratti. Twitter: @fzaratti
[1] http://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-mendieta-romero/2017/11/25/peregrina-idea-elegir-magistrados-160753.html . Cet article montre que l’idée d’élire les magistrats provient de membres de la fondation espagnole Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) ayant joué le rôle d’experts pour la rédaction de la Constitution, en 2007 et 2008. Ce groupe, qui a donné naissance au parti Podemos, a aussi conseillé l’Assemblée constituante vénézuelienne. « Dans des documents publiés par la Vice Présidence, et dans d’autres non destinés à être diffusés en Bolivie, ces assesseurs argumentent l’idée qu’il faut séparer démocratie et libéralisme. Ils cherchent à modifier la démocratie en refoulant les peurs libérales relatives à la concentration des pouvoirs… et ils opposent la démocratie radicale de Rousseau au scepticisme de Montesquieu (qui l’amène à séparer les pouvoirs publics afin de les limiter), écrit Gonzalo Mendieta. L’information est détaillée dans un autre article : Raúl Peñaranda U, « Elección de jueces, una idea que llegó de España ». https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/eleccion-de-jueces-una-idea-que-llego-de-espana-384028
[2] Traducteur qui accompagnait Pizarre lors de sa rencontre avec Atahualpa, appartenant à une tribu rivale de ce dernier, devenu l’archétype du traître de petite envergure.
[3] Bandelette de laine blanche que portaient les prêtres dans l’antiquité romaine.
[4] Résolution du Tribunal constitutionnel du 28 novembre dernier habilitant Evo Morales pour les élections de 2019. Les magistrats ont argumenté leur sentence en soutenant que les "droits polítiques" reconnus par la Bolivie dans la Convention américaine sur les droits de l’homme doivent prendre le pas sur la Constitution, et que c’est un droit de l’homme d’être indéfiniment candidat.
[5]Judas est passé dans l’Histoire pour avoir livré Jésus contre monnaies sonnantes et trébuchantes.
*
[1] Auxquels il faut ajouter les 26 suppléants.
[2] http://www.paginasiete.bo/especial01/2017/12/5/tribunos-electos-trabajaron-gobierno-exviceministros-161987.html
[3] Ne pas voter expose à une amende de 500 bolivianos et à des restrictions temporaires concernant les démarches bancaires, l’obtention d’un passeport et l’accès à des charges publiques. On peut éviter ces sanctions en justifiant les raisons de l’absence. Mais étant donné les dysfonctionnements de l’administration, cette formalité peut être coûteuse en temps et en argent.
[4] http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/03122017/los_votos_nulos_se_imponen_en_unas_elecciones_marcadas_por_la_burla
[5] http://eju.tv/2017/12/herida-de-muerte/
[6] Le 9 novembre dernier dans la ville de Potosi. http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_11/nt171110/politica.php?n=69
[7] http://eju.tv/2017/12/herida-de-muerte/
[8] http://eju.tv/2017/12/el-plan-c/
[9] https://zaratti.wordpress.com/about/
[10] http://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20171203/columna/camino-al-totalitarismo
[11] http://www.eldeber.com.bo/opinion/Las-elecciones-mas-largas-de-la-historia-20171204-0106.html



