De nombreux commentateurs constatent que le régime bolivien s’achemine vers la dictature – ou qu’il vient d’y entrer. Ils en veulent pour preuve la sentence du tribunal Constitutionnel qui lève la barrière limitant le mandat présidentiel à deux exercices consécutifs (28 novembre 2017), l’élection truquée des hauts magistrats qui fait de la justice un appendice du pouvoir exécutif (3 décembre 2017), ou encore la réforme du Code pénal (15 décembre 2017) – aujourd’hui différée[1] – qu’ils interprètent comme un moyen de contrôler plus étroitement la société civile en durcissant les peines, en instillant la peur, et en inventant de nouveaux délits[2], alors même que l’appareil judiciaire est de l’aveu même des gouvernants, inepte et profondément corrompu.
Cependant, douze années ont passé depuis l’élection triomphale d’Evo Morales. Douze années pendant lesquelles le nouveau régime s’est appliqué sans relâche à concentrer les pouvoirs, à éliminer ses adversaires politiques, à détricoter les outils de contrôle du budget et du respect des lois, à adopter des mesures ou entreprendre des actions restreignant les libertés (des media, des ONG, des syndicats, des organisations d’indigènes …). Douze années pendant lesquelles le président, en campagne électorale permanente, n’a cessé de répartir, ici et là, de manière discrétionnaire, des cadeaux (tracteurs, ambulances, moteurs de bateaux hors-bord, matériels scolaires…), et des chèques pour construire des stades à pelouse synthétique, des frontons de pelote basque, des salles polyvalentes pompeusement baptisées colisées et, beaucoup plus parcimonieusement, des écoles et des centres de santé…qu’il n’a jamais manqué d’aller inaugurer pour entretenir ses clientèles ; des clientèles encadrées par les prétendus « mouvements sociaux » qui sont en fait des organisations corporatistes, dont les leaders ont été grassement récompensés par des postes et des prébendes, et les produits de la corruption qu’il leur a ainsi été donné de pratiquer. Pendant ce temps, il a traité avec le plus profond mépris les populations les plus démunies qui osaient revendiquer des droits ou des subsides : indigènes des Basses Terres, handicapés, victimes des inondations… et même les plus pauvres du monde indigène des hautes Terres, ceux de Potosi[3] – « le fondement de la Patrie (la fuente) » selon le vice-président –[4], réclamant à juste titre des équipements et des attentions.
La vulgate qui veut qu’Evo Morales ait trompé son monde, et que la situation quasi dictatoriale dans laquelle se trouve le pays est une dérive ne tient donc pas. Le ver est dans le fruit depuis longtemps. Depuis le début. Et ce qui advient était prévisible. Même si, évidemment, il était impossible de deviner le cours des évènements.
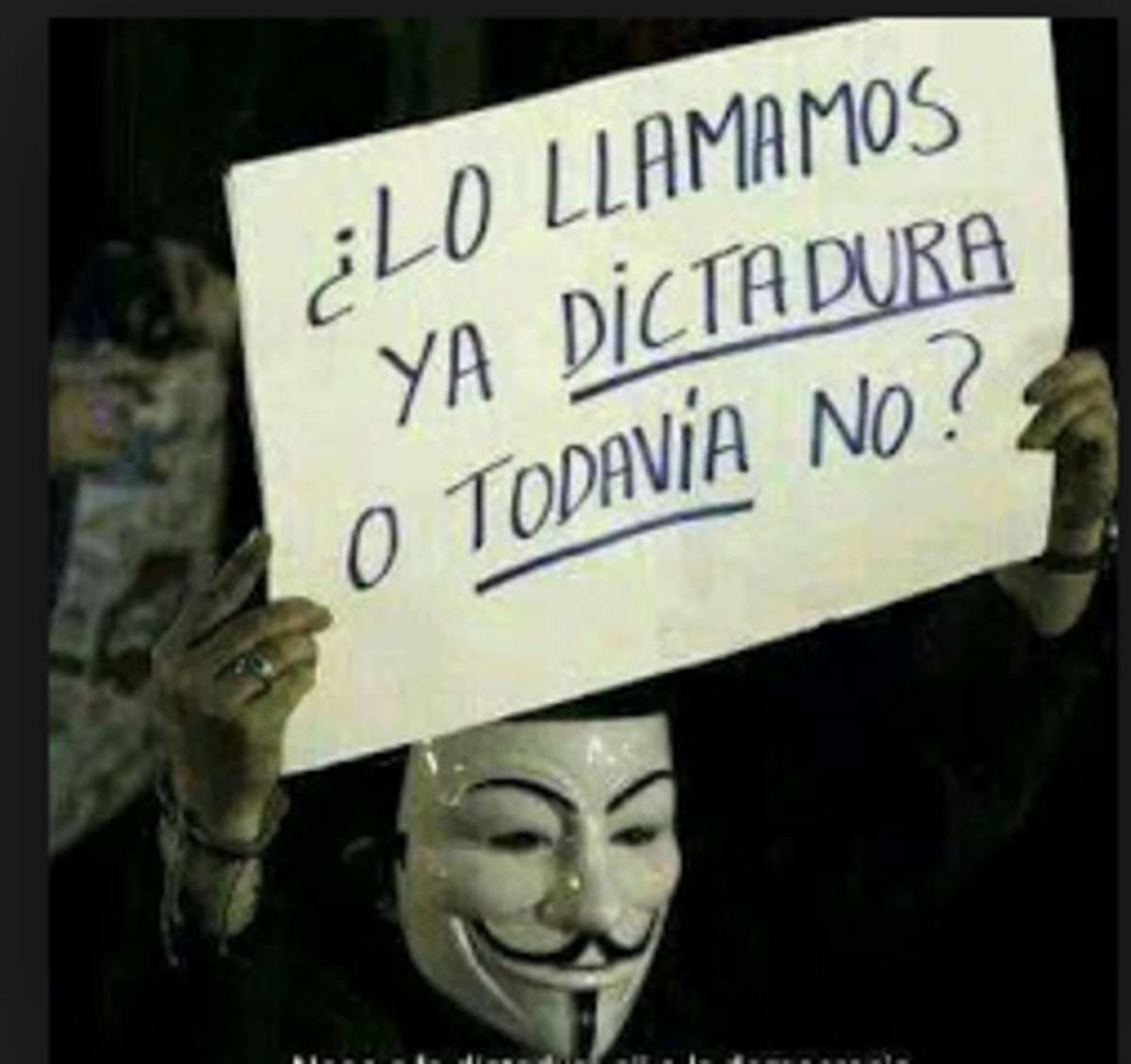
Les prémisses
On peut au moins appuyer ce jugement sur trois constats : la conception de la vie politique diffusée par les idéologues du nouveau pouvoir ; les alliances qu’il a nouées dès avant son élection avec les régimes cubain et vénézuélien, et le fonctionnement du mouvement syndical cocalero que Morales a dominé depuis 1996.
Entre la révolution de 1952 et les années 1980, la vie politique bolivienne a été très marquée par le populisme centraliste et clientéliste du Mouvement nationaliste révolutionnaire (MNR), puis des régimes militaires; et cette manière de faire de la politique n’a pas disparue par la suite. Dans ce cadre général, les partis politiques (quelle que soit l’orientation idéologique qu’ils affichent) ont un impératif besoin de faire partie de l'appareil gouvernemental. Leur survie en dépend. En effet, les troupes ne suivent que si elles trouvent leur compte en emplois et en facilités diverses. Sinon, vue la porosité des systèmes partisans, elles vont grossir les rangs des partis dont les leaders accèdent au pouvoir.
De plus, la gauche bolivienne n’a jamais manifesté d’intérêt, et a fortiori de goût, pour la démocratie représentative (qualifiée de libérale ou néo libérale), ni dans son discours ni dans ses pratiques. Son approche est demeurée très économiste. Centrée sur le combat pour l’égalité des conditions, elle a continué, selon un schéma marxiste, de faire de la politique une conséquence des conditions de la production et de la répartition des richesses. Pour l’actuel vice-président, idéologue du courant Comuna et inspirateur du chef de l’État, L’ennemi, c’est le libéralisme ou le néolibéralisme porté par l’Empire (les États Unis). Il est conçu et fustigé comme un tout économico-politique : « un modèle ». Le vaincre et en sortir suffit à réaliser la démocratie ; il peut même y avoir des gouvernements démocratiques sans élections[5]. Or on sait que le combat pour l’égalisation des conditions ne va pas de soi – l’histoire l’a abondamment prouvé. Pour les révolutionnaires, et ceux qui les suivent, il implique l’usage de la violence qu’une partie des membres du Movimiento al socialismo (MAS) n’écarte pas, voire même préconise.
Dans un écrit attribué (faussement ?) au vice-président García Linera qui a circulé à la fin de l’année 2006, il était question de « priver le Blanc (q'ara)[6] de son capital économique, social, culturel et politique…de l’appauvrir, de rompre ses relations sociales et les mécanismes de son ascension et de sa reproduction sociale », de « dévaloriser sa formation académique, ses mérites et ses modes de reconnaissance car « nier l’utilité de ses services, de ses connaissances et de ses expériences est la meilleure façon de tuer son âme »[7].
Dans les discours de cette « gauche » on peut aussi observer une fascination pour le moment même du combat, de l’insurrection. La démocratie procédurière fixerait ou figerait les inégalités, tandis que la contestation figurerait la démocratie en actes. Le mouvement révolutionnaire doit donc durer.
Enfin, le sujet de l’histoire serait la « plèbe » ou la « multitude », à laquelle le pouvoir doit revenir directement, sans intermédiaires ou délégation car l’élection n’est qu’une sélection périodique d’élites. Ce qui est évidemment rigoureusement impossible sans le tour de passe-passe qui consiste à faire croire que le caudillo incarne la masse en question.
Au fond, ce galimatias – car ces idées sont à extraire d’un discours le plus souvent amphigourique –, n’est guère qu’une muleta visant à provoquer le taureau de la multitude. Et moyennant que la plèbe secoue les élites et provoque l’euphorie d’une grande excitation collective, peu importe ce qui suivra et qui, en réalité, ne peut être qu’une dictature – plus ou moins prolongée –, quel que soit le gagnant de la bataille.
Le système d’alliance internationale d’Evo Morales était tout aussi prédictif de son comportement. Il faut une grande cécité pour ne pas comprendre que le régime cubain est dictatorial et que la population de l’île est prisonnière. Et il ne fallait pas être grand clerc pour saisir que le régime d'Hugo Chávez lui emboîtait le pas : les nationalisations abusives, les brutalités à l’égard des opposants, la corruption, et l’insécurité du pays, sans compter ses accointances avec le trafic de la drogue étaient déjà connues. On ne pouvait donc pas s‘attendre à ce que la gauche bolivienne, dont le MAS avait réussi à fédérer les débris, tienne les promesses d’un avenir meilleur pour la population (aucun des régimes du communisme réel ne les a jamais tenues), et encore moins à ce qu’il respecte les règles de la démocratie.
Juste avant le sommet de l’Organisation des États Américains (OEA) de Mar del Plata, au début du mois de novembre 2005, Evo Morales avait tenu un meeting avec Hugo Chávez fustigeant les États Unis et la globalisation devant une affiche gigantesque de Che Guevara, un homme dont la brutalité guerrière et répressive contraste avec la figure christique qu’il est devenu[8]. À peine élu, il s’était rendu à Cuba où Fidel Castro lui avait offert une aide en matière de santé, d’éducation et de sport. Puis il s’était envolé pour Caracas où il avait passé un accord avec Hugo Chávez concernant un échange de carburant diesel contre des produits agricoles. À la veille de sa prise de fonctions, le 21 janvier 2006, ce sont les services de sécurité vénézuéliens qui ont passé le palais présidentiel et la résidence du chef de l’État au peigne fin pour y détecter d’éventuels pièges ou mouchards. Quelques jours auparavant, il avait effectué une vaste tournée internationale entièrement financée par le Venezuela : avion vénézuélien, protocole et sécurité vénézuélienne. Et le nouveau chef de l’État n’était pas encore installé qu’Hugo Chávez annonçait déjà un complot contre lui, ourdi par les États Unis qui, comme tous ceux qu’Evo Morales a révélés par la suite, s’est avéré inexistant[9] ; cette mise en scène n’étant qu’une technique mobilisatrice dont l’un et l’autre caudillo ont usé et abusé[10].
Puis les assistants cubains n’ont pas tardé à débarquer pour « décoloniser » l’éducation en mettant en œuvre un vaste plan d’alphabétisation[11], et pour secourir les victimes des inondations, tandis qu’une fournée d’apprentis médecins boliviens obtenait des bourses pour se former à Cuba.
Mais c’est surtout le fonctionnement du mouvement cocalero qui permettait d’anticiper un futur autoritaire. Car c’est là qu’Evo Morales trouve ses appuis les plus déterminés, et c’est là qu’il a été formé à l’exercice des responsabilités syndicales et politiques.
Le syndicalisme cocalero s’inscrit dans la mouvance du syndicalisme paysan, généralisé à partir de1953, car la loi de Réforme agraire faisait obligation à ses bénéficiaires de s’organiser en syndicats pour entreprendre les démarches nécessaires à l’obtention de leurs titres de propriété. Le syndicat des cultivateurs de coca fonctionne, lui aussi, sur le modèle du closed shop : il est impossible d’exploiter son champ de coca si l’on n’adhère pas au syndicat[12]. Il se mêle de tout, non seulement des affaires collectives (chemins, viabilisation, éducation, santé, sport…), mais aussi des conflits familiaux et intimes. Les décisions sont entérinées dans les assemblées qui élisent aussi les dirigeants.
Ces assemblées sont souvent présentées comme des lieux de démocratie participative, ethnique, ou directe. C’est oublier un peu vite que l’organisation syndicale est pyramidale et que les syndicats de base sont coiffés par des centrales et des fédérations. Et lorsqu’on se penche sur le fonctionnement des assemblées on perçoit rapidement que la parole y est très inégalement répartie (ce qui n’est guère étonnant), que les dirigeants manipulent l’ordre du jour à leur convenance (ce qui n’est guère étonnant non plus), que les interventions critiques à l’égard des positions des leaders sont rares, que les votes se font à main levée et surtout qu’une grande partie des réunions est consacrée à détailler les prises de position et les directives qui proviennent des échelons supérieurs. Dans un tel dispositif les écarts se payent cher[13] ; ils peuvent aller jusqu’au bannissement. Le coup de maître d’Evo Morales a été de s’installer durablement (jusqu’à aujourd’hui) à la tête d’une coordination englobant l’ensemble de la structure syndicale cocalera de la région du Chaparé (département de Cochabamba) – dont 95% de la coca produite va au trafic de cocaïne.
Ce type de fonctionnement n’a donc rien de démocratique et le rêve d’Evo Morales, encore exprimé récemment, a toujours été de se passer de « la démocratie occidentale de majorités et minorités », et de la remplacer par un système de fonctionnement communautaire : « Je viens du mouvement indigène originaire et j’ai vu comment on prenait les décisions dans les réunions, les assemblées de l’ayllu[14], de la communauté ; il n’y avait pas de vote parce que le vote met en évidence des majorités et des minorités »[15]. Il ne s’en cache pas et ne s’en est jamais caché.
Dans un de ses premiers discours[16], en février 2006, il a prévenu qu’il attendait de l’Assemblée constituante qu’elle l’autorise à gouverner à sa guise : « parce que parfois je me sens prisonnier des lois néolibérales ; je veux faire quelque chose et ils me disent que c’est illégal de le faire par un décret ; je veux entreprendre autre chose et ils me disent que c’est anticonstitutionnel parce que tout ce que pense le peuple est anticonstitutionnel, et donc je veux dire que je me sens prisonnier des lois boliviennes».
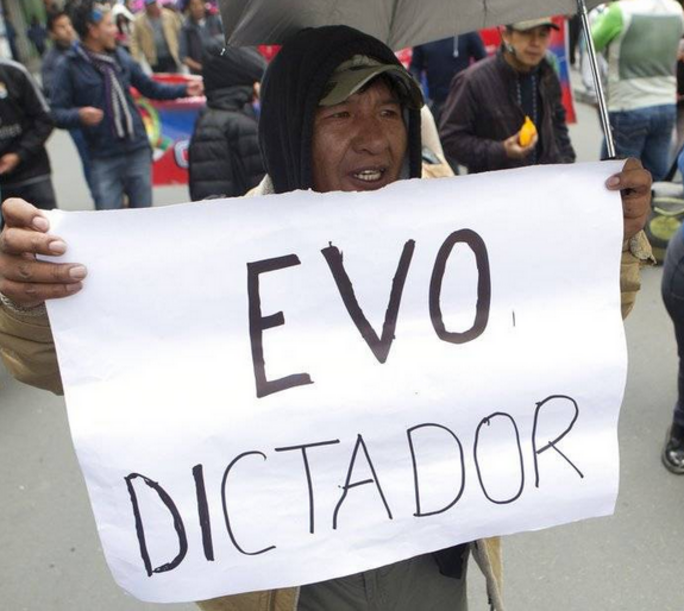
Les agissements
Et il s’est effectivement rapidement affranchi des lois, comme il l’a revendiqué le 29 juillet 2008 dans une formule devenue célèbre : « Quand un juriste me dit Evo tu te trompes, ce que tu fais est illégal, je fonce, même si c’est illégal. Ensuite je dis à mes avocats : si c’est illégal faites le nécessaire pour que cela devienne légal ; vous avez étudié pour ça »[17].
Les premières mesures du gouvernement avaient de quoi alerter les observateurs, mais très rares sont ceux qui, dans les rangs de la gauche, s’en sont inquiétés. Cela a commencé par la mise à pied de 28 généraux et le saut de trois promotions pour nommer le nouveau commandement militaire. Puis les présidents des principales institutions démocratiques indépendantes ont été forcés à la démission : Cour suprême de justice, Conseil constitutionnel, Cour nationale électorale. Ce fut chose faite dès la fin mars 2006, et il fut fait pression sur les membres restants de ces instances pour qu’ils démissionnent à leur tour, ce qui ne tarda pas. Ce travail de sape est allé bien au-delà du spoil system classique : toutes les instances démocratiques mises en place depuis 1982 (l’année où l’armée abandonne le pouvoir) ont été systématiquement minées et leurs responsables discrédités, diffamés, et menacés.
Des procès infâmes ont été montés de toute pièce contre des personnes honorables comme Juan Antonio Morales[18], président de la Banque centrale de 1995 à 2006, ou l’ingénieur José María Bakovic, président du Servicio Nacional de Caminos (SNC) (qui en est mort[19]). Une série d’atteintes aux principes démocratiques et au droit des personnes a suivi : les conditions grotesques et violentes de l’accouchement de la nouvelle Constitution (2007-2008), le siège et l’incendie de la Préfecture de Cochabamba par les cocaleros pour en chasser le préfet (2007), l’occupation militaire du Pando après la provocation meurtrière de Porvenir, et l’emprisonnement de son préfet Leopoldo Fernández (2008), l’encerclement de la ville de Santa Cruz par des organisations paysannes armées (2008)[20], l’ assassinat de supposés terroristes et séparatistes dans l’hôtel Las Americas de Santa Cruz (2009), les charges meurtrières de la police à Caranavi (La Paz) (2010)… Et j’en omets beaucoup. Toujours est-il qu’au bout de quatre années, le gouvernement avait assiégé des villes, envoyé des troupes paysannes tuer et se faire tuer, militarisé des départements, changé la structure juridique du pays pour pénaliser les opposants, promulgué des lois contraires à la Constitution … Or nombreux sont ceux qui ont accepté ces manières de gouverner abusives, discrétionnaires et violentes. Au nom de quoi ont-ils pensé qu’il fallait laisser faire ou soutenir de telles pratiques ?
Et comment ne pas voir la rapide installation du culte de la personnalité d’un caudillo mis dans la position de décider du sort de tout son entourage ; un entourage qui multiplie les courbettes et qui vit dans la crainte, car pour lui « tous sont des traîtres potentiels, des corrompus, des vendus à l’ennemi », a écrit Fernando Molina.[21] Tout cela est évidemment contraire à la démocratie représentative qui permet un accès temporaire et régulé aux fonctions d’autorité. Mais peu importe si on fait partie de la cour du jefazo[22], ou même si, d’une manière ou d’une autre, on s’identifie à lui.
Certains semblent aujourd’hui surpris de constater que Morales ment, ne tient pas ses promesses et s’entoure de collaborateurs intolérants et violents mais, pour les journalistes d’un certain âge comme Maggy Talavera, qui ont suivi de près sa carrière, ils ne devraient pas l’être parce que « le leadership du dirigeant cocalero Evo Morales est le résultat de beaucoup de violence »[23].
Les avertissements n’ont pourtant pas manqué. Mais comme le dit Claudio Ferrufino, « en 2006 la critique n’était ni bienvenue, ni écoutée… » « nous étions peu nombreux et je crois que nous le sommes encore ». Ceux qui ont publié leurs observations et leurs jugements ont été traités de « fachos », de « réactionnaires » et enduré d’autres épithètes du même tabac. Ils ont passé ces douze années « à se casser la tête contre un mur et à supporter les insultes et les verbiages vaniteux de tartuffes... »[24].
Et contrairement aux affirmations de la propagande gouvernementale, toutes les critiques des décisions et des manières du gouvernement ne provenaient pas des rangs de la droite et de la réaction, ou bien de l’oligarchie complice des impérialistes yankees. Alfonso Gumucio Dagron (plutôt bien disposé à l’égard du régime cubain) écrivait en juin 2006 : « Il est triste qu’un processus de transformation comme celui qu’ambitionne la Bolivie soit terni par les attitudes autoritaires de ceux qui abusent du pouvoir. La persécution politique que pratique le gouvernement du MAS n’est pas justifiable … »[25], et trois mois plus tard : « L’autoritarisme est un des traits les plus surprenant d’Evo Morales …il se manifeste tous les jours en tous lieux … Il dirigeait peut-être ainsi les syndicats des cocaleros du Chaparé, mais si ces derniers supportaient un pouvoir aussi vertical et rétif au dialogue, il n’y a aucune raison pour que le reste des boliviens l’accepte »[26]. Alors vraiment, je le répète, il n’y aucune dérive dans la manière de gouverner du clan Morales, aucun durcissement véritable. Et si certaines orientations ou certaines politiques ont varié au gré des circonstances, parce qu’il fallait apprivoiser tel ou tel secteur organisé, ou au contraire le mater, le cap a toujours été le même : jouir du pouvoir, le conserver à tout prix, et pour cela faire taire toute forme d’opposition.
*
Ce qui a changé c’est que, peu à peu, les yeux des boliviens se sont dessillés et que fleurissent maintenant des associations qui se donnent pour but explicite la défense (ou l’instauration) de la démocratie.
[1] La loi a été abrogée le 26 janvier 2018 à la suite d’une vague de protestations.
[2]Ce texte de loi généralise à la société civile la persécution par voie judiciaire qui a permis de décimer l’opposition politique ces douze dernières années. Exemple d’articles dont la rédaction est suffisamment vague pour persécuter tous les gêneurs : « la personne qui se soulève publiquement en faisant preuve d’une franche hostilité pour s’opposer à l’accomplissement des lois et des décrets (…) et qui perturbe ou trouble l’ordre public, sera sanctionnée par un à trois ans de prison et devra accomplir un travail d’utilité publique » (article 293)[2]. Selon l’article 294, intitulé “Atribuirse los derechos del pueblo”, « les groupes de personnes qui s’attribuent les droits du peuple et prétendent les exercer en leur nom », seront punies de deux à quatre ans de prison. Et il omet certains délits comme le trafic d’animaux, ou la bigamie.
[3] En août 2010 et en 2014 (grève de trois semaines et marche vers La Paz).
[4] García Linera, La Razón, 11 juin 2010.
[5] Pluriverso-Teoria politica boliviana, La Paz, Comuna/Muela del diablo editores ? 2001, p.103.
[6] Littéralement pelé, ou nu en langue aymara.
[7] Le texte est intitulé: Emancipación y Contrahegemonía en Bolivia, Estrategias Para Destruir la Dominación kh´ara. http://eju.tv/2010/09/estrategias-para-destruir-la-dominacin-khara-en-bolivia/
Garcia Linera nie en être l’auteur et l’attribue à un “mal alumno que lo habría tergiversado en clases” Divers articles de Susana Seleme Antelo ont contribué à le faire connaître et à accréditer l’idée que les politiques du gouvernement poursuivaient effectivement cet objectif. Voici le dernier en date :
https://www.eldia.com.bo/index.php?c=OPINION&articulo=Las-entranas-del-poder&cat=162&pla=3&id_articulo=243716
Voir aussi trois articles de la même chroniqueuse intitulés, Me han dicho.I II,III parus en 2010. http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=29964
[8] Voir : Che's Second Coming? By David Rieffnov. 20novembre 2005 http://www.nytimes.com/2005/11/20/magazine/ches-second-coming.html
http://www.letraslibres.com/mexico-espana/la-venganza-del-che Sur la réalité des conduites du Che voir : https://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-nord/la-face-cachee-du-che_475196.html
[9] Los Tiempos, 11 janvier 2006.
[10] Selon le quotidien La Razón du 12 octobre 2006, en huit mois et demi de mandat, il y a eu au moins huit avis de cette sorte.
[11] Une vaste fumisterie qui a duré quelques mois, les cubains n’ayant aucune maîtrise des langues vernaculaires, mais qui a bien servi la propagande du gouvernement.
[12] Une grande quantité des dirigeants populaires actuels sont produits par le système syndical bolivien et se singularisent par un mélange de maximalisme rhétorique et d’égoïsme sectoriel. C’est à ce groupe qu’appartient Evo Morales. Si bien que l’écrivain Ruber Carvalho qualifie la Bolivie de "pays- syndicat". «El partido que lo gobierna (una especie de tribu cocalera) se fundó, precisamente, como una vanguardia del movimiento cocalero del Chapare, al decir entonces de su propio caudillo… «Las bases piden y yo obedezco », es la consigna hipócrita, pilatuna y mentirosa, como si el rebaño tuviera iniciativa propia. En Bolivia esas bases se llaman movimientos sociales, que no son otra cosa que simples retazos sindicales del gobierno; sindicatos de ningún rubro, sino simple montoneras dispuestas a "marchar" sobre sus objetivos, para bloquear, guasquear e incendiar. » Revista Cash, 12 juillet 2007.
[13] Une série de sanctions sont prévues. La présence aux assemblées est obligatoire et l’absence est punie par une amende, même le retard donne lieu à une amende.
[14] Communauté en langue Quechua et Aymara.
[15] https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Morales-defiende-la-democracia-comunal-y-el-modelo-del-ayllu-20171110-0009.html
[16] Pulso, 17 février 2006 et Fernando Molina, Buscando el porvenir en el pasado,radiografia de la ideologia del gobierno, La Paz, Eureka ediciones, 2007, p.144.
[17] http://correodelsur.com/panorama/20151025_evo-cumple-mandato-mas-largo--y-mas-anecdotico-por-evadas.html
[18] Il était accusé d’avoir soustrait 100 millions de dollars de la Banque centrale sur la base d’un montage vidéo grossier. Il fut brièvement détenu en 2011 et relâché après des protestations nationales et internationales.
[19] Élu à son poste en 2001 par un vote du Congrès acquis à plus de 90% pour lutter contre la corruption. Ce combat lui a valu beaucoup d’ennemis. Il a été accablé par 76 procès entre 2006 et 2012. À 75 ans, malade, il a été jeté en prison (de 2010 à 2012).
[20] Selon une étude de la fondation Unir, l’année 2008 fut particulièrement agitée avec 68 confrontations entre juillet et décembre, dont quatre de portée nationale http://www.eldeber.com.bo/septimodia/Desgaste-y-division--las-formulas-del-Gobierno-frente-a-los-conflictos-20180106-0038.html
[21]Fernando Molina op.cit., p.117.
[22] Titre du livre hagiographique de Martín Sivak : Jefazo, retrato intimo de Evo Morales, Santa Cruz de la Sierra, Editorial El País, 2008.
[23] http://www.paginasiete.bo/ideas/2018/1/28/repostulacin-corrupcin-socavaron-credibilidad-morales-167774.html
[24] Claudio Ferrufino, De ascos y otros, El Día 9 janvier 2018 https://www.eldia.com.bo/index.php?c=OPINION&articulo=De-ascos-y-otros&cat=162&pla=3&id_articulo=242628
[25] http://www.bolpress.net/art.php?Cod=2006060910
[26] http://www.bolpress.net/art.php?Cod=2006090201
On peut aussi relire les éditoriaux de Ronald "Gordo” Méndez Alpire (clairement pro cubain) dans le journal El Mundo (l’homme et le journal sont aujourd’hui disparus), ou encore la série des lettres de l’écrivain Ruber Carvalho qui s’indigne des pratiques autoritaires et violentes des nouveaux maîtres du pays en des termes véhéments, et les chroniques de bien d’autres journalistes ou analystes encore, quel que soit leur bord politique (Fernando Molina, Jorge Lazarte, Susana Seleme, Diego Ayo, Carlos Valverde, Cayetano Llobet...), qui n’ont jamais été dupes et ont publié des centaines d’articles documentés et argumentés sur la déglingue systématique des institutions démocratiques par le gouvernement du « progrès ».



