De la charge de 2015 aux lois scélérates
Le 10 août 2015, le vice-président García Linera s’en prend à quatre ONG prestigieuses qui, toutes, diffusent une information libre sur les conditions de vie dans le pays : la Fundación Tierra, historiquement liée à la coopération hollandaise et membre du réseau Asociación Latinoamericana de Organismo de Promoción (ALOP), un ensemble d’organisations non gouvernementales de développement de vingt pays d’Amérique latine et des Caraïbes, le Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) reconnu internationalement pour ses diagnostics économiques et sociaux, le Centro de Documentación e Investigación (CEDIB)) qui a plus de trente ans d’âge et la Fundación Milenio. Si la Fundación Milenio, dont les études ont toujours été indépendantes, financée en partie par la fondation Konrad Adenauer (KAS) liée au parti démocrate- chrétien allemand, est plutôt d’inspiration libérale[1], les trois autres ont une longue histoire de liens avec les courants de gauche et ont, à un moment ou à l’autre, cautionné et appuyé le gouvernement d’Evo Morales.
Il entend aussi gommer du paysage le réseau d’information Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL). Né le 18 juillet 1967, composé de 151 radios et institutions d’éducation [2], disséminées sur le territoire national, il se définit comme « une association de radios populaires, d’institutions d’éducation et de production d’inspiration chrétienne qui promeut la démocratisation des connaissances et l’information, la valorisation de la diversité culturelle, l’équité de genre, le plein exercice des droits de l’homme et l’intégration nationale ».
Cette attaque en règle au droit à l’information a suscité la protestation des syndicats de la presse et des médias, de diverses associations de droits de l’homme, dont Human rights watch, et finalement d’un groupe d’une quarantaine d’intellectuels étrangers de gauche qui a lancé une pétition[3]. Pour ces derniers, « Si ces menaces se concrétisaient elles entraineraient une grave atteinte aux droits civils, notamment à la liberté d’expression et d’association et, par conséquent, un énorme recul de la démocratie bolivienne »[4].
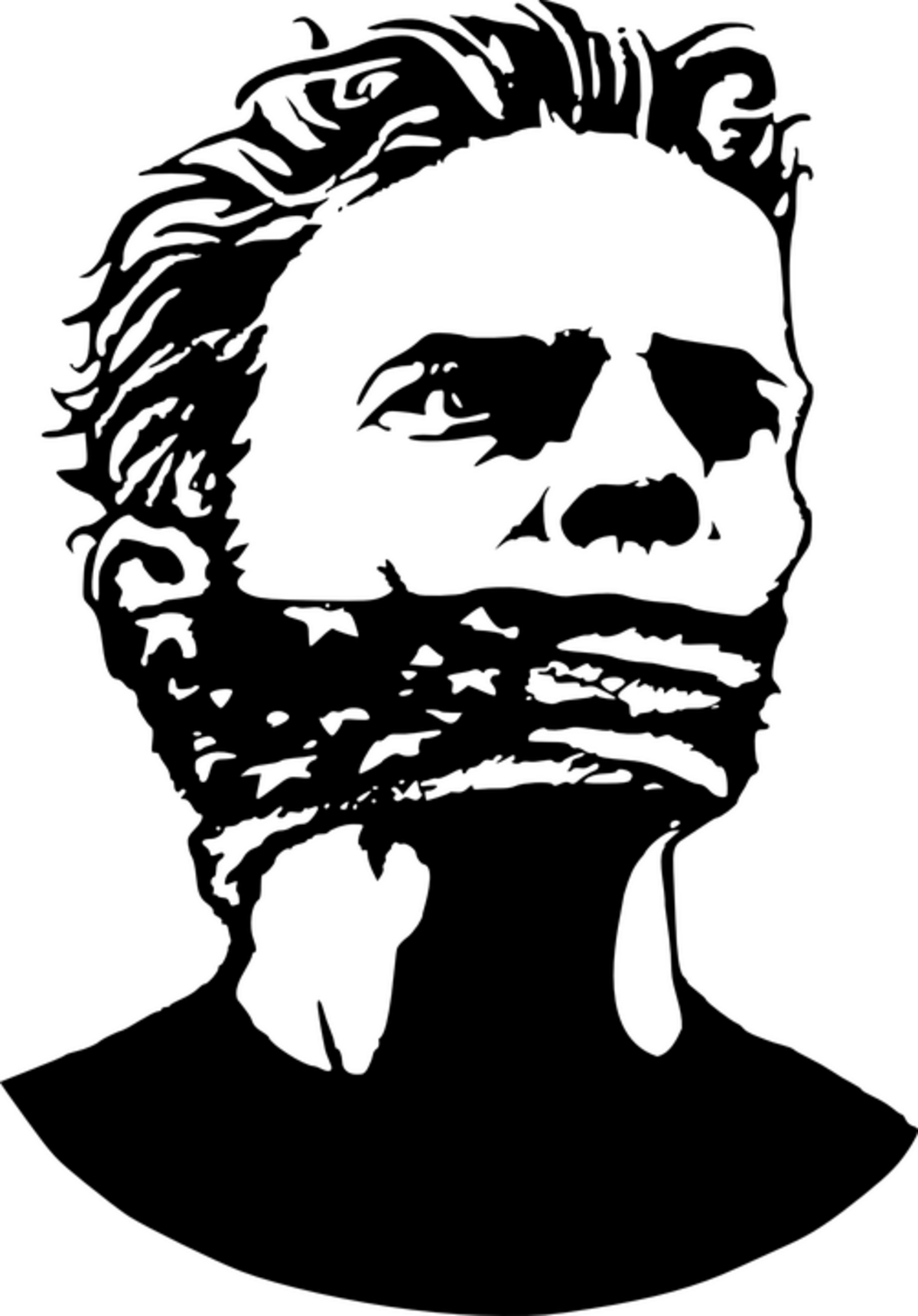
Agrandissement : Illustration 1
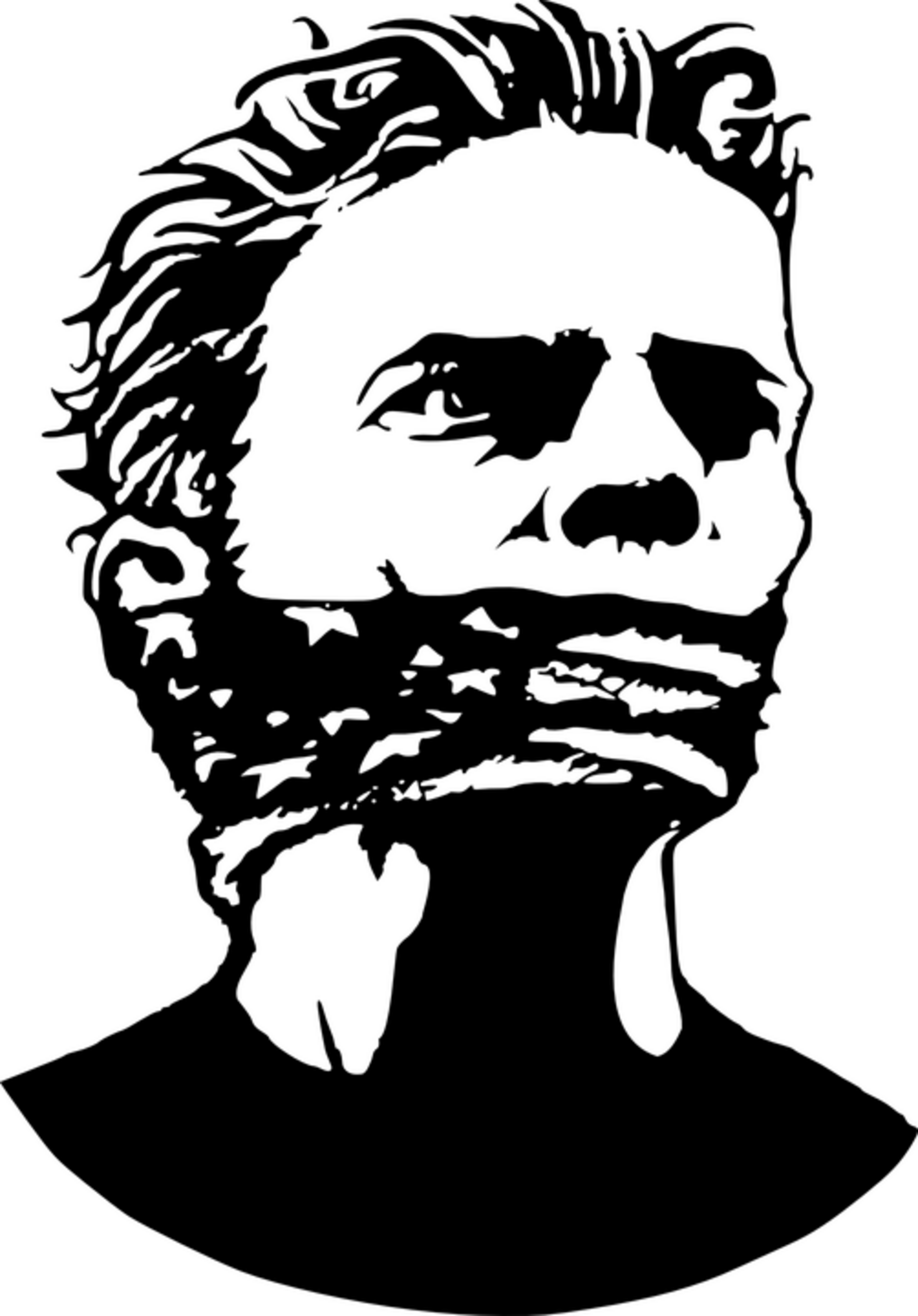
Mais pour le vice-président García Linera « … il est pleinement démontré que ces ONG mentent d’une manière telle qu’elles obtiennent que des personnes bien intentionnées s’associent au discours impérialiste et créent la suspicion sur la réalité du respect des libertés démocratiques et des droits civils des régimes révolutionnaires et progressistes d’Amérique latine »[5]. Dans sa réponse à la pétition des intellectuels étrangers du 18 août, il réitère ses attaques : « J’ai dénoncé le fait que quatre ONG mentent et camouflent leur activisme politique réactionnaire sous le couvert d’une entreprise « non gouvernementale » ».[6] Puis il prend les signataires de la pétition pour des enfants de chœur : «Je comprends que vous vous préoccupiez de la liberté d’expression, mais je considère que c’est en vain (.. .) parce que dans aucune de mes déclarations relatives aux quatre ONG, ni maintenant, ni auparavant, je n’ai préconisé leur fermeture, leur expulsion ou une quelconque restriction de leurs activités (…) Je déplore sincèrement que vous ayez été manœuvrés par ces quatre ONG qui veulent donner une image autoritaire d’un pays qui, vous le savez bien est un des plus démocratiques du monde» (sic). Il prétend aussi que ces associations ne sont pas des «organisations non gouvernementales » mais des « organisations d’autres gouvernements sur le territoire bolivien ». Elles sont qualifiées d’étrangères du fait qu’elles reçoivent des financements de l’extérieur et sont donc considérées comme des antennes du capitalisme et de l’impérialisme qui effectuent un travail politique de sape du gouvernement. Cette insistance sur leur extranéité est évidemment un argument de poids pour justifier leur possible clôture ou leur expulsion du pays.
Selon un processus bien rodé, le mécanisme par lequel les ONG sont cadenassées emprunte la voie juridique. L’assemblée nationale, majoritairement acquise au pouvoir exécutif et à ses ordres, adopte la disposition restrictive et répressive requise, et il ne reste plus qu’à la faire appliquer. Certains de ces dispositifs légaux ont permis d’éliminer les élus d’opposition gênants, les journalistes trop perspicaces, à garantir des hauts magistrats aux ordres, etc… En l’occurrence, c’est la loi 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas a organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro du 19 mars 2013 et son décret d’application 1597 du 5 juin 2013 qui servent le dessein gouvernemental.
Selon ces textes, toutes les ONG sont sommées d’entreprendre les démarches nécessaires pour renouveler leur reconnaissance juridique. Celle-ci ne peut être acquise qu’au prix de l’acceptation des plans de développement du gouvernement ; celles qui candidatent doivent prouver leur contribution au « développement économique et social » (article 7 de la loi). Le gouvernement peut dissoudre une ONG ou une fondation sans autorisation judiciaire, au prétexte qu’elle ne respecte pas ses statuts, qu’elle fait de la politique, ou ne s’ajuste pas à la conception officielle du développement...
En juin 2013, le Defensor del Pueblo (médiateur), Rolando Villena, a présenté un recours en inconstitutionnalité contre deux articles de ces nouvelles normes : article 7 de la loi et article 19 du décret. Il a reçu le soutien des Nations Unies[7], de la Communauté européenne en la personne de son représentant en Bolivie[8], de groupements d’ONG nationales et étrangères[9], et encore de Human Rights Watch[10] et Amnesty international, toutes organisations qui s’inquiètent de l’atteinte à la liberté d’association que cette loi signifie ; une loi contraire à la Constitution et aux traités internationaux signés par le pays.
Le Tribunal constitutionnel plurinational (TCP) a livré son verdict le 4 juillet 2016. Il juge la loi 351 et son décret d’application conformes à la Constitution et n’y voit aucun empêchement à la liberté d’association. Et le nouveau Defensor del pueblo, élu le 12 mai dernier par l’Assemblée législative plurinationale a approuvé ce verdict. Si bien que le 29 septembre 2016, l’Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) et trois ONG, le Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), le Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) et le Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) ont décidé d’intenter un recours auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) qui dépend de l’Organisation des États américains (OEA).
Le gouvernement n’en a cure. Il continue à fustiger les ONG osant encore informer sur des projets et des grands travaux qui portent atteinte à l’environnement et lèsent les peuples indigènes des Basses Terres : construction de deux énormes barrages hydroélectriques sur le rio Beni, El Bala et El Chepete[11], prospection pétrolière dans les parcs naturels et les territoires indigènes[12], avancées de la route Villa Tunari –San Ignacio de Moxos qui avait suscité la marche protestataire de 2011, violemment réprimée à Chaparina[13].
Le discours officiel ne varie pas : tous ceux qui critiquent ces projets ou simplement demandent une information sur leur conception, leur coût, leur impact social et environnemental, font le jeu du capitalisme étranger qui conspire contre le gouvernement du peuple. Ce à quoi Pablo Solón[14] réplique, en se référant aux projets de barrage, qu’en suivant ce chemin il faudra bientôt traiter d’étrangères les populations indigènes des réserves de la biosphère et des terres communautaires d’origine de Madidi et de Pilón Lajas (mosetenes, chimanes, tacanas, lecos et autres populations paysannes) qui viennent de signifier leur refus de la construction des barrages[15].

Agrandissement : Illustration 2

Une nouvelle loi[16] est en préparation qui va définitivement garrotter les ONG et les fondations par le contrôle de leur financement : « Cette loi a pour but de mettre en place des procédures d’administration des fondations et des ONG afin de s’assurer qu’elles poursuivent leurs objectifs, et de contrôler que leur gestion économique obéit au principe de souveraineté », explique le vice-président de la Chambre des députés. Elle va donc prohiber les dons ou financements conditionnés par des positions politiques ou des lignes idéologiques affectant ce principe, qu’ils proviennent d’organismes financiers multilatéraux, d’agences de coopération internationales, de gouvernements ou d’ailleurs. Les dons et ressources reçus devront être enregistrés semestriellement.
Fin 2015, sur 2176 institutions 250 seulement avaient obtenu leur agrément[17]. Certaines d’entre elles ont préféré limiter leur champ d’activité pour échapper aux tracas de la démarche de reconnaissance juridique[18] et d’autres, comme le Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), ont mis la clef sous la porte [19].
Les financements en provenance de l’étranger ont profondément chuté[20]. Et finalement, comme le constate amèrement une amie responsable d’une ONG : « Nous ramons contre le courant après que la majorité des ONG eurent choisi de s’aligner sur les options du gouvernement, certaines par crainte, d’autres par pur opportunisme. Il ne reste quasiment plus de bailleurs parce que ceux qui nous appuyaient ont fui la Bolivie. Même les agences des Nations Unies, soucieuses de ne pas heurter le gouvernement n’appuient plus que les « mouvements sociaux » officiels. Nous verrons bien jusqu’à quand nous pourrons tirer sur la corde avant d’éteindre les lumières et de fermer les portes ».
Les débuts du harcèlement
La traque des ONG a été brusquée en 2011, à la suite de la marche de protestation contre la construction d’une route asphaltée de Villa Tunari à San Ignacio de Moxos destinée à lier le département de Cochabamba à celui du Beni, coupant en son milieu le territoire indigène et parc national Isiboro-Securé (TIPNIS). Les leaders indigènes du parc naturel, soutenus par les associations de défense de l’environnement s’étaient opposés à ce projet qui, outre ses effets destructeurs pour la faune et la flore aurait pour effet immédiat l’extension de la zone de plantation de coca qui le borde au sud et favoriserait l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures. Deux groupements indigènes nationaux, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) qui unit toutes les organisations des Basses Terres, et le Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) qui représente une partie des paysans indiens de l’altiplano, ainsi que diverses ONG (de promotion des indigènes, environnementales, de défense des droits de l’homme…) ont encadré et soutenu les associations indigènes locales pour mener la longue marche de protestation entre Trinidad (Beni) et La Paz, qui a duré deux mois. Accueillis triomphalement dans la capitale les marcheurs sont parvenus à faire reculer momentanément le gouvernement[21]. Pendant la marche le ministre de l’Information a fustigé les associations écologistesForo Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) et la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) et d’autres organisations telle que le Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en les accusant de déstabiliser le gouvernement et de salir l’image de ses autorités. Le vice-président García Linera, idéologue propagandiste du « proceso de cambio », a justifié ces attaques dans une plaquette largement diffusée – dont le titre est calqué sur celui d’un livre de Lénine : El oenegismo, enfermedad infantil del derechismo – dans laquelle il qualifie de «rancuniers » certains de ses anciens compagnons qui se sont alliés aux marcheurs. Un second écrit du vice-président Geopolítica de la Amazonía (2012) stigmatise les organisations indigènes opposées au projet et « l’environnementalisme colonial » des ONG et des agences de coopération.
Puis le gouvernement s’emploie à discréditer, diviser et priver de ressources la CIDOB et le CONAMAQ. Les plus exposées des ONG sont quant à elles victimes de divers types de harcèlement : poursuites judiciaires de leurs administrateurs, contrôles financiers, inspections de leur travail...
Un nouveau pas est franchi le 20 décembre 201, quand le gouvernement bolivien expulse du pays l’ONG danoise IBIS. Selon le ministre de la Présidence, elle aurait discrédité l’autorité gouvernementale et abusé de l’hospitalité de l’État ; « nous avons toute la documentation pour le prouver » ajoute-t-il. IBIS serait ainsi responsable de la division interne de la CONAMAQ et de la CIDOB –en réalité ourdie par le pouvoir exécutif[22]. Tant le vice-président qu’Evo Morales en personne relaient ces attaques et accusent même l’ONG de conspiration.
À regarder de près le programme d’IBIS en Bolivie[23] et ses réalisations, on comprend bien l’agacement, pour ne pas dire la hargne du gouvernement. IBIS se mêle en effet d’éducation interculturelle, de promotion de la démocratie, de préservation de l’environnement. Elle défend avec conviction et obstination le droit à la consultation préalable des indigènes à tout projet d’aménagement ou d’exploitation sur leur territoire (CCPLI) inscrit tant dans la Constitution que dans la Convention 169 de l’OIT relative aux droits des peuples indigènes et tribaux que le gouvernement a signé, et dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qu’il a transformée en loi, mais dont il n’a que faire. Mais surtout, péché majeur, elle a produit un documentaire filmé de plus d’une heure sur la question de la route Villa Tunari -San Ignacio de Moxos (307 km) qui doit traverser la réserve naturelle du TIPNIS, la marche de protestation qu’elle a entrainée, et la répression dont les marcheurs ont été victimes ; un document sans concession à l’égard de la conduite des gouvernants, pour ne pas dire accablant, diffusé nationalement et internationalement.
Cette expulsion, soigneusement orchestrée, est destinée à domestiquer et à museler les autres ONG : « L’État bolivien défendra sa souveraineté et toutes les ONG qui dénaturent ses fonctions seront chassées comme IBIS, menace Quintana (le ministre de la Présidence) qui rappelle en outre que l’expulsion de l’Agence des États Unis pour le Développement International (USAID) obéissait aux mêmes raisons »[24].
Puis la hargne contre les associations de défense des droits de l’homme a pris des formes inquiétantes. Entre le 18 et le 21 janvier 2014, le siège de l’Assemblée permanente pour la défense des droits de l’homme (APDHB) de La Paz a été bloqué par la police et envahi par des « mouvements sociaux » liés au gouvernement, pour empêcher la tenue d’un congrès. Dans la nuit du 8 au 9 février deux tentes occupées par des membres de l’association Plataforma de Víctimas de la Violencia Política y Sobrevivientes de las Dictaduras ont été incendiées. Les représentants qui les avaient installées étaient en alerte depuis le 13 mars 2012 pour réclamer l’indemnité aux torturés et blessés pendant les régimes militaires dictatoriaux prévue par la loi 2640, et l’ouverture des archives militaires – systématiquement bloquée par le gouvernement. De plus, la directrice de l’Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI)[25] et certains de ses membres ont été menacés de mort. Le 11 février ces attaques ont amené la protestation publique du représentant à la Paz de la Oficina del alto comisionado para los derechos humanos (OACNUDH) qui a considéré que ces menaces et exactions créaient un contexte défavorable au travail légitime des défenseurs des droits de l’homme ; il a demandé aux autorités nationales de remplir « leur devoir de protection et de garantie des droits des personnes », et de sanctionner les auteurs de leur violation.
Fin 2013, on comptait 31 dénonciations pour violation des droits de l’homme auprès d’instances internationales telles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) ou l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Tribunal International de La Haye, car la plupart des plaintes déposées dans le pays n’avaient donné lieu à aucune instruction ni jugement[26].
Conclusion
Rappelons d’abord que la plupart des ONG aujourd’hui persécutées ont activement contribué à forger la figure d’Evo Morales, puis à asseoir son pouvoir et sa légitimité. Et c’est vrai aussi des intellectuels étrangers pétitionnaires de 2015 qui ont accrédité aux yeux du monde le caractère progressiste de l’équipe gouvernementale guidée par l’ « Indien » Morales.
Autrement dit, nombreux sont ceux qui se réveillent tard après que, patiemment et avec constance, le gouvernement « du changement » eut démonté ou inféodé tous les contre-pouvoirs par des manœuvres aussi visibles qu’illégales, voire pour certaines criminelles.
Et par conséquent, ce qui advient aujourd’hui à certaines ONG, tant aux institutions qu’aux personnes qui y travaillent, c’est précisément ce qu’elles ont toléré depuis 2006 quand ce gouvernement a commencé à diriger le pays, et qu’elles ont avalisé jusqu’à il y a peu : une forme idéologisée de violence et de délinquance.
Prétendre que le gouvernement a changé comme l’écrivent les intellectuels pétitionnaires en 2015, qu’il est devenu autoritaire, qu’il met aujourd’hui en péril la démocratie relève d’une piètre analyse, ou d’une cécité volontaire. Les attaques aux libertés ont été constantes depuis 2006, et bien des boliviens en ont subi les conséquences, jusqu’à en mourir. Ces défenseurs soudains des ONG ne s’en sont guère émus… Comme le souligne l’analyste Diego Ayo, qui est loin de tout recenser : « Un, les comités civiques[27]: on a intimidé, jugé, emprisonné leurs principaux porte-paroles. Deux, les entrepreneurs (principalement ceux des régions orientales): on les a coopté avec des faveurs de tout type pour qu’ils « fassent des affaires et non de la politique », comme le préconisait la seconde autorité du pays. Trois, les partis politiques: on les a sevrés de tout financement … et de ce fait marginalisés. Quatre, les medias: on les a acculés de telle sorte qu’ils s’autocensurent, on leur a interdit de recevoir la publicité provenant du secteur public, on a acheté des medias privés et consolidé une chaîne publique en réalité personnelle : celle d’Evo. Cinq, l’Église: on l’a obligée à s’occuper des affaires célestes et à délaisser les affaires terrestres. Et on lui a ôté les ressources publiques qui allaient aux écoles qu’elle administre. Six, la coopération : menacée de subir le même sort que l’USAID, elle fait l’autruche. Et l’ONG danoise qui s’est risquée à relever la tête a été expulsée. Sept, les juges qui faisaient leur travail ont été évincés par des procès truqués. Huit, les policiers rebelles ont été maintenus 200 jours en prison pour donner une leçon à ceux d’entre eux qui pensent »[28].
Tout allait bien jusqu’à ce que les représentants des ONG qui se disent progressistes se trouvent étiquetés de droite, de suppôts de l’impérialisme, voire de comploteurs, et harcelés par le gouvernement qui incarne le progrès. On comprend aisément qu’une partie de ces anciens adeptes des cocaleros et du MAS aient maintenant du mal à demeurer complices d’un gouvernement dont ils ne peuvent plus faire semblant d’ignorer qu’il méprise et persécute une partie de ceux auxquels ils apportent leur aide. On comprend qu’ils ne veuillent plus avaliser aux yeux du monde cette politique de mépris, d’inféodation et de répression qu’ils ont tardé à dénoncer. Mais comme le dit joliment et avec humour Karen Arauz[29] dans une chronique publiée le 28 décembre 2013, jour des Saints Innocents :« Parmi les pauvres innocents de ces derniers temps, il y a les ONG qui, des années durant, ont dégrossi et entraîné des leaders comme Morales Ayma, Romero (le ministre de l’Intérieur), García (le vice-président) et une kyrielle d’autres Maintenant, elles doivent aller se faire voir ailleurs[30]. Leurs pupilles ont atteint l’âge de la majorité ; ils n’en ont plus besoin. Pauvres innocents ! Quelle tristesse de finir ainsi ! Élève des corbeaux, et ils t’arracheront les yeux [31] ».
Quant au gouvernement, il poursuit simplement avec constance et obstination sa concentration des pouvoirs, et sa traque des opposants ou gêneurs pour se maintenir le plus longtemps possible au sommet de l’État et en tirer tous les bénéfices possibles. Comme ses ressources dépendent principalement de l’exploitation des immenses richesses de son sous-sol, il fait feu de tout bois pour exploiter de nouveaux gisements, ou engendrer des profits stables comme ceux qu’il entend tirer de l’énergie électrique produite par des barrages géants, quel qu’en soit le coût humain et le prix environnemental. Il est notoire que pendant ces quelques années de régime « du changement » l’économie du pays est devenue de plus en plus « extractiviste ». Cette dérive a été favorisée par les prix très élevés des matières premières sur le marché mondial. Et pendant ce temps, le déjà maigre secteur entrepreneurial industriel a été délaissé – notamment le secteur textile. Or les ONG qui sont orientées vers la défense de l’environnement et des populations qui en tirent leurs ressources et en vivent font obstacle à ces visées. Si bien que le gouvernement s’énerve et les harcèle.
Peu importe que la politique actuelle soit en totale contradiction avec la Constitution qui sanctuarise la Terre-mère (Pacha mama) et dont une part considérable des articles sont consacrés aux droits des indigènes. Peu importe le « Bien vivre » (suma qamaña) préconisé dans la Constitution et publicisé dans les forums internationaux. Ce qui conduit Rafael Puente, ancien préfet nommé par Evo Morales, à s’exclamer : « Nous osons affirmer qu’aussi bien les ONG (environnementalistes) que de nombreux citoyens attendent qu’il nous soit montré un seul cas de défense effective des droits de la Terre Mère proclamés mondialement par notre président Evo Morales »[32].
Rappelons pour terminer que le seul gouvernement bolivien ayant jusqu’ici traqué les ONG est celui du dictateur militaire trafiquant García Meza (1980-1981). Même le gouvernement autoritaire du général Banzer (1971-1978) n’avait pas osé.
[1] Cf.Juan Antonio Morales, “Fundaciones y think-tanks”, http://www.paginasiete.bo/opinion/2015/8/19/fundaciones-think-tanks-67020.html
Sur ce même sujet, voir l’article de Chrystelle Barbier paru dans Le Monde: http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/11/en-bolivie-des-ong-ecologistes-menacees-par-le-gouvernement_4753316_3244.html
[2] En 2009.
[3] http://eju.tv/2015/08/ong-solidaridad-con-el-cedib-145-personalidades-y-50-entidades-piden-al-gobierno-boliviano-garantias-para-su-trabajo/
[4]http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/8/13/intelectuales-mundo-califican-amenazas-contra-como-gesto-autoritarismo-intolerancia-66457.html Parmi les intellectuels signataires on trouve : Boaventura de Souza Santos, portugais ; l’ex épouse de García Linera ; Raquel Gutiérrez; l’ex président de la Assemblée constituante équatorienne, Alberto Acosta ; Maristella Svampa, chercheur au Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet),argentine, Eduardo Gudynas, du Centro Latino Americano de Ecología Social uruguayen…
Chaque organisation visée a aussi lancé son comité de soutien, si bien que le réseau des défenseurs s’est rapidement étoffé. Et c’est ainsi, par exemple, que Noam Chomsky, s’est fait le défenseur de la Fondation Tierra.
[5]http://www.la-razon.com/nacional/Garcia-Linera-ONG-mintieron-intelectuales_0_2328367221.html
[6]Página Siete, 18 août 2015.
[7] http://www.la-razon.com/la_gaceta_juridica/Ley-ONG-vulnera-derecho-asociacion_0_2321767881.html
[8] http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_08/nt150818/politica.php?n=76&-delegado-de-union-europea-defiende-labor-de-las-ong
[9] Voir notamment la lettre adressée au pape le 8 juillet 2015 par l’Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) : http://www.aida-americas.org/es/blog/carta-al-papa-francisco-sobre-situacion-delicada-de-las-ong-en-bolivia#sthash.dgAdCemj.dpuf
Voir aussi la protestation de la directrice de l’Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS)
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2015/0823/noticias.php?id=169015
[10] https://www.hrw.org/es/news/2015/08/05/bolivia-restricciones-la-defensa-de-los-derechos-humanos
[11] El Bala se trouve à 15 km des villes de San Buenaventura, au nord du département de La Paz et de Rurrenabaque au sud de celui du Beni. El Chepete est situé à 70 km au-dessus deRurrenabaque, dans la province Franz Tamayo du département de La Paz. Pour plus de renseignements sur ces futures réalisations voir l’éclairante présentation suivante : https://fundacionsolon.org/2016/10/16/presentacion-sobre-el-bala-y-chepete/ L’entreprise italienne Geoconsult est en train de réaliser les études préalables au tracé final des barrages. Je consacrerai un prochain billet à ces projets.
[12] http://www.noticiasfides.com/politica/exploracion-petrolera-ypfb-contrato-a-dos-empresas-chinas-para-que-hagan-61-mil-detonaciones-en-la-amazonia-363605/ http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/10/8/evo-algunos-indigenas-dejan-explorar-112682.html
[13] http://paginasiete.bo/nacional/2015/6/4/anuncia-camino-villa-tunari-ignacio-moxos-realiza-58865.html http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160530/inician-camino-cerca-del-tipnis-zona-beniana
[14] Ancien ambassadeur de Bolivieauprès de l’ONU de février 2009 à juillet 2011. Il dirige la Fondation Solón qui promeut à la fois les activités artistiques et le développement durable.
[15] http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/10/18/indigenas-rechazan-proyecto-represa-bala-113878.html http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20160816/represa-bala-desplazaria-53-comunidades
[16] http://eju.tv/2015/10/%EF%BB%BFperfilan-segunda-ley-para-fiscalizar-el-dinero-de-las-ong/
[17] Los Tiempos, 28 décembre, 2015.
[18] https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=188595
[19] http://www.paginasiete.bo/seguridad/2016/2/14/tras-anos-cidem-cierra-ayuda-victimas-violencia-86657.html
[20] http://eju.tv/2016/02/ong-trabajan-bolivia-sufren-recortes-presupuestarios-50/
[21] La construction de la route est toujours d’actualité. Pendant la campagne électorale de 2014, les candidats du MAS promirent qu’elle serait asphaltée entre 2015 et 2020.
[22] http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013122001
[23] http://ibisbolivia.org/publications/memoria-institucional-2012
[24] http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2013122001
[25] http://www.radiofides.com/noticia/social/Centro_contra_la_tortura_estatal_denuncia_persecucion_politica
[26] El Deber, 23 décembre 2013.
[27] Groupements d’associations, de coopératives et de syndicats destinés à défendre les intérêts et le développement local.
[28] http://www.paginasiete.bo/ideas/2015/8/23/defensa-estado-derecho-67289.html
[29] Karen Arauz , Pobres innocentes, ejutv, 27 décembre 2013.
[30]« se tienen que mandar a jalar », dit le texte en espagnol ce qui peut se traduire plus vulgairement par :
Ils peuvent aller se faire foutre, si on fait de jalar un synonyme de tirar.
[31]«Cria cuervos … y te sacarán los ojos ». En français : « Oignez vilain, il vous poindra… » (Rabelais), ou, plus crade : « Fais du bien à un vilain, il te chie dans la main! »
[32] Rafael Puente Guardia, ONG y Estado, Pagina Siete, 23 août 2015.



