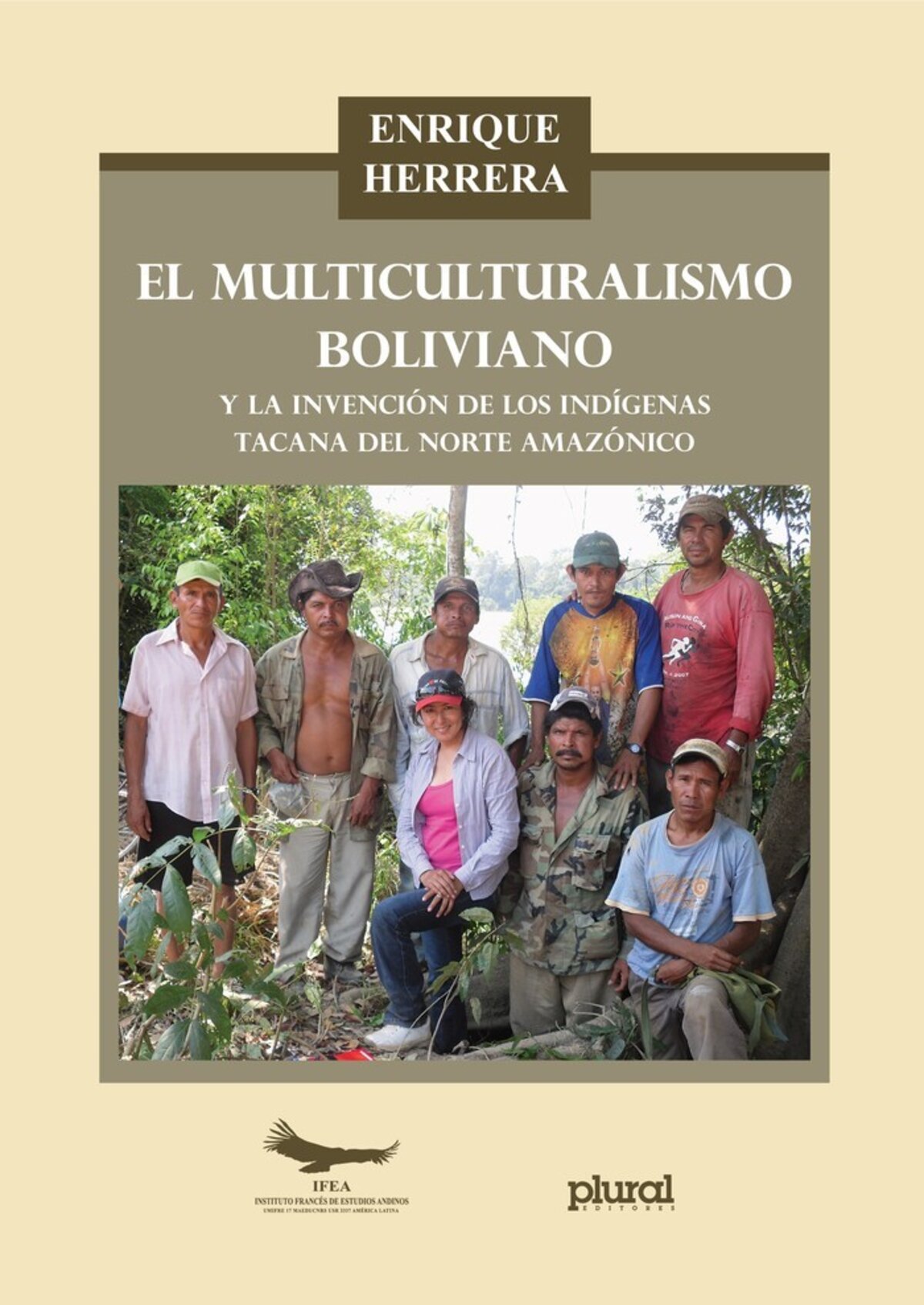
Agrandissement : Illustration 1
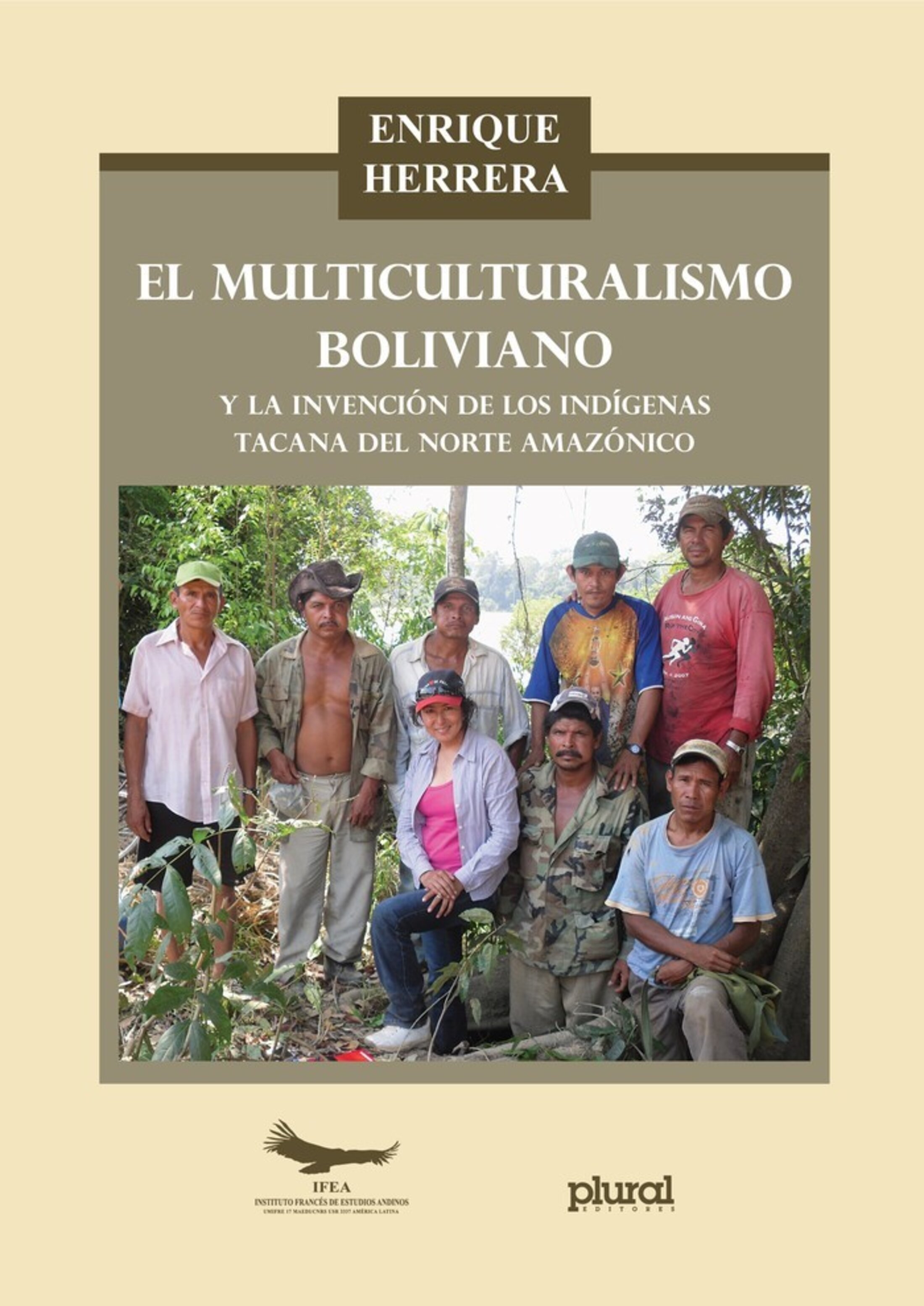
Le livre d’Enrique Herrera[1] est construit à partir d’une hypothèse centrale: l’élaboration par l’État bolivien d’une politique nationale d’inspiration multiculturaliste a joué un rôle décisif dans la création du groupe ethnique Tacana ; elle a également suscité les actions collectives de ses membres pour obtenir la propriété d’aires territoriales communes. Le texte qui suit cet énoncé est la démonstration ordonnée, rigoureuse et parfaitement réussie de la validité de cette hypothèse.
Précisons donc d’emblée que le lecteur ne trouvera pas dans ce livre une ethnographie classique (système de parenté, mythes, rites, coutumes, mœurs...) du groupe désigné par l’ethnonyme Tacana. Si tel était le cas cela supposerait que l’identité Tacana est antérieure aux processus de sa construction. Or l’objet de cette étude est d’analyser les circonstances particulières qui amènent ce groupe social à se transformer en un sujet ethnique, et de dévoiler les mécanismes qu’il mobilise pour utiliser l’ethnicité comme une ressource politique en vue d’objectifs spécifiques. En d’autres termes, ce qui fait problème, et que le chercheur se propose d’étudier, ce n’est pas l’identité Tacana – terme à la mode qui essentialise dangereusement la culture – mais le processus d’identification Tacana.
L’étude s’appuie sur les recherches menées par l’auteur entre 1994 et 2009 au sein du Territorio Multiétnico 2 dans la partie amazonienne du nord de la Bolivie[2]. Elle montre clairement que des discussions internes aux communautés amènent de plus en plus de groupes à s’autoproclamer Tacana : un en 1991, 17 en 1997, 25 en 2000, 34 en 2005.
Etant donné son parti pris de départ, Enrique Herrera est conduit à une analyse dynamique pluridisciplinaire qui mêle harmonieusement histoire anthropologie, sociologie, et économie. Dans les deux premiers chapitres, il montre que l’Amazonie est loin d’être un lieu isolé mais bien une terre de mouvements migratoires qui suivent les cycles économiques. Au fil des siècles elle a incorporé des populations d’origines diverses et continue, sans doute plus que jamais, de le faire. C’est dans ce contexte fluctuant qu’ Herrera expose avec soin l’histoire de l’invention du groupe Tacana depuis l’apparition de l’ethnonyme au 18ème siècle. Il montre d’abord le brassage des regroupements ethniques effectués par les missions franciscaines des Basses terres tropicales de la province Iturralde du département de La Paz où se forge le groupe. Puis il met en évidence, à la période républicaine, lors du boom de l’économie du caoutchouc, le mélange des populations employées dans ces domaines forestiers, provenant tant de la province Iturralde que des départements de Santa Cruz et du Beni, par suite de migrations suscitées – voire forcées –, et il décrit la promiscuité des migrants liés au patron des barracas du caoutchouc par un système de servitude par endettement. Quand le marché du caoutchouc s’effondre définitivement, à la fin des années 1980, ces populations très largement mêlées – ou du moins ce qu’il en reste après des dizaines d’années d’exploitation forcenées– se réinsèrent en grande partie dans le circuit de production de la noix du Brésil. Si bien qu’avant qu’il ne ressurgisse dans les années 1990, le taxon Tacana avait pratiquement disparu.
Deux passages du livre sont particulièrement réussis : celui qui montre par comparaison, et au fil du temps, la fluctuation des ethnonymes, que je conseille volontiers de mettre entre les mains de tous les étudiants qui travaillent la question ethnique ; et la synthèse relative au cadre juridique international dans lequel prennent corps les revendications et les luttes indianistes, et finalement les politiques nationales qui aboutissent à la prise en compte des groupes étiquetés indiens.
L’étude d’Enrique Herrera corrobore les hypothèses de François Bourricaud relatives tant à la définition de l’Indien qu’à la naissance et au développement du mouvement indianiste actuel ; des hypothèses qui sont formulées pour la première fois sur la base de ses observations au Pérou dans le livre Changements à Puno, publié en 1962[3], mais dont les principaux matériaux avaient été réunis au début des années 1950 ; un ouvrage qui anticipe les thèses de Fredrik Barth développées dans Ethnic Groups and. Boundaries, écrit en 1969. Pour lui, l’indien de Puno est le produit de situations sociales, de rapports sociaux de subordination – et non celui de réalités primordiales ou d’une culture. Ce qui explique que les mêmes individus se perçoivent – et sont perçus – tantôt comme des cholos, tantôt comme des métis, tantôt comme des Indiens. Et « les questions d’ethnicité » émergent lorsque « le système de valeur est déjà orienté vers l’accomplissement (achievement) et que les barrières entre les groupes ont été ouvertes ou entrouvertes par une multiplicité de transactions économiques ou non. C’est seulement lorsque les différentes « races » ont été placées dans le même cadre juridique que leur identité ou leur égalité peuvent être affirmées »[4]. En cessant d’être des étrangers, les Indiens deviennent des ennemis, ou du moins des rivaux à la chasse des mêmes opportunités économiques, des mêmes chances sociales et des mêmes statuts. C’est alors que se formalise en termes ethniques aussi bien l’idéologie de l’exclusion que celle de la revendication. Et ce que le travail d’Enrique Herrera expose parfaitement c’est, précisément, cette « multiplicité de transactions économiques ou non ».
Le livre décrit aussi les artifices du comptage ethnique, cet instrument de fabrication d’une vérité pseudo scientifique par des professionnels du chiffrage ; une vérité nécessaire pour légitimer l’existence du groupe et obtenir sa reconnaissance et les droits et financements, nationaux et internationaux, qui vont avec. L’opération de recensement des Tacanas (ou plutôt des recensements) y est décrite de l’intérieur puisqu’Enrique Herrera a participé à l’un d’entre eux. Et il montre excellemment comment leur nombre fluctue au gré des politiques agraires nationales et des stratégies des Tacana pour contrôler et s’approprier leur environnement.
Dans la dernière partie de son livre, après avoir dépeint la genèse de la mobilisation identitaire Tacana et en avoir soupesé les causes, Enrique Herrera décrit son actuel déclin et l’abandon du discours identitaire et ethnique qui en constituait le corpus idéologique. Ces sujets ethniques se veulent maintenant et avant tout les exploitants de leurs propres territoires fonciers (individuels ou familiaux, dans le cadre de domaines fonciers délimités au cœur du territoire attribué collectivement) ; en somme moins ethniquement Tacana qu’agriculteurs, pêcheurs, exploitants forestiers… boliviens comme les autres, ce qui ne va pas sans contradictions avec la législation qui en fait, du moins pour certains d’entre eux, des sujets de droit collectif en tant que peuple administrant un territoire commun.
Ce qu’il me paraît intéressant de souligner pour prolonger les observations d’Enrique Herrera , c’est que tant les membres de la Confédération paysanne bolivienne (CSUTCB) que ceux des organisations de colonisateurs, regroupées dans l’ex Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), rebaptisée Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), à la fois pour gommer le stigmate attaché au mot colonisateur, et s’ajuster à l’air du temps multiculturel, venus du haut plateau et des vallées et qui déferlent dans les Basses Terres depuis une trentaine d’années – à commencer par les cultivateurs de coca (cocaleros) du Chaparé et d’ailleurs; il y en a maintenant dans chaque zone de colonisation ou presque – se battent pour faire éclater le verrou de l’attribution collective des terres rendu obligatoire par la loi de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de 2006. Ils entendent s’établir sur des portions de plus en plus larges des territoires qui sont habités et exploités par des groupes qui s’y sont installés préalablement, depuis des périodes plus ou moins reculées, et qui en ont obtenu la propriété collective depuis les années 1990-2000, à l’instar des Tacana. Un de leurs arguments consiste à dire que ces terres sont des latifundios improductifs et qu’ils doivent être éclatés pour qu’ils y aient leur part. Pour ce qui les concerne, et dans cette bagarre, jamais l’argument ethnique n’est invoqué comme arme de mobilisation ; il l’est en revanche pour disqualifier leurs adversaires catégorisés avec dédain indigènes – quand ce n’est pas sauvages. La construction d’une route au cœur du Parc Isiboro Sécuré (à la fois parc protégé et territoire indigène) qui borde la région de production cocalera du Chaparé, qui a déclenché une longue marche contestataire (15 août –19 octobre 2011) a bien mis en évidence cette condescendance, voire ce mépris. Le secrétaire exécutif de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) porte-parole de colons qui se pensent et veulent modernes et progressistes n-a-t-il pas soutenu pour justifier la saignée de la route dans le parc protégé : « Nous ne voulons pas que les indigènes (du parc) vivent comme des sauvages »[5].
Par conséquent, la volonté d’appropriations et d’exploitations foncières individuelles ou familiales est à l’œuvre partout en Bolivie, et particulièrement dans les zones de colonisation. Et dans ce champ de bataille pour l’appropriation des terres, de plus en plus tendu au fur et à mesure que l’espace disponible se restreint, comme le montre Enrique Herrera, l’habit – et j’ai envie de dire l’alibi – ethnique est adopté ou non, sert tel ou tel, ou ne sert pas, ou dessert selon le contexte national et international, le moment et l’adversaire. Et les mêmes peuvent aussi bien l’endosser que le rejeter selon les circonstances.
Il serait évidemment passionnant de de reprendre l’étude aujourd’hui, tant pour dresser le bilan de la manière dont le TCO Territorio Indígena Multiétnico (TIM) est habité et géré que d’identifier les stratégies des différents acteurs et la manière dont l’arme ethnique est utilisée –ou non – pour engager telle ou telle action ou lutte. Quoiqu’il en soit, ce qui me paraît sûr, c’est que dans le contexte politique bolivien actuel, l’attribution d’un territoire collectif propre ne protège pas les populations de ces territoires contre les exactions ou déprédations. Présentement, les conditions de vie des habitants du TIM et de troisTierras Comunitarias de Orígen (TCO) environnantes sont menacées par des grands projets soutenus par le gouvernement d’Evo Morales qui s’affiche « indigène » : el Corredor norte (La Paz-Guayaramerin-Cobija-Rio Branco), la route Rurrenabaque - Riberalta et la Centrale hydroélectrique de Cachuela Esperanza. Et finalement, tant pour la viabilisation et la modernisation de la production des noix du Brésil (almendras) que pour les secours à apporter aux victimes des inondations –de plus en plus catastrophiques du fait du déboisement et des barrages en aval, en territoire brésilien - ce sont les ONG étrangères qui continuent de secourir les populations : International conservation fund of Canada (ICFC)qui a pris la suite de l’USAID, Christian Aid, Practical Action …
En tout état de cause, la recherche d’Enrique Herrera est une fenêtre bienvenue et stimulante pour éclairer les processus d’identification ethnique en Bolivie, en démêler les fils, en saisir les enjeux et en apprécier les dérives ; et sa richesse invite à poursuivre ses raisonnements.
[1] Sociologue et anthropologue. Il a obtenu son doctorat en sociologie à l’université de Paris 3 Sorbonne nouvelle. Il est consultant pour des agences internationales et des organisations non gouvernementales en Bolivie et au Pérou. Il enseigne à la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cet ouvrage a fait l’objet d’une présentation publique à La Paz le 18 avril dernier. http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/derroteros-multiculturalismo-estatal-boliviano_0_2474152590.html
[2] Enrique Herrera a coordonné un travail d’étape relatif à cette même question, qui a donné lieu à une présentation sommaire : HERRERA, Enrique; CÁRDENAS, Cleverth; TERCEROS, Elba. Identidades y territorios indígenas. Estrategias identitarias de los tacana y ayoreo frente a la ley INRA,La Paz, PIEB, 2004.
Voir aussi cette synthèse de 2006 : La nueva legislación agraria boliviana y la construcción identitaria indígena
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00104295/document
[3] Changements à Puno. Étude de sociologie andine, Paris, Travaux et Mémoires de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine, 1962.
[4] “Indian, Mestizo and Cholo as Symbols in the Peruvian System of Stratification” in Nathan Glazer and Daniel P. Moynihan edit., Ethnicity. Theory and Experience,Cambrige, London, Harvard University Press, 1975, p.357-358.
[5] http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20110906/roberto-coraite-de-la-csutcb-afirmo-que-desea-que-la-carretera-evite-que_5690_9859.html



