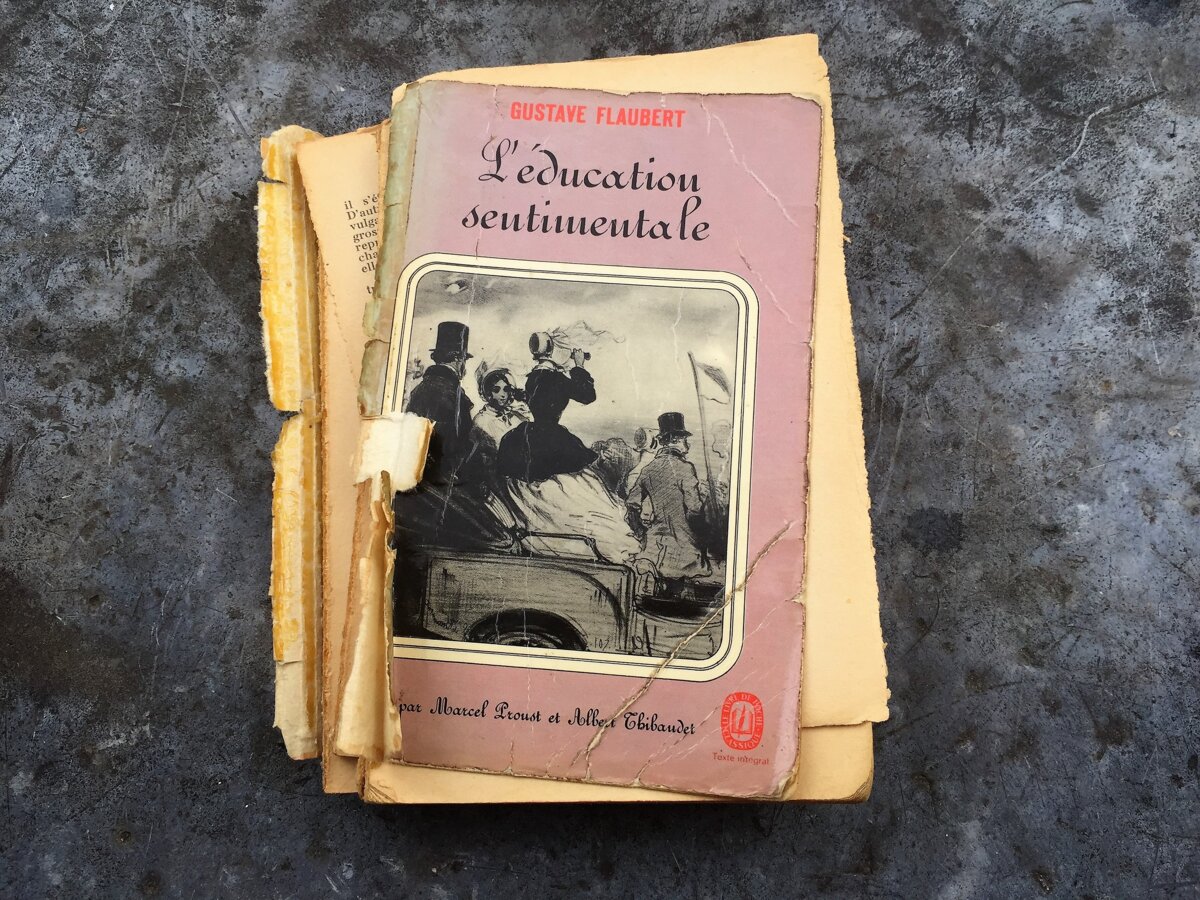
Agrandissement : Illustration 1
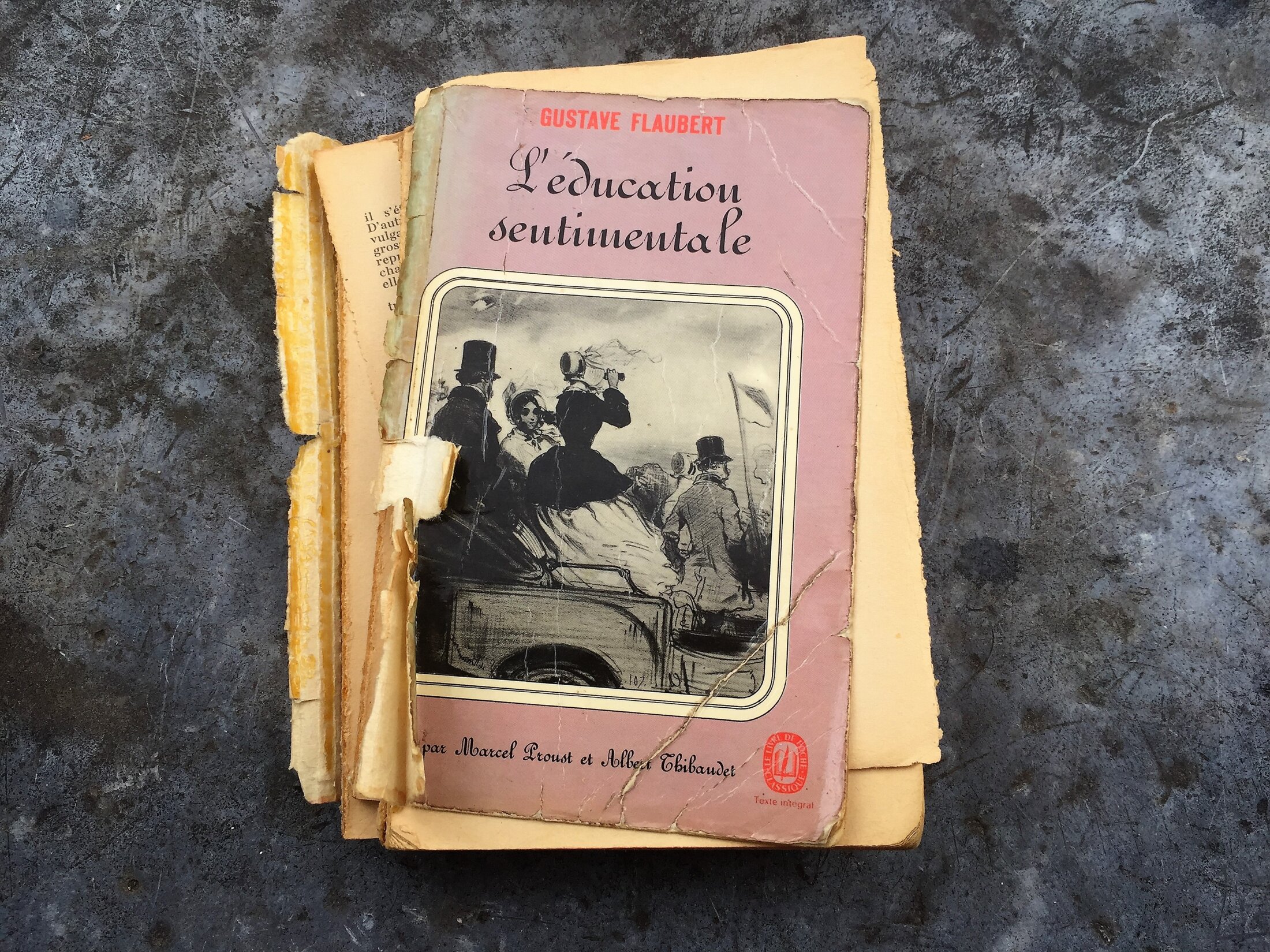
Dans l’une des ses Chroniques, initialement parue en 1920 dans la Nouvelle Revue Française, Marcel Proust fait l’éloge du style de Flaubert, en particulier de ses belles « irrégularités grammaticales », du glissement de ses pronoms personnels, de son usage du « et », des prépositions et des adverbes qui n’ont « presque jamais dans sa phrase qu’une valeur rythmique ». Rien n’est plus beau, plus consolateur que la phrase flaubertienne. Pour un lecteur dont la lecture réitérée de L’Education sentimentale, dans son entièreté ou au hasard des pages, n’a jamais altéré le ravissement qu’elle procure, apprendre qu’une jeune compagnie théâtrale des Hauts-de-France, l’Éventuel hérisson bleu, allait porter à la scène ce roman des romans, suscita un effroi mêlé de curiosité. On craignait le pire, ce fut une bonne surprise, d’autant que le héros principal de ce spectacle, ce n’est pas Frédéric, c’est le livre lui-même. Je le suppose connu (pour rafraîchir la mémoire, lire ici).
« Ce fut comme une apparition »
Assise devant une petite table ronde posée légèrement sur le côté à l’avant-scène sur laquelle le livre est ouvert, l’une des actrices qui par ailleurs interprète l’un des rôles des femmes qui vont marquer la vie de Frédéric Moreau (Antoine Thiollier), lit. Les actrices se relaieront au fil de la représentation pour lire des pages et des pages. En particulier le début et à la fin du roman quasi intégralement lus. Le spectacle dure environ quatre heures (entractes et pauses compris). On s’éloigne parfois du texte, on y revient toujours, le phrasé flaubertien est le métronome du spectacle et sa basse continue. Hugues Mallon qui signe la mise en scène avait entamé son travail en signant l’adaptation.
Ainsi sommes-nous embarqués sur la Ville-de-Montereau où le jeune homme de dix-huit ans qu’est Frédéric se tient sur le pont « immobile ». Flaubert après avoir décrit le « tumulte » du départ et le paysage des rives de la Seine, s’attarde sur le pont. « Déjà les farceurs commençaient leurs plaisanteries. Beaucoup chantaient. On était gai. Ils se versaient des petits verres. »
Ah, la beauté, la force stylistique de ce « ils se versaient des petits verres ». Ah comme il est bon d’entendre pour la première fois cette phrase après l’avoir lue tant de fois. Frédéric se met enfin en mouvement et noue une conversation avec Jacques Arnoux, le propriétaire de L’Art industriel, à la fois journal de peinture et magasin de tableaux. Et, deux pages plus loin, advient cette phase connue par cœur et qui frappe au cœur tout lecteur – les cinq mots simples et magiques de la grande déflagration : « Ce fut comme une apparition. »
Le spectacle qui jusqu’alors s’en tenait à la lecture du texte et avait embarqué sur le navire tous les spectateurs, interrompt la lecture pour fêter ces cinq mots en nous montrant ce qu’ils désignent avant de le dire : le choc que fut la vision de Madame Arnoux pour Frédéric traduit dans une danse d’apparition de cette femme plus que fatale, lointaine, comme venue d’un songe (ce qu’exprime à merveille son interprète, Stéphanie Aflalo), qui accompagnera Frédéric sa vie durant. Une danse de possession aussi bien, mise en musique et accompagnée par les musiciens du spectacle (Aurélien Hamm, clavier, voix, machines, et Antoine Cadot, batterie). Après quoi la lecture reprendra avec des coupes – le plus souvent bien faites.
« Elle jeta un cri et disparut. »
Dans toute cette première partie du spectacle, Frédéric n’apparaît que filmé, astucieuse façon de signifier l’état de songe dans lequel il est embarqué dès cette rencontre bouleversante et fondatrice. « Frédéric alla de l’estaminet chez Arnoux comme soulevé par un vent tiède et avec l’aisance extraordinaire que l’on éprouve dans les songes », écrira Flaubert un peu plus loin.
Le parti pris de la mise en scène privilégie l’une des lignes de force du roman : la vie de Frédéric vue à travers les femmes qui vont la traverser. Madame Arnoux encore et toujours, le Grand Amour. La petite Louise, excellente Aude Mondoloni, qui aurait souhaité quitter sa campagne pour le suivre et le servir. Et deux maîtresses à l’opposé l’une de l’autre. Rosanette dont Maybie Vareilles saisit bien l’effronterie espiègle – « elle fumait des chibouques et elle chantait des tyroliennes » – et l’insouciance. Et Madame Dambreuse, parfaite Marion Bordessoulles, que Frédéric « convoitait comme une chose anormale et difficile, parce qu’elle était noble, parce qu’elle était riche, parce qu’elle était dévote, se figurant qu’elle avait des délicatesses de sentiment, rares comme ses dentelles, avec des amulettes sur la peau et des pudeurs dans la dépravation ». Aaaah, devait gémir Proust en lisant une telle phrase !

Agrandissement : Illustration 2

Autant de femmes qui éclairent par contrastes les relations de Frédéric avec Madame Arnoux. Tel ce dialogue dont on peut penser qu’il inspirera François Truffaut. C’est au milieu du livre et du spectacle. Frédéric rend une visite inopinée à Madame Arnoux. La cuisinière et la bonne étant sorties, il pousse une porte et la surprend seule devant la glace en robe de chambre entr’ouverte. « Elle jeta un cri et disparut. » Elle revient. Pour justifier sa venue imprévue, « Frédéric conta qu’il avait eu un rêve affreux ». S’ensuit ce bref dialogue (repris dans le spectacle) :
« - J’ai rêvé que vous étiez gravement malade, près de mourir.
- Oh ! Ni moi, ni mon mari ne sommes jamais malades !
- Je n’ai rêvé que de vous, dit-il.
Elle le regarda d’un air calme.
- Les rêves ne se réalisent pas toujours. »
On croirait entendre la voix de Delphine Seyrig dans Baisers volés, il se peut que cette cette divine actrice ait été une source d’inspiration pour l’actrice qui interprète Madame Arnoux.
« Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots... »
Par ricochet, l’autre ligne de force de L’Education sentimentale, celle des amis de Frédéric et de leur engagement, est réduite au seul Deslauriers (Romain Crivellari aux taquets), l’ami le plus proche, connu depuis l’enfance : « Il ambitionnait d’être un jour le Walter Scott de la France. Deslauriers méditait un vaste système de philosophie qui aurait les applications les plus lointaines. » Dans le spectacle, il est fait allusion à Sénécal et Dussardier (le seul à mourir jeune au front de ses idées), mais sans plus. On peut le regretter comme on peut trouver, un peu court, bien que juste, le traitement du contexte politique du roman. Pour le Flaubert de L’Education sentimentale, la volonté politique de transformer le monde est comme l’amour, une chimère dont le chemin est pavé de désillusions.
Le spectacle se présente comme un « roman-performance » et trouve sa cohérence dans un dispositif d’ensemble qui suit les mouvements de fond du livre tout en lui offrant des éclairages divers qui vont d’une séquence radiophonique (authentique) entre une animatrice de France Inter et Pierre-Marc de Biasi (grand spécialiste de Flaubert auquel on doit en particulier l’édition des Carnets de travail de Flaubert chez Balland) à « Education sentimentale » de Maxime Le Forestier que le public reprend en chœur avec les acteurs en lisant le texte sur un prompteur.

Agrandissement : Illustration 3

Face aux musiciens installés côté jardin, le côté cour est occupé par un homme (quand il n’interprète pas le rôle de Deslauriers) à la fois bruiteur, bricoleur et militant de la société civile option solidarité et communauté. Une sorte de Nuit debout à lui-tout seul. Plus d’une fois, il décrète une pause pour discuter avec le public, proposant aux spectateurs de participer à divers ateliers, actions communes ou commissions, en écho aux rêves de paroles libérées de la Révolution de 1848 au cœur du roman.
Comme la musique, la vidéo en direct constitue un autre contrepoint. L’intention est dramaturgiquement juste mais sa réalisation mériterait un travail plus approfondi. On ne peut pas reprocher à cette jeune compagnie de ne pas avoir l’aisance à la caméra des collaborateurs de Frank Castorf ni à l’acteur qui interprète Frédéric l’inventivité des acteurs du maître allemand.
La fin du spectacle renoue avec la lecture prolongée, celle des dernières pages du livre. Le fameux : « Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l’étourdissement des paysages et des ruines, l’amertume des sympathies interrompus. Il revint... » Puis c’est la dernière rencontre avec Madame Arnoux (« il y a un moment dans les séparations où la personne aimée n’est déjà plus là »), l’adieu qu’elle lui offre en lui baisant le front ainsi qu’une mèche de ses cheveux blancs. Et puis c’est le bouquet final, pianissimo, la fin sublime où Deslauriers et Frédéric se remémorent un souvenir du temps de leur prime adolescence, ce jour où ils allèrent chez la Turque, un bordel dont ils s’enfuiront sans avoir consommé, répétant l’un après l’autre le non moins fameux : « C’est là ce que nous avons eu de meilleur. » Les deux acteurs aux cheveux gris (perruque) sont assis au fond du plateau, sur le côté, deux petits vieux ressemblant l’un à l’autre, ressemblant déjà l’un à Bouvard, l’autre à Pécuchet.
La compagnie de l’Eventuel hérisson bleu fait partie de « Campus », un « pôle européen de création décentralisé pour l’accompagnement de la création en Hauts-de-France » qui associe le Phénix de Valenciennes et la Maison de la culture d’Amiens, deux établissements mutualisant ainsi leurs moyens de production. Si bien que le spectacle a bénéficié de cinq semaines de résidence de création à Valenciennes et une première série de dix représentations. Un exemple à suivre.
La compagnie a été fondée en 2009 par cinq copains qui se sont rencontrés en faisant des études de Lettres. C’est un collectif où chacun peut signer des mises en scène. Pour sa part, Hugo Mallon a poursuivi ses études en faisant un master d’Etudes théâtrales à Nanterre tout en intégrant l’Ecole du jeu, l’un des meilleurs cours privés parisiens. En 2011, la compagnie s’est installée à Canny-sur-Thérain où elle anime un festival. Après quelques spectacles, L’Education sentimentale constitue leur premier projet d’envergure.
Phénix de Valenciennes à 19h (durée : 4h) jusqu’au 28 septembre (sf les 22 et 23). Le spectacle sera repris à la Maison de la culture d’Amiens en janvier pour cinq représentations.



