emerald.com Traduction de "Evaluating Kupferstein’s claims of the relationship of behavioral intervention to PTSS for individuals with autism" Advances in Autism 4 octobre 2018
Évaluation des affirmations de Kupferstein sur la relation entre l'intervention comportementale et le stress post-traumatique chez les personnes autistes.
Justin Barrett Leaf , Robert K. Ross , Joseph H. Cihon , Mary Jane Weiss (Autism Special Interest Group, Seal Beach, California, USA)
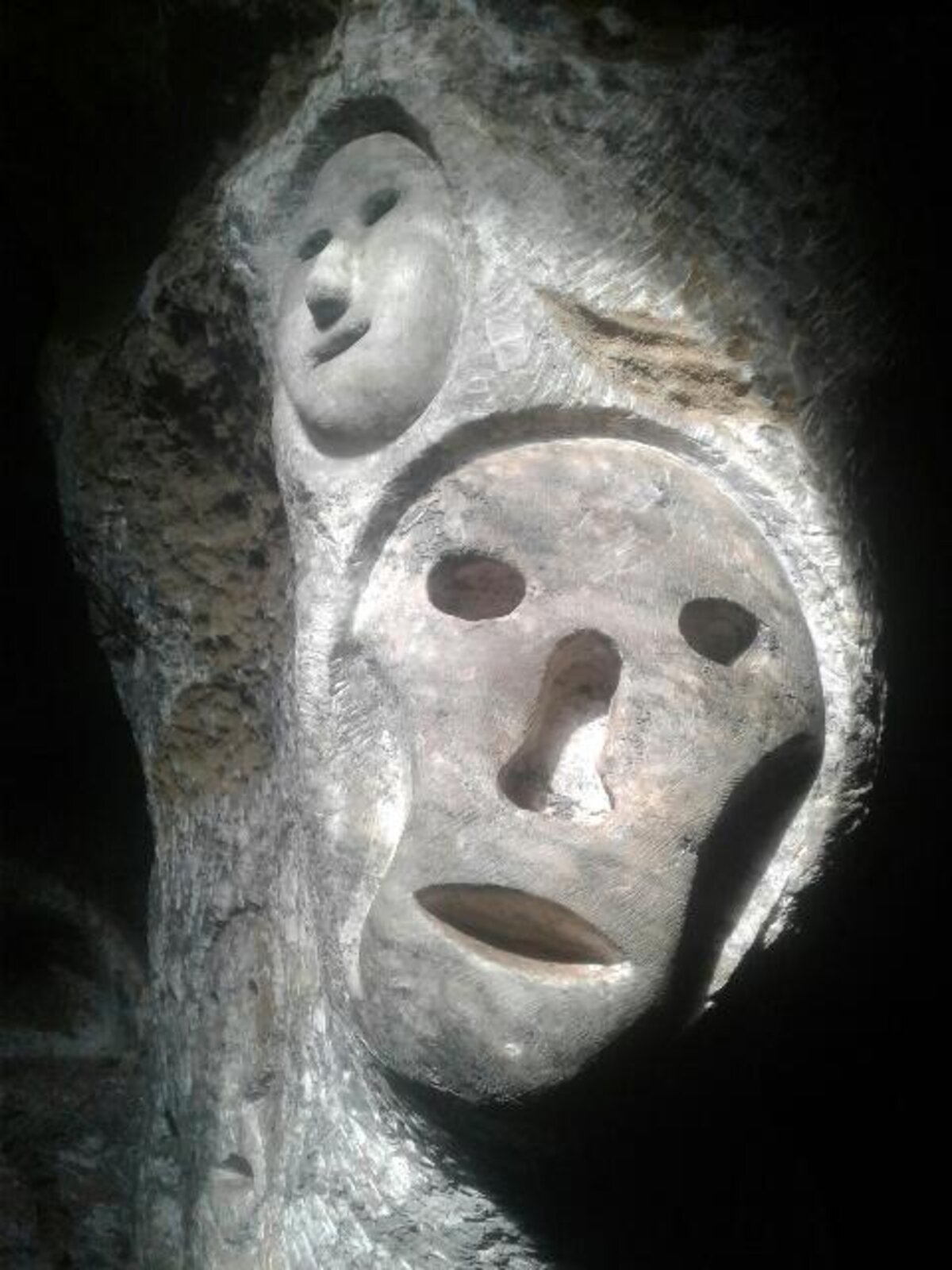
Agrandissement : Illustration 1
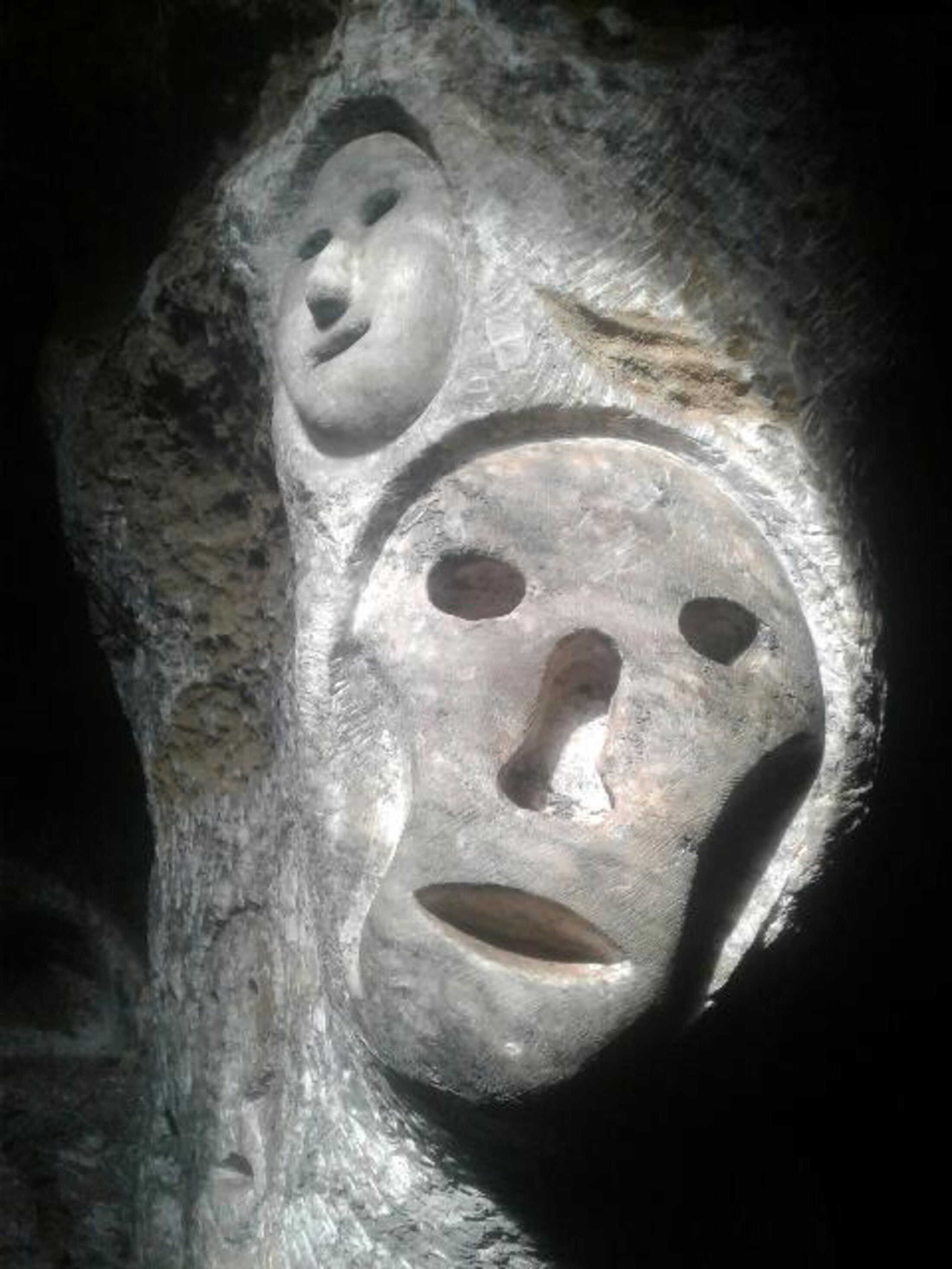
Résumé
Objectif
Kupferstein (2018) a enquêté auprès de 460 répondants et a constaté que 46 % d'entre eux ont atteint le seuil diagnostique du syndrome de stress post-traumatique après avoir été exposés à une intervention fondée sur l'analyse comportementale appliquée. L'objectif de cet article est de fournir une évaluation, une analyse critique de Kupferstein (2018), y compris les méthodes expérimentales et la discussion des résultats.
Conception/méthodologie/approche
Les auteurs ont évalué la rigueur méthodologique de Kupferstein en ce qui concerne l'utilisation de tests d'hypothèses, l'utilisation de mesures indirectes, la sélection des répondants, l'ambiguïté des définitions, le système de mesure et la formulation de la question expérimentale lors de l'analyse corrélationnelle en plus de l'analyse et de la discussion des résultats de Kupferstein.
Constatations
Sur la base de l'analyse, les résultats de Kupferstein doivent être considérés avec une extrême prudence en raison de plusieurs failles méthodologiques et conceptuelles, y compris, mais sans s'y limiter, les questions suggestives utilisées dans une enquête non validée, l'absence de confirmation du diagnostic et la description incomplète des interventions.
Originalité/valeur
Les auteurs espèrent que cette analyse fournira aux soignants, aux cliniciens et aux prestataires de services une perspective scientifique qui leur permettra de voir les limites et les failles méthodologiques de Kupferstein.
L'analyse comportementale appliquée (Applied behavior analysis ABA) constitue l'une des trois branches de la science de l'analyse comportementale, les deux autres étant l'analyse expérimentale du comportement et le behaviorisme, ou la philosophie du comportement (Cooper et al., 2007). En tant que science, l'ABA peut être décrite comme une approche systématique de la compréhension du comportement d'intérêt social. En tant que pratique, l'ABA a été désignée comme l'application systématique des principes de l'analyse du comportement pour améliorer les comportements socialement importants. L'une des applications les plus courantes de l'ABA a été le développement d'interventions basées sur l'ABA pour améliorer la qualité de vie globale des personnes diagnostiquées avec un trouble du spectre autistique (TSA) (Smith, 2012). Depuis les années 1950, de nombreuses études empiriques ont démontré la valeur des interventions complètes fondées sur l'ABA pour les personnes ayant reçu un diagnostic de TSA (par exemple, Anderson et al., 1987 ; Ballaban-Gil et al., 1996 ; Cohen et al., 2006 ; Howard et al., 2005 ; Howard et al., 2014 ; Lovaas, 1987 ; Smith et al, 2000 ; Sallows et Graupner, 2005) et de nombreuses études démontrant l'efficacité de procédures spécifiques basées sur l'ABA (par exemple, l'entraînement aux compétences comportementales ; Miltenberger et al., 2009) pour améliorer les déficits associés à un diagnostic de TSA (par exemple, l'amélioration des comportements sociaux ; Leaf et al., 2017).
Les interventions fondées sur l'ABA représentent la plus grande catégorie d'interventions établies pour les personnes diagnostiquées avec un TSA (voir National Autism Center, 2015 pour un examen complet des niveaux de preuve des interventions pour les personnes diagnostiquées avec un TSA). Il a été démontré que les interventions fondées sur l'ABA entraînent des changements positifs importants dans la qualité de vie des personnes atteintes de TSA (p. ex. Howard et coll., 2014 ; Linstead et coll., 2017 ; Lovaas, 1987 ; McEachin et coll., 1993), et elles ont été approuvées par de nombreux organismes (p. ex. Autism Speaks, The Association for Behavior Analysis International, The United States Surgeon General, National Institute of Mental Health, The American Psychological Association).
Bien que de nombreuses démonstrations aient démontré l'efficacité des interventions basées sur l'ABA, il existe un intérêt pour les études qui démontrent les effets secondaires négatifs potentiels. L'intervention comportementale étant basée sur la science du comportement, ces études sont importantes pour l'évolution et la croissance continues du domaine de l'ABA. Lorsque des professionnels, des soignants ou des personnes diagnostiquées avec un TSA rédigent des critiques, mènent des études montrant des effets secondaires négatifs ou effectuent des recherches comparant les interventions fondées sur l'AbA à d'autres interventions, les résultats peuvent être réellement instructifs. Ces études peuvent permettre aux analystes du comportement, aux professionnels, aux soignants et aux personnes autistes de comprendre certains pièges, réels ou perçus, des interventions fondées sur l'AbA. Les données obtenues à partir de ces études sont plus informatives lorsqu'elles sont bien conçues, que les résultats sont clairement démontrés, que les conclusions sont basées sur des données recueillies objectivement et qu'elles ne sont pas conçues pour soutenir une idée ou une croyance préconçue. Lorsque les études ne répondent pas à ces critères, elles deviennent moins informatives et peuvent être potentiellement nuisibles au domaine de l'analyse du comportement et aux personnes diagnostiquées avec un TSA et à leurs familles (Critchfield, 2015).
Dans un exemple récent de critique des interventions basées sur l'ABA pour les personnes diagnostiquées avec un TSA, Kupferstein (2018) a évalué les " preuves d'une augmentation des symptômes de SSPT chez les autistes exposés à l'analyse comportementale appliquée. " Dans cette étude, Kupferstein a interrogé 460 répondants pour évaluer une corrélation potentielle entre les personnes recevant et/ou ayant reçu une intervention basée sur l'ABA et la prévalence des symptômes de stress post-traumatique (SSPT). Kupferstein a évalué cette corrélation en utilisant une enquête avec un questionnaire auto-administré. Les résultats de Kupferstein sont inquiétants : 46 % des personnes interrogées ont atteint le seuil de diagnostic du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) après avoir été exposées à une intervention basée sur l'ABA. En outre, ce chiffre était beaucoup plus élevé que celui des participants ayant bénéficié d'interventions ayant une base empirique limitée, voire inexistante (voir Jacobson et al., 2005 ; National Autism Center, 2015 pour une analyse complète), telles que la méthode de stimulation rapide - Rapid Prompting Method (3,4 % ; voir Travers et al., 2014 pour une analyse), DIR/Floortime (4,3 % ; voir National Autism Center, 2015 pour une analyse) ou la communication facilitée (1,7 % ; voir Schlosser et al., 2014 pour une analyse).
Compte tenu des résultats de Kupferstein (2018) et des problèmes qui pourraient survenir, il est nécessaire d'évaluer la nature scientifique des méthodes et de la discussion des résultats. Ce faisant, nous nous alignons sur les objectifs du groupe d'intérêt spécial sur l'autisme (Autism SIG). En effet, l'un des objectifs du SIG Autism est de protéger les personnes diagnostiquées avec un TSA et leurs familles contre les traitements inefficaces ou dangereux. C'est pourquoi le Conseil exécutif a voté en faveur d'une analyse de l'étude de Kupferstein. Nous espérons que cette analyse permettra d'informer les praticiens, les familles et les personnes diagnostiquées avec un TSA sur la manière d'interpréter ces résultats. Malheureusement, les résultats de notre analyse ont identifié plusieurs défauts méthodologiques et conceptuels des méthodes de Kupferstein et de la discussion des résultats. Chacune des préoccupations soulevées dans notre analyse est décrite en détail ci-dessous.
Préoccupations
Biais des tests d'hypothèse
Dans l'introduction, Kupferstein (2018) a déclaré : " Nous avons émis l'hypothèse que l'exposition à l'ABA par rapport à d'autres interventions sur l'autisme serait fortement corrélée à la gravité du SSPT rapportée, et que le manque d'exposition à l'ABA prédirait moins de rapports dans les symptômes de traumatisme " (p. 21). Les recherches visant à prouver ou à réfuter une hypothèse peuvent conduire à l'élaboration, délibérément ou par inadvertance, de méthodes permettant d'étayer ou de réfuter cette hypothèse. Compte tenu de la prémisse documentée des auteurs selon laquelle les interventions basées sur l'ABA sont nuisibles (par exemple, Kupferstein, 2016), il semble que diverses décisions concernant les méthodes et la discussion des résultats aient pu être affectées par un biais. Plusieurs de ces décisions sont développées dans le présent document et comprennent, sans s'y limiter, la sélection des répondants pour l'enquête, l'élaboration d'une enquête personnalisée et la corrélation entre les réponses à l'enquête et les critères de diagnostic du SSPT. Toute recherche visant à confirmer ou à infirmer un biais nécessite une évaluation minutieuse. Le biais peut être atténué par l'inclusion de garanties telles que l'évaluation indépendante, la mesure objective et les évaluations en aveugle. Malheureusement, Kupferstein a omis d'inclure la plupart de ces garanties de recherche de base qui obligent le lecteur à prendre les résultats avec prudence.
Mesures indirectes
Kupferstein (2018) a tenté d'évaluer les corrélations potentielles entre l'intervention basée sur l'ABA et le SSPT pour les personnes diagnostiquées avec un TSA en se basant sur les données collectées via une enquête. Bien que les données d'enquête puissent fournir des informations utiles (par exemple, des mesures de validité sociale), l'utilisation d'une enquête comme principale source de données présente également des limites (Cooper et al., 2007 ; Kazdin, 2011). Les enquêtes qui demandent aux individus de déclarer leur comportement et les données qu'ils déclarent eux-mêmes sont notoirement inexactes (Cooper et al., 2007 ; Kazdin, 2011). Les sources d'inexactitude des résultats obtenus à partir de l'autodéclaration peuvent provenir d'un manque de correspondance entre la réponse déclarée et la réponse réelle (c'est-à-dire un manque de correspondance entre le dire et le faire) et des effets de récence, pour n'en citer que quelques-uns (Cooper et al., 2007 ; Kazdin, 2011). En outre, les questions de l'enquête peuvent être construites de manière à produire des résultats qui profitent à la question de recherche. Les questions suggestives et les questions rédigées en termes généraux peuvent gonfler ou pousser à répondre de manière spécifique, de sorte qu'un plus grand nombre de réponses dans une catégorie se produisent (décrit plus loin ; Loftus, 1975). Enfin, et c'est le plus important, les données acquises à partir d'enquêtes empêchent l'identification de relations causales (par exemple, les relations "si-alors" ; Kazdin, 2011). Au mieux, les données d'enquête permettent de développer des corrélations lâches, qui ne doivent pas être interprétées comme des causalités. À ce titre, les tentatives de Kupferstein d'établir une relation entre les interventions basées sur l'ABA et le SSPT (par exemple, "[...] nous prévoyons que près de la moitié des enfants autistes exposés à l'ABA répondront aux critères du SSPT quatre semaines après le début de l'intervention [...]" p. 27) ne peut pas être considérée comme une relation causale. De plus, pour développer une éventuelle relation corrélationnelle, il aurait fallu contrôler d'autres variables (par exemple, l'utilisation d'un groupe de contrôle) qui auraient pu contribuer aux résultats (par exemple, la maturation, l'histoire, le test, l'interaction de sélection ; Campbell et Stanley, 1963 ; Kazdin, 2011). Bien que les données d'enquête soient fréquemment utilisées dans la recherche psychologique ou éducative, en raison des limites susmentionnées, les résultats doivent être pris avec prudence.
Sélection des répondants
Kupferstein (2018) a inclus des répondants qui ont reçu un diagnostic professionnel de TSA, qui ont été auto-diagnostiqués avec un TSA, et les aidants d'une personne diagnostiquée avec un TSA. Les répondants devaient être âgés d'au moins 18 ans. Les répondants ont été recrutés à partir de diverses sources, notamment les médias sociaux, les rassemblements d'adultes et la base de données du Réseau de recherche sur l'autisme. Au total, 460 personnes ont été recrutées pour participer à l'enquête. Le lecteur doit être mis en garde contre plusieurs aspects de la sélection des répondants dans l'étude de Kupferstein.
Tout d'abord, le diagnostic n'a été confirmé pour aucun des répondants, qu'il s'agisse d'un auto-diagnostic ou autre. En fait, Kupferstein (2018) a spécifiquement déclaré : " Les rapports de diagnostic n'ont pas été collectés ni stockés pour protéger la confidentialité des participants, et [la] validité de l'auto-évaluation a été présumée " (p. 21). Bien qu'il soit important de protéger la confidentialité dans toute étude, cela ne dépasse pas la nécessité de valider les variables critiques qui affectent l'interprétation des résultats (par exemple, les personnes qui remplissent l'enquête sont-elles un individu ou un aidant d'une personne ayant un diagnostic d'autisme ?). Sans validation du diagnostic, il est difficile de savoir si l'un des 460 répondants était réellement une personne ou un aidant d'une personne ayant un diagnostic d'autisme.
Deuxièmement, certains répondants comprenaient des personnes qui s'étaient diagnostiquées elles-mêmes un TSA (c'est-à-dire qu'elles s'étaient auto-diagnostiquées). À l'heure actuelle, les médecins et les psychologues ayant reçu une formation en diagnostic procèdent à des évaluations comportementales (p. ex. Autism Diagnostic Observation Schedule ; Lord et al., 2000, Autism Diagnostic Interview™ ; Lord et al., 1994, Gilliam Autism Rating Scale - Second Edition ; Gilliam, 2006) afin de poser ou de confirmer un diagnostic d'autisme. En outre, l'évaluation diagnostique fait généralement intervenir une équipe de professionnels (par exemple, un médecin, un orthophoniste, un psychologue). Les professionnels qui peuvent fournir ou confirmer un diagnostic doivent répondre aux normes du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux - cinquième édition (DSM-5) ou de la Classification internationale des maladies - dixième édition (CIM-10). Il est tout à fait possible que ces participants reçoivent un diagnostic de TSA, et il faut continuer à mener des recherches sur la validité de l'autodiagnostic. Toutefois, l'autodiagnostic n'est pas actuellement un moyen d'obtenir ou de confirmer un diagnostic légitime de TSA. Par conséquent, ces répondants ne répondraient pas aux critères d'inclusion des études évaluant la corrélation entre l'intervention fondée sur l'ABA pour les personnes diagnostiquées avec un TSA et toute autre variable (p. ex., le SSPT).
Troisièmement, 47 % des répondants inclus dans Kupferstein (2018) étaient des aidants de personnes ayant reçu un diagnostic de TSA. Les rapports des aidants sur leur expérience et celle de leur enfant avec une intervention basée sur l'ABA peuvent fournir des informations précieuses (par exemple, les goûts et les dégoûts, la satisfaction des résultats). Cependant, la collecte d'informations subjectives sur les interventions basées sur l'ABA n'était pas l'objectif de l'étude, et l'objectif de Kupferstein peut laisser les informations recueillies auprès des aidants invalidées, au mieux. De plus, de nombreuses questions visaient à obtenir des informations sur des événements privés ou des comportements secrets (par exemple, des pensées, des visions, des cauchemars) survenus chez une personne ayant reçu un diagnostic de TSA. Bien qu'il soit probable que ces rapports ne soient pas négligés par un aidant (par exemple, les rapports de cauchemars sont susceptibles de donner lieu à des consolations et à des soins), il est improbable qu'un aidant puisse fournir des informations précises pour ces questions qui peuvent être corrélées avec les symptômes du SSPT. Par conséquent, les données recueillies auprès de près de la moitié des participants (c'est-à-dire 47 %) sont au mieux douteuses et devraient très probablement être exclues des résultats.
Ambiguïté des interventions basées sur l'ABA décrites
L'objectif de Kupferstein (2018) était d'évaluer les corrélations potentielles entre les interventions basées sur l'ABA et le SSPT pour les personnes diagnostiquées avec un TSA. Étant donné l'ampleur des interventions basées sur l'ABA disponibles (par exemple, la méthode Lovaas, Applied Verbal Behavior, Pivotal Response Training; Romanczyk et McEachin, 2016), les différences entre ces interventions et les résultats potentiels de ces interventions,
il serait nécessaire de définir et de décrire les diverses interventions basées sur l'ABA reçues par les répondants. En outre, sans identifier les caractéristiques de l'intervention fournie, il n'est pas clair si les résultats sont simplement corrélés à des interventions basées sur l'ABA mal menées (c'est-à-dire que " [...] l'ABA mal faite n'est, en fait, pas vraiment de l'ABA [...] ; " Critchfield, 2015, p. 125). L'enquête de Kupferstein offrait aux répondants la possibilité d'énumérer les types d'intervention précoce à partir d'une liste préformatée. Cependant, ces types semblent inclure toutes les interventions basées sur l'ABA dans une seule catégorie, " ABA ". Les autres options d'intervention précoce ne comprenaient que d'autres interventions couramment utilisées, mais non basées sur l'ABA (par exemple, DIR/Floortime).
Pour examiner les corrélations potentielles entre les interventions basées sur l'ACA et le SSPT, il est nécessaire de préciser les variables critiques relatives aux diverses interventions basées sur l'ABA. Ces variables comprennent, sans s'y limiter, l'intensité (nombre d'heures) et la durée (nombre de mois) de l'intervention comportementale, l'intervenant (par exemple, un analyste du comportement certifié et/ou qualifié), le lieu de l'intervention, l'objectif de l'intervention (par exemple, aptitudes sociales, réduction des comportements aberrants, développement du langage), la technique de changement de comportement utilisée (par exemple, punition ou renforcement), les objectifs de l'intervention, les caractéristiques des participants avant et après l'intervention, l'existence d'autres interventions simultanées, la satisfaction des aidants et la raison de la fin de l'intervention. Toutes ces variables, et probablement d'autres, sont importantes pour déterminer les corrélations potentielles entre le SSPT et les interventions basées sur l'ABA ou si le SSPT est corrélé avec d'autres variables étrangères (par exemple, une approche éclectique ou l'insatisfaction de l'aidant). De plus, comme pour les difficultés de diagnostic, les résultats de l'enquête n'ont pas été validés (c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de confirmation de l'existence d'une intervention fondée sur l'ABA), il est possible que les répondants aient mal identifié ou mal étiqueté une autre thérapie comme étant une intervention fondée sur l'ABA.
Étant donné que l'objectif principal de Kupferstein (2018) était d'évaluer les corrélations potentielles entre les interventions basées sur l'ABA et le SSPT, nous espérons que cela a été fait pour aider à fournir des informations utiles afin d'améliorer les aspects potentiellement nuisibles des interventions basées sur l'ABA. Pour ce faire, il aurait été essentiel de fournir des données sur les caractéristiques de l'intervention basée sur l'ABA. La fourniture de ces données aurait permis aux partisans des interventions basées sur l'ABA d'améliorer la plus grande catégorie d'interventions établies pour les personnes diagnostiquées avec un TSA (National Autism Center, 2015). Malheureusement, ces données n'ont pas été fournies, ce qui limite grandement l'utilité des résultats, rendant impossible l'évaluation d'une corrélation entre diverses interventions basées sur l'ABA et le SSPT, et pouvant induire les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu'une intervention bénéficiant d'un vaste soutien empirique est nuisible plutôt qu'efficace.
Système de mesure
La principale variable que Kupferstein (2018) a tenté de mesurer était la prévalence du SSPT chez les personnes diagnostiquées avec un TSA. Encore une fois, cette mesure a été obtenue par les réponses aux questions d'une enquête auto-administrée. Les réponses à ces questions ont ensuite été corrélées avec les critères définis par le DSM-5 pour un diagnostic de SSPT. En d'autres termes, Kupferstein a tenté de corréler les mesures du SSPT rapportées subjectivement dans le cadre de sa propre évaluation avec les critères de diagnostic du SSPT. La classification subjective des mesures du SSPT pour les aligner sur un diagnostic de SSPT crée plusieurs problèmes lors de l'interprétation des résultats.
Tout d'abord, comme pour l'obtention d'un diagnostic de TSA, la seule façon pour une personne de recevoir un diagnostic de SSPT est de s'adresser à un médecin ayant une expérience des maladies mentales, comme un psychiatre ou un psychologue, qui utilise objectivement le critère décrit dans le DSM-V et la CIM-10. Cependant, Kupferstein (2018) semble faire le saut des mesures subjectives du SSPT à un diagnostic de SSPT lorsqu'il décrit les résultats (par exemple, la figure 3 fournissant une analyse de régression de la gravité du SSPT ; Kupferstein, 2018, p. 25). Bien qu'il soit tout à fait possible que les répondants aient signalé la présence d'un SSPT, les résultats ne doivent pas être interprétés comme une méthode de diagnostic du SSPT ou une corrélation entre le fait de recevoir des interventions basées sur l'ABA et de recevoir un diagnostic de SSPT.
Deuxièmement, Kupferstein (2018) a développé une enquête qui a modélisé les questions d'une enquête existante (c'est-à-dire le PCL-5 ; Weathers et al., 2013). Il est important de noter que le PCL-5 a trois versions différentes : militaire, civile et spécifique. De plus, le PCL-5 n'est pas utilisé pour fournir un diagnostic formel de SSPT, il est plutôt utilisé comme système de suivi pendant le traitement, comme outil de dépistage et, au mieux, pour établir un diagnostic provisoire de SSPT (Weathers et al., 2013).
Kupferstein n'a pas précisé lequel de ces trois éléments a été utilisé pour élaborer les questions du sondage qu'elle a utilisé ou si les questions qu'elle a élaborées démontrent la même cohérence interne, la même cohérence test-retest et la même validité convergente et discriminante du PCL-5 que celles démontrées avec les anciens combattants (par exemple, Bovin et al., 2016). Par conséquent, il faut s'interroger sur la validité de l'enquête utilisée et, par conséquent, sur les résultats obtenus à partir de cette enquête.
Troisièmement, des exemples de questions fournies par Kupferstein (2018) suscitent des inquiétudes. Par exemple, l'une des questions de l'enquête était la suivante : " Lorsque vous suiviez une thérapie, étiez-vous gêné par la thérapie que vous receviez ? " (p. 23). Les questions de ce type sont qualifiées de questions " suggestives ", dans lesquelles la formulation de la question amène le répondant à fournir une réponse spécifique. L'utilisation de questions suggestives, comme celle mentionnée ci-dessus, dans l'enquête peut empêcher une évaluation précise des résultats de l'enquête (Loftus, 1975). De même, des questions telles que "Pensez-vous avoir déjà atteint les objectifs du thérapeute ?" (Kupferstein, 2018, p. 22) impliquent que le thérapeute dans les interventions basées sur l'ABA est le seul à déterminer les objectifs. Il s'agit d'une représentation erronée des interventions basées sur l'ABA, qui suggèrent également un biais potentiel, qui utilisent une myriade de méthodes pour déterminer les objectifs du programme, y compris la contribution de l'individu recevant l'intervention (Bannerman et al., 1900 ; Van Houten et al., 1988).
Ensemble, l'utilisation de mesures subjectives du SSPT, l'élaboration d'une enquête qui n'a pas été validée comme principale source de données et la nature trompeuse des questions sont autant de failles méthodologiques majeures qui doivent être prises en compte lors de l'interprétation des résultats de Kupferstein (2018).
Cadre introductif
Une dernière préoccupation découle du cadre d'introduction de Kupferstein (2018), qui tente d'aligner à tort les interventions basées sur l'ABA comme étant nuisibles pour les personnes diagnostiquées avec un TSA. Kupferstein inclut une discussion sur les effets des chocs sur le fonctionnement comportemental des rats. Il n'est pas clair comment la discussion sur les chocs avec les rats s'applique à l'objectif de l'étude des auteurs. Il est possible que Kupferstein ait tenté d'aligner l'intervention basée sur l'ABA sur les chocs et, ce faisant, ait induit les lecteurs en erreur en leur faisant croire que les interventions basées sur l'ABA incluent l'utilisation de chocs, ce qui ne correspond pas à la base documentaire actuelle, ou que les chocs et les interventions basées sur l'ABA produisent les mêmes effets sur les humains et les rats, ce qui ne correspond pas à la base documentaire actuelle. Cette tentative de lien, ainsi que d'autres, donne une fausse image des interventions basées sur l'ABA dont bénéficient de nombreuses personnes autistes. De plus, les auteurs passent immédiatement d'une description inexacte des interventions basées sur l'ABA à une discussion sur les événements potentiellement traumatiques (EPT). Cela semble être une tentative d'aligner les interventions basées sur l'ABA avec les événements potentiellement traumatisants sans preuve ni raison. De plus, étant donné la complexité des interventions basées sur l'ABA, il n'est pas clair quelles composantes des interventions basées sur l'ABA conduisent à un ETP ou fonctionnent comme tel. Par exemple, la mise en œuvre d'une évaluation fonctionnelle du comportement, qui est conçue pour préserver un individu de tout dommage, pourrait-elle fonctionner comme un ETP ?
Conclusions
Kupferstein (2018) a conclu que " les personnes exposées à l'ABA avaient une probabilité de 46 % de présenter un SSPT " (p. 27). De plus, Kupferstein (2018) " prédit que près de la moitié des enfants autistes exposés à l'ABA devraient répondre aux critères du SSPT quatre semaines après le début de l'intervention ; si l'intervention ABA persiste, on aura tendance à observer une augmentation de la satisfaction des parents malgré l'absence de diminution de la gravité du SSPT " (p. 27). Ces conclusions sont bouleversantes, et il est probable que de nombreuses personnes prendront contact avec cette étude et les conclusions de Kupferstein. Dans le cadre de la mission du SIG Autism, nous avons jugé nécessaire d'examiner de plus près les méthodes et les conclusions de Kupferstein. Sur la base de notre analyse, les résultats et les affirmations fondées sur ces résultats doivent, pour le moins, être considérés avec prudence et pourraient être potentiellement préjudiciables pour les personnes diagnostiquées avec un TSA et leurs familles. L'étude de Kupferstein comportait d'importantes lacunes méthodologiques et conceptuelles associées à ce qui semble être une analyse biaisée, ce qui a conduit à des affirmations frappantes avec peu ou pas de preuves à l'appui.
De nombreuses études ont documenté les résultats positifs des interventions basées sur l'ABA pour les personnes diagnostiquées avec un TSA (par exemple, Anderson et al., 1987 ; Ballaban-Gil et al., 1996 ; Cohen et al., 2006 ; Howard et al., 2005 ; Howard et al., 2014 ; Leaf et al., 2011 ; Lovaas, 1987 ; Smith et al., 2000 ; Sallows et Graupner, 2005). Néanmoins, la simple présence d'études telles que celle de Kupferstein (2018) met en évidence une situation difficile majeure pour ceux qui font partie du domaine de l'ABA et de l'intervention en matière de TSA. Même avec l'énorme succès des interventions basées sur l'ABA pour les personnes diagnostiquées avec un TSA, il est important d'évaluer régulièrement l'acceptabilité de nos interventions.
Les personnes travaillant dans ce domaine doivent prendre au sérieux toute accusation selon laquelle les interventions basées sur l'ABA pourraient être potentiellement traumatisantes pour les personnes qui bénéficient de ces interventions. À ce titre, nous encourageons les recherches visant à évaluer l'opinion des utilisateurs sur les interventions basées sur l'ABA, ainsi que les recherches qui mesurent avec précision les effets collatéraux positifs et négatifs potentiels des interventions basées sur l'ABA, sans parti pris ni préjugé. Ce type de recherche aiderait les analystes du comportement appliqués à continuer à affiner les méthodes et à améliorer les interventions fondées sur l'ABA pour les personnes atteintes de TSA. Il est regrettable que des défauts méthodologiques et autres empêchent les résultats de Kupferstein de fournir ces informations.
La possibilité la plus inquiétante résultant de Kupferstein (2018) est peut-être le potentiel pour les familles d'éviter de rechercher et de recevoir ce qui a été documenté comme la plus grande catégorie d'interventions établies pour les personnes diagnostiquées avec un TSA (voir National Autism Center, 2015 pour un examen complet des niveaux de preuve des interventions pour les personnes diagnostiquées avec un TSA). Les affirmations dramatiques et surprenantes faites dans l'étude de Kupferstein pourraient créer la prémisse pour refuser aux familles une intervention efficace et/ou détourner les familles de l'obtention d'interventions basées sur l'AbA. Nous espérons que cette analyse de l'étude de Kupferstein met en évidence les limites et les failles méthodologiques qui remettent en question les résultats et les affirmations basées sur ces résultats. Sur la base de cette analyse, nous soutenons que les prestataires de services, les analystes du comportement, les organismes de financement et les parents devraient évaluer soigneusement et objectivement cette étude avant d'éviter de faire des recommandations sur les interventions basées sur l'ABA pour les personnes diagnostiquées avec un TSA sur la base des résultats.
emerald.com Evidence of increased PTSD symptoms in autistics exposed to applied behavior analysis Advances in Autism 2 janvier 2018Preuve de l'augmentation des symptômes du PTSD chez les autistes exposés à l'analyse comportementale appliquée
Henny Kupferstein,
Résumé
Objectif
L'objectif de cet article est d'examiner la prévalence des symptômes de stress post-traumatique (SSPT) chez les adultes et les enfants qui ont été exposés à l'analyse comportementale appliquée (ABA) dans le cadre de l'intervention auprès des jeunes autistes. En utilisant un questionnaire en ligne pour sonder les adultes autistes et les aidants d'enfants autistes, l'auteur a recueilli auprès de 460 répondants des données démographiques, des types d'intervention et des comportements pathologiques actuels à l'aide d'échelles de gravité des symptômes. Cette étude a relevé un SSPT chez près de la moitié des participants exposés à l'ABA, alors que les témoins non exposés avaient 72 % de chances d'être asymptomatiques. La satisfaction des aidants à l'égard de l'ABA était en moyenne neutre ou légère. En revanche, la satisfaction des adultes à l'égard de l'ABA était en moyenne plus faible et avait également tendance à prendre des notes extrêmement faibles ou extrêmement élevées. L'exposition à l'ABA a prédit un taux plus élevé et un SSPT plus sévère chez les participants, mais la durée de l'exposition n'a pas affecté la satisfaction des aidants à l'égard de l'intervention.
Conception/méthodologie/approche
Les participants ont été recrutés pour une enquête en ligne par le biais de réseaux de médias sociaux, de rassemblements d'adultes, de groupes d'aptitudes sociales et de groupes de soutien aux autistes dans tout le pays. Les critères d'inclusion des adultes étaient l'autisme - diagnostiqué ou auto-diagnostiqué - et un âge de 18 ans ou plus. Un total de 460 répondants, composés d'adultes autistes et d'aidants d'enfants autistes, ont rempli une enquête en ligne. Les entrées des soignants (n=217) concernaient 79% d'enfants de sexe masculin, 21% d'enfants de sexe féminin (ratio homme/femme de 3,80:1) et un enfant transgenre MtF, âgés de 1 à 38 ans, avec un âge moyen au moment du diagnostic de 4,69 ans. Les entrées d'adultes (n=243) concernaient 30 % d'hommes, 55 % de femmes (ratio homme/femme de 0,55:1) et 14 % d'un autre sexe, âgés de 18 à 73 ans, avec un âge moyen au moment du diagnostic de 25,38 ans.
Résultats
Près de la moitié (46 %) des répondants exposés à l'ABA ont atteint le seuil diagnostique du SSPT, et des niveaux extrêmes de sévérité ont été enregistrés dans 47 % du sous-groupe affecté. Les répondants de tous âges qui ont été exposés à l'ABA avaient 86 % plus de chances de répondre aux critères de SSPT que les répondants qui n'ont pas été exposés à l'ABA. Les adultes et les enfants avaient tous deux plus de chances (41 % et 130 %, respectivement) de répondre aux critères de SSPT s'ils étaient exposés à l'ABA. Les adultes et les enfants non exposés à l'ABA avaient 72 % de chances de ne pas déclarer de SSPT (voir figure 1). Au moment de l'étude, 41 % des aidants ont déclaré utiliser des interventions basées sur l'ABA.
Originalité/valeur
La majorité des adultes interrogés étaient des femmes, ce qui soulève des questions sur la population des autistes interrogés en ligne. De plus, le nombre élevé de répondants adultes ayant déclaré un sexe autre que masculin ou féminin, ainsi qu'au moins un enfant MtF parmi les répondants aidants, indique que les études futures devraient prendre en compte ces intersections. Ces résultats s'accompagnent de divergences significatives dans les biais de déclaration entre les aidants et les personnes exposées à l'ABA, ce qui souligne la nécessité d'inclure la voix des adultes autistes dans la conception des interventions futures. Sur la base de ces résultats, l'auteur estime que près de la moitié des enfants autistes exposés à l'ABA devraient répondre aux critères de SSPT quatre semaines après le début de l'intervention ; si l'intervention ABA se poursuit, on aura tendance à observer une augmentation de la satisfaction des parents malgré l'absence de diminution de la sévérité du SSPT. (...)



