Pour vous abonner à la nouvelle liste Autisme : http://referentiel-autisme.fr/AutismeML.html
link.springer.com Traduction de "Does a Person’s Autism Play a Role in Their Interactions with Police: The Perceptions of Autistic Adults and Parent/Carers"Kaaren Haas &Vicki Gibbs - Journal of Autism and Developmental Disorders (18 août 2020)
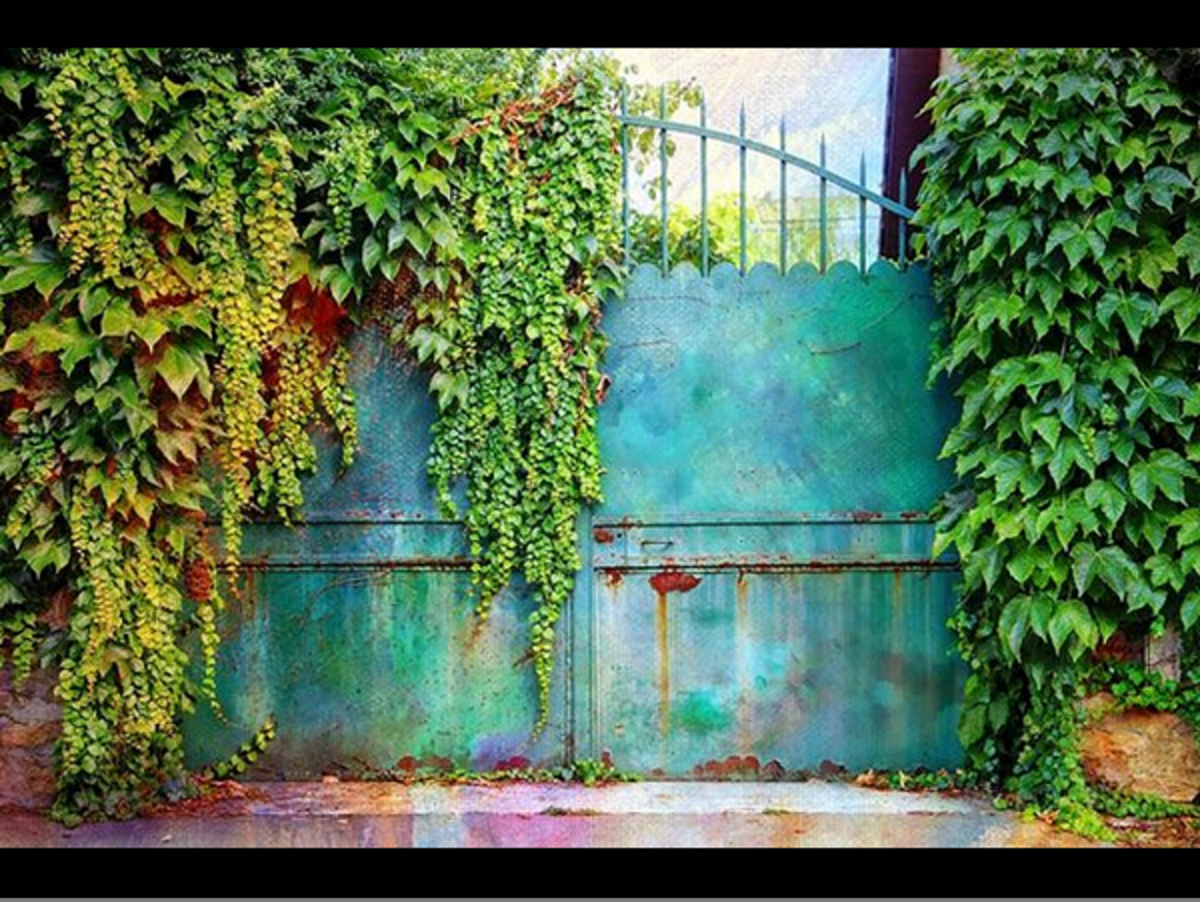
Agrandissement : Illustration 1
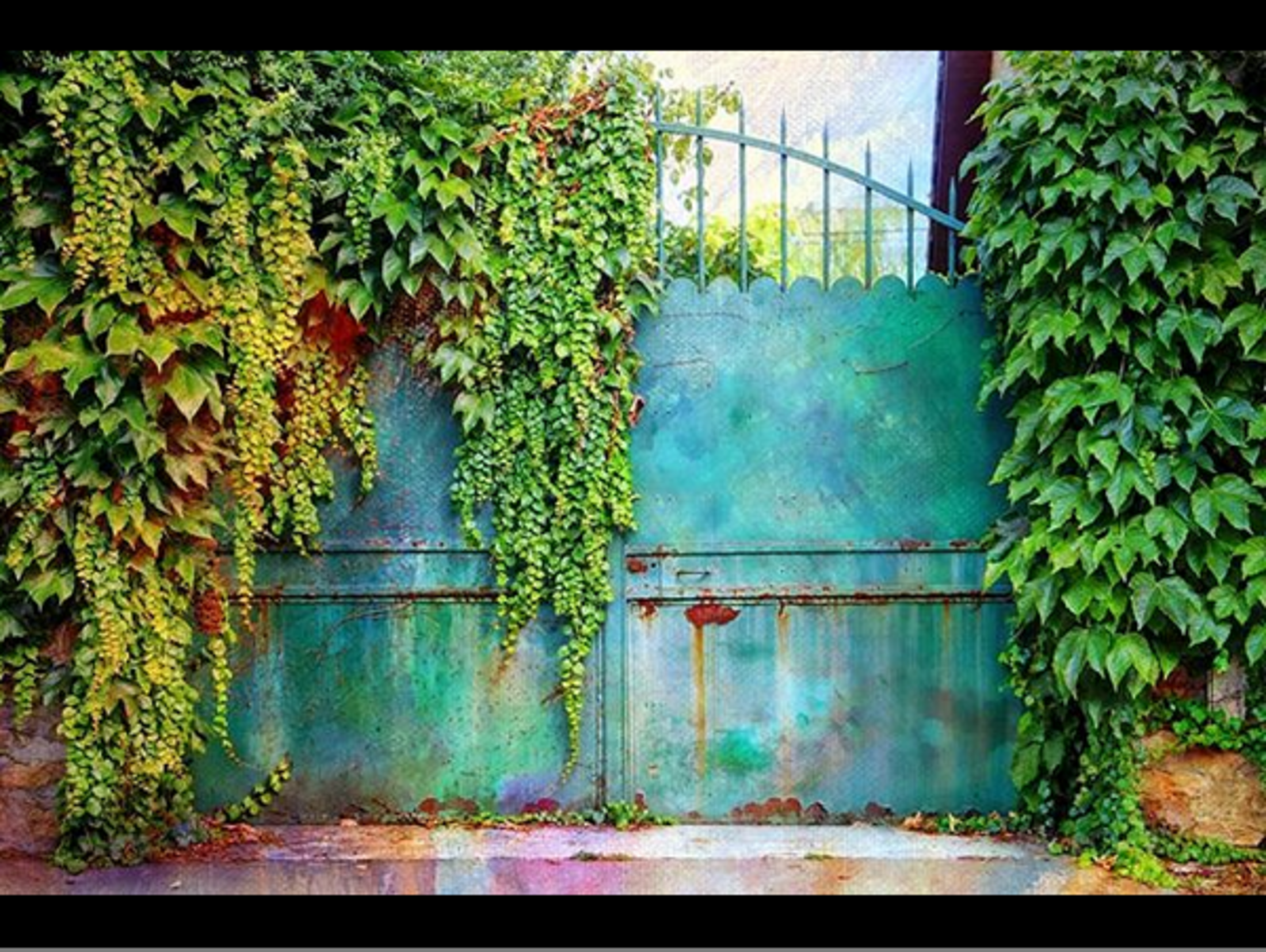
L'autisme d'une personne joue-t-il un rôle dans ses interactions avec la police : Les perceptions des adultes autistes et des parents/soignants
Résumé
Cette étude visait à décrire l'impact des caractéristiques autistiques (caractéristiques essentielles de l'autisme et affections concomitantes) sur les interactions avec la police. Douze adultes autistes et 19 parents/soignants ont été interrogés sur leurs interactions avec la police au cours des cinq dernières années. L'analyse du contenu a permis de constater que dans la plupart des interactions (92,3 %), les caractéristiques autistiques ont été décrites comme ayant un rôle dans l'interaction avec la police, soit comme un facteur causal, soit plus souvent en affectant le déroulement de l'interaction. Dans ce dernier cas, l'impact était associé à des perceptions négatives de l'interaction. En échantillonnant un groupe plus représentatif en fonction de l'âge, du sexe, des capacités fonctionnelles et du contexte, cette étude donne un aperçu des facteurs qui sous-tendent l'insatisfaction déclarée de nombreuses personnes autistes à l'égard des interactions avec la police.
Introduction
Des études menées auprès de personnes autistes, de leurs familles et de leurs soignants montrent que les personnes autistes de tous âges interagissent avec la police dans divers contextes, et qu'à de nombreuses occasions, ces interactions avec la police peuvent poser problème (Gibbs et Haas 2020 ; Railey et al. 2020 ; Salerno et Schuller 2019 ; Tint et al. 2017). Pour comprendre pourquoi il peut en être ainsi, un facteur à prendre en compte est le rôle (le cas échéant) que les caractéristiques sociales, communicationnelles et comportementales de l'autisme peuvent jouer dans ces expériences. Une sous-estimation claire de l'impact que l'autisme d'une personne peut avoir sur ses interactions avec la police est essentielle à toute tentative de recherche d'un accès équitable au système judiciaire pour les personnes autistes (Ortoleva 2011). Cette connaissance est également essentielle pour informer le développement de programmes et de ressources qui favorisentune sensibilisation, une compréhension et des compétences accrues pour la police afin d'améliorer les résultats des personnes autistes dans leurs interactions avec les forces de l'ordre (Chown 2010).
Il existe un nombre restreint mais croissant de recherches concernant les contacts des personnes autistes avec la police (King et Murphy 2014 ; Railey et al. 2020). En général, la plupart de ces travaux visent à déterminer si les personnes autistes sont plus susceptibles d'être impliquées dans une série d'infractions pénales et dans quelle mesure cela peut être dû à leur condition d'autiste (Rob- ertson et McGillivray 2015 ; Rutten et al. 2017). Loureiro et al. (2018) ont tenté de répondre à cette question en examinant la prévalence des traits autistiques chez les délinquants condamnés. Ils ont comparé l'étendue et le type de traits autistiques présents chez les délinquants avec ceux des non-délinquants dans leur étude portant sur 101 détenus hébergés dans une prison de haute sécurité au Portugal. Ils ont trouvé des traits autistiques plus importants chez les détenus que dans le groupe de contrôle apparié de non délinquants, ce qui a conduit les auteurs à conclure que la présence de traits autistiques était un facteur de risque indépendant pour l'emprisonnement. En revanche, une étude de Woodbury-Smith et al. de 2005 comparant 21 délinquants adultes autistes à 23 non délinquants autistes a révélé que si les non délinquants étaient plus à même de reconnaître les expressions émotionnelles de peur, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes pour les mesures de la théorie de l'esprit, du fonctionnement exécutif ou de la reconnaissance de l'expression faciale de tristesse. Sur la base de ces résultats, les auteurs ont proposé que pour un petit groupe d'autistes, la présence de troubles du comportement antisocial concomitants peut expliquer leur vulnérabilité à la délinquance plutôt que les caractéristiques de l'autisme en soi.
Plus récemment, les chercheurs ont cherché à rendre compte des motivations et des expériences des personnes autistes dans leurs interactions avec la police. Dans cette littérature, le rôle de l'autisme d'un individu dans ses interactions avec la police a été défini dans deux contextes différents. Le premier est le postulat selon lequel les caractéristiques sociales, communicationnelles et comportementales de l'autisme d'un individu peuvent le prédisposer à attirer l'attention de la police. Cela peut se produire lorsque la police elle-même rencontre dans la communauté une personne autiste qui a un comportement délinquant ou est soupçonnée de l'avoir. Howlin (2004) a proposé un certain nombre de caractéristiques autistiques qui pourraient rendre les personnes autistes plus susceptibles de commettre des actes agressifs justifiant une intervention de la police, notamment la perturbation des routines, l'adhésion trop rigide aux règles, le manque de compréhension des situations sociales, de mauvaises capacités de négociation, la poursuite d'un intérêt obsessionnel, l'incapacité à reconnaître les implications de son comportement pour lui-même et pour les autres. Les rapports dans lesquels la compréhension atypique d'une personne autiste des conventions sociales, de l'expression émotionnelle et verbale, ou de l'interprétation des comportements et de la communication d'autrui se traduit par des comportements sociaux que la police ou d'autres considèrent comme inappropriés ou suspects sont également fréquents (Allen et al. 2008 ; Dickie et Dorrity 2018 ; Helver- schou et al. 2015, 2018 ; Woodbury-Smith et al. 2005). Dans d'autres cas, il a été observé que la naïveté sociale d'une personne autiste ou son désir d'être acceptée par ses pairs peut également l'exposer à un risque accru d'être poussée par d'autres personnes à adopter un comportement délictueux (Freckelton 2013 ; Helverschou et al. 2018). Plusieurs études ont rapporté que les intérêts particuliers, les comportements obsessifs ou les schémas de pensée fixes d'une personne autiste ont été un facteur qui a influencé l'individu à commettre une infraction (Allen et al. 2008 ; Helverschou et al. 2018 ; Murrie et al. 2002 ; Woodbury-Smith et al. 2010). Enfin, les inquiétudes concernant le comportement d'une personne autiste peuvent inciter les membres de la famille ou de la communauté à demander l'aide de la police. De tels appels à l'aide ont été signalés dans des cas où une personne autiste s'est enfuie de son entourage (Anderson et al. 2012), ou a connu un isolement (sans violence) ou un effondrement avec violence entraînant des dommages matériels ou un risque de préjudice pour elle-même ou pour autrui (Gibbs et Haas 2020). Bien que ce ne soit pas une caractéristique essentielle du diagnostic de l'autisme, les difficultés de régulation des émotions sont courantes chez les personnes autistes (Cibralic et al. 2019) et il a également été signalé que des personnes autistes étaient prédisposées à agir de manière impulsive et donc à commettre des infractions sans tenir pleinement compte des conséquences de leurs actes (Allen et al. 2008 ; Helverschou et al. 2018).
Les chercheurs ont également examiné l'hypothèse selon laquelle les caractéristiques sociales, de communication et de comportement de l'autisme d'une personne peuvent contribuer à aggraver son état lors de ses rencontres avec la police. Par exemple, la façon dont une personne autiste utilise et comprend la communication non verbale et le discours non littéral, et les différences dans le traitement de l'information peuvent augmenter la probabilité d'une mauvaise compréhension de la part de la personne autiste et des policiers (Dickie et Dorrity 2018). Dans d'autres cas, des études ont montré qu'une personne autiste peut ressentir une anxiété et un stress accrus dans une situation inhabituelle, comme une rencontre avec la police, et donc être plus touchée par l'événement qu'une personne non autiste (auteurs, en projet). Dans une étude britannique, six personnes autistes qui avaient été en contact avec la police ont déclaré que leur expérience lors de l'arrestation comprenait le fait de ne pas pouvoir comprendre tout ce qui se passait ou ce qui était dit, l'incertitude de ne pas savoir ce qui allait se passer ensuite et le fait de se sentir mal à l'aise avec d'autres personnes au poste de police. Parmi les problèmes qu'ils ont rencontrés lors des interrogatoires, citons l'incapacité à se concentrer, le fait de devoir répondre à de nombreuses questions et le fait de se sentir sous pression et mal à l'aise (Allen et al. 2008).
Un certain nombre d'études ont conclu que les traits de suggestibilité, de soumission et d'évitement des conflits peuvent éventuellement accroître la vulnérabilité d'une personne autiste à des pressions in situ telles que les interrogatoires de police (Allen et al. 2008 ; Freck- elton 2013 ; Maras et Bowler 2012 ; North et al. 2008). Dans l'étude de Helverschou et al. de 2015 sur les rapports de cas de 48 adultes autistes ayant subi un examen médico-légal, et dans leur étude de suivi de 2018 (Helverschou et al. 2018), la majorité des délinquants autistes avaient fait un aveu complet ou partiel de leur crime immédiatement après leur arrestation ou à la vue de tous, tandis que certains avaient également avoué plus d'actes criminels que ceux pour lesquels ils étaient accusés. Une récente étude expérimentale simulant des rencontres avec la police a suggéré que dans les cas où une personne autiste est suspectée à tort par la police d'une activité criminelle, certains peuvent avoir des difficultés particulières à convaincre la police de son innocence en raison de leurs difficultés de compréhension et de mise en perspective (Young et Brewer 2020).
Bien que ces résultats soutiennent généralement l'hypothèse selon laquelle les caractéristiques autistiques d'une personne sont susceptibles d'avoir un impact sur ses interactions avec la police, les limites des recherches menées à ce jour rendent difficile la généralisation de leurs conclusions à l'ensemble de la communauté autiste. Tout d'abord, si la plupart des recherches menées à ce jour ont porté sur les délinquants, les personnes autistes ont plus souvent des interactions avec la police dans une série d'autres circonstances et cadres (par exemple en tant que victime, témoin et dans des affaires non pénales, comme les infractions routières, voir Gibbs et Haas 2020). Il est donc nécessaire d'étudier l'impact de la nature autistique d'une personne dans ces situations. Deuxièmement, seules deux études ont fait état de conclusions tirées de témoignages de première main sur les expériences de personnes autistes dans leurs interactions avec la police (Allen et al. 2008 ; Helverschou et al. 2018). Il est essentiel d'entendre les voix des personnes autistes sur leurs expériences vécues pour bien comprendre le raisonnement et les motivations de leurs actions dans leurs interactions avec la police et les réactions de la police dans ces situations (Pellicano et al. 2019). En outre, les recherches existantes sur ce sujet se limitent à l'Amérique du Nord et à l'Europe, et aucune donnée n'est disponible sur les interactions entre les personnes autistes et la police en Australie. L'étude des expériences de personnes autistes de différents pays peut permettre d'identifier à la fois des points communs et des différences entre diverses juridictions où le fonctionnement du système de justice pénale et les relations entre la police et la communauté en général peuvent différer considérablement. La présente étude vise à fournir des données empiriques supplémentaires pour combler ces lacunes dans nos connaissances actuelles.
La recherche présentée ici fait partie d'une étude exploratoire plus large sur la nature des interactions entre les personnes autistes et la police en Australie. À ce jour, cette étude plus vaste a fait état de conclusions sur les types d'interaction, la satisfaction des participants aux interactions et les questions relatives à la divulgation de l'autisme (Gibbs et Haas 2020). Un prochain document fera état des résultats sur les perceptions des participants quant au comportement de la police dans les interactions, et l'impact de l'interaction sur la personne autiste et sa famille après l'événement. Cet article se concentre sur les résultats de l'étude concernant la manière dont le caractère social, la communication et le comportement des personnes autistes et les défis associés (par exemple, les difficultés de régulation des émotions, l'anxiété, les difficultés de compréhension) ont affecté leurs interactions avec la police, telles qu'elles sont perçues par la personne autiste et/ou son parent/soignant.
Méthodes
L'approbation éthique a été donnée par le bureau de recherche de l'université Griffith.
Échantillon
Les participants éligibles étaient :
- Les adultes (âgés de plus de 18 ans) ayant reçu un diagnostic professionnel autodéclaré de toute forme d'autisme (y compris l'autisme, les troubles autistiques, les troubles du spectre autistique, l'autisme atypique, les troubles envahissants du développement - non spécifiés autrement, le syndrome d'Asperger) et ayant eu au moins une interaction avec la police (à l'exception des tests de dépistage d'alcool ou de drogue) en Australie au cours des 5 dernières années ; et
- Les parents/tuteurs de personnes autistes de tout âge qui répondent aux critères ci-dessus.
Recrutement
Le recrutement (entrepris dans le cadre du projet plus vaste) a été effectué via les médias sociaux (Facebook), par courrier électronique et sur des publicités web faites par un certain nombre de prestataires de services dans toute l'Australie à l'intention des adultes autistes et des parents/tuteurs de personnes autistes de tout âge. Les informations relatives au recrutement ont fourni un lien vers un formulaire de déclaration d'information et de consentement des participants, que ces derniers ont rempli avant d'accéder au questionnaire en ligne destiné aux adultes ou aux parents/tuteurs dans le cadre du projet plus vaste. À la fin du questionnaire, les participants pouvaient alors fournir leurs coordonnées (via un formulaire en ligne séparé) pour indiquer leur intérêt à participer à un entretien téléphonique de suivi avec l'équipe de recherche. Le contenu de ces entretiens a fourni les données nécessaires à cette étude.
Participants
Au total, 31 participants ont été interrogés, dont 12 adultes autistes âgés de 25 à 64 ans (7 femmes et 5 hommes) et 19 parents d'autistes âgés de 6 à 24 ans (1 femme autiste et 18 hommes autistes).Les informations démographiques et cliniques concernant la personne autiste qui a eu des contacts avec la police ont été obtenues grâce aux questionnaires pour adultes et pour parents/tuteurs remplis avant l'entretien (tableau 1).
Entretiens
Les entretiens ont été menés par l'un des auteurs entre août et septembre 2018, en personne, par téléphone ou par vidéoconférence, selon la préférence du participant. Les entretiens ont duré entre 20 et 30 minutes et ont été enregistrés avec le consentement du participant. Les entretiens utilisaient un schéma semi-structuré de questions pour guider les participants dans leur propre description de leurs interactions avec la police au cours des 5 années précédentes, et comprenaient des questions pour obtenir la description par les participants des circonstances qui ont conduit à l'interaction ; et la nature de l'interaction elle-même (y compris ce qui a été dit et fait par la police) et la personne autiste pendant l'interaction.
Analyse des données
L'analyse du contenu, tant qualitative que quantitative, a été appliquée en plusieurs étapes. Il s'agissait tout d'abord d'identifier puis de quantifier les cas dans les données où les descriptions des interactions des participants avec la police comprenaient des références à :
Toute communication sociale, interaction sociale ou caractéristique comportementale de la personne autiste qui serait considérée comme une preuve de l'un des critères diagnostiques de l'autisme tels que décrits dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux - cinquième édition (DSM5, APA 2013), que nous appellerons "caractéristique essentielle de l'autisme" ou toute autre difficulté de santé mentale, de langage ou de régulation émotionnelle qui se manifeste couramment dans l'autisme, que nous appellerons "affections concomitantes"- Comment les caractéristiques essentielles de l'autisme ou des affections concomitantes (que nous regrouperons sous le terme de "caractéristiques autistiques") ont eu, d'une certaine manière, un impact sur l'interaction de l'individu avec la police.
Tableau 1 Caractéristiques démographiques des personnes autistes (...)
L'analyse de contenu était la méthode d'analyse idéale pour cette tâche, pour un certain nombre de raisons. En règle générale, l'analyse de contenu s'est développée pour englober une série de techniques scientifiques qui permettent au chercheur de coder à la fois le texte et les interprétations du texte en catégories, puis de compter la fréquence des occurrences au sein de chaque catégorie (Ahuvia 2001). Ces techniques comprennent l'analyse qualitative du contenu, qui a la flexibilité de combiner l'analyse inductive et déductive du texte (Cho et Lee 2014), et la capacité d'extraire les significations manifestes et latentes des aspects particuliers du texte qui sont pertinents pour la question de recherche examinée (Graneheim et Lundman 2004 ; Schreier 2012) ; et l'analyse quantitative du contenu, qui permet d'attribuer des valeurs numériques aux codes et d'analyser les relations impliquant ces valeurs à l'aide de méthodes statistiques standard, afin de tirer des conclusions (Riffe et al. 2019).
L'analyse des descriptions des participants a commencé par la prise de notes de terrain par les deux auteurs pendant et après chaque entretien, afin d'identifier les éventuelles significations manifestes et latentes initiales dans les descriptions des participants. Les enregistrements des entretiens ont ensuite été transcrits mot pour mot par KH. Le codage était initialement ouvert et inductif, les deux auteurs lisant et relisant indépendamment toutes les transcriptions et codant à la main ligne par ligne pour coder provisoirement toute signification manifeste ou latente émergeant des descriptions. Les auteurs se sont réunis pour comparer et discuter de leur tentative de codage individuelle. À partir de là, ils ont élaboré conjointement un cadre de codage initial, qui comprend l'identification dans les données de toute référence (i) aux caractéristiques autistiques de la personne et (ii) au rôle que ces caractéristiques ont pu jouer dans l'interaction avec la police. Toutes les transcriptions des entretiens ont été importées dans le logiciel NVivo12 par KH pour permettre un codage et une analyse systématiques des données. Le codage s'est d'abord déroulé de manière ouverte et inductive, les deux auteurs se réunissant à plusieurs reprises pour examiner les résultats afin de développer et d'affiner de manière itérative un cadre de codage. Le cadre de codage final a ensuite été appliqué de manière déductive à l'ensemble des données établies par KH pour classer toutes les données qui faisaient référence soit (i) aux caractéristiques autistiques d'un individu, soit (ii) au rôle qu'une caractéristique autistique jouait dans l'interaction avec la police. En dernier lieu, les deux auteurs ont examiné conjointement l'ensemble du codage et ont discuté et convenu du codage par consensus, ce qui a permis d'obtenir un niveau élevé de fiabilité entre les évaluateurs.
Le tableau 2 présente le cadre de codage final et les définitions utilisées pour les caractéristiques autistiques. nitions utilisées pour les caractéristiques autistiques. Les jugements concernant ce qui constituait une caractéristique autistique était basé sur la compréhension professionnelle des chercheurs de la présentation et de l'expérience vécue de l'autisme, qui comprenait l'expertise de VG, en tant que psychologue clinicien, dans le diagnostic de l'autisme ; les critères de diagnostic du DSM-V (APA 2013) ; les connaissances acquises par les deux en tant que chercheurs sur l'autisme connaissant la littérature sur l'autisme et travaillant également aux côtés de chercheurs sur l'autisme ; et leur expérience vécue en tant que parents de personnes autistes. Une consultation a également été menée auprès de deux chercheurs spécialisés dans l'autisme afin de parvenir à un consensus sur les définitions et la terminologie utilisées dans le cadre de codage final.
Après le codage, des requêtes de matrices et de tableaux croisés ont été appliquées dans NVivo pour explorer et quantifier toute association entre les caractéristiques autistiques et le rôle possible que chacune a pu jouer dans l'interaction ; et les schémas dans les données selon les caractéristiques des participants. Des statistiques descriptives ont été utilisées pour quantifier le nombre d'occurrences des phénomènes identifiés dans les données, par groupe de participants.
Résultats
Au total, 31 participants ont fourni des descriptions de 39 interactions séparées avec la police au cours des 5 années précédentes - 12 adultes autistes ont fourni des informations sur 14 interactions, et 19 parents ont fourni des informations sur 25 interactions séparées que leurs fils ou leurs filles avaient vécues. Ces interactions étaient liées à six contextes différents : victime d'un crime, suspect, témoin, trafic, demande d'assistance (fugue) et demande d'assistance (effondrement) (voir tableau 3).
Dans la plupart (92,3 %) des 39 interactions décrites par les participants, une ou plusieurs des caractéristiques autistiques des individus ont été décrites comme ayant un rôle dans leur interaction avec la police. C'était le cas pour 13 des 14 interactions décrites par les adultes autistes, et pour 23 des 25 cas où les parents ont décrit les interactions de leur enfant avec la police.
Comme le montrent les tableaux 4 et 5, dans leurs descriptions des interactions de la personne autiste avec la police, les participants ont fourni des informations sur deux façons différentes dont les traits autistiques de la personne ont joué un rôle dans l'interaction avec la police : premièrement, comme cause directe de l'interaction avec la police ; deuxièmement, comme affectant ce qui s'est passé pendant l'interaction.
Les caractéristiques autistiques ont joué un rôle dans l'implication avec la police
Dans 21 (54%) des 39 interactions signalées par l'ensemble des participants aux entretiens, leurs interactions avec la police ont été le résultat direct d'une ou plusieurs des caractéristiques autistiques de la personne. C'était plus souvent le cas pour les interactions.
Tableau 2 Caractéristiques de l'autisme (caractéristiques essentielles de l'autisme et conditions concomitantes) telles que rapportées par les participants (...) Problèmes de santé mentale - en général Problèmes de santé mentale non spécifiés signalés par les parents (68 %) par rapport à ceux signalés par les adultes autistes (28,6 %).
Sur les 12 participants adultes autistes, quatre (33 %) ont décrit une série de caractéristiques autistiques comme étant causales à leur l'interaction avec la police, y compris leurs aptitudes relationnelles, leur préférence pour la routine, la certitude et les schémas de pensée fixes, les problèmes de santé mentale et les difficultés de régulation des émotions.
Tableau 3 Contexte des interactions signalées par les adultes autistes et les parents/soignants
Tableau 4 Nombre d'interactions où une caractéristique autistique a joué un rôle dans l'interaction avec la police, par déclarant et âge de la personne autiste
- Adulte autiste : L'une des choses les plus importantes, je suppose, a été que j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon service de santé mentale et que cet environnement était tellement mauvais pour moi que j'ai fini par avoir des crises de nerfs et tout ça et ils ont appelé la police.
Interviewer : Qu'avez-vous fait pour qu'ils appellent la police ?
Adulte autiste : J'ai été accusé de dommages matériels, mais aussi d'agression, non pas parce que j'avais frappé ou touché physiquement une personne, mais à cause de mes manières, ils étaient effrayés. (Adulte autiste n°19, femme, 25-39 ans) - Adulte autiste : "Le policier m'a suivi et je suis sorti de la voiture, et j'ai dit "Puis-je vous aider ?" et il a dit "Avez-vous un problème avec vos feux arrière ?" et j'ai répondu "Non, je n'en ai pas", je veux dire, je voyageais juste comme d'habitude. Parfois, j'essaie de maintenir ma vitesse, par exemple en appuyant sur l'accélérateur, puis sur le frein, juste pour m'assurer que je roule exactement à la bonne vitesse et que je roule constamment à la bonne vitesse.
Interviewer : Pensez-vous qu'il vous a vu freiner puis ne pas freiner, freiner puis ne pas freiner parce que c'est comme ça qu'on maintient sa vitesse, et il se demande ce qui se passe ici.
Un adulte autiste : Ouais. (Adulte autiste n°3, homme, 40-64 ans).
Sur les 25 interactions décrites par les parents en relation avec leurs enfants autistes (d'âge scolaire et jeunes adultes), 17 interactions ont fait référence à une ou plusieurs caractéristiques autistiques comme étant à l'origine de l'interaction de leur enfant avec la police. Pour ces interactions rapportées par les parents, les causes les plus fréquentes étaient le manque de conscience des situations sociales menant à la fugue (7) et l'effondrement avec violence (7).
- " ... mon mari se promenait dans le parc, un parc assez grand, et il faisait la queue pour aller aux toilettes, alors il est allé aux toilettes, mais (le fils) est obsédé par l'eau, et en deux minutes ou même une minute quand il est sorti des toilettes, il ne l'a pas trouvé. Il errait donc et m'a téléphoné ... et il a dit "Je ne trouve pas (fils)" alors j'ai appelé la police et j'ai fait un signalement. (Fils) a un très mauvais contrôle de lui-même et de ses impulsions, donc il est manifestement dans le lac, il ne peut pas attendre une minute pendant que vous êtes aux toilettes ... il est très motivé par la recherche sensorielle et il n'a pas vraiment le sens du danger, il va juste dans l'eau, il avait des chaussures et tout, mais il n'avait aucune inquiétude pour sa sécurité, il manque donc d'indépendance dans ces domaines". (FAM #27, Parent d'un homme autiste, 6-11 ans).
- "...il y a eu une nuit où je l'ai emmené en ville parce que je pensais qu'il avait besoin de sortir et dans la ville j'ai dû appeler la police de Centrepoint parce qu'il ne voulait pas bouger, nous étions là depuis une heure et je n'ai pas pu le faire bouger, c'est parce qu'il avait tout arrêté, et ils sont sortis et ils nous ont aidés et nous sommes arrivés à Wynyard. Puis il s'est enfui, et c'était la nuit, alors je les ai appelés, et la même police est sortie. Ils étaient vraiment bons, ils disaient "Ne vous inquiétez pas, nous le trouverons" et nous l'avons trouvé, il s'était recroquevillé dans un coin en haut de la gare de Wynyard. (FAM n°44, parent d'un homme autiste, 12-17 ans).
- "... il venait de se réveiller et il était en train de faire une crise, comme une énorme crise, et je ne sais pas d'où ça venait. D'habitude, je peux essayer de le calmer ou de le laisser faire, mais il devenait très agressif et il se mettait à balancer ses bras. Maman a 88 ans et ne mesure même pas 1,50 m, et il mesure 1,80 m, c'est un grand garçon, et j'ai eu peur pour nous, il criait, pleurait et hurlait. Alors j'ai J'ai appelé une ambulance et j'ai dit : "Regardez, mon fils a 16 ans, il est autiste, il est en pleine crise et je ne peux pas le calmer, pouvez-vous envoyer quelqu'un" et ils pouvaient l'entendre crier dans le fond. Alors la minute suivante, ces trois grands policiers sont à la porte d'entrée, parce que l'ambulance les avait appelés parce qu'ils pouvaient l'entendre". (FAM #52, Parent d'un homme autiste, 12-17 ans).
Tableau 5 Nombre d'interactions où la caractéristique autistique a eu un impact sur l'interaction
Caractéristique autistique affectant le déroulement de l'interaction
Dans 32 (82 %) des 39 interactions, les descriptions des participants comprenaient des informations sur la manière dont une ou plusieurs caractéristiques autistiques affectaient le déroulement ou le résultat de l'interaction, en affectant soit le comportement, l'attitude ou la capacité de la personne autiste, soit le ou les agents de police.
Pour les participants adultes autistes, toutes les interactions, sauf une, ont été décrites comme étant affectées par une ou plusieurs de leurs caractéristiques autistiques. Les caractéristiques qu'ils ont le plus souvent décrites comme ayant une incidence sur la conduite ou le résultat de l'interaction avec la police étaient leurs compétences relationnelles (7 interactions), et leur préférence pour la routine, la certitude et les schémas de pensée fixes, y compris l'interprétation littérale du langage (7 interactions).
- Je pense que cela me laisse très incompris, ce qui entraîne beaucoup de frustration, et aussi je prends les choses un peu différemment et parfois la police pense que vous êtes un peu intelligent, mais en fait vous ne l'êtes pas, c'est juste une partie de votre autisme. Mais c'est surtout le fait d'être mal compris qui est important (Autiste adulte n°2 homme, 25-39 ans).
- J'ai donc commencé à me disputer avec ce policier, incapable de voir ce qu'il disait, parce qu'il ne le répétait pas d'une certaine manière... ce n'était pas clair pour moi, donc c'était une période où le fait d'être sur le spectre me bloquait ou était un problème pour moi parce que cela rendait la chose difficile à comprendre. C'était difficile pour eux de me comprendre et pour moi de les comprendre (adulte autiste n°19, femme, 25-39 ans).
- Je comprends, d'après mon expérience, qu'il est tout à fait possible qu'on leur apprenne à poser des questions ambiguës ou des questions ouvertes afin que les gens leur donnent des informations sans s'en rendre compte. Je n'en sais rien. Peut-être sont-ils formés pour poser des questions de cette manière, mais je trouve cela vraiment difficile, mais je suis une personne honnête et si vous me posez une question directe, je vous répondrai directement si je me trompe ou non. Je serai toujours ouvert et honnête quelle que soit ma réponse. Je sais qu'ils n'attendent pas cela des gens. Vous dites que j'ai peut-être besoin d'avoir un panneau sur moi qui dit "Je suis autiste". Si vous voulez me poser une question, posez-la correctement ou demandez-moi exactement ce que vous voulez savoir. Une fois, je faisais du jogging sur la route, la voiture de police s'est arrêtée et m'a dit : "Depuis combien de temps courez-vous ?" et mon cerveau m'a dit : "Ok, maintenant est-ce qu'ils veulent dire jusqu'où je suis allé aujourd'hui ? Et jusqu'où dois-je aller ? Est-ce qu'ils veulent dire depuis combien de temps je pratique ce sport de course ?" Je n'ai pas compris ce qu'ils signifient et j'ai donc dit environ 5 ans. Ce qui n'était pas ce qu'ils essayaient de découvrir. (Adulte autiste n°56, femme, 40-64 ans).
Sur les 25 interactions décrites par les parents en rapport avec les interactions de leurs enfants autistes d'âge scolaire ou de jeunes adultes, le déroulement ou le résultat de 76 % de ces interactions ont été décrits comme étant affectés par une ou plusieurs des caractéristiques autistiques de leur enfant. Les caractéristiques les plus souvent décrites comme affectant le déroulement ou le résultat de l'interaction étaient les compétences linguistiques de l'enfant (10 interactions), les difficultés de régulation des émotions (7 interactions) et un éventail de compétences relationnelles (5 interactions).
- Oui, ils lui ont parlé, mais avec mon fils, il faudrait peut-être lui poser des questions de trois manières différentes, et même moi je dois le faire parfois, parce que les deux premières façons qu'il ne comprend pas, ça pourrait être parce qu'il est au pied de la lettre, ça pourrait être à cause de son trouble de traitement, qui sait, il ne peut pas me le dire lui-même. Je sais donc qu'il faut parfois être créatif dans la façon de poser la question, et ne pas essayer de l'amener à donner une réponse que l'on veut entendre. Ils n'étaient donc pas du tout intéressés à explorer cela pour qu'il puisse avoir une voix. (FAM#1, parent d'un homme autiste de 12 à 17 ans).
- La première fois, il y avait juste une interaction dans notre rue, et la police faisait du porte à porte dans toute la rue. Ils sont entrés dans notre cour, ont frappé à la porte, et (fils) s'est excité, a sauté et a couru pour embrasser le policier. Et c'est un grand garçon, même si c'était il y a quelques années, il était assez grand et il peut avoir l'air tout à fait normal. Et son coéquipier, qui n'avait pas encore franchi le portail, pensait en fait que (le fils) cherchait son arme, parce qu'il était assez exubérant quand il a sauté du canapé et a en quelque sorte couru vers elle. J'étais en train de faire la lessive sur la corde à linge à ce moment-là et je l'ai vu chercher son arme, et je me suis dit "Non, s'il te plaît, ne fais pas ça ! Il est autiste. S'il vous plaît, ne faites pas..." (FAM#38, parent d'un homme autiste, 12-17 ans).
- "Je leur ai dit, mon fils est autiste. Il ne saura pas où il vit pour pouvoir rentrer, il ne pourra pas communiquer avec vous, il ne pourra pas vous dire comment rentrer chez vous même s'il le voulait. Il risque de marcher sur la route lorsqu'il est dans cet état d'esprit de rythme qu'il n'observe pas du tout. Il risque de se faire renverser par une voiture. Il risque de sauter dans la rivière si quelque chose se trouve sur sa route sans savoir nager (FAM n°39, parent d'un homme autiste, 6-11 ans).
Dans deux cas, les parents ont décrit des niveaux élevés d'anxiété lors de leurs interactions avec la police, ce qui a provoqué l'effondrement ou la rupture [meltdown or shutdown] de leur enfant.
- Ces policiers sont immédiatement allés le mettre à l'aise, le toucher ou simplement l'attraper, et la situation s'aggrave généralement à partir de là. C'est énorme, surtout s'il est énervé et qu'il fait de son mieux, qu'il fait les cent pas et qu'il essaie de se calmer ou qu'il essaie de traiter quelque chose et que quelqu'un vient et pose physiquement ses mains sur vous plutôt que de rester en arrière et de regarder, puis il explose tout simplement. (FAM #39, parent d'un homme autiste, 6-11 ans).
Perceptions des participants concernant les interactions où l'autisme a joué un rôle
Au cours des entretiens, les participants ont également exprimé des perceptions positives ou négatives sur les interactions. Ces données ont été codées comme étant des perceptions positives ou négatives. Une tabulation croisée a été utilisée pour analyser toute association de ces perceptions avec le type d'impact qu'une caractéristique autistique a eu sur une interaction. Le tableau 6 présente les résultats de cette analyse. Dans les cas où la caractéristique autistique était causale à l'interaction, un nombre relativement égal de perceptions positives et négatives ont été exprimées à propos de l'interaction. Cependant, dans les cas où une caractéristique autistique a affecté le déroulement ou le résultat de l'interaction, en affectant soit le comportement, l'attitude ou la capacité de la personne autiste, soit le ou les agents de police, la majorité des perceptions des participants concernant l'interaction étaient négatives.
Discussion
Dans le cadre d'une étude plus vaste sur les interactions des personnes autistes avec la police en Australie, cette étude est l'une des premières à examiner de manière intentionnelle et systématique le rôle que les caractéristiques autistes jouent lors des interactions avec la police dans toute une série de contextes et de circonstances. Il est important de noter que cet examen a été basé sur la façon dont les adultes autistes et les parents d'autistes ont perçu les interactions d'une personne autiste avec la police et fournit des preuves claires qu'il est très probable dans la plupart des situations que l'autisme d'une personne jouera d'une certaine façon un rôle dans ses interactions avec la police.
Dans cette étude, 12 adultes autistes et 19 parents d'enfants et de jeunes adultes autistes ont décrit 39 interactions distinctes avec la police au cours des 5 années précédentes. L'analyse de contenu a montré que dans la plupart des interactions, une ou plusieurs caractéristiques autistiques étaient décrites comme ayant un rôle à jouer dans l'interaction. Les caractéristiques autistiques ont été considérées comme jouant un rôle dans les interactions de deux façons : premièrement, comme une cause directe de l'interaction et deuxièmement, comme affectant ce qui s'est passé pendant l'interaction. Le plus souvent, lorsque l'autisme d'une personne affecte l'interaction, la personne autiste ou son parent/soignant a une perception négative de la rencontre.
Ces résultats viennent s'ajouter à l'ensemble des connaissances sur la nature des interactions entre les personnes autistes et la police, car à ce jour, il y a eu très peu de recherches sur l'impact des caractéristiques des autistes lors d'une interaction avec la police. La plupart des recherches antérieures se sont limitées à des études menées auprès de jeunes hommes adultes et se sont concentrées sur la façon dont l'autisme d'une personne peut avoir attiré l'attention de la police dans le contexte d'un comportement délinquant uniquement (Allely et Creaby-Attwood 2016 ; Mogavero 2016 ; Mouridsen 2012). La présente étude a étendu la recherche sur ce sujet en examinant des témoignages relatifs à des hommes et des femmes, dont l'âge varie entre celui des enfants d'âge scolaire et celui des adultes plus âgés, et qui représentent un large éventail de capacités fonctionnelles. Elle a également élargi le champ des recherches existantes en examinant les interactions dans six contextes différents où une personne autiste a interagi avec la police - en tant que victime d'un crime, suspect, témoin, en tant que personne impliquée dans la circulation, dans une demande d'assistance (fugue) et dans une demande d'assistance (effondrement).
Grâce à cet échantillonnage élargi, la présente étude a montré que lorsque les caractéristiques autistiques conduisaient à une interaction avec la police, plutôt que dans le contexte d'un crime ou d'un suspect, c'était le plus souvent dans le contexte de parents demandant de l'aide à la police, lorsqu'un enfant était en crise ou s'était enfui. En outre, dans notre étude, il était beaucoup plus fréquent, dans l'ensemble, que l'impact des traits autistiques d'une personne affecte une interaction, plutôt que de la précipiter.
Il n'est pas surprenant que lorsque les caractéristiques autistiques avaient un impact sur une interaction avec la police, cet impact était perçu par les personnes autistes ou leurs parents/tuteurs comme étant préjudiciable pour eux ou leurs enfants dans cette situation. Cette conclusion s'appuie sur des recherches antérieures qui ont mis en évidence des niveaux élevés d'insatisfaction par rapport aux rencontres avec la police pour les personnes autistes (Crane et al. 2016 ; Gibbs et Haas 2020 ; Salerno et Schuller 2019). Notre étude a analysé des comptes rendus narratifs de première main sur différents types d'interactions afin de mettre en lumière les mécanismes qui pourraient être à l'origine du mécontentement exprimé par de nombreuses personnes autistes, et par les membres de leur famille en leur nom, à propos des rencontres avec la police. Sur la base de ces récits de première main, l'autisme d'une personne a eu un impact sur presque toutes les interactions avec la police en affectant directement soit le comportement, l'attitude ou la capacité de la personne autiste, soit le(s) policier(s). Un certain nombre de caractéristiques essentielles de l'autisme
Tableau 6 Perceptions des participants concernant les interactions dans lesquelles l'autisme a joué un rôle (...)
Parmi les difficultés rencontrées, on note des difficultés de prise de perspective, la naïveté sociale, l'interprétation littérale du langage, le manque de sensibilisation aux conventions sociales, les sensibilités sensorielles, la préférence pour la routine et l'interprétation littérale du langage, qui ont un impact sur les interactions avec la police. Ceci est cohérent avec les recherches précédentes qui ont montré que des difficultés spécifiques dans les interactions sociales, des intérêts obsessionnels et une rigidité sont associés à un comportement délinquant (Helverschou et al. 2015, 2018 ; Murrie et al. 2002).
En plus des caractéristiques essentielles de l'autisme ayant un impact sur les interactions avec la police, la présente étude a montré que des conditions concomitantes telles que des difficultés de langage, des problèmes de santé mentale et des difficultés de régulation des émotions avaient également un impact sur les interactions avec la police. Les participants ont donné de nombreux exemples de difficultés d'élocution et de langage affectant leurs interactions, tant en termes de difficulté à comprendre le policier et ses instructions qu'en termes de capacité à communiquer avec le policier ou à répondre aux questions de manière efficace.
Les participants ont également fourni un certain nombre de cas où des problèmes de santé mentale, en particulier l'anxiété, ont eu un impact sur leur capacité à s'engager dans l'interaction, entraînant parfois une frustration de la part du policier, telle que perçue par la personne autiste ou ses parents. Les difficultés de régulation émotionnelle ont également eu un impact sur les interactions, provoquant chez les personnes une certaine accablement et une "fermeture" pendant l'interaction avec la police. Ces conclusions sont conformes aux études portant sur les interactions entre la police et les personnes souffrant de déficience intellectuelle et de troubles mentaux. Il a été démontré que les deux groupes ont des taux d'interaction avec la police plus élevés et une vulnérabilité accrue lors des rencontres avec la police en raison de la naïveté sociale, d'une mauvaise perception et de difficultés de communication (King et Murphy 2014 ; Baldry et al. 2012)
La portée étendue de ces résultats souligne la valeur de l'approche phénoménologique adoptée dans les entretiens, où les participants ont été invités à décrire leur propre expérience dans leurs propres mots et de leur propre point de vue, plutôt que de répondre à des questions basées sur une prémisse préconçue sur le rôle de l'autisme dans leurs interactions avec la police.
Cette étude présente un certain nombre de limites. Elle a été menée avec un petit échantillon de 31 participants, et le diagnostic d'autisme a été posé par les participants eux-mêmes. Les participants se sont portés volontaires pour participer à l'étude et ne constituent donc peut-être pas un échantillon représentatif des types d'incidents dans lesquels les personnes autistes sont impliquées avec la police, et peuvent être ceux qui souhaitent le plus souvent partager une expérience négative. Cependant, un certain nombre de parents/responsables d'enfants ont déclaré avoir participé à l'étude dans le but de partager les expériences positives de leur enfant avec la police. Les expériences des personnes autistes avec la police australienne ne sont pas nécessairement représentatives des expériences dans d'autres juridictions où la reconnaissance et la compréhension de l'autisme par un policier peuvent être différentes en raison de la sensibilisation générale de la société ainsi que de l'offre d'une formation spécialisée. Nos conclusions sur l'impact des caractéristiques autistiques sur les interactions se limitent aux points de vue des personnes autistes et des membres de leur famille. Une compréhension plus complète pourrait être obtenue en entreprenant des études d'observation de rencontres réelles, ou en obtenant le point de vue de l'agent de police et de la personne autiste sur la même rencontre.
Nos conclusions selon lesquelles les caractéristiques des autistes, tant les caractéristiques de base que les conditions concomitantes, ont un impact négatif sur le déroulement des rencontres avec la police indiquent que les personnes autistes sont désavantagées lors de ces rencontres, ce qui a des implications importantes pour leur accès équitable au système judiciaire. Comme le note Ortoleva (2011), "Tant que les personnes handicapées seront confrontées à des obstacles à leur participation au système judiciaire, elles ne pourront pas assumer pleinement leurs responsabilités en tant que membres de la société ou faire valoir leurs droits. Pour cette raison, il est important que les obstacles soient supprimés afin que les personnes handicapées puissent bénéficier de l'égalité des chances dans l'exercice de leurs fonctions en tant que parties, témoins, jurés, avocats, procureurs, juges, arbitres et autres participants à l'administration de la justice".
À cette fin, les conclusions indiquent également l'importance de la formation des policiers afin que l'impact de l'autisme puisse être atténué. Les interactions négatives avec la police peuvent avoir une influence durable sur les attitudes et les comportements envers l'autorité et peuvent affecter la coopération et conduire à une sous-déclaration de la victimisation et à une réticence à demander de l'aide lorsqu'ils en ont besoin (Hinds 2009).
La police peut être informée des adaptations telles que les aides à la communication et les aides sensorielles qui peuvent réduire l'anxiété des personnes autistes et également réduire la probabilité de malentendus tant de la part des personnes autistes que des policiers. Dans une étude récente, des adultes autistes ont parlé de la vulnérabilité accrue découlant de leurs différences de communication et de l'importance pour les autres de comprendre cela et d'adapter leur style de communication pour faciliter la vie des personnes autistes (Cummins et al. 2020). Il est toutefois important de noter que même avec la mise en place de programmes de formation sur l'autisme pour la police, il est irréaliste d'attendre des policiers qu'ils reconnaissent qu'une personne peut être autiste dès le premier contact. Les personnes autistes et les membres de leur famille doivent se sentir en confiance pour révéler leur diagnostic à la police en espérant que cela conduira à un soutien et une compréhension accrus plutôt que d'être perçues à travers des stéréotypes négatifs.
Plutôt que de se concentrer uniquement sur la formation de la police, il pourrait également être bénéfique de fournir aux personnes autistes une formation sur la police et leurs droits lors de ces rencontres, par exemple sur les contrôles routiers de routine, les informations qu'elles doivent fournir à la police, leur droit de demander un aménagement/un soutien, la signification d'une mise en garde de la police.
Conclusion
En examinant systématiquement les témoignages d'un échantillon de personnes autistes et de leurs parents, et en élargissant le champ de la recherche sur ce sujet pour inclure une représentation plus complète de l'âge, du sexe et des capacités fonctionnelles dans un éventail de contextes, cette étude a pu mettre en lumière le rôle que jouent les caractéristiques des autistes lors de leurs interactions avec la police. Les conclusions selon lesquelles, dans la plupart des interactions, une ou plusieurs caractéristiques autistiques ont joué un rôle dans l'interaction, soit comme cause directe de l'interaction, soit plus souvent en ayant un impact négatif sur ce qui s'est passé pendant l'interaction, apportent un éclairage supplémentaire sur les facteurs qui sont à l'origine de l'insatisfaction déclarée par de nombreux autistes à l'égard des interactions avec la police. Cela souligne l'importance de la formation de sensibilisation à l'autisme pour la police, afin de s'assurer que les personnes autistes sont en mesure de s'engager pleinement dans cet aspect du système judiciaire.



