spectrumnews.org Traduction de "In search of ‘social’ subtypes of autism | Spectrum | Autism Research News" / 21 juillet 2020
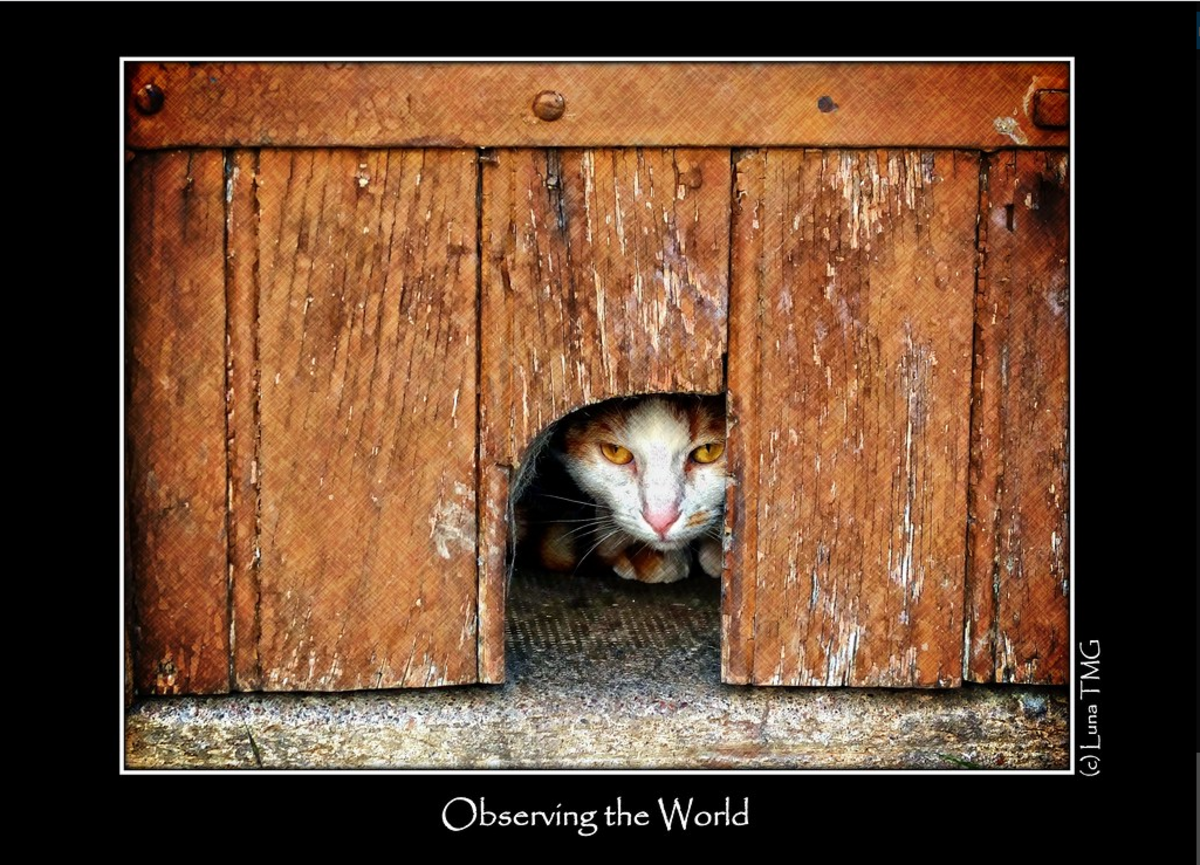
Agrandissement : Illustration 1
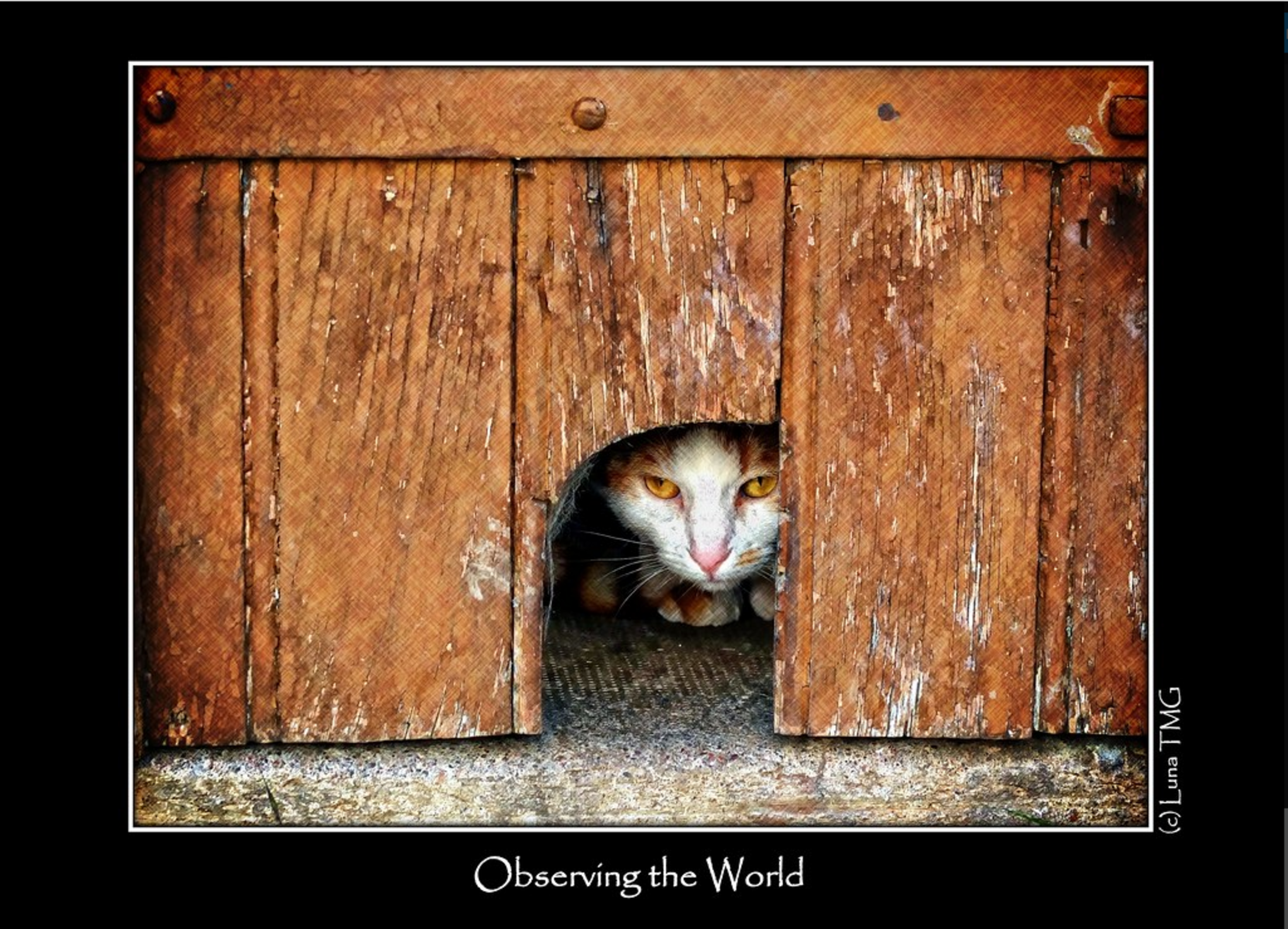
Expert - Mirko Uljarević, chercheur principal, École des sciences psychologiques de l'Université de Melbourne dans l'État de Victoria, Australie
Expert - Thomas Frazier, Professeur de psychologie, Université John Carroll à University Heights, Ohio
Les difficultés sociales sont considérées comme une caractéristique déterminante de l'autisme depuis que Leo Kanner a publié les premières descriptions cliniques de la condition en 1943. Cependant, les personnes autistes peuvent présenter une variabilité frappante dans leur fonction sociale : certains manquent d'intérêt social et de conscience des autres et ont une capacité limitée à communiquer. D'autres s'intéressent vivement à la formation de liens sociaux et communiquent facilement leurs besoins, leurs pensées et leurs émotions.
Compte tenu de ces différences, toutes les personnes autistes n'ont pas les mêmes besoins en matière d'intervention, et les différents types de soutien sont plus ou moins efficaces selon les forces et les limites sociales de chacun.
Malgré la nécessité évidente de mieux comprendre les différences de compétences sociales dans l'autisme, il y a eu étonnamment peu de tentatives pour identifier des groupes de personnes autistes présentant des profils similaires de forces et de vulnérabilités. Les études antérieures, bien qu'instructives, se sont surtout concentrées sur des comportements et des caractéristiques particuliers, sans prendre en compte d'autres aspects importants du fonctionnement social 1,2,3.
Pour naviguer dans le monde social, il faut posséder une série de compétences de base qui, si elles sont altérées, peuvent créer les difficultés sociales que nous observons chez les personnes autistes. Ces compétences comprennent la motivation sociale, ou le désir d'interagir et de se lier avec d'autres personnes ; la communication sociale, ou la capacité à transmettre des informations sociales et émotionnelles à d'autres personnes par divers moyens, tels que le contact visuel, l'expression faciale, les gestes, le langage corporel et le ton de la voix ; et la reconnaissance sociale, ou la capacité à percevoir et à interpréter les informations communiquées par d'autres personnes.
Les chercheurs et les cliniciens disposent de plusieurs excellents outils pour diagnostiquer l'autisme et mesurer sa sévérité globale, mais pour mieux comprendre les points forts et les besoins d'une personne autiste, ils doivent également être capables de mesurer les compétences sociales essentielles. Nous avons développé l'échelle des dimensions sociales de Stanford (SSDS - Stanford Social Dimensions Scale) spécialement à cette fin.
Nous avons conçu la SSDS à partir d'une analyse exhaustive de la littérature et en consultation avec des experts et des cliniciens spécialisés dans l'autisme. Nous avons montré qu'elle est valable et permet une évaluation complète des différents aspects de la motivation sociale, de la communication sociale et de la reconnaissance sociale 4. Nous pensons que ce travail représente un pas important vers la découverte des origines des difficultés sociales dans l'autisme et l'élaboration de plans d'intervention et de gestion de dossier personnalisés pour les personnes autistes. Nous pensons également que ces travaux peuvent être utiles et instructifs pour comprendre le fonctionnement social dans d'autres conditions neurodéveloppementales et neuropsychiatriques.
Profils sociaux
Nous avons utilisé la SSDS dans une étude portant sur 164 enfants et adolescents autistes âgés de 2 à 17 ans. Les parents de ces enfants ont rempli le questionnaire et plusieurs autres mesures des traits autistiques, des niveaux d'anxiété et des problèmes de comportement de leur enfant. En utilisant une approche basée sur les données, nous avons classé les participants en fonction de leurs scores dans des domaines spécifiques de la SSDS, révélant ainsi cinq sous-groupes distincts 5.
Les sous-groupes que nous avons identifiés pourraient être utiles aux cliniciens qui choisissent les traitements. Par exemple, un sous-groupe de personnes autistes a montré des forces en matière de reconnaissance sociale et de motivation, mais une faiblesse en matière de communication expressive. Ce sous-groupe présentait également des niveaux élevés d'anxiété. Ces personnes pourraient bénéficier d'interventions visant spécifiquement à améliorer les compétences de communication sociale et à réduire l'anxiété. Un deuxième sous-groupe a montré des forces relatives dans tous les domaines sauf la reconnaissance sociale, qui pourrait être un domaine d'intérêt dans leurs traitements.
Outre les avantages cliniques, l'étude de groupes de personnes autistes présentant des profils sociaux similaires pourrait accroître la capacité des chercheurs à détecter les mécanismes neurobiologiques sous-jacents à des traits particuliers de l'autisme. Il est possible, voire probable, que des aspects spécifiques de la motivation sociale fassent apparaître des mécanismes distincts les uns des autres et des processus de communication sociale.
Bien que prometteuses, nos conclusions sont préliminaires. Nous prévoyons de mener des études qui pourraient fournir une validation plus solide de la SSDS et des normes plus précises, afin de mieux identifier les schémas chez les individus par rapport à leurs pairs typiques et aux autres personnes autistes. Les études futures devront également valider la SSDS en utilisant un éventail plus large d'évaluations, y compris des mesures plus objectives telles que le suivi des yeux. Ces études devront également suivre les jeunes de différents sous-groupes au fil du temps afin de saisir les trajectoires à plus long terme du comportement social.
Au niveau de la recherche fondamentale, il sera important de tester si les sous-groupes que nous avons identifiés présentent des différences en neurobiologie et répondent à des interventions spécifiques.
La SSDS pourrait également être utilisée chez des personnes souffrant d'autres troubles du développement neurologique afin de mieux comprendre leur profil social. Étant donné que la plupart des personnes sur le spectre montreront des problèmes dans la plupart des domaines du fonctionnement social, les sous-groupes que nous avons identifiés pourraient ne pas s'appliquer aux personnes souffrant d'autres conditions. Cette approche s'aligne sur les vues dimensionnelles des troubles neurodéveloppementaux, telles que les critères du domaine de recherche proposés par l'Institut national de la santé mentale 6. Se concentrer sur les traits plutôt que sur les critères de diagnostic est très prometteur pour le développement de la médecine de précision.

Mirko Uljarević est chercheur principal à l'École des sciences psychologiques de l'Université de Melbourne, dans l'État de Victoria, en Australie. Thomas W. Frazier est professeur de psychologie à l'université John Carroll à University Heights, dans l'Ohio.

Références:
- Wing L. and J. Gould J. Autism Dev. Disord. 9, 11-29 (1979) PubMed
- Livingston L.A. et al. J. Child Psychol. Psychiatry 60, 102-110 (2019) PubMed
- Kang E. et al. J. Clin. Child Adolesc. Psychol. 49, 251-263 (2020) PubMed
- Phillips J.M. et al. Mol. Autism 10, 48 (2019) PubMed
- Uljarević M. et al. Autism Res. Epub ahead of print (2020) PubMed
- Insel T. et al. Am. J. Psychiatry 167, 748-751 (2010) PubMed



