spectrumnews.org Traduction de "Gut microbiome meta-analysis reveals consistent autism signal"
Une méta-analyse du microbiome intestinal révèle un signal cohérent en faveur de l'autisme
Calli McMurray - 22 août 2023
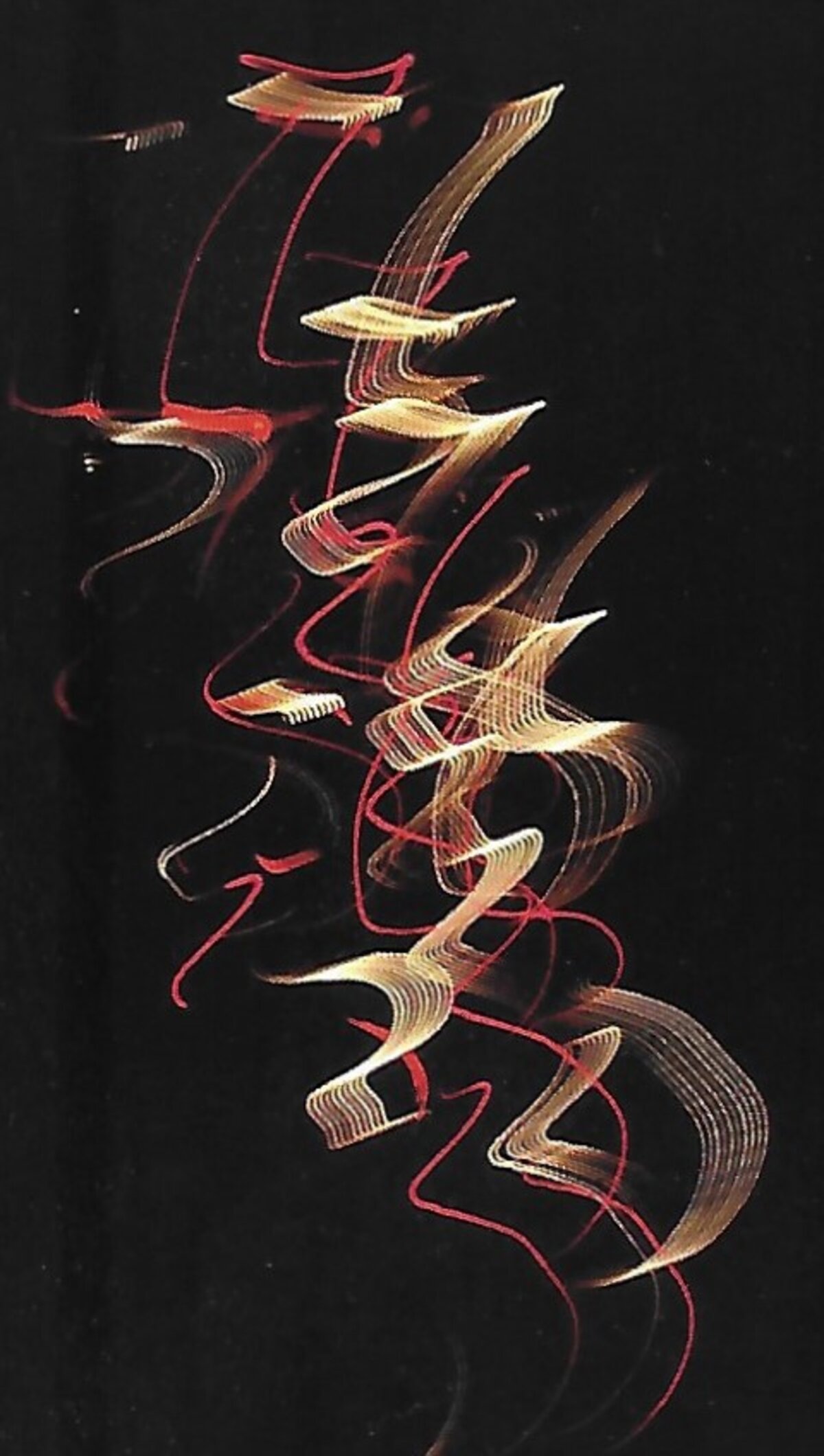
Agrandissement : Illustration 1
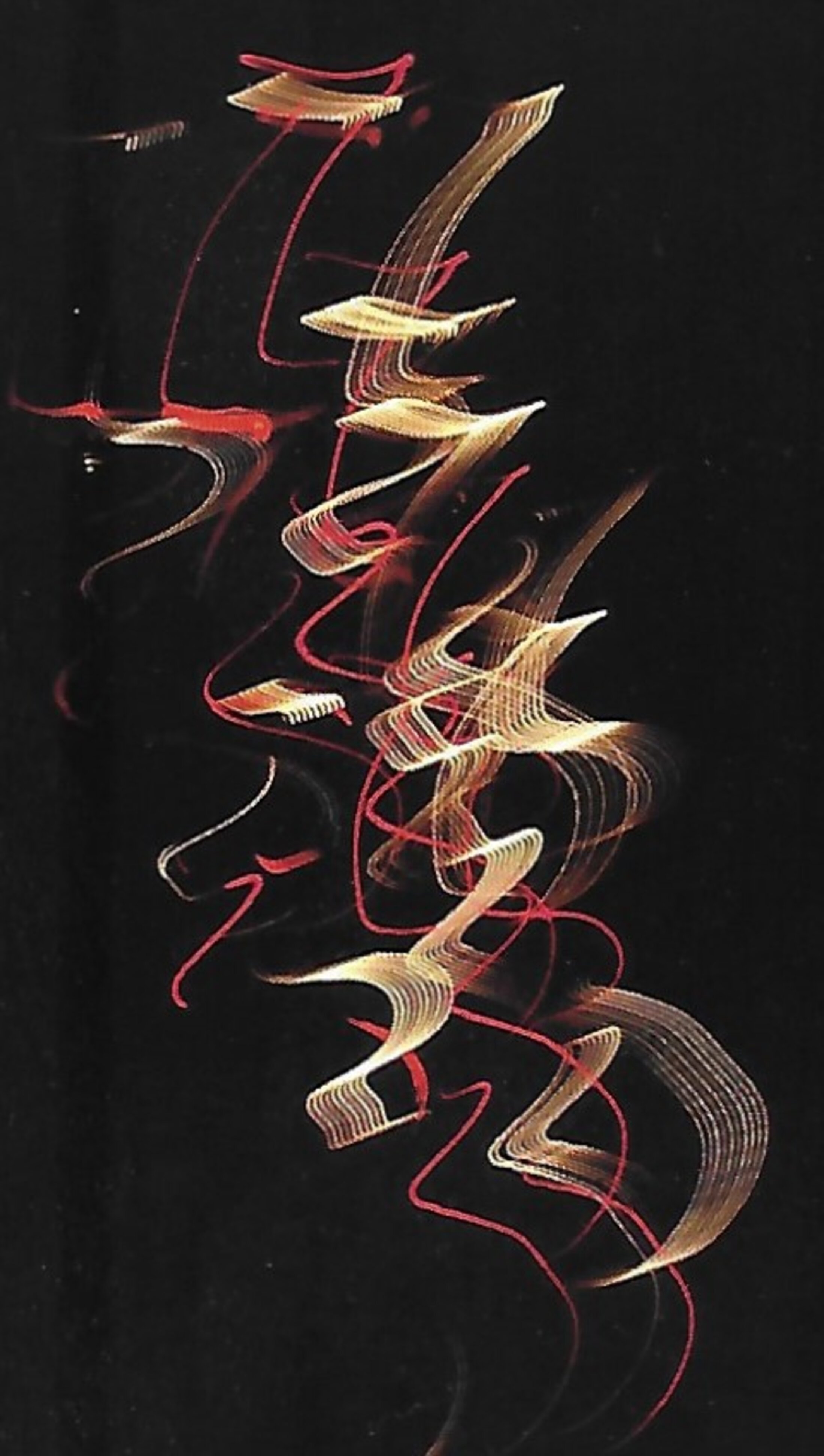
Malgré une décennie de résultats contradictoires, les microbiomes des enfants autistes et non autistes diffèrent bel et bien, selon une méta-analyse récente de 10 études et de 15 grands ensembles de données.
"Il ne s'agit pas encore d'un diagnostic, et nous n'avons pas encore établi de relation de cause à effet", déclare James Morton, cochercheur principal et ancien chercheur associé à la Simons Foundation, l'organisation mère de Spectrum. Mais, ajoute-t-il, "cette [méta-analyse] nous a donné un aperçu de la cohérence de ces signaux dans toutes ces études".
Dans la méta-analyse, les métabolites produits par les voies métaboliques microbiennes et cérébrales divergeaient entre les enfants autistes et non autistes. En outre, 591 microbes étaient plus fréquents chez les enfants autistes et 169 microbes étaient plus fréquents chez les enfants non autistes. Les signatures de chaque groupe étaient en corrélation avec les habitudes alimentaires, les niveaux de molécules immunitaires appelées cytokines et les profils d'expression génétique dans le cerveau, ce qui indique qu'elles reflètent une relation globale entre l'autisme et le microbiome.
"Ils ne sont pas en mesure de fournir des voies concrètes, des bactéries spécifiques interagissant avec des récepteurs spécifiques chez l'homme, mais ils trouvent un modèle généralisé de différences qui persiste entre les études", déclare Thomaz Bastiaanssen, chercheur postdoctoral et bioinformaticien principal dans le laboratoire de John Cryan à l'University College Cork en Irlande, qui n'a pas été impliqué dans l'étude. "En ce sens, je pense qu'il s'agit plutôt d'une confirmation de l'existence de quelque chose, mais ce qu'il en est exactement reste encore très flou."
Des dizaines d'études ont déjà cherché une signature microbienne de l'autisme dans des échantillons de selles de personnes et ont rapporté des résultats contradictoires. La plupart ont montré que les microbes intestinaux diffèrent entre les personnes autistes et non autistes, mais l'ampleur de la différence et les microbes exacts impliqués varient d'une étude à l'autre. Une étude réalisée en 2021 est venue compliquer encore davantage ces résultats en suggérant que toute différence de microbiome liée à l'autisme chez les enfants autistes pouvait être attribuée à un régime alimentaire moins varié.
Le problème réside en partie dans le fait que la plupart des études étaient transversales et ne représentaient donc le microbiome qu'à un moment donné. En outre, les études comparaient des moyennes entre les groupes autistes et non autistes, au lieu d'analyser les données au niveau de chaque participant.
"Comme la plupart des études ont été réalisées de cette manière, beaucoup d'informations ont été perdues", explique Gaspar Taroncher-Oldenburg, cochercheur principal, directeur des alliances thérapeutiques à l'université de New York et consultant en résidence à la Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI).
Taroncher-Oldenburg, Morton et leurs collègues ont adopté une approche différente. Ils ont mis au point un algorithme statistique qui a permis d'harmoniser les données de toutes les études et ont ensuite comparé un total de 528 personnes autistes à 528 témoins non autistes appariés selon l'âge et le sexe. Les résultats ont été publiés en juin dans Nature Neuroscience.
"Il s'agit d'un véritable tour de force statistique", déclare Bastiaanssen.
Les études sur le microbiome utilisent généralement les frères et sœurs des participants autistes comme témoins, car cela permet de réduire l'effet de l'environnement, explique le chercheur de l'étude, Maude David, professeure adjointe de microbiologie à l'université d'État de l'Oregon, à Corvallis. Les frères et sœurs qui vivent dans la même maison ont tendance à avoir des microbes intestinaux similaires parce qu'ils boivent la même eau, mangent des aliments provenant des mêmes magasins et interagissent avec les mêmes animaux de compagnie, explique-t-elle.
Mais la fratrie ne constitue pas un contrôle parfait, car le microbiome intestinal change avec l'âge. Dans la méta-analyse, le signal associé à l'autisme a disparu lorsque l'équipe a analysé les données de personnes autistes appariées à des frères et sœurs témoins.
Les résultats indiquent que les chercheurs doivent veiller à contrôler les variables confusionnelles pertinentes en fonction du type de contrôle utilisé, explique David.
Les microbes identifiés dans la méta-analyse corroborent les résultats d'une étude de 2019 sur la transplantation de matière fécale. Dans le cadre de l'essai ouvert de phase 1, 18 enfants autistes ont été soumis à deux semaines d'antibiotiques et à un nettoyage intestinal suivi d'une transplantation de matières fécales provenant d'un donneur non autiste. Le traitement a permis de réduire les symptômes gastro-intestinaux et d'atténuer les traits autistiques selon l'échelle d'évaluation de l'autisme infantile (Childhood Autism Rating Scale). Les bénéfices ont persisté pendant les deux années qui ont suivi le traitement.
Morton a réanalysé les données brutes de l'essai et a constaté que certains des microbes associés à l'autisme signalés par la méta-analyse étaient plus abondants avant le traitement et diminuaient après le traitement.
"Ces microbes initialement associés aux TSA ont en fait été modulés par le traitement", explique Rosa Krajmalnik-Brown, professeure d'ingénierie à l'université d'État de l'Arizona à Tempe, qui a dirigé l'essai de 2019.
Selon Bastiaanssen, cette méta-analyse marque une transition dans le domaine du microbiome. Maintenant que les études transversales antérieures ont été combinées et que les différences entre les grands groupes ont été analysées, il est temps de concevoir des études plus spécifiques. "À mon avis, l'objectif de ces grands ensembles de données en sciences omiques est de formuler des hypothèses mécanistes vérifiables."
Afin d'obtenir des informations sur le sens de la causalité - à savoir si le microbiome contribue à l'autisme ou si l'autisme entraîne une altération du microbiome - la prochaine vague de recherche devrait prendre la forme "d'études longitudinales avec un certain type de composante d'intervention", explique Taroncher-Oldenburg. "C'est la seule solution."



