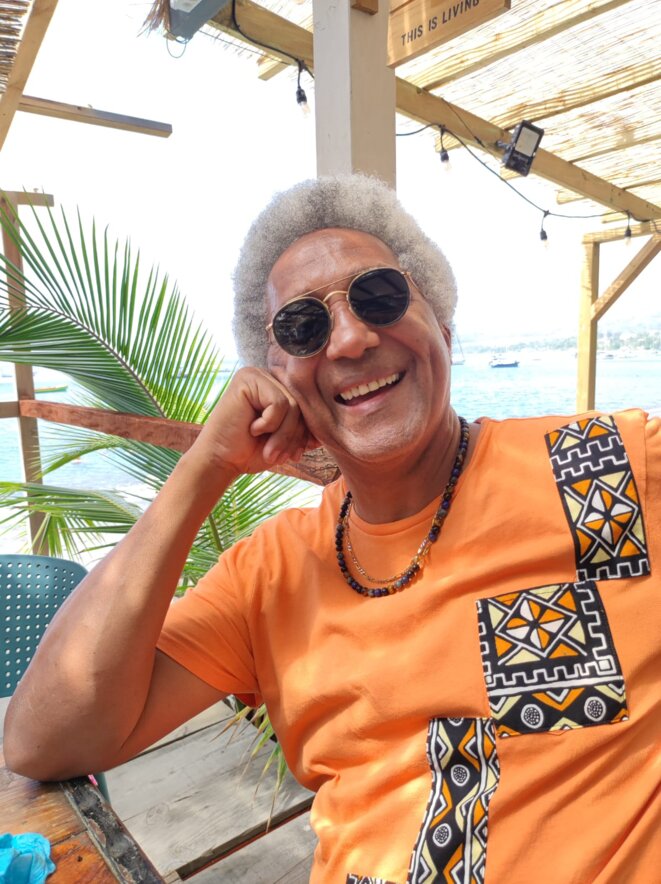Parallèlement à cela, elle présente toute une série de marqueurs d’une exceptionnelle gravité en matière d’inégalité et d’exclusion sociales et professionnelles. Peu de productions, beaucoup d’importations, une économie de services, tout cela s’accompagnant d’un fort taux de chômage (environ 23% de la population active) et d’une pauvreté grandissante (environ 70 000 personnes en dessous du seuil de pauvreté).
Dans le même temps, les schémas et les plans de développement proposés depuis des décennies n’aboutissent qu’à faire perdurer un système mis en place depuis bientôt quatre siècles, celui d’une économie coloniale de type comptoir basée sur une culture spéculative : hier la canne, aujourd’hui la banane, principalement destinée aux marchés européens. À côté de cela, quelques créneaux porteurs dans la conjoncture actuelle tentent d’émerger comme le tourisme, le rhum produit phare avec le label qualité ou quelques initiatives ici et là dans la diversification agricole. Voici là l’essentiel des richesses créées sur place.
Paradoxalement, la question qui a longtemps préoccupé la classe politique martiniquaise est celle du pouvoir, de l’identité, de la gouvernance de ses propres affaires par elle-même et en l’occurrence quelle nouvelle relation pourrait être construite avec la France.
Nous sommes globalement tous d’accord sur notre désir collectif de voir la Martinique évoluer vers un progrès qui n’ignore ni son patrimoine ni sa biodiversité et surtout une Martinique qui n’ignore pas les effets de la culture de la dépendance, l’importance de la précarité et notre fragilité économique.
Un long chemin
En ce sens, l’année 2019 est une année de référence dans ce qu’elle représente comme indicateur de capitalisation d’expériences, d’avancées ou de reculs.
En effet, nous sommes dix ans après la crise de Février 2009 qui avait mis en exergue le mal être des Martiniquais confrontés à la vie chère, au chômage, au manque d’avenir, à l’insécurité, aux inégalités et à toutes ces difficultés structurelles qui sont la marque de fabrique d’une société post coloniale en mal de développement.
2019 c’est aussi dix ans après la décision du gouvernement de Nicolas SARKOZY de répondre à cette crise par une consultation sur une évolution institutionnelle ou sur un changement de statut vers l’autonomie de l’article 74 de la Constitution.
Pour rappel, cela correspondait aussi à la décision du Congrès des élus de Martinique du 18 décembre 2008 présidé par Alfred Marie-Jeanne de demander la création d’une Collectivité Unique dans le cadre de l’Article 74 de la Constitution française. Cette décision avait été votée à 74% des élus ! Une aspiration affichée à la responsabilité.
Encore un pas….
La Martinique ne pouvait se résigner à la docile posture d’un pays qui attend ce que la France offre, autorise, accorde. Elle avait le devoir de s’approprier l’imagination, l’initiative et l’action pour répondre de manière urgente aux graves problèmes qui minent la vie des Martiniquais mais aussi pour répondre aux défis du développement. Aucun pays, aucune ville, aucune communauté ne peut être tenu en haleine indéfiniment, ne peut se moderniser dans un contexte permanent de perfusion sociale.
Il s’agissait fondamentalement de savoir si nous voulions passer d’une « situation d’irresponsabilité décentralisée » à une « situation de responsabilisation pleinement et collectivement assumée » quant à la mise en œuvre de notre devenir. Voilà quelle était l’alternative, elle était simple, et claire !
Irresponsabilité ou responsabilité ?
Ce n’était ni une affaire d’article ni une affaire juridique. C’était avant tout une affaire de principe, une affaire politique.
De plus, 2019 c’est quasiment 20 ans après que l’Etat français par la voix de son président de l’époque, Jacques Chirac estime que chacune des collectivités d’Outre-mer avait le droit à un « statut sur mesure ». Ainsi, le 13 décembre 2000 la Loi d’orientation pour l’Outre-mer (LOOM) instaure le Congrès des élus départementaux et régionaux et prévoit une méthode d’évolution institutionnelle différenciée des DOM. Il s’agit là d’une avancée majeure après la décision du Conseil Constitutionnel déclarant non conforme à la Constitution le projet de Loi adopté le 23 novembre 1982 par le Parlement tendant à doter chaque DOM d’une Assemblée Unique se substituant au Conseil Général et au Conseil Régional.
…..inachevé
En résumé, 2019 aurait dû être alors l’année de bilan de presque cinq ans de mise en œuvre de la Collectivité Territoriale de Martinique, de 20 ans d’initiative d’évolution institutionnelle enclenchée par la convention de Basse-Terre du 1er décembre 1999 et près de 50 ans d’espérance d’émancipation dans le cadre républicain français, dont les bases ont été forgées dans « Convention du Morne-Rouge pour l’autonomie des 16-17-18 Août 1971 ».
Les Martiniquais étaient en droit d’attendre du concret, une conception nouvelle, des idées et des projets nouveaux qui rendent l’ensemble du Pays et de ses acteurs collectivement responsables.
En 2019, si l’on peut se satisfaire d’un aménagement institutionnel dans la fusion des deux collectivités, les leaders politiques n’ont pas su convaincre les Martiniquais du pas vers la responsabilité !
Les marqueurs
Le paysage politique martiniquais se caractérise par :
- la bipolarisation du débat politique entre le Mouvement Indépendantiste Martiniquais et le Parti Progressiste Martiniquais, et particulièrement entre leurs leaders,
- une alternance entre ces deux partis de la gouvernance des collectivités majeures,
- une droite très affaiblie mais qui joue le rôle de maillon fort en permettant soit aux indépendantistes (les Républicains, et Forces Martiniquaises de Progrès) soit aux progressistes (Osons oser, le Parti Régionaliste Martiniquais) d’emporter les batailles électorales en faisant l’appoint des voix,
- la marginalisation des socialistes (diminués par leur expérience de l’alliance Ensemble Pour une Martinique Nouvelle qui rassemble des partis de droite, de gauche et de quelques maires de sensibilité diverses),
- la quasi disparition du Parti Communiste Martiniquais qui survit grâce à l’alliance gagnante de territoriales de 2015 « gran sanblé pou ba péyi-a an chans » qui rassemble une bonne frange de la droite et le Mouvement Indépendantiste Martiniquais,
- une mouvance nationaliste complètement éteinte qui ne se résume qu’à quelques « anciens combattants » qui n’ont de visibilité que sur des communiqués, des graffitis de revendications sur des murs ou encore des participations opportunistes à des actions sensibles.
- une tentative de regroupement de maires en 2006 (le RDM Rassemblement Démocratique pour la Martinique) avec une prétendue fibre politique de gauche qui n’a rien apporté au débat politique et encore moins en matière de projet de société pour la Martinique. Cette initiative à géométrie variable n’a pas su faire non plus avancer la prise de responsabilité malgré son alliance avec le MIM lors de la consultation sur l’évolution statutaire.
En fait, ces formations (le MIM, le RDM, le PPM) qui dominent la vie politique ont comme dénominateur commun le débat sur le statut, la quête identitaire et l’absence de responsabilité. Elles ne se différencient que par le profil de leur leader entre despote hystérique, despote sophistiqué et despote christique.
Une autre caractéristique réside dans l’incapacité de ces partis politiques dominants à se régénérer et à ne proposer interminablement que leur leader comme potentiel tête de liste aux élections territoriales. Le scrutin de 2021 semble se profiler sous le même schéma si l’on en croit les déclarations faites à ce jour.
Où en est-on ?
Les Martiniquais à travers leurs votes des 10 et 24 janvier 2010, refus de l’article 74 et la fusion des deux collectivités Conseil Général et Conseil Régional, ont souhaité une Assemblée Martiniquaise qui remplace les actuelles institutions. Cette nouvelle assemblée devrait refléter les réalités diverses du territoire martiniquais, par un mode de scrutin qui assure à la fois une représentation proportionnelle et une assise majoritaire. Ce scrutin mixte était le meilleur compromis à pouvoir faire en sorte que la représentativité colle au plus près des réalités si différentes du Sud, du Centre et du Nord et que toutes les communes, tous les quartiers, soient pris en compte au plus juste. Un équilibre de la gouvernance avait été imaginé entre un président du Conseil exécutif et un président de l’Assemblée.
Dans la réalité, c’est un véritable fiasco. Nous assistons dans l’impunité totale au non-respect des règles de fonctionnement de l’Assemblée de Martinique, à une présence permanente, voire non règlementaire du président de l’exécutif dans les plénières de l’Assemblée avec des interventions intempestives et parfois inopportunes.
Face à lui, un président de l’Assemblée dont la capacité d’agir a été confisquée et une majorité de figurants qui fait le nombre au moment des votes. Les élus de cette majorité payent sans difficulté le prix de leur participation au pouvoir par la soumission, bénéficiant en retour pour eux et leurs proches des maigres avantages que leur confère leur position.
Un vrai hold-up sur les institutions !
Et l’opposition ? Pour faire simple, on dira que l’opposition sans véritable leader pousse des cris silencieux.
L’accession au pouvoir est devenue une fin en soi. On veut avant tout gagner, sortir l’autre, conquérir le pouvoir pour le pouvoir. Les discours se vident de sens le travail idéologique s’affaiblit et le projet devient de moins en moins visible, voire inexistant.
Si les institutions bougent et donnent des marges de manœuvre, le personnel politique ne semble pas à la hauteur des enjeux.
Il est donc urgent de quitter le marigot des querelles politiciennes et des cancans pour hisser cette opportunité de la prise de responsabilité à l’échelle d’une initiative collective, digne, respectueuse et constructive.
L’imagination et l’audace devraient nous amener à renouveler sans délai le personnel politique en favorisant l’accès au pouvoir aux jeunes, aux femmes, aux personnes porteuses de handicaps et celles issues de milieux précaires….
…et pendant ce temps
Comme beaucoup de pays, la Martinique est structurellement dans un mélange d’âge agricole et d’agonie industrielle, alimenté par des transferts publics et le grouillement d’une économie de services et de consommation.
Beaucoup de pays de par le monde vivent ce mélange des âges à des intensités diverses et la conduite du chariot à bœufs s’emmêle à celle du tracteur électrique.
Mais tous, à des degrés variables, reçoivent, vivent ou subissent l’âge informationnel symbolisé par l’ordinateur, le smartphone et les applications numériques qui constituent le contexte déterminant actuel (Facebook, WhatsApp et autre…).
La vie chère est aussi incontestablement un des signes de la crise structurelle d’un système qui implose de toutes parts.
La violence au quotidien, l’éclatement de la famille minée par les conséquences de la marchandisation des valeurs éducatives, le suicide silencieux d’une partie de la jeunesse, l’exsanguination progressive du pays de sa jeunesse : tout ceci participe du même processus de la déliquescence.
L’exclusion de milliers d’isolés spoliés de leurs droits à une vie décente, l’ostentation de nos élites tend à faire croire au miracle d’un développement par assimilation, et dite de manière moderne d’ « égalité réelle ».
Tout cela conduit à désapprouver le choix de nos politiques d’orienter l’action sur un aménagement du système global de consommation plutôt que sur une remise à plat des scories coloniales dont notre société et notre économie restent encore tributaires.
Le modèle sur lequel a été fondée la société martiniquaise depuis quatre siècles n’est pas soutenable. Il nous faut donc sortir de la démesure, du toujours plus et oser reposer les questions fondamentales : « À quoi doit servir l’économie ? », « Pourquoi travaillons-nous ? », « Comment articuler qualité de vie sociale et progrès économique ? » « Quel projet pour la Martinique ? »
Enfin, la « période de transition mondiale » que nous vivons nous impose une exigence : la conscientisation du plus grand nombre. On ne transforme rien sans le plus grand nombre. On ne change pas de paradigme sans que chacun ne devienne à la fois concepteur, acteur, évaluateur et transformateur de son immédiat et de son quotidien. Car si nous voulons vraiment changer de modèle, il faut un choc, un choc qui est aussi d’ordre culturel. Car l’aliénation économique que nous subissons ne peut être dissociée de l’aliénation culturelle.
Nous pourrions décliner à l’envi les éléments qui nous font craindre que les promesses ou projets électoraux d’une droite conservatrice, d’une gauche sans perspectives qui se spécialise dans la défense des acquis sociaux et d’une extrême gauche populiste, ne répondent que très partiellement aux attentes profondes du peuple martiniquais.
Que peut-on espérer ?
La société martiniquaise est née sous le triple sceau du génocide initial, de la traite négrière transatlantique et de la période coloniale. Les luttes pour l’émancipation ont été des tragédies humaines et dans le même temps, porteuses de courage, de créativité, de volonté et de projection vers le futur.
La crise déclenchée par la mise en lumière du scandale du Chlordécone s’inscrit dans ces luttes.
Ces récentes révoltes dites « des blocages de supermarchés »ont aussi réveillé la douleur de cette blessure originelle qui appelle réparation, préalable à toute réconciliation, qu’il ne faudrait pas confondre avec cette fragile pacification ambiante.
Elles mettent en évidence que l’un des derniers combats à mener serait de démontrer la capacité de la société martiniquaise, balkanisée socialement, à faire vivre ensemble ses différentes composantes en particulier avec la communauté dite « béké ».
Cette crise a mis en lumière les comportements et dérives auxquels beaucoup d’entre nous sont capables de céder quand on arrive au « stade suprême de la consommation ».
Que la jeunesse s’en mêle….
Ces événements ont été aussi révélateurs de l’expression d’une jeunesse si souvent décriée et de sa détermination à prendre le relais de cette lutte pour l’émancipation.
Une jeune femme porte-drapeau de ces nouveaux combattants incarne selon moi en cette année 2019 toutes ces luttes, tous ces rendez-vous ratés, toutes ces tragédies encore aujourd’hui subies. Cette femme, quoi que l’on puisse penser, et au-delà des dérives de son entourage, symbolise aussi ce courage, cette abnégation, cette espérance de croire que ce peuple martiniquais est doté d’une personnalité collective, d’une culture, d’une identité et d’une langue. Le combat auquel elle porte sa pierre confirme que ce peuple qui constitue une communauté d’individus vivant sur un même territoire, formant un tout économique et culturel saura trouver sa place à la manière d’Aimé CESAIRE en 1974 quand il accueillait François Mitterrand : « le vrai problème est à mes yeux, celui de notre place, de notre juste place dans cette communauté ». C’est « une place qui ne soit ni humiliante, ni dégradante, ni aliénante, une place qui ne soit ni discriminatoire, ni attentatoire à notre personnalité, ni dirimante de nos responsabilités »
Pour demain
L’expérience nous enseigne que les situations de crise sont très souvent des opportunités pour tenter de se projeter à long terme tout en répondant à l’urgence.
Cette crise sanitaire que connaît aujourd’hui la Martinique, la France, le monde entier, est une invitation à sortir des postures radicales et d’aveuglement du « Ti neg mawon » ou du « Politicien bien glacé » qui consiste à réclamer sur les tréteaux électoraux de manière très sonore ce qui n’est pas en rapport avec le conscient collectif populaire en cours, et de se cantonner alors dans « cet impossible » pour justifier peut-être un manque de courage ou un déficit en désir de responsabilité vraie.
Jeff Lafontaine 17 avril 2020
#jefflafontaine