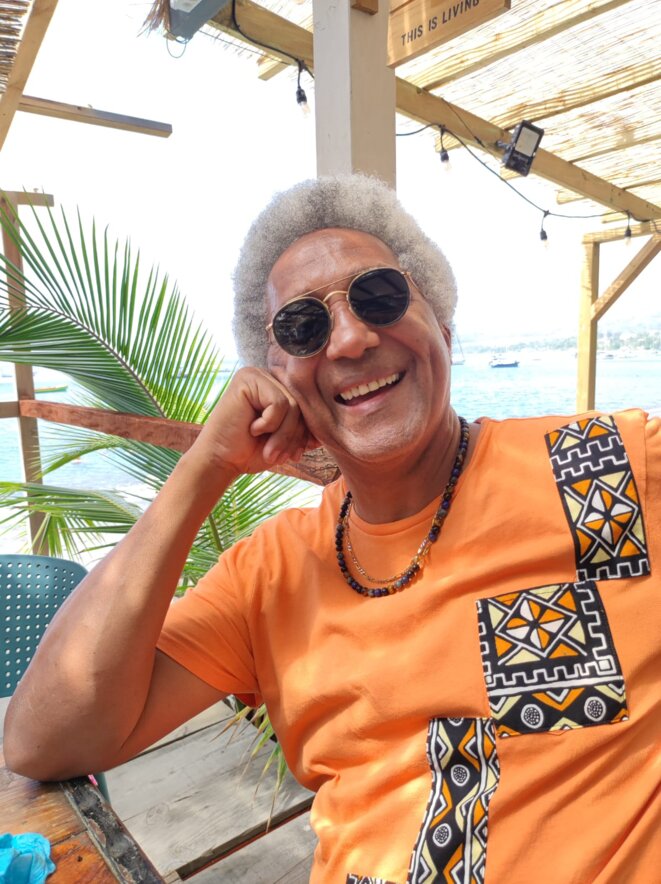Le communiqué de presse publié par la préfecture de Martinique à la suite des trois décès par arme à feu à Fort-de-France le 11 mai 2025 n’est pas un simple message de circonstance. Derrière les mots calibrés de l’administration se dessine une rhétorique de déplacement, une stratégie d'inversion des responsabilités, qui vise à camoufler la faillite sécuritaire de l’État colonial et à alimenter un imaginaire xénophobe justifiant la dérive autoritaire du pouvoir.
Une compassion de façade pour un basculement sécuritaire
Le texte commence par une expression de condoléances : « Le préfet exprime ses pensées endeuillées aux victimes et à leurs proches. » Rien à redire, en apparence. Mais cette compassion protocolaire, strictement encadrée, sert de préambule à une rhétorique sécuritaire, totalement détachée de l’analyse réelle des faits. Pas un mot sur les conditions sociales, sur les défaillances institutionnelles, sur les causes endogènes de cette violence — juste un passage rapide vers l’ennemi supposé : l’étranger.
Le coupable idéal : le dehors, l’ailleurs, l’étranger
Le cœur du discours est ici : « L’État renforce le contrôle des frontières depuis 2024. »
Sans preuve, sans lien direct établi avec la fusillade, le communiqué opère un glissement discursif : de la scène locale à une invasion invisible, faite d’armes, de trafics, de corps étrangers. La logique est redoutable : la violence qui frappe la Martinique ne serait pas née ici, elle viendrait d’Haïti, de Sainte-Lucie, de la Dominique… de ces « voisins » qui, dans l’imaginaire colonial, restent des figures du chaos et de la menace.
Ainsi, plutôt que de se regarder dans le miroir de ses propres manquements, l’État préfère designer un bouc émissaire — une stratégie vieille comme l’ordre colonial lui-même.
Une démonstration de force inefficace… mais ostentatoire
Le préfet annonce fièrement la saisie de 51 armes depuis janvier, et 177 l’an passé. Mais ces chiffres sont dérisoires face à la fréquence des homicides. À défaut d’efficacité, l’État mise sur la visibilité : CRS, GIGN, RAID, gendarmerie mobile quadrillent l’île. À cela s’ajoute l’installation massive de radars automatiques sur les routes martiniquaises, prétendument pour des raisons de sécurité routière. En réalité, cette hyperprésence techno policière donne le sentiment d’un territoire sous surveillance, d’une population sous suspicion, sans pour autant éradiquer la violence réelle.
L’État colonisateur transforme l’incurie sécuritaire en spectacle de fermeté, pour rassurer une opinion publique qu’il manipule autant qu’il abandonne.
L’ombre de la xénophobie institutionnalisée
Derrière le discours préfectoral, on retrouve les accents bien connus de la politique sécuritaire gouvernementale : l’étranger est la menace, les quartiers populaires sont des foyers de danger, et la République est assiégée. Ce discours, qui fait le lit de l’extrême droite, est aujourd’hui intégré aux pratiques gouvernementales. En Martinique, il permet de justifier :
- Le rejet implicite des populations issues de l’immigration caribéenne.
- La suspicion permanente envers les mobilités entre îles.
- Une répression policière accrue sans projet social.
Le préfet devient alors non pas un garant de la sécurité publique, mais un relais de l’idéologie coloniale contemporaine, celle qui préfère l’ordre à la justice, la stigmatisation à la solidarité, et le contrôle des populations à leur émancipation.
Colonialité et aveuglement
À aucun moment le communiqué ne pose les vraies questions :
- Comment ces armes circulent-elles dans un territoire sous contrôle militaire permanent ?
- Pourquoi tant de jeunes Martiniquais se retrouvent dans des logiques de guerre urbaine ?
- Quel rôle l’État joue-t-il dans l’abandon économique et éducatif des quartiers populaires ?
Le silence est assourdissant.
La colonialité s’exprime non seulement dans le refus de réparer, mais dans la propension à criminaliser, à réprimer, à masquer l’échec par la surenchère autoritaire.
Et puis, il faut bien poser la question que ce communiqué élude soigneusement : à quoi sert vraiment cette présence policière massive en Martinique ? Est-elle là pour protéger l’ordre public, dans une approche républicaine d’égalité, de justice et de sécurité partagée ? Ou bien est-elle là, fondamentalement, pour protéger l’ordre colonial, c’est-à-dire garantir le contrôle d’un territoire perçu comme périphérique, instable, à tenir en respect ?
Les CRS, les brigades mobiles, les radars, les opérations coup de poing… tout cela donne à voir une île sous haute surveillance, non pas parce qu’elle menace la République, mais parce qu’elle n’en fait pas vraiment partie.
Et au cœur de ce drame, il faut aussi dire notre immense chagrin face à cette nouvelle tuerie entre jeunes Martiniquais. Quelles que soient les causes ou les trajectoires individuelles, voir des jeunes s’entre-tuer dans la rue, c’est aussi le symptôme d’un désespoir social, d’un échec collectif.
Nous n’avons ni le temps, ni le nombre, ni le luxe démographique pour nous entretuer.
Nous avons autre chose à faire de notre bravoure, de notre intelligence, de notre énergie : reconstruire notre pays, redresser nos solidarités, préparer notre émancipation.
Ce courage là, celui de résister ensemble à ce qui nous détruit, est la seule violence légitime : celle qui renverse le système qui nous broie.
Mais il faut aller plus loin :
Ce drame révèle aussi la désertion massive de notre classe politique locale en matière de politiques éducatives, culturelles et de jeunesse. Depuis des années, les priorités budgétaires, les discours publics, les choix institutionnels relèguent au second plan ce qui devrait être au cœur d’un projet d’émancipation. Et ce silence, cette inaction, ce mépris latent pour les jeunesses populaires participent pleinement de la crise que nous vivons aujourd’hui.
À cela s’ajoute la posture de nos habituels « champions de l’appel à l’Etat », qui, dans leurs rôles d’intendants dociles du système, se sont empressés de demander davantage de moyens répressifs. Plutôt que d’interroger les causes sociales de cette tuerie, ils en appellent à un renforcement de la réponse policière, pensée par l’Etat, mise en œuvre par l’Etat, cautionnant de fait la stratégie coloniale de contrôle.
Pourquoi pas un congrès des élus martiniquais sur la question?
Sécuriser pour dominer, non pour protéger
Ce communiqué n’est pas un texte neutre. Il est un outil de propagande, un exercice de communication politique, qui participe à une guerre symbolique contre les classes populaires et les étrangers, dans une île que l’État refuse toujours de considérer comme un espace à égalité de droits et de dignité.
Face à cette stratégie, il est urgent de porter une autre parole, ancrée dans la vérité des faits, la justice sociale, et la souveraineté des peuples. Ce n’est pas en contrôlant les ports et en posant des radars qu’on reconstruira le tissu social martiniquais. C’est en remettant en cause le système colonial lui-même.
Jeff Lafontaine