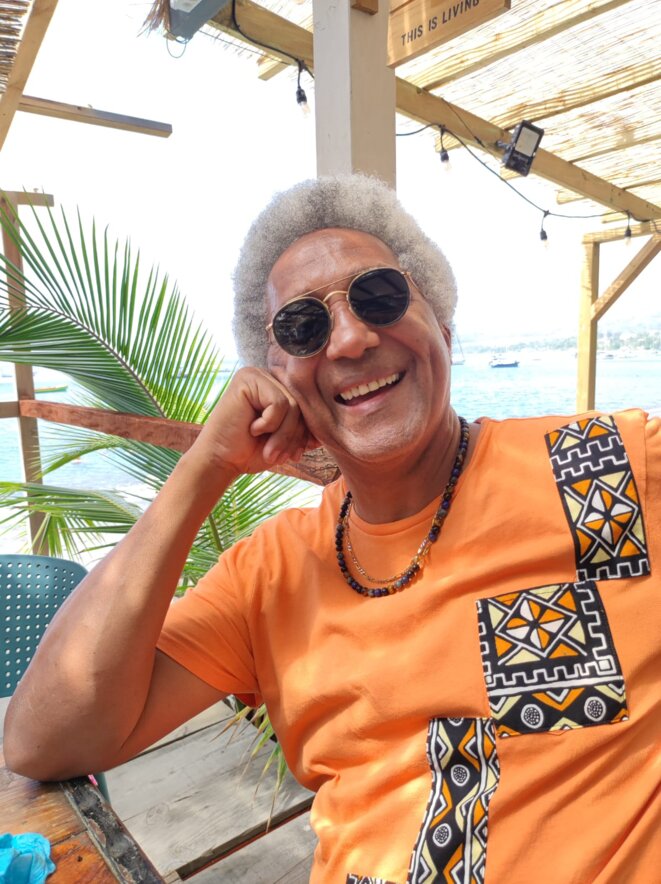Fiche de lecture : DÈWÒ – Imaniyé Dalila Daniel

Propos introductif
Ce résumé de DÈWÒ est proposé sous le prisme singulier d’un musicien. J’ai choisi d’analyser ce roman avec les outils et la sensibilité qui m’appartiennent : ceux de la musique. Ainsi, le récit est abordé comme une partition où se croisent rythmes et contretemps, harmonies et dissonances, silences et résonances. Cette lecture fait écho à la polyrythmie qui traverse l’œuvre : binaire et ternaire à la fois, syncopée parfois, ample à d’autres moments.
En empruntant ce langage, il ne s’agit pas de plaquer une métaphore gratuite, mais de montrer comment la musique, art du temps et de l’émotion, permet de saisir autrement la dynamique du texte : ses équilibres, ses tensions, ses résolutions. Le regard que je propose est donc celui d’un musicien qui, en lisant DÈWÒ, entend une partition vivante, avec ses cadences, ses contrastes et ses improvisations.
Résumé
DÈWÒ raconte l’histoire de Kenzo, un jeune martiniquais dont la famille porte encore les marques de l’héritage colonial. Comme beaucoup de ses compatriotes, certains sont partis étudier en France ; lui, en revanche, y est né, issu d’une famille émigrée. La maladie de sa grand-mère le ramène en Martinique, où il est accueilli par son grand-père.
Au fil de ses déambulations à travers le pays, et tout particulièrement dans les rues de Fort-de-France, ses connaissances livresques se heurtent avec brutalité à la réalité. Passionné d’histoire, Kenzo constate que de nombreuses rues et lieux publics portent encore les noms de figures liées à l’esclavage et à la colonisation. Cette découverte le révolte : comment ses parents, ses grands-parents, et plus largement la société martiniquaise, ont-ils pu vivre si longtemps dans ce véritable « musée à ciel ouvert » de la mémoire coloniale et de l’esclavage sans en questionner la portée ?
Le roman suit la montée en puissance de sa prise de conscience, nourrie autant par ses observations que par les discussions, les rencontres familiales et autres échanges du quotidien. Elle s’affermit aussi dans la découverte d’une culture martiniquaise vivante, à travers la cuisine, les rituels familiaux et sa langue natale, le créole, qu’il ne pratique pas mais qu’il comprend. Entre le silence hérité et la nécessité de dire, Kenzo chemine vers une parole neuve, à la fois intime et collective.
Personnages principaux
Wilson, le grand-père : figure du guide, porteur de la mémoire et de l’expérience, il incarne la sagesse des anciens et la transmission des racines.
Philip, le père : témoin lucide d’une époque marquée par la résignation et le silence, il vit dans l’ombre de ses rêves brisés et incarne les compromis imposés par la société coloniale.
Kenzo, le fils et petit-fils : l’élève, héritier de cette mémoire, animé d’une soif de vérité et porteur de l’élan vers l’avenir.
Personnages secondaires
Jordan : marginal en quête de repères, il représente la tentation du doute pour Kenzo, avant de se laisser emporter par la passion contagieuse de son ami pour la quête de mémoire.
Sweety : celle qui fait battre le cœur de Kenzo, donnant au récit une dimension intime et sentimentale, essentielle pour humaniser son parcours.
Marie-Louise : militante déjà conscientisée, elle incarne la figure de l’engagement clair et assumé.
Jacqueline : épouse de Philip et mère de Kenzo, personnage clé qui révèle à son mari ses rêves enfouis de musicien sacrifiés pour se conformer aux normes de la société coloniale.
Ras Royal : sage marginal, figure de clairvoyance, il a compris dans sa chair les souffrances de Kenzo et les enjeux de sa quête.
Maminette dite Berlande : la grand-mère et , gardienne des traditions culturelles, elle incarne la mémoire vivante à travers la cuisine, les repas partagés et les rituels de convivialité, lieux privilégiés de transmission.
Thèmes principaux
DÈWÒ s’inscrit dans une véritable polyrythmie, à la fois binaire et ternaire.
Comme en musique, le récit alterne des mesures régulières, qui laissent le temps de développer un thème, et des séquences plus syncopées, rapides, presque haletantes.
Pour filer cette métaphore musicale, DÈWÒ ressemble à une quadrille littéraire : une danse collective où chaque figure se répond et s’entrelace, mais où chaque génération doit trouver sa place, son pas, sa mission. Cette chorégraphie est éclairée par la pensée de Frantz Fanon dans Les Damnés de la terre :
« Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l’accomplir ou la trahir. »
En binaire, le roman avance parfois sur quatre temps, comme une marche solide et ample. C’est le tempo nécessaire pour installer les thèmes de fond : l’histoire, les blessures de la colonisation, les traces visibles dans l’espace public. Le binaire donne du poids, il installe une stabilité.
1. Historique : Le roman met en lumière l’histoire longue de la Martinique, de la colonisation et de l’esclavage, et souligne combien leurs traces demeurent inscrites dans l’espace public. Fort-de-France devient le décor paradoxal d’un « musée colonial à ciel ouvert », où statues et toponymes rappellent encore les figures des bourreaux d’hier.
2. Politique : Le récit interroge les responsabilités collectives et individuelles. Comment, dans la ville d’Aimé Césaire, peut-on encore accepter que des rues portent le nom de Du Parquet ou d’autres figures de la domination ? Le roman dénonce l’inertie des institutions et appelle à une réappropriation symbolique de l’espace public.
3. Sociologique et humain : Au-delà des enjeux historiques et politiques, l’autrice plonge dans la vie quotidienne : familles, voisins, amitiés, amours. Elle montre que la mémoire coloniale n’est pas seulement affaire d’archives ou de monuments, mais qu’elle se joue aussi dans les silences, les repas partagés, les héritages transmis ou tus. La résilience, l’amour et la capacité à vivre malgré les blessures de l’histoire forment la trame intime du roman.
4. Initiatique : Le parcours de Kenzo n’est pas seulement intellectuel ou politique, il est aussi spirituel. Comme toute initiation, il comporte sa part de mystère, d’incompréhension, de contradiction, mais aussi d’élévation intellectuelle et spirituelle. Confronté brutalement à l’histoire de son pays, Kenzo vit une immersion douloureuse mais nécessaire dans la culture martiniquaise, dans ses blessures autant que dans ses forces. Son voyage ressemble à un aller-retour entre le pays réel et le pays rêvé : d’un côté, la matérialité des rues, des statues, des noms chargés de mémoire coloniale ; de l’autre, la projection d’une Martinique réconciliée avec sa dignité, où la mémoire devient force et non fardeau. Cette initiation dépasse son destin individuel : elle peut être celle des jeunes dits nègzagon (nés en France dite hexagone), confrontés à la redécouverte de leurs racines, mais aussi de ceux qui, après avoir longtemps vécu ailleurs, reviennent affronter ce qu’ils avaient quitté.
En ce sens, DÈWÒ n’est pas seulement un roman sur la mémoire : c’est le récit d’une transformation intérieure, qui montre que la réconciliation avec soi-même et avec son histoire passe par une traversée initiatique, exigeante, douloureuse parfois, mais féconde.
En ternaire, au contraire, le récit se fait plus dansant, plus serré. Trois temps suffisent pour exprimer la tension, l’urgence, la syncope de la douleur ou de la révolte. Ce rythme ternaire, plus léger en apparence, porte en lui l’énergie des déplacements, des contradictions et des accélérations.
Cette cadence ternaire se déploie dans les pas de trois personnages centraux :
1. Wilson, le grand-père : le guide, porteur de la mémoire et de l’expérience.
2. Philip, le père : témoin d’une époque marquée par la résignation, incarnation des compromis imposés par la société coloniale.
3. Kenzo, le fils : l’élève, héritier de cette mémoire, animé d’une soif de vérité et porteur d’un élan vers l’avenir.
Chacun, à sa manière et dans son époque, accomplit sa mission. Ensemble, ils rappellent que la lutte pour la dignité et la liberté ne disparaît jamais : elle se transforme, s’adapte et se renouvelle de génération en génération.
Un prolongement de son travail de mémoire
Avec DÈWÒ, Imaniyé Dalila Daniel poursuit le fil conducteur de toute son œuvre : redonner une voix à celles et ceux que l’histoire officielle a réduits au silence — esclaves, colonisés, oubliés. La fiction devient un outil de mémoire collective, permettant de restituer des vérités enfouies. Le titre lui-même, DÈWÒ (“dehors” en créole), en est le symbole : il évoque à la fois l’exclusion et le bannissement, mais aussi l’acte de résistance consistant à sortir du cadre imposé.
Une écriture incarnée et accessible
Le style de l’autrice se distingue par sa fluidité et sa force narrative. Elle parvient à rendre la lecture intense sans jamais la rendre opaque. Ses personnages, profondément incarnés, donnent chair à l’histoire et à l’émotion. Loin de l’essai ou de la démonstration théorique, DÈWÒ associe la rigueur historique à la sensibilité, transformant l’émotion en vecteur de mémoire.
Des thématiques fortes
Le roman met en scène des thèmes majeurs qui traversent toute l’œuvre d’Imaniyé :
- L’exil et le bannissement : figures de marrons, marginaux et exclus, qui choisissent la fuite ou la rupture.
- Le dedans et le dehors : ceux qui subissent ou acceptent le système, et ceux qui décident d’en sortir, même au prix de la marginalité.
- La dignité et la liberté : la quête d’un espace d’humanité malgré la violence coloniale et ses séquelles.
- La transmission : chaque génération cherche à offrir des clés aux suivantes pour comprendre leur passé et affronter leur présent.
La portée symbolique du titre
Enfin, le titre DÈWÒ constitue une invitation à franchir les murs et les carcans, qu’ils soient coloniaux ou contemporains. Ce roman invite à penser “dehors”, c’est-à-dire en dehors des catégories imposées, pour retrouver une liberté à la fois intime et collective. C’est un appel à sortir des cadres conventionnels pour retrouver une liberté authentique et affirmer son identité en dehors des structures imposées. Dans la culture martiniquaise, cette notion de “dèwò” se décline de multiples façons :
- “Ych dèwò” : un enfant né en dehors du mariage. → Cela illustre comment la société désigne ce qui échappe aux normes officielles de filiation et de légitimité, mais qui n’en demeure pas moins une réalité vivante et assumée.
- “Fanm dèwò” : une femme entretenue ou une relation en dehors du couple officiel. → L’expression traduit la coexistence entre les règles sociales et les désirs individuels, et montre comment “dèwò” devient l’espace du non-dit ou de la transgression.
- “An kou dèwò” : une relation sexuelle hors du couple établi. → Manière crue d’exprimer la transgression, cette expression rappelle que “dèwò” c’est aussi franchir consciemment les limites, assumer un choix qui peut exposer au risque social ou moral.
- “An dèwò” : aller pêcher au large, au-delà des zones habituelles. → Ici, “dèwò” signifie courage, exploration, quête de nouveaux horizons, acceptation de l’inconnu et dépassement des sécurités.
- “Fwansé dèwò” : expression qui ne désigne pas des individus, mais le système colonial français. → Elle exprime le refus d’une domination imposée de l’extérieur. Dire “fwansé dèwò”, c’est affirmer la volonté de garder à distance un cadre de domination qui empêche l’épanouissement identitaire et collectif.
- “Mwen di’w dèwò isia !” (je t’ai dit de sortir d’ici) : injonction courante. → Dans ce cas, “dèwò” prend un sens direct : mettre quelqu’un dehors, hors d’un espace. Mais symboliquement, cela rappelle aussi l’acte de rupture, d’exclusion, ou d’invitation à être soi-même ailleurs.
Ainsi, DÈWÒ est plus qu’un titre : c’est une métaphore plurielle. Dans toutes ses déclinaisons, le mot évoque la sortie, la rupture, la transgression, le refus ou l’exploration. Le roman d’Imaniyé Dalila Daniel réactive cette richesse du créole pour rappeler qu’aller dèwò, c’est toujours un geste de liberté, parfois douloureux, mais nécessaire pour s’émanciper.
Conclusion
À la veille du 34ᵉ anniversaire de la mort d’Eugène Mona, ce dimanche 21 septembre, permettez-moi de reprendre son cri dans un de ses titres emblématiques : « il faut sortir des mondes démon ». Ce vers résonne puissamment avec l’invitation lancée par Imaniyé Dalila Daniel dans DÈWÒ. Sortir des mondes démon, c’est refuser les cadres imposés — ceux de la colonisation, de l’oubli, des normes sociales, des silences familiaux. C’est choisir la lucidité, la dignité et la liberté.
À travers ce roman, comme à travers la voix intemporelle de Mona, il nous est rappelé que la mémoire et l’émancipation ne se négocient pas : elles se vivent, se disent, se transmettent.
“Il faut sortir des mondes démon.”
DÈWÒ
Jeff Lafontaine