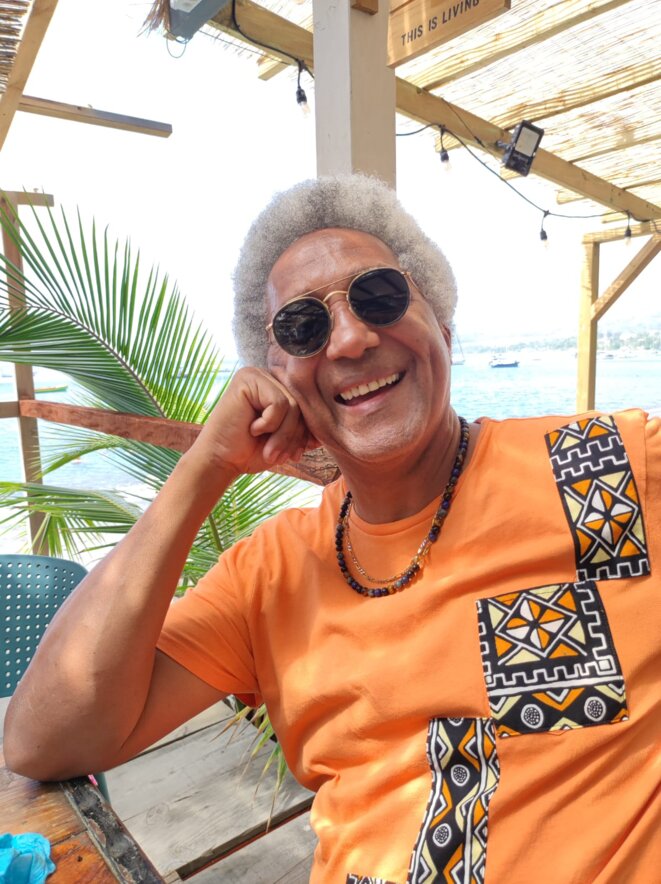Une abondance trompeuse cachant une réalité coloniale
Le moment que nous vivons en Martinique est marqué par des contradictions profondes. D'un côté, nous sommes plongés dans une abondance apparente de biens de consommation et de modernisation, une illusion de confort matérialiste. De l'autre, cette abondance cache mal les réalités de l’injustice sociale, de la précarité économique, et de la persistance d’un système colonial déguisé en modernité.
Le colonialisme exerce une violence psychique par son discours et ses postures : le colonisé est perçu comme “laid”, “bête”, “paresseux”, et sa sexualité comme “maladive”. Fanon explique que le colonisé finit par intérioriser ces stigmates, développant un sentiment d’infériorité, un mépris pour sa propre culture, langue et peuple. Ce processus pousse le colonisé à vouloir imiter le colonisateur dans tous les aspects de sa vie, y compris ses modes de consommation alimentaire. Cette imitation va jusqu'à préférer les produits importés, souvent coûteux, au détriment de la production locale. Cela contribue à rendre ces produits inaccessibles pour une frange croissante de la population martiniquaise, renforçant les inégalités et la dépendance économique, jusqu’à ce que la libération ne puisse se concevoir que dans et par la violence, une violence qui « désintoxique » et « débarrasse le colonisé de son complexe d’infériorité » et de son illusion d'être traité un jour à l'égal du colon.
Violences invisibles et colère légitime : symptômes d’une société étouffée
Les manifestations de colère et de violence que nous observons sont les symptômes d’une société en souffrance, étouffée par une arrogance coloniale conjuguée à une vacuité de propositions politiques qui ne sortent jamais du cadre colonial imposé, (octroi de mer, égalité réelle, ajustement de TVA, continuité territoriale etc...) Ces actes traduisent une colère légitime qui ne demande qu’à exploser.
Les conditions sont réunies pour que surgissent, à tout moment et dans les lieux les plus inattendus, des actions violentes que les détenteurs de "bonnes consciences" s’empresseront de condamner. Chaque fois que nous voyons des jeunes en échec scolaire, des familles luttant contre la précarité, ou une génération privée de perspectives d’émancipation collective, la violence se nourrit discrètement dans les interstices de notre société.
Ces violences invisibles, l’injustice économique, les dénis de justice, et l’ignorance culturelle imposée, nourrissent inexorablement les violences visibles. La colère qui gronde aujourd’hui en Martinique n’est pas un simple débordement ; c’est l’expression d’un peuple qui refuse de continuer à vivre dans l’ombre de lui-même et d’être étranger dans son propre pays.
Pour une société martiniquaise émancipée : rompre avec le colonialisme
Au-delà de l'urgence à résoudre la précarité flagrante d'une grande partie du peuple Martiniquais, la violence que nous voyons éclater sous nos yeux est aussi celle que nos élus, qui promettent l'émancipation depuis 70 ans, ont contribué à entretenir en ne remettant pas en cause les structures de domination et d’exploitation qui continuent de nous asservir. Les endormissements, les résignations et les soumissions de nos élus ne peuvent être que temporaires.
Il est temps de repenser notre avenir, non pas en tant que colonie moderne, mais en tant que société martiniquaise émancipée, consciente et responsable de son propre destin. Cette nouvelle donne sera l'œuvre de l'action citoyenne, en dehors du cadre républicain colonial français.
Jeff Lafontaine