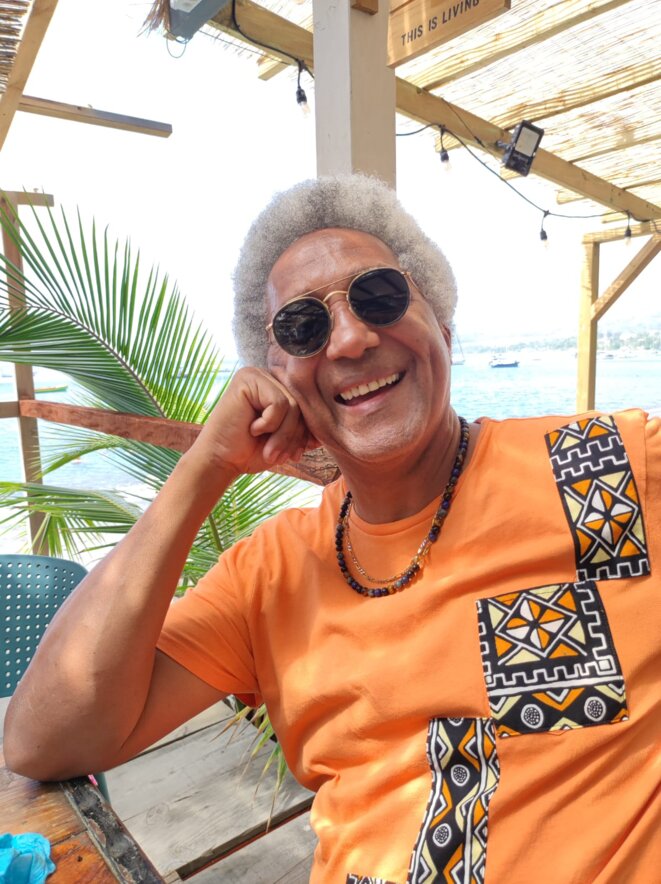On reproche à certains manifestants d’être responsables de dégradations, de s’en prendre aux infrastructures et aux biens matériels. Mais poser ainsi la question, c’est refuser de voir la réalité d’un peuple dépossédé, exilé sur sa propre terre, étranger dans un pays qui lui a été confisqué.
Ce texte ne cherche pas à glorifier la violence, mais à en comprendre les causes. Les dégradations qui accompagnent les manifestations sociales sont souvent une réponse directe à la violence institutionnelle. Ma réflexion s’appuie sur des auteurs qui, depuis des décennies, analysent les relations toxiques entre colonisés et colonisateurs. Il s'agit pour nous de replonger dans cette histoire et, surtout, de nous inspirer du parcours de notre peuple martiniquais.
Les dégâts matériels survenus lors des récentes manifestations ne relèvent ni du caprice ni d’un simple débordement de colère. Ce sont les infrastructures publiques, les entreprises liées aux réseaux de la pwofitasyon, et parfois d’autres bâtiments, publics ou privés, qui sont ciblés. Bien entendu, il faut déplorer les dégradations qui ne sont pas directement liées au mouvement et qui ne concernent pas les intérêts des Martiniquais.
Nous marchons dans des rues aux noms étrangers à notre histoire, bordées de bâtiments qui incarnent notre subjugation. Nous évoluons dans des espaces publics où trônent encore des symboles glorifiant les crimes du colonialisme et de l’esclavage. Cette réalité, lourde et omniprésente, alimente une colère légitime et profonde.
Alors oui, quand la colère éclate et que le feu dévore, nous, Martiniquais en lutte, ne détruisons rien qui nous appartient véritablement. Ces dégradations sont l’expression d’un peuple spolié, qui se soulève contre un système oppressif, économique et judiciaire. Le colonialisme ne s’est pas contenté de piller nos richesses et d’exploiter notre force de travail : il nous a également privés de notre droit à l’appartenance.
Nous avons bien compris, avec la prolifération excessive des radars sur les routes et la centralisation de l’administration française que les infrastructures coloniales n’ont jamais été construites pour les peuples colonisés, mais pour les exploiter et les contrôler. En Martinique, nos infrastructures ne sont pas neutres : elles portent l’empreinte de l’ordre colonial, elles maintiennent notre dépendance et nous rappellent chaque jour que nous ne sommes pas maîtres chez nous.
Comment peut-on exiger d’un peuple qu’il se sente attaché à ce qui ne lui appartient pas ? Nos actes de destruction ne sont pas dirigés contre notre pays, mais contre les symboles de notre asservissement. Chaque bâtiment incendié, chaque monument renversé, est une rébellion contre les chaînes invisibles du colonialisme. Rappelez-vous les destructions des monuments du 22 mai 2020, dénoncées par les représentants du système colonial et leurs relais. De même, souvenons-nous des soulèvements en Guadeloupe contre la pwofitasyon et des mobilisations kanak pour la souveraineté, autant de luttes qui s’inscrivent dans une même dynamique de libération.
Pa menyen bagay bétjé a ! Mwen kay an travay bétjé a ! Tè bétjé a !
Qui ne connaît pas ces expressions qui précédaient chaque envie, chaque initiative ? Une dépossession historique et systémique de soi-même. Un peuple exilé sur sa propre terre. Le colonialisme ne s’est pas limité à voler nos terres, exploiter notre travail et briser nos solidarités. Il a privé les Martiniquais du droit de se sentir chez eux, de se reconnaître dans leur propre pays. Il nous a volé notre nation.
Frantz Fanon, dans Les Damnés de la Terre, expliquait que la violence coloniale détruit jusqu’au sentiment d’identité du colonisé. Celui-ci ne voit pas dans les institutions coloniales un espace à défendre, mais une prison à abattre. La domination ne se limite pas à l’exploitation économique ou politique : elle est aussi psychologique. Elle maintient le colonisé dans une position de subalterne, coupé de son histoire et de son territoire.
Aimé Césaire, dans son Discours sur le colonialisme, dénonçait cette dépossession : le colonisé est vidé de lui-même, sa culture piétinée, ses institutions minées. Il n’est pas invité à s’identifier à son propre pays, mais à se conformer à un modèle imposé qui ne le reconnaît jamais comme un sujet légitime.
Quand un Martiniquais en colère met le feu à une structure ou renverse un symbole de l’ordre colonial, il ne détruit pas ce qui lui appartient. Il ne brûle pas son pays, car on l’a empêché de s’y sentir chez lui. Ces destructions et dégradations sont la conséquence directe de la domination coloniale, une réponse aux injustices accumulées. C'est le revers de la médaille. La violence matérielle de certaines manifestations est l’expression visible d’une oppression structurelle plus ancienne, plus profonde : racisme systémique, exploitation économique, négation des identités martiniquaises et de leur droit à l’autodétermination.
Edouard Glissant évoquait une opacité imposée : les Martiniquais sont maintenus dans l’ignorance des raisons de leur précarité, de l’injustice de leur système judiciaire, du contrôle exercé sur leur économie.
Walter Rodney, dans How Europe Underdeveloped Africa, montrait que les infrastructures coloniales n’ont jamais été conçues pour servir les colonisés, mais pour les contrôler et les exploiter. En Martinique, la même logique perdure : nos institutions économiques et judiciaires ne nous servent pas, elles nous marginalisent. Quand un manifestant brise une vitrine ou met le feu à un bâtiment administratif, il ne détruit pas ce qui est à lui : il s’attaque à ce qui l’opprime.
Mais la vraie violence, c’est celle du système
La destruction la plus grave n’est pas celle des vitrines brisées ou des feux dans les rues. La vraie destruction, c’est celle d’un peuple condamné à la précarité, à l’exploitation et à la répression, tout comme les peuples autochtones d’Amérique latine qui luttent contre l’extractivisme, ou les mouvements noirs qui combattent les discriminations systémiques à travers le monde. C’était le destin imposé aux captifs déportés : Servir et périr.
La vraie violence, c’est celle qui prive un peuple de son accès à la terre, à un emploi digne et à la reconnaissance de sa valeur.
- C’est celle des jugements à deux vitesses, où les nôtres écopent de peines lourdes pendant que d’autres s’en sortent avec des amendes.
- C’est le rôle de l’État de maintenir et protéger les monopoles économiques qui perpétuent notre dépendance.
- C’est l’accélération du processus de colonisation et de domination de la Martinique.
- C’est le leurre que constitue la caste béké qui n’est qu’un instrument, un rouage essentiel du système colonial qui dédouane l'État de ses responsabilités dans ce bourbier colonial. Les privilèges de cette communauté ne sont ni fortuits ni accidentels : ils sont voulus, encouragés et protégés.
Face à cette violence systémique, les manifestations ne sont pas un problème : elles sont une réponse. Ceux qui dénoncent les dégradations devraient se poser une autre question : pourquoi un peuple doit-il en arriver là pour se faire entendre ?
Nous n’avons pas à demander la permission de nous révolter
On nous dit qu’il faut manifester autrement. Mais ceux qui nous demandent d’être sages et disciplinés sont les mêmes qui ne nous écoutent jamais quand nous parlons calmement.
Nous ne mendierons pas la justice. Nous la prendrons. Nous ne demandons pas qu’on nous laisse exister. Nous affirmons notre droit à vivre et à lutter. Nous ne nous excuserons pas d’être en colère.
Si notre pays brûle, c’est parce qu’on nous refuse le droit d’y être pleinement chez nous. Et demain, quand nous aurons brisé les chaînes économiques et politiques qui nous maintiennent sous domination, nous construirons autre chose. Mais en attendant, nous ne laisserons pas ceux qui nous exploitent nous dire comment nous devons lutter. Car toute condamnation, tout projet de développement et toute allégeance au système seront vains si ces souffrances historiques séculaires ne sont pas prises en considération. Cela passe notamment par des réparations et l’ouverture des dossiers des assassinats perpétrés lors des luttes sociales et politiques pour la liberté.
Nous savons pourquoi nous nous battons. Nous n’avons rien détruit qui nous appartient. Nous reprenons ce qui est à nous.
Les flammes qui s’élèvent aujourd’hui ne sont que le prolongement des cendres laissées par des siècles de domination.
Quand ça brûle, ce n'est pas le chaos, c'est un avertissement.
Ce qui est en train de se passer n’est pas une destruction, c’est une reconquête.
Jeff Lafontaine