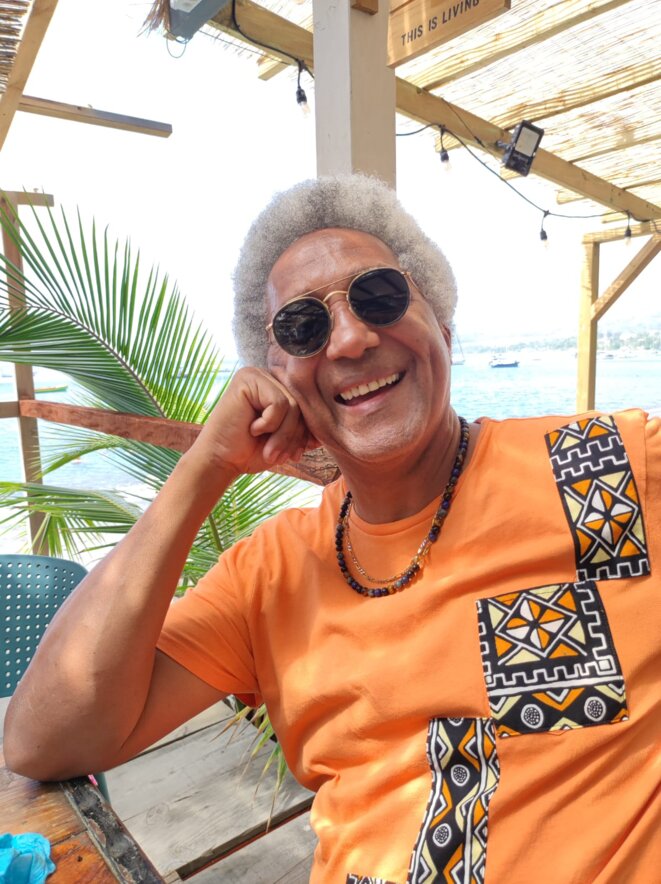Agrandissement : Illustration 1

Avant-propos
Ce texte n’a pas vocation à accuser ni à dénigrer des artistes en particulier. Les noms cités apparaissent uniquement comme exemples, car ils incarnent certains choix esthétiques et certaines logiques culturelles. Chacun d’eux suit son propre chemin, avec ses moyens, ses choix et ses contextes.
Mon propos n’est pas de juger des trajectoires individuelles, mais de mettre en lumière un système qui les dépasse : celui de l’industrie culturelle, des institutions et des logiques économiques qui orientent ce que nous appelons “musique martiniquaise”.
La musique n’est pas seulement une affaire de sons ou de divertissement. Elle façonne nos imaginaires, elle reflète nos valeurs collectives et elle peut devenir un outil politique et social : levier d’élévation et de résistance, ou au contraire instrument de normalisation et d’abaissement.
La question posée ici est donc moins celle de quelques artistes que celle de la société entière : qu’est-ce que nous choisissons de mettre en avant comme identité culturelle et musicale ? Alors, bien sûr, critiquer, est devenu une stratégie banale dans le monde de la musique comme en politique. Mais je pense qu’il faut creuser plus loin. Car au-delà de mon goût personnel – je le dis clairement, musicalement je ne vois pas cela d’un bon œil – ce succès me paraît être le symptôme de quelque chose de plus profond.
L’art : une question d’exigence
L’art véritable a toujours été une affaire d’exigence. Exigence de travail, de profondeur, d’authenticité. Exigence de vérité, aussi, face à soi-même et face au monde. Or, à observer certaines orientations de la musique martiniquaise contemporaine, une question se pose : que reste-t-il de cette exigence ?
Entre expression brute et création exigeante, il y a un écart décisif. C’est cet écart que nous devons interroger aujourd’hui : qu’est-ce que nous appelons « musique » ? Qu’est-ce que nous choisissons de promouvoir comme identité culturelle ? Et surtout : la musique martiniquaise contemporaine élève-t-elle encore, ou bien se contente-t-elle de refléter une société en perte d’exigence ?
À l’instar de nombreux observateurs de la société martiniquaise, je me suis intéressé aux événements musicaux qui ont marqué les dernières grandes vacances, et notamment à ce qu’il est convenu d’appeler les musiques urbaines, en particulier le courant baptisé Shatta.
Ce qui m’a frappé, c’est la communication officielle de la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM) qui, dans ses campagnes, présente ce phénomène comme « un rythme musical martiniquais devenu phénomène mondial », porté par des « pionniers visionnaires », et qui aurait conquis « les outre-mer et au-delà », une véritable « explosion mondiale ». La CTM va jusqu’à proclamer que le Shatta serait « le son de la jeunesse martiniquaise ».
Une telle rhétorique appelle, me semble-t-il, un questionnement critique.
En effet, une part importante de la production musicale martiniquaise, promue par nos institutions et célébrée comme un emblème identitaire, ressemble davantage à ce que le philosophe Omraam Mikhaël Aïvanhov appelait « les excréments de l’artiste », qu’à une véritable œuvre. Je le cite :
« Beaucoup d’artistes étalent devant le public leurs excréments psychiques. Ils croient créer, mais ils ne font qu’exprimer leurs désordres intérieurs. L’art véritable n’est pas une projection de ses bas-fonds : il doit élever, purifier, relier l’âme humaine à la beauté et au divin. »
Aïvanhov insistait ainsi sur une distinction fondamentale entre exprimer et créer:
Exprimer, c’est projeter à l’extérieur ce que l’on porte intérieurement, sans discernement ni sublimation ;
Créer, c’est transformer, élever et sublimer, afin de donner à autrui une forme qui nourrit et inspire.
Et de conclure : « Tout le monde peut s’exprimer, mais doit-on vraiment tout montrer de ce qui sort ? L’art a pour tâche d’élever l’âme humaine. ». Cette exigence ancienne garde toute sa pertinence aujourd’hui. Elle nous invite à réfléchir à la valeur de ce que nous appelons « musique » et à ce que nos institutions choisissent de promouvoir comme emblème culturel.
De quoi s’agit-il ? Pourquoi parle-t-on de régression ?
La critique portée ici n’est pas seulement esthétique, elle est également technique. Comme l’ont relevé plusieurs musiciens et amateurs éclairés, la production actuelle dite « urbaine » présente des caractéristiques musicales appauvries :
Harmonie : souvent réduite à un ou deux accords stables, sans modulation ni tension/résolution, et marquée par la disparition des couleurs (extensions, substitutions, contre-chants).
Mélodie : lignes étroites, peu d’intervalles, peu de motifs ; l’autotune n’est plus un outil ponctuel de correction, mais devient une esthétique en soi.
Rythme : basé sur des ostinatos élémentaires ; le « groove » se résume à une répétition mécanique, sans micro-variations ni contre-rythmes.
Arrangements : dominés par la compression et les limiteurs, qui favorisent l’impact sonore immédiat ; le sound design sert trop souvent à masquer l’absence d’écriture.
Certes, il est possible de créer un chef-d’œuvre avec un seul accord — l’histoire du jazz, du funk ou de certaines musiques traditionnelles en témoigne. Mais cela suppose une richesse ailleurs : dans les timbres, les polyrythmies, l’orchestration, ou la dramaturgie musicale. Ici, au contraire, l’économie de moyens vise principalement le coût bas et l’effet rapide.
À cela s’ajoute la question de l’esthétique visuelle.
Les clips et mises en scène reposent largement sur une image volontairement vulgaire, parfois obscène, souvent indécente, dans une logique de provocation. Certes, la provocation n’est pas nouvelle dans l’histoire des musiques populaires, mais dans ce cas précis, sa banalisation systématique et sa répétition industrielle conduisent à une inquiétante uniformisation.
Le contraste est d’autant plus frappant si l’on considère l’héritage de musiciens comme Alexandre Stellio, Barel Coppet, Robert Mavounzy, Eugène Mona, Max Cilla, Alain Jean-Marie ou Mario Canonge. Ces créateurs ont puisé dans l’héritage martiniquais pour offrir au monde des œuvres enracinées et universelles, exigeantes, travaillées, et porteuses d’une véritable dimension spirituelle : elles ouvraient des horizons, elles inspiraient, elles élevaient.
Aujourd’hui, à l’inverse, on érige en modèles des figures comme Kalash, Meryl ou Maureen. Non pas pour la profondeur ou l’exigence de leur musique, mais parce qu’ils incarnent la logique du buzz. Plus encore, on leur confère une légitimité symbolique et sociale, en les érigeant en porte-parole de la société, comme si leur production culturelle suffisait à leur donner compétence pour juger de tout.
Or la vérité est là : ces artistes ne font que refléter un système qui privilégie la loi du moindre effort et conduit à la médiocrité plutôt qu’à l’exigence. Et ce système n’est pas neutre : il est porté, validé et renforcé par nos institutions politiques et par les organisateurs de scènes qui, en les promouvant, installent dans la conscience collective l’idée que « ceci est la musique martiniquaise ».
Le mythe de l’universalisme – Global n’est pas universel
Certains diront : « Dans les musiques africaines ou sud-américaines, le rythme a toujours occupé une place centrale. » C’est vrai, et nul ne saurait nier que ces traditions musicales ont donné au monde des trésors de créativité rythmique et polyrythmique. Mais ce qui me semble contradictoire dans la production actuelle, c’est de mettre en avant un rythme répétitif et pauvre, réduit à un ostinato mécanique, tout en empruntant aux codes esthétiques hyper-occidentaux de l’industrie musicale : hôtels standardisés, piscines, voitures de luxe, imagerie mondialisée et interchangeable.
Le résultat est une musique qui cumule les mêmes carences : répétitive, peu mélodique, pauvre en accords, saturée d’autotune, et marquée par une véritable indigence harmonique. On ne retrouve ni la richesse rythmique des musiques africaines, ni la sophistication orchestrale des traditions latino-américaines, mais une imitation industrialisée de leurs clichés, vidée de substance.
D’aucuns prétendront que cette orientation manifeste une « immersion dans la modernité » ou une « ouverture à l’universel ». Mais il convient de rappeler une évidence : l’universalité ne se décrète pas. Elle se construit dans le travail, la profondeur et la justesse. Or, beaucoup de ces artistes se proclament aujourd’hui « voix du peuple » ou « porte-parole de la jeunesse », posture flatteuse mais fragile. Car l’universalité ne naît pas d’une revendication médiatique ou institutionnelle : elle naît de l’œuvre elle-même, de sa capacité à parler à la fois au singulier et au commun, au local et à l’universel.
C’est exactement ce qu’avaient réalisé des musiciens comme Stellio, Coppet, Mona, Jean-Marie, Marius Cultier ou Al Lirvat. Jamais ils n’ont eu besoin de proclamer leur universalité : leur musique l’était de fait, parce qu’elle était enracinée dans la tradition martiniquaise tout en s’ouvrant aux grands langages de leur temps.
Par contraste, appeler aujourd’hui « diversité » cette production standardisée relève d’un abus de langage. Car il ne s’agit pas d’une diversité des formes et des voix, mais d’une homogénéisation mondialisée, habillée des apparences du local. Nous assistons à ce que l’on peut nommer une politique culturelle de l’abaissement, où la métrique (nombre de vues, de streams, de certifications) sert de boussole et où l’institution confère une légitimité artificielle à la médiocrité en l’élevant au rang de « fierté ».
La logique industrielle : de la Martinique à la France
Ce qui se passe en Martinique n’est pas un cas isolé. En France, le phénomène Aya Nakamura illustre exactement la même mécanique. Là encore, on consacre une artiste non pour l’exigence de ses textes ni la richesse de son univers musical, mais parce qu’elle coche les cases de l’industrie :
rythme répétitif,
harmonie pauvre,
autotune omniprésent,
provocation visuelle.
Aya, comme nos « stars locales », est portée par un système qui ne vise pas l’Art mais la rentabilité immédiate. Le parallèle est évident : la Martinique, loin de s’enraciner dans sa propre richesse musicale, se contente d’importer et de décliner le modèle dominant.
Entre exigence et décadence : la musique miroir de notre société
Ce n’est pas un plaidoyer « contre la jeunesse », ni « contre la fête », ni « pour la nostalgie ». Nous sommes pour l’art :
pour des œuvres qui durent,
pour des musiques qui racontent,
pour des formes qui élèvent.
Le problème n’est pas Kalash, Meryl, Maureen ou Aya en tant que personnes. Le problème, c’est le système qui les glorifie au détriment de l’exigence et de la richesse. La question n’est pas d’interdire le Shatta ou de censurer tel ou tel artiste ou encore de mépriser ceux qui font le choix d'écouter ou de pratiquer ce genre musical. La question est : que choisissons-nous de mettre en avant comme identité musicale et culturelle ?
La Martinique a les moyens d’offrir au monde des œuvres riches, belles, inspirantes. Elle a déjà produit des musiciens de génie, enracinés et universels. Mais si nous laissons l’industrie et la politique culturelle actuelle définir notre horizon, nous serons réduits à des identités de playlist, interchangeables, éphémères, consommables.
Le succès de ce genre musical n’est donc pas une anecdote, mais le symptôme d’un phénomène plus profond. Il appelle à une réflexion collective sur notre rapport à la culture, à la création et à l’exigence.
Faut-il s’en indigner ?
Oui, il faut s’en indigner, mais avec intelligence. La beauté, la subtilité, le raffinement reviendront toujours : l’histoire de l’art est faite de cycles. Nous traversons une période de médiocrité, mais je demeure convaincu que l’être humain est naturellement attiré par le beau. Car nos grands-parents, nos parents et beaucoup d’entre nous ont été bercés par cette lignée musicale du savoir, du beau et du solide.
Nous sommes les enfants de Al Lirvat, Marius Cultier, Robert Mavounzy, Turenne, Alexandre Stellio, Barel Coppet, André Condouant, Henri Guédon.
Nous sommes les frères et sœurs de Mario Canonge, Michel Alibo, Jean-Marc Albicy, Paulo Rosine, Patrick Saint-Éloi, Eric Virgal, Orlane, Suzy Trebau, Edith Lefel, Tanya Saint-Val, Ralph Thamar, Kali.
Nous sommes les cousins de Étienne Mbappé, Youssou N’Dour, Manu Dibango, Cesaria Evora, Salif Keita, mais aussi Nemours Jean-Baptiste, Weber Sicot, Coupé Cloué, Dadou Pasquet, Emeline Michel.
Nous sommes les voisins de Bob Marley, Burning Spear, Aston Barett, Mighty Sparrow, Harry Belafonte, Celia Cruz, Rubén Blades, Wilie Colon, Eddie Palmierie.
Et nous sommes aussi les héritiers du souffle universel du jazz porté par Miles Davis, John Coltrane, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Charlie Parker, Camilo, Rubalcaba, Benson, Victor Woten.
Leur point commun n’était pas seulement l’exigence musicale. Tous, à leur manière, ont incarné une résistance à l’injustice et une revendication de singularité face à la volonté d’uniformisation culturelle. Leur musique était un acte de liberté, une affirmation de dignité, un refus d’être absorbés par le moule imposé.
Voilà la constellation dans laquelle s’inscrit notre mémoire musicale. Nous avons grandi dans cet univers sonore, qui a nourri notre imaginaire et façonné notre sensibilité.
Face à cela, les « artistes » mis en avant aujourd’hui ne sont pas, en eux-mêmes, un problème. Ils ne sont que les produits d’un système qui les porte et les glorifie.
Le vrai problème, c’est ce système : profondément déséquilibré, injuste, orienté vers le nivellement par le bas.
Un système qui mérite d’être repensé, corrigé, et, s’il le faut, abattu pour que renaisse une véritable politique culturelle de l’exigence et de la création.
Jeff Lafontaine
Bibliographie
Philosophie et critique des industries culturelles
Adorno, Theodor W., Horkheimer, Max. Dialectique de la raison. Paris : Gallimard, 1974.
Adorno, Theodor W. Quasi una Fantasia. Paris : Gallimard, 1962.
Aïvanhov, Omraam Mikhaël. Œuvres complètes, Tome XXIV : L’art à la lumière de l’ésotérisme. Prosveta, 1986.
Fanon, Frantz. Peau noire, masques blancs. Paris : Seuil, 1952.
Glissant, Édouard. Poétique de la relation. Paris : Gallimard, 1990.
Hesmondhalgh, David. The Cultural Industries. Sage, 2013.
Musiques martiniquaises et caribéennes
Bériss, Hugues. Marius Cultier, pianiste caribéen. Fort-de-France : Désormeaux, 1992.
Garnier, Xavier. La biguine parisienne : musiques antillaises et société française (1920-1950). Paris : Karthala, 1995.
Guilbault, Jocelyne. Zouk: World Music in the West Indies. University of Chicago Press, 1993.
Laborel, Jean-Paul. Jazz et créolité : musiciens antillais et afro-américains. Paris : Outre-Mers Éditions, 2008.
Monpierre, Marc. Mario Canonge, le jazz créole universel. Paris : L’Harmattan, 2015.
Discographie indicative
Alexandre Stellio : Alexandre Stellio et son Orchestre créole (1930s).
Robert Mavounzy : Biguine à Paris (1946).
Al Lirvat : Biguines et mazurkas (1950).
Marius Cultier : Ouelele (1975).
Eugène Mona : Bwa brilé (1981).
Max Cilla : La Flûte des Mornes (1981).
Alain Jean-Marie : Biguine Reflections (2000).
Mario Canonge : Caraïbes (2002).
Paulo Rosine & Malavoi : Malavoi Tjézel (1983).
Patrick Saint-Éloi : Misik Ce Lan-Mou (1994).
Youssou N’Dour : Set (1990).
Manu Dibango : Soul Makossa (1972).
Cesaria Evora : Miss Perfumado (1992).
Bob Marley : Exodus (1977).
Mighty Sparrow : Sparrow at the Hilton (1967).
Rubén Blades : Siembra (1978).
Nemours Jean-Baptiste : Compas Direct (1956).
Weber Sicot : Haiti Fiesta Orchestra (1961).
Coupé Cloué : Coupé Cloué et Trio Select (1978).
Tabou Combo : New York City (1974).
Emeline Michel : Rhum & Flamme (1986).
Miles Davis : Kind of Blue (1959).
John Coltrane : A Love Supreme (1965).