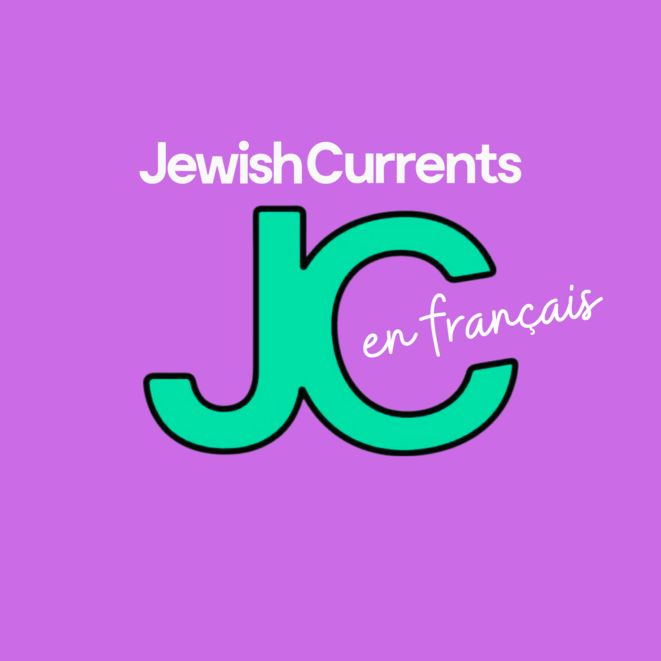Cette semaine a été la plus difficile que l'équipe de Jewish Currents ait jamais eue à traverser. Les événements se succèdent à une telle vitesse, qu’il semble impossible tant de les saisir qu'à les raconter justement dans un contexte si mouvant que chaque moment et son analyse appartiennent aussitôt au passé.
Alors que nous pensons achever une partie de notre « explainer » [article-ressource, qui se veut factuellement exhaustif et contextualisant, ndlt], de nouvelles informations font surface et le rendent obsolète. Et ce n’est pas qu’une question factuelle. Les sentiments et les positions [de notre équipe] sont également mouvants.
Des questionnements politiques et des lignes de fracture qui couvaient depuis longtemps au sein de notre organisation — dans la gauche juive et, je soupçonne dans la gauche en général aussi — ont éclaté au grand jour et ont enrayé notre capacité de travail alors que le moment nous poussait à l'urgence absolue.
Les salarié·es du journal fondent en larmes encore et encore, se disputent avec leurs familles ou leurs ami·es, carburent au peu de sommeil qu’elles et ils arrivent à trouver. Le fils d'un de nos contributeurs est l’un des otages. Un autre de nos contributeurs envoie un message depuis Gaza, sa ville : « Toujours vivant. Ils bombardent partout. On n'est à l'abri nulle part. »

Agrandissement : Illustration 1

Nos désaccords portent sur la forme juste de l’expression de notre chagrin
La plupart de nos désaccords internes portent sur la forme juste de l’expression de notre chagrin. Notre équipe est à l’image du reste du monde juif en ce que beaucoup d'entre nous ne sont que très peu éloigné·es d'une personne décédée ou prise en otage. Comment pleurer publiquement la mort et la souffrance des Israélien·nes sans que nos sentiments soient politiquement métabolisés contre les Palestiniens ?
Nous avons de bonnes raisons de nous en inquiéter : alors que les Israélien·nes comptent leurs mort·es, des politiques israélien·nes et américain·nes appellent à faire couler le sang palestinien déployant un langage direct, génocidaire. « Nous combattons des animaux humains et nous agirons en conséquence », a déclaré [lundi 9 octobre] le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant. « Netanyahou, finissez-les », a demandé l'ancienne ambassadrice [états-unienne] aux Nations unies et candidate républicaine à l'élection présidentielle, Nikki Haley. « Neutralisez les terroristes », a exigé le sénateur démocrate John Fetterman. Des Juif·ves [américain·es] partagent des mèmes dénonçant le plus grand nombre de victimes juives depuis l'Holocauste, sans chercher à savoir qui, en ce moment même, fait l'objet d'un nettoyage ethnique, ou à savoir le nombre de massacres de cette ampleur que Gaza a connu dans la dernière décennie.
De ce langage fusent des bombes qui s'abattent sur les habitant·es de Gaza depuis le ciel, rasant des quartiers entiers, anéantissant sans sommation des familles, blotties dans leurs maisons parce qu'elles n'ont nulle part où fuir.
« Il y a des morceaux de corps éparpillés partout. Il y a encore des disparus », a déclaré à CNN un homme vivant au nord de Gaza City. « Nous sommes toujours à la recherche de nos frères, de nos enfants. C'est comme si nous étions obligés de vivre bloqués dans un cauchemar ».
Sans doute, cette poussée génocidaire s’étendra bientôt, alors que le gouvernement israélien distribue des armes automatiques aux colons de Cisjordanie dont beaucoup étaient déjà des militants armés prônant l'élimination [de cell·eux qu'ils appellent « les Arabes », ndlt]. Par ce biais le deuil juif est dévoyé, alimentant la violence d'un système impitoyable d'asservissement des Palestiniens de la Méditerranée au Jourdain.
Ce deuil est mobilisé par les politiques américains qui soutiennent Benjamin Netanyahou et son gouvernement extrémiste qui a semé la mort, provoqué le déplacement de tant de Palestinien·nes et annihilé tout espoir de solution diplomatique. Ce deuil est aussi mobilisé, avec tambours et trompettes, pour soutenir la livraison d'armes à Israël alors même que nous savons, comme l'a écrit Haggai Mattar dans +972 Magazine, « qu'il n'y a pas de solution militaire au problème d'Israël avec Gaza, ni à la résistance qui émerge naturellement en réponse à un apartheid violent ».
Du manque de vocabulaire émotionnel et politique
Nous ne pouvons pas laisser notre chagrin être détourné vers ces objectifs, mais, savoir alors où le diriger n’est pas clair. Quiconque a évolué dans nos mouvements sait qu'ils ne sont pas préparé·es à encaisser les coûts émotionnels et politiques.
Nous voyons des individus et groupes juifs que nous pensions avoir ralliés à notre lutte, ou au moins avoir commencé à faire bouger politiquement, serrer soudain les rangs, proclamer leur soutien à l’armée israélienne, se réfugier dans le désespoir.
Les relations déjà complexes et fragiles entre les militant·es palestinien·nes et juif·ves de gauche - ainsi qu'entre courants au sein de ces deux entités - sont ébranlées par le fait que nous peinons à trouver une signification commune aux images qui nous parviennent via nos écrans. Des ami·es et des collègues de tous bords sont blessés par les réactions publiques des un·es et des autres, ou par leur silence.
Un militant antisioniste chevronné avec qui j'ai discuté se demande si un « gouffre » n'est pas en train de se creuser entre les militant·es palestinien·nes et juif·ves, d'autant que le moment actuel a rendu visibles les liens tangibles des Juif·ves de la diaspora avec ce lieu et ces personnes qui ne sont pas, comme on pourrait s'y attendre, uniquement le fruit de la propagande israélienne.
Au cours du week-end [du 7 et 8 octobre], de nombreux·ses Juif·ves antisionistes patentés n’ont pas réussi à se joindre aux manifestations de solidarité, découvrant qu'ils avaient besoin de quelque chose que les manifestations ne pouvaient pas leur fournir : un espace pour pleurer les mort·es israélien·nes, pour lutter depuis leur propre place dans le processus politique qui s'ouvre.
C'est une situation à laquelle aucun·e d'entre nous n'a jamais été véritablement confronté·e puisque le nombre de mort·es est, depuis longtemps, terriblement disproportionné. Et aujourd'hui, alors que nous en avons le plus besoin, nous nous débattons, aux prises avec une insuffisance de vocabulaire émotionnel et politique.
Découvrir le goût de cette peur
Le 7 octobre, mon propre ressenti a énormément varié. D’abord, la peur. Écouter attentivement le langage génocidaire de ce gouvernement israélien depuis un an, c’est vivre dans la terreur du jour où il trouverait une excuse pour le transformer en actes. Dans n+1, un autre rédacteur en chef de Jewish Currents, David Klion, rapporte les paroles d'un militant universitaire [anti guerre] après le 11 septembre : le jour où Bush a déclaré la guerre aux Irakiens, il avait prophétisé : « Ils sont déjà morts », leurs destins étaient scellés. J'ai senti cette même sentence dans mon corps, m’effondrant en pleurs devant l'écran.
Très vite aussi, j’ai été admirative. J'ai regardé encore et encore l'image du bulldozer détruisant la clôture de Gaza et j'ai pleuré des larmes d'espoir. J’ai vu des adolescents palestiniens en rodéo sur une voiture volée, à 800 mètres de là où ils n’étaient jamais allés ; un blogueur gazaoui réalisant subitement un reportage depuis Israël.
Mais ces images ont été rapidement rejointes par d’autres : l’image d’un corps de femme, largement dénudé et tordu à l’arrière d’un camion ; des pièces pleines des corps des familles empilés, les murs éclaboussés de sang.
Je voulais désespérément garder ces images séparées, conserver la métaphore libératrice et bannir la violence de la réalité. Lorsque j’ai commencé à accepter qu’il s’agissait de photos du même événement, je fus accablée de désespoir et me retrouvai aux prises grandissantes avec un sentiment d'aliénation envers celles et ceux qui ne semblaient pas partager mon chagrin, alors que l’ampleur du massacre devenait visible.
« J'ai des amis juifs antisionistes qui ont légitimement peur », a écrit l’écrivaine et journaliste [palestinienne], Hebh Jamal, dans un article du Mondoweiss. Elle analyse que, malgré toute l'empathie qu'ils et elles ressentent pour la souffrance palestinienne, il est probable que ces allié·es ne découvrent que maintenant le goût de cette peur – et de cet état de deuil – qui définit l'expérience des Palestinien·nes depuis des décennies. Elle aussi a perdu quelqu'un cette semaine : un cousin de 20 ans. « Je ne me réjouis pas de la mort. Je me réjouis de la possibilité de vivre », écrit-elle, et c'est pourquoi « si je crois ne serait-ce qu’une seconde qu’une fin à tout cela est possible, je ne peux pas réprouver les militants. »
Hebh décrit le "sentiment de possible" que ces événement ont fait naître chez de nombreux·ses Palestinien·nes, car ils ont boulversé – peut-être juste momentanément, cela reste à voir – la grille de lecture hégémonique qui les condamne à mourir dans l’attente de leur liberté, puisque tant des chemins non-violents empruntés pour se libérer ont été réprimés ou ignorés. Sa vision semble partagée par tant de Palestinien·nes que je connais, et en qui j'ai confiance, que je me dois de trouver les moyens d'entendre.
Leçon de l'Exode
Derrière mon écran, alors que j'observais les gens débattre des modèles de lutte anticoloniale en convoquant des comparaisons avec l’Algérie, l’Amérique du Nord et l’Afrique du Sud, le mythe fondateur de la libération juive m'est revenu : l’Exode. Difficile de ne pas penser à ce moment du Seder [repas rituel, ndlt] de Pâque où nous égrennons les plaies [d'Égypte, ndlt] en prélevant, goutte par goutte du bout de nos doigts, le vin qui remplit nos verres. Ce rituel s’est imposé comme une référence fondamentale car il met en exergue l'idée que, pour conserver notre humanité, toute violence doit susciter notre chagrin, même celle dirigée contre l'oppresseur.
J'ai aussi repensé aux plaies elles-mêmes, en particulier la dernière, la mort qui s'abat sur tous les premiers-nés [égyptiens, ndlt] – enfants, adultes, personnes âgées. J'ai réalisé qu'au cœur du mythe de notre libération se cache l’idée que la violence s'abattra sans distinction sur la société de l'oppresseur.
Je sais que j’ai beaucoup d’amis, et que Jewish Currents a de nombreux lecteur·rices, qui se demandent comment faire partie d’une gauche qui semble considérer la mort d’Israélien·nes comme un mal nécessaire, sinon souhaitable, de la libération palestinienne. Mais ce que nous rappelle l’Exode, c’est que la déshumanisation nécessaire à l'oppression et l'occupation d’un peuple déshumanise toujours, aussi, celui qui l'opprime.
Si certain·es sentent que leur douleur est dépréciée, c’est parce qu’elle l’est : c'est la marque d'une spirale de dévalorisation de la vie humaine. Comme le dit la géographe abolitionniste [des prisons et de la police, ndlt] Ruth Wilson Gilmore : « Là où la vie est précieuse, la vie est précieuse ».
Nous découvrons que les Juif·ves, en tant qu’agents de l’apartheid, ne seront pas épargnés — même ceux d’entre nous qui ont consacré leur vie à œuvrer pour y mettre fin. (Je pense à Hayim Katsman, zichrono l'vracha [que sa mémoire soit bénie, ndlt] tué par le Hamas, qui militait contre l'expulsion de la communauté palestinienne de Masafer Yatta en Cisjordanie, et à Vivian Silver, otage à Gaza, connue de nombreux·ses habitant·es comme la personne au poste-frontière d'Erez, qui plaide et rend possible leur transfert vers des hôpitaux israéliens pour recevoir des soins)
Les Palestiniens sont les protagonistes de l'histoire
S'interroger sur les moyens de renouer avec cette humanité constitue, en définitive, une question pour notre militantisme.
Ces derniers jours, beaucoup ont martelé que « personne ne peut se permettre de dire aux Palestiniens comment résister ». Cet axiome devrait être compris littéralement : ils ne le demandent pas.
Ce qui a rendu l’expérience de cet événement si différente du statu quo – pour les Palestinien·nes comme pour les Juif·ves – tient au fait que les Palestiniens étaient, pour une fois, totalement sujets du moment et, non objets des actes des autres. Ils sont les protagonistes de l'histoire.
Je considère comme un énorme échec de nos mouvements de ne pas avoir été capables de façonner un outil capable de produire un tel renversement par d’autres moyens.
Nos mouvements juifs pour la Palestine n'ont pas été assez puissants pour empêcher d’autres Juif·ves d’abattre des Palestinien·nes lors des manifestations pacifiques vers les murs qui enferment Gaza, ni pour empêcher les Palestinien·nes d’être viré·es, harcelé·es et attaqué·es en justice pour avoir dit la vérité sur leur expérience ou – blasphème ! – pour avoir prôné la tactique non-violente du boycott.
Nous voilà, aujourd’hui, dépourvu·es d'une véritable lutte commune, capable de répondre de manière crédible à ces massacres d’Israélien·nes et de Palestinien·nes. Connaissant tout le chemin parcouru par de nombreux·ses Juif·ves et Palestinien·nes pour se rapprocher depuis de longues années, je suis profondément convaincue que c’est cet échec qui, aujourd'hui, nous divise.
À ma connaissance, aucune formation politique majeure n'existe, parvenant à englober la subjectivité politique des Juif·ves et celles des Palestinien·nes en ce moment, sans tenter de dissoudre l’une dans l’autre. Nul lieu n’existe où, les Juif·ves et les Palestinien·nes qui s’accordent sur les bases de la libération palestinienne – le droit au retour, l'égalité et les réparations – parviennent à formuler une stratégie cohérente synthétisant leurs deux subjectivités.
L’inéluctabilité de cet événement constitue l’une de ses plus terribles dimensions. La violence de l'apartheid et du colonialisme engendre toujours plus de violence. De nombreuses personnes se sont débattues avec la sentence qu'implique ce constat, s'efforçant d'expliquer que le reconnaître ne signifie pas l'accepter.
La Palestine, lieu des possibles
Je me rappelle que ce sont les Palestinien·nes, dont beaucoup écrivent et s'expriment entre ces pages, qui m’ont appris à considérer la Palestine comme un lieu des possibles — un endroit où l'idée même de l'État-nation, qui a tant nui aux deux peuples, pourrait être remodelée, voire entièrement détruite. Et que ce sont les Palestinien·nes qui m'ont ouvert l'esprit à de multiples visions du partage de la terre.
À gauche, j’espère que nous ne prendrons pas l’inéluctabilité de la violence pour une limite indépassable de notre travail ou la fin de notre exigence intellectuelle. Même si nos rêves d’un mieux ont échoué, ils doivent nous accompagner dans la traversée de ce moment.
Nous devons imaginer un mouvement de libération dépassant même l'Exode — un exode où aucun des deux peuples ne doit partir. Où leurs membres restent pour recoller les morceaux, se refondant non pas seulement en tant que Juif·ves ou Palestinien·nes, mais aussi en tant qu'antifascistes, travailleurs et artistes.
Ce que je veux c'est ce que la poétesse et activiste juive portoricaine Aurora Levins Morales décrit dans son poème Mer rouge* :
Nous ne traverserons pas tant que nous ne nous portons pas entre nous,
nous tou·tes réfugié·es, nous tou·tes prophètes.
Fini l’attente de son tour sur la roue de l'histoire
tentant de recouvrer de vieilles dettes que nul ne peut payer.
La mer ne s’ouvrira pas ainsi.
Cette fois-ci, ce pays
est ce que nous nous promettons l'un·e à l'autre,
notre rage qui s'écrase entre nos joues pressées les unes contre les autres
jusqu'à ce que les larmes inondent l'espace qui les séparent,
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ennemis,
car cette fois personne ne sera abandonné à la noyade
et nous tou·tes devrons être élu·es.
Cette fois, c'est nous tou·tes ou aucun·e.
*Écrit en avril 2002, pendant la deuxième intifada [ndlt].
Traduction : Sarah Benichou & Arno Soheil Pedram
Version originale sur le site de Jewish Currents
----------------------
Nota Bene : Les propos ici traduits ont été produits dans un contexte différent de celui que nous connaissons en France. Parmi les 6 à 7 millions de Juif·ves vivant aux États-Unis, une part importante appartiennent à des mouvements ou structures religieuses, politiques et culturelles juives qui sont nombreuses et extrêmement diverses. Les controverses qui les opposent ou les traversent existent dans le débat public, ainsi qu'au sein des mouvements sociaux et de la gauche.