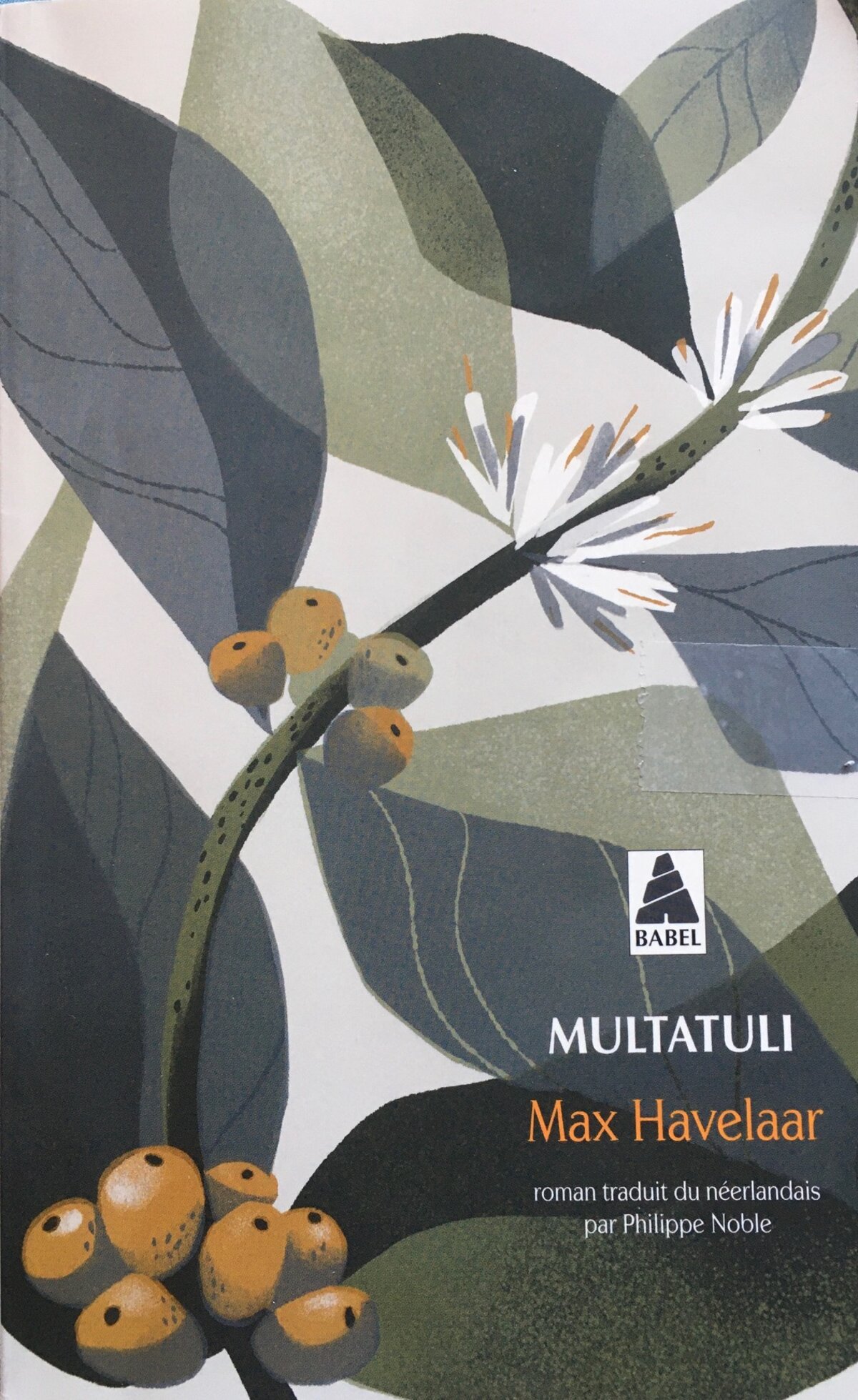
Agrandissement : Illustration 1
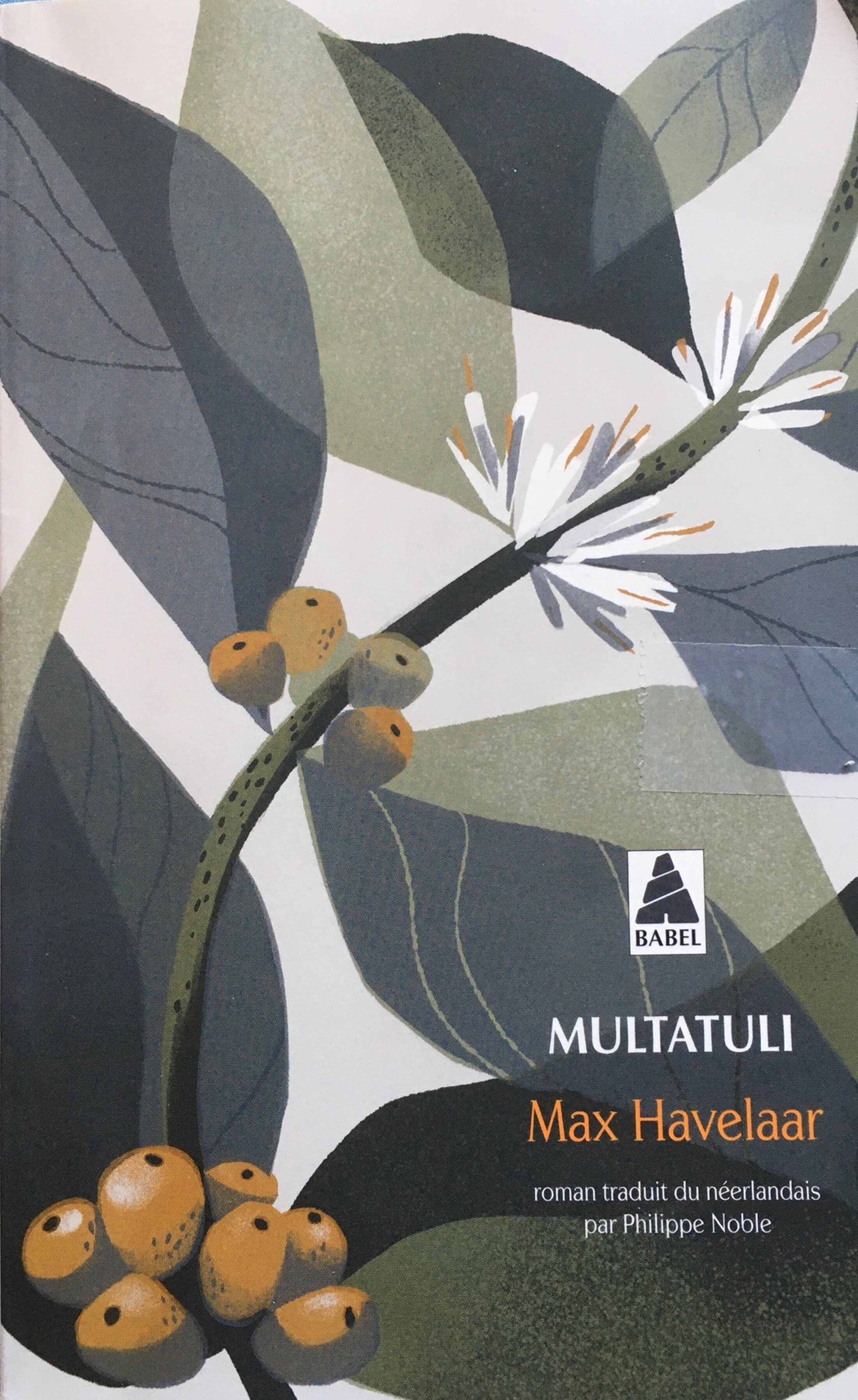
Peu de romans ont changé le monde. En France, on pourrait citer Les Misérables de Victor Hugo, paru en 1862, qui a donné chair à l'élan révolutionnaire commencé près d'un siècle plus tôt: il fut le bréviaire de générations d'opprimés. Max Havelaar, publié en 1860 et maintes fois réédité depuis, devenu un classique étudié dans les établissements scolaires des Pays-Bas, appartient à cette catégorie, il a eu un impact immense sur l'opinion et contribué à modifier les lois.
Son auteur, "Multatuli" (un pseudonyme), est immortalisé par une statue à Amsterdam, l'une des principales marques de café équitable s'appelle "Max Havelaar", mais le livre reste méconnu en France, peut-être parce que l'empire colonial français s'est surtout déployé en Afrique et aux Antilles, alors que son action se situe pour l'essentiel dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Indonésie, mais dont la plus grande partie était à l'époque une colonie des Pays-Bas, les "Indes néerlandaises".
Le système des cultures forcées
Une colonie mise en coupe réglée, d'abord par la puissante Compagnie des Indes orientales, la VOC, qui a réussi à évincer les Portugais du très lucratif commerce des épices (un gramme de clou de girofle valait plus que son poids en or). Puis, à partir de 1799, par l'État néerlandais. Ayant brisé les rébellions, en particulier à Java où la répression fit 200 000 morts dans la population civile, celui-ci a mis en place un système de cultures forcées dont les produits étaient exportés vers la métropole : les paysans étaient tenus de réserver jusqu'à un tiers de leurs terres, souvent des propriétés collectives, à des denrées qui avaient un intérêt pour les marchés européens - principalement le café, mais aussi le thé, le sucre, le poivre ou l'indigo - au détriment de cultures vivrières telles que le riz.
Les Pays-Bas s'appuyaient pour cela sur un réseau étendu d'administrateurs et de comptables venus de Hollande, les résidents et résidents adjoints, comparables à nos préfets et sous-préfets, mais aussi sur l'aristocratie locale, dont la hiérarchie était coiffée par un régent - c'est la version néerlandaise de l'indirect rule qui a permis aux Britanniques de contrôler un immense empire colonial avec peu de militaires et d'expatriés. Tous, régents compris, étaient des fonctionnaires payés par l'État, les résidents prêtant le serment de défendre la population, soit des dizaines de milliers de personnes, parfois jusqu'à 100 000, contre les abus des possédants. Dans la réalité, les paysans étaient pressurés des deux côtés, réquisitionnés en masse pour des corvées chez le noble du coin ou l'administrateur européen, tandis que leurs buffles, leurs femmes ou leurs filles pouvaient être également "confisqués". Quand ils étaient à bout, ils s'enfuyaient et parfois rejoignaient la rébellion armée dans une province voisine.
Foncièrement intranquille
Il était plus commode de muter un résident qui prenait ses responsabilités trop au sérieux que de s'attaquer à un régent : c'est l'amère expérience qu'a faite l'auteur de Max Havelaar, Eduard Douwes Dekker (1820-1887), qui a passé près de deux décennies dans différentes régions de l'actuelle Indonésie, où il était parti à l'âge de dix-huit ans. Imprégné du texte biblique (ses parents appartenaient au courant protestant mennonite, qui préfère l'engagement personnel au dogme religieux), mais aussi de Goethe ou Diderot, il devient franc-maçon, et même le premier athée militant des Pays-Bas. Très endetté - un thème récurrent dans le roman -, il mène une vie errante en Europe, n'osant pas retourner dans son pays de peur de ses créanciers, et meurt dans le dénuement.
Entretemps il a écrit, sous le nom de "Multatuli" ("J'ai beaucoup supporté" en latin), ce roman étonnamment moderne mêlant avec humour le monologue d'un négociant en café d'Amsterdam, convaincu que la prospérité est un signe de la faveur divine et que la misère n'accable que les paresseux ou les méchants, à des poèmes, des contes, des lettres administratives, et bien sûr le récit de l'affrontement de son double, Max Havelaar, avec une administration pour qui l'idéal suprême est la "tranquille tranquillité". C'est un indigné aux Indes néerlandaises - on dirait aujourd'hui un "lanceur d'alerte". Mais Douwes Dekker est aussi un écrivain qui use de plusieurs techniques littéraires, en avance à cet égard sur son temps.
Foncièrement "intranquille", Havelaar est un homme qui allie l'intelligence à la plus vive sensibilité, déchiré entre ses responsabilités de père de famille et sa conviction qu'il faut redresser l'injustice. Il a été marié un temps à Sumatra à une femme "indigène", Si Upi Keteh, et il est fait allusion à cette union dans le livre, ce qui était totalement tabou à l'époque.
En avance sur son temps
C'est surtout un homme qui ne veut pas être réduit à sa fonction, à un "costume", qui sait qu'une certaine vérité de l'être se dévoile ailleurs que dans le travail : "Le matin au réveil, le monde vous tombe de tout son poids sur le coeur et c'est lourd à porter pour un coeur, même des plus forts. Mais le soir on fait une pause. Dix heures pleines s'étendent entre l'instant présent et celui où l'on reverra son costume. Dix heures : trente-six mille secondes pour être vraiment humain! La perspective sourit à tout un chacun. C'est l'instant où j'espère mourir, pour arriver dans l'au-delà en arborant un visage non officiel. C'est l'instant où votre femme retrouve sur vos traits un peu de ce qui l'a attirée...". Ses rapports avec son épouse européenne, "Tine", sont d'une étonnante vivacité, elle est le contraire d'une femme-potiche.
"LE JAVANAIS EST OPPRIMÉ", en lettres capitales, est le message final de ce livre qui eut dès sa parution un grand retentissement : il occasionna un débat au parlement de La Haye, ce qui était sans précédent pour une fiction littéraire. Convaincus que le système des "cultures forcées" était obsolète et qu'il valait mieux le remplacer par le salariat "libre", les libéraux se saisissent du thème. En 1870 une loi agraire est adoptée qui participe de cette évolution : désormais on va privilégier un colonialisme dit "éthique", qui voit dans l'enseignement ou la santé des populations une partie intégrante de ses prérogatives. En 1899, des juristes néerlandais élaborent le concept de "dette d'honneur" (Een Eereschuld) pour souligner l'apport de l'empire colonial à l'enrichissement des Pays-Bas. On retrouve cette idée dans les débats actuels autour des compensations réelles ou symboliques : ni la Grande-Bretagne, ni la France, ni la Belgique n'auraient connu une telle puissance industrielle sans leurs empires coloniaux.
Phare du tiers-monde
L'auteur de Max Havelaar était déjà mort, et avait exprimé durant les dernières années de sa vie une opinion critique des bienfaits du salariat ou du capitalisme, au vu de ce qui se passait aux Pays-Bas. Quant à l'empire colonial néerlandais en "Insulinde", il s'est maintenu jusqu'à l'invasion japonaise, en 1942, les Pays-Bas essayant de le rétablir après la victoire des Alliés. Mais le mouvement indépendantiste indonésien avait déjà pris son essor, non sans convulsions, avant que l'Indonésie ne devienne l'un des phares du "tiers-monde" et du jeune mouvement des non-alignés à la conférence de Bandoung, en 1955, à laquelle ont notamment participé le Chinois Zhou Enlai, l'Égyptien Nasser, l'Indien Nehru et le futur président ghanéen Kwame Nkrumah.
Ce volet a fait l'objet d'un récit de l'historien et écrivain belge de langue flamande David Van Reybrouck (dont l'extraordinaire Congo a marqué les esprits) : Revolusi - le nom que porte en Indonésie l'accession à l'indépendance. Il sortira en français à la rentrée chez Actes Sud, traduit par Isabelle Rosselin, à qui on devait la version française de Congo, et par Philippe Noble, qui a récemment révisé sa traduction de Max Havelaar, toujours chez Actes Sud. On ne peut que la recommander.



