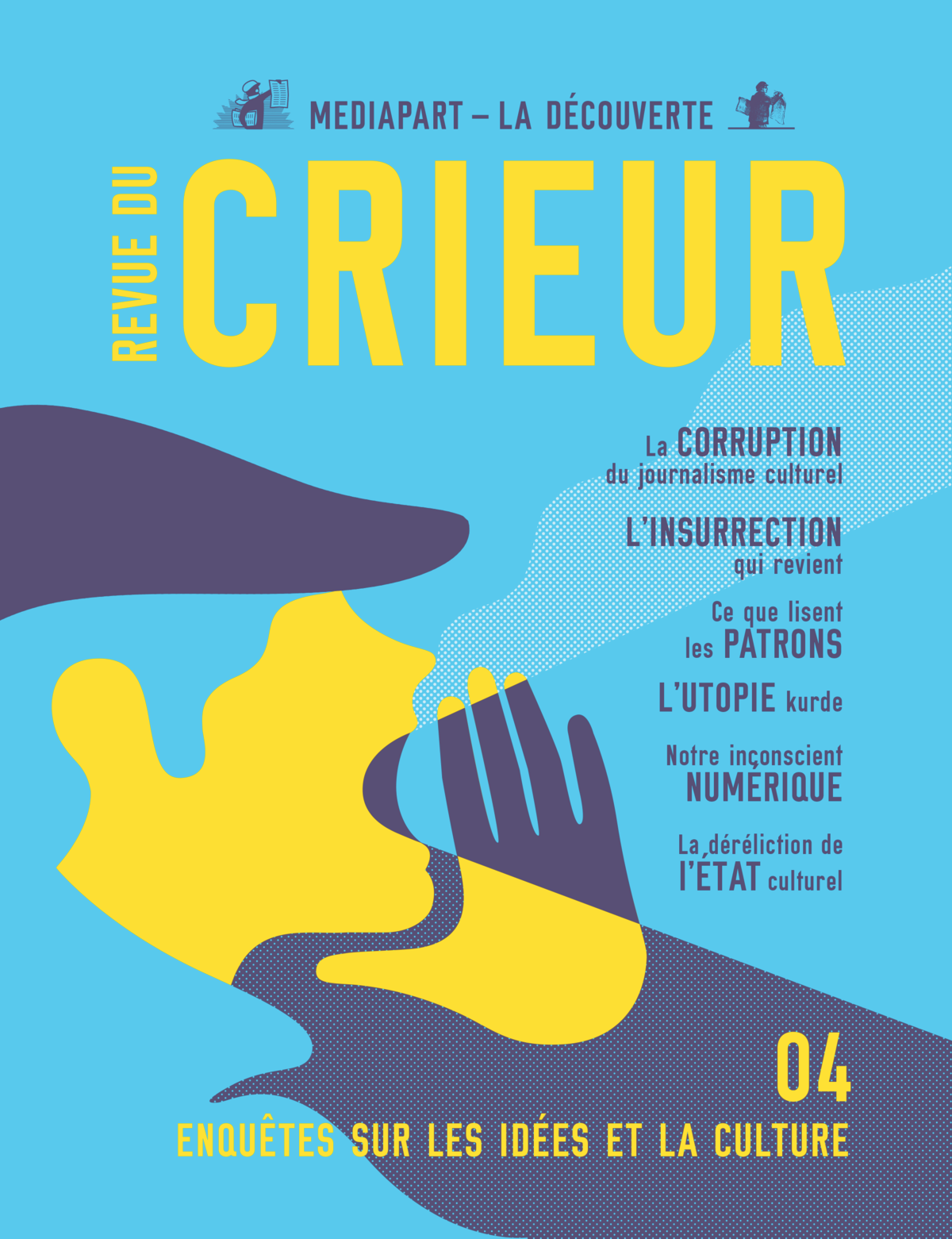
Agrandissement : Illustration 1
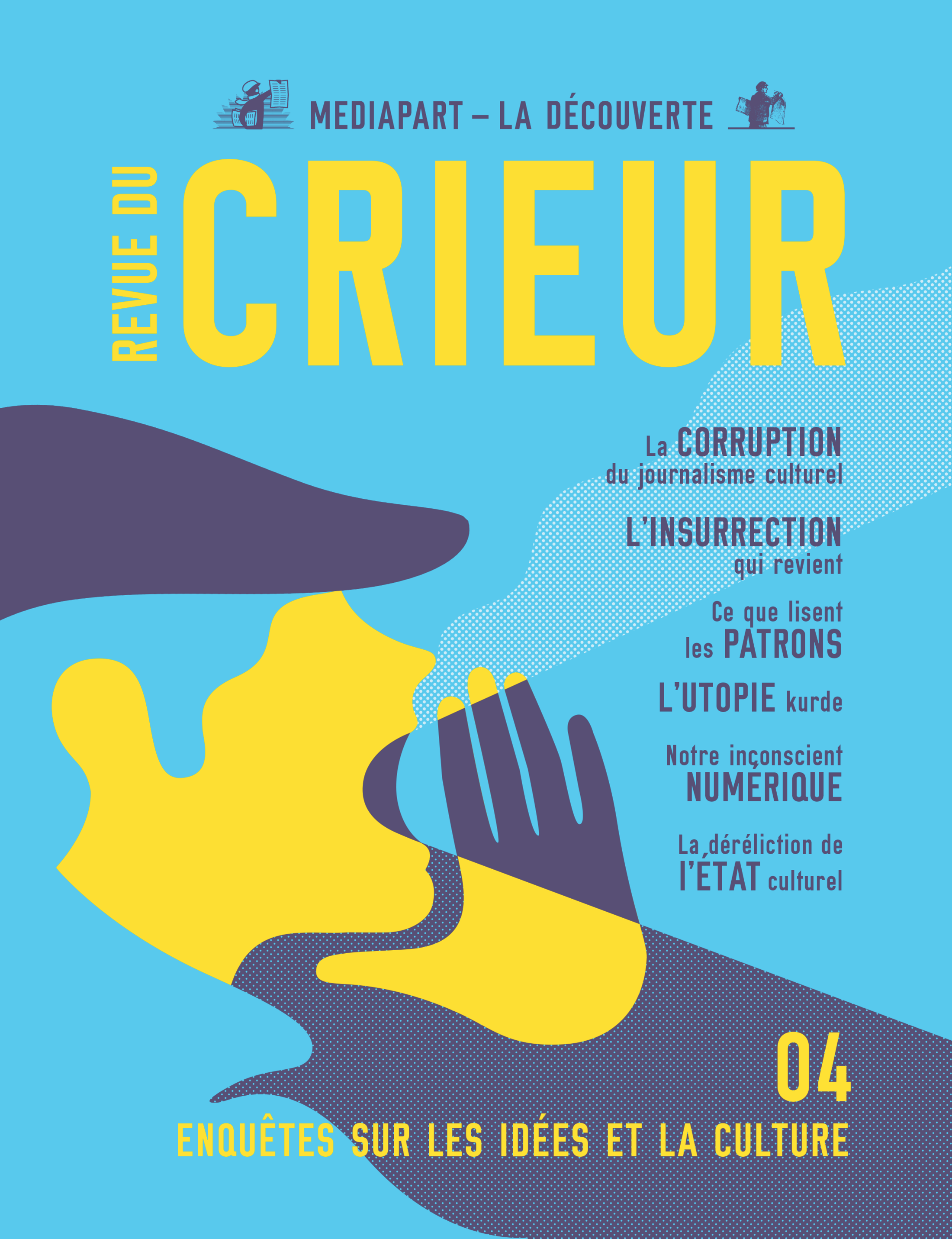
La « Nuit debout », qui a surgi au cœur des villes françaises dans le sillage des mobilisations contre le dynamitage réactionnaire du Code du travail, a commencé par inventer un nouveau calendrier. Démarrant le 31 mars, premier soir de rassemblement sur la place de la République à Paris, il n’envisage les jours qu’en prolongation de la lutte, sa durée gagnée et ses convergences accumulées. Un interminable mois de mars se dresse ainsi comme une barricade de temps sauvé et libéré, face à la machinerie horlogère du pouvoir, ses décisions imposées d’en haut, ses passages en force oligarchiques, son agenda autoritaire et inégalitaire.
Dans ses thèses « Sur le concept d’histoire », son dernier écrit de 1940, Walter Benjamin soulignait combien tout réel bouleversement démocratique et social de l’ordre existant suppose un autre imaginaire du temps. « La grande Révolution introduisit un nouveau calendrier, écrit-il. Le jour avec lequel commence un nouveau calendrier fonctionne comme un ramasseur historique de temps. Et c’est au fond le même jour qui revient toujours sous la forme des jours de fête, lesquels sont des jours de remémoration. » Et de rappeler aussi qu’en juillet 1830, durant les Trois Glorieuses, on vit des insurgés parisiens tirer sur des horloges murales.
Pourfendeur d’une histoire écrite par avance, ne laissant pas de place à l’imprévisible de l’événement, Benjamin opposait le calendrier à l’horloge, l’invention de l’un à la répétition de l’autre. Le temps mécanique, quantitatif et immuable, de l’horloge ou de la montre, c’est celui de la domination, un temps d’immédiateté, sans mémoire ni histoire, temps d’un présent monstre où l’oubli du passé congédie le possible du futur. Avec l’inattendu de la révolte surgit la tentative d’arrêter ce temps vide et d’ouvrir la voie à un autre temps, celui de la pensée, de la parole et de l’action. Un temps nouveau, porteur d’une espérance improbable qui puisse conjurer le probable de la catastrophe.
Parier sur cet improbable, c’est prendre le temps de l’invention contre la fatalité. Le temps, aussi, de reconstruire des cadres d’espérance et de réarmer des possibles – comme le font plusieurs expérimentations politiques, du Kurdistan aux campus sud-africains, en passant par les nouveaux imaginaires et pratiques de la révolte en France, dont la Revue du crieur se fait l’écho dans ce numéro.
Découvrez le sommaire :




