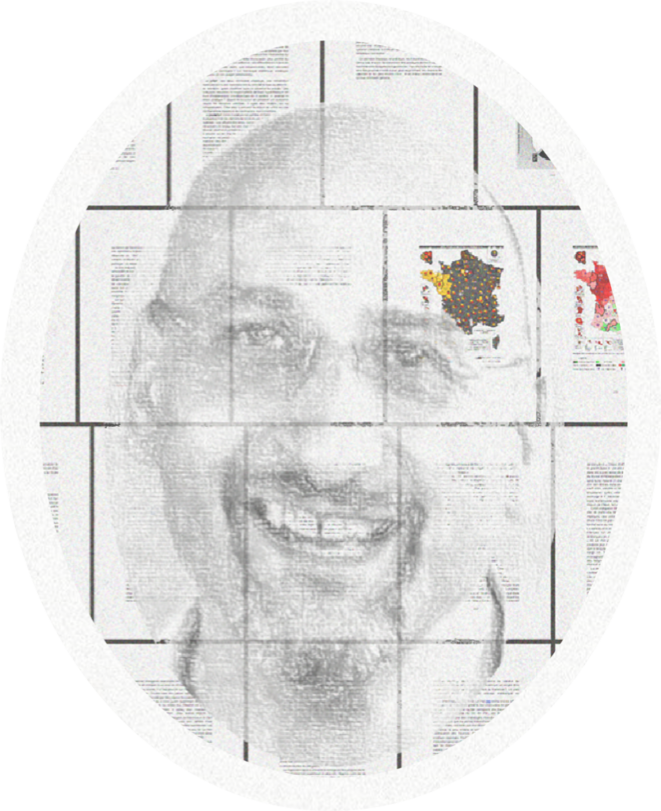A tous les médias qui ont relayé en juin 2024 l’information d’un score de J. Bardella à 31 % ( de quelques 50 % d’inscrits )[1], il faudrait retourner la verte critique de S. Leys, autrefois adressée à une éminence de l’intelligentsia maoïste parisienne : « Le problème c’est… Que les électeurs, il faut les prendre au sérieux. […] Je parle de son œuvre, pas de sa personne. […] Ce qu’on peut dire de plus charitable, c’est que c’est d’une stupidité totale. Parce que si on ne l’accusait pas d’être stupide, il faudrait dire que c’est une escroquerie. »[2] Comme quoi, les idées changent, le microcosme reste.
Que ces mésusages des données chiffrées aient été stupides ou escrocs, une fois rectifiés, il apparaît que la question institutionnelle se fait de plus en plus pressante en vue de ressouder ce qui peut encore l’être d’un corps civique fracturé.
- En juin, quels favoris pour les législatives ?
L’histoire républicaine de la France a débuté en 1792, l’Institut d’études politiques de Paris existe depuis plus d’un siècle et demi. Pourtant, dans l’espace public, les scores électoraux sont encore débattus comme s’il s’agissait d’une langue étrangère. Il semblerait même qu’universitaires et élus, à savoir les spécialistes les plus concernés par ces sources, en fassent des interprétations erronées et proposent des stratégies électorales ou politiques inefficientes.
Il suffisait de faire une soustraction pour réaliser que, dans le corps électoral, la liste conduite par J. Bardella aux européennes totalisait environ 400 000 voix de moins que M. Le Pen au premier tour de 2022. Autrement dit, ses pseudos progrès étaient imputables au jeu politique plutôt qu’à une quelconque lame de fond sociétale, prétendument aussi subite qu’irrésistible. Le chef du parti lepéniste a-t-il vraiment cru qu’il parviendrait à élargir son socle électoral de manière à la fois substantielle et généralisée dans le territoire pour atteindre la majorité des sièges à l’Assemblée ? Même si la répétition obsessionnelle de ce scénario peut lui donner force de vérité aux yeux des néophytes, tout spécialiste devait estimer ce récit fantaisiste au vu de la concentration des électeurs du Rassemblement National dans quelques régions et de la faiblesse structurelle d’un parti qui n’a jamais excédé le tiers de l’électorat national.
Paradoxalement, la dissolution offrait au parti présidentiel l’opportunité d’un succès relatif facile, plutôt matière à un plan de communication qu’à la mise en œuvre de politiques publiques. En effet, les défections les plus nombreuses aux européennes venaient de ses rangs, et ses réserves électorales se montaient aux deux tiers de l’électorat d’E. Macron en 2022. Cet atout stratégique n’a pas été pleinement valorisé faute d’une bonne gestion tactique de la campagne. Même si le moment pouvait sembler favorable à la remobilisation de ses troupes, le prétexte de dissolution, à savoir la débâcle aux européennes, était un premier écueil sur lequel le parti présidentiel s’est abîmé. Au-delà des arguments avancés sur le caractère national ou non de ce scrutin, il avait péniblement réuni dans les bureaux de vote la moitié des inscrits sur listes électorales. Une élection ainsi négligée est par nature un non-événement, et en faire l’origine d’une crise politique majeure passe pour une basse manœuvre. La cacophonie qui s’ensuivit parmi les députés macronistes sortants traduisait l’absence de préparation de cette campagne à mener tambour battant.
Quant à la gauche, malgré des réserves également importantes en raison du dédain de nombre de ses sympathisants pour le fait européen ; sa situation initiale apparaissait plus fragile, compte tenu de son assise électorale étriquée à l’échelle nationale. En effet, depuis que s’est ouvert le cycle macroniste en 2017, l’ensemble des gauches piétine à un niveau plus bas que lors des législatives catastrophiques de 1993. Ce qui était alors une défaite infamante passe aujourd’hui pour une victoire glorieuse, c’est dire à quel point elles ont perdu en crédibilité… Et bien su gérer les législatives d’un point de vue strictement tactique. Quitte à se réclamer de l’histoire, faut-il souligner qu’aux deux années requises durant les années 1930 pour concilier les gauches révolutionnaire et réformiste, seuls quelques jours ont été nécessaires à nos deus ex machina des années 2020 ? Ces accords opportunistes de Nouveau Front Populaire sur la quasi-totalité des circonscriptions ont optimisé leurs faibles voix. Cela amène la question du front républicain.
- 2024 : un front républicain de pacotille ?
En 2002, les ralliements à J. Chirac du premier au second tour réunissaient près de la moitié du corps électoral. A elles seules, les sorties d’abstentions se chiffraient à 6 % des inscrits. En 2024, non seulement les sorties d’abstentions sont dérisoires, mais en plus divisées entre les partis à l’initiative du front républicain et celui qui en est la cible. Les ententes d’appareil pour des désistements mutuellement avantageux permettent d’évaluer à 8,4 % des inscrits du second tour les électeurs en déshérence qui ont reporté leur voix vers un candidat de front républicain. Or, les inscrits du second tour ne tiennent pas compte des quelques 6 millions d’inscrits qui n’ont pas été convoqués en raison d’un siège pourvu au premier tour dans leur circonscription. En 2024, les masses humaines engagées dans ce processus de Front républicain sont donc, à l’échelle de la France et du précédent historique de 2002, dérisoires. Elles relèvent du même ordre de grandeur que les seules sorties d’abstention de 2002.
Pire encore : il serait possible de mener une étude plus détaillée pour déterminer d’une part où ces voix ont permis une victoire à l’arrachée, où chacune a été indispensable ; d’autre part où elles ont servi à creuser l’écart, à envoyer un message. La portée symbolique de celui-ci est d’autant plus brouillée que ce mouvement est faible à l’échelle nationale. Forcément, le lepénisme actuel pesant deux fois plus lourd que celui des années 2000, il se pourrait même que des électeurs ayant participé en 2002 au front républicain soient désormais passés dans l’autre bord. Quant à les mesurer de manière plus fine, ce travail reste à entreprendre.
Ce front républicain apparaît plus comme un accord de partis que comme une dynamique populaire. Dans les villes où le vote de gauche était plus massif, et où les médias se concentrent, l’illusion peut avoir paru crédible et justifié les discours ambiants sur la puissance de ce phénomène. En effet, une fois les bureaux de vote triés selon l’offre électorale après éliminations et désistements, le détail des reports de voix montre que ce mot d’ordre a été presque unanimement suivi à gauche ; sauf pour deux dixièmes de cet électorat qui se partagent à parts égales entre l’extrême droite et les non exprimés ( abstentions, blancs & nuls ). Dans les circonscriptions où la droite a été éliminée dès le premier tour, l’emprise du front républicain a été beaucoup plus mitigée, seule la moitié des électeurs ayant infléchi leur vote à cet impératif. Autrement dit, la surestimation médiatique du front républicain agit comme un marqueur socio-culturel, procède plus d’une culture partisane que de l’observation du corps électoral.
- Mais alors, qui a gagné ?
Lors d’un scrutin législatif, soit la victoire s’impose d’elle-même par l’acquisition de la majorité absolue des sièges, voire une majorité relative en position ultradominante comme lors de la législature 2022 ; soit il faut admettre la défaite collective. Paradoxalement, ce n’est pas la rupture avec la précédente législature qui marque le plus profondément cette nouvelle assemblée, mais la continuité. 408 députés ont été réélus, soit que leur ancrage local reste indiscuté, soit que les électeurs aient voulu annuler l’initiative présidentielle en reconduisant autant que possible les députés à leur poste. Les changements ne peuvent tenir qu’aux 139 primo-députés qui découvrent le palais Bourbon et aux 30 anciens députés qui siègent après une interruption.
Certes, ces nouvelles forces offrent un avantage au Nouveau Front Populaire. L’occupation assidue de l’espace médiatique a accrédité l’idée d’une victoire. Cependant, les extrêmes droites et les partis centristes talonnent cette alliance politique de circonstance. En fait, le rééquilibrage d’une assemblée dépourvue de majorité absolue permet à de faibles variations d’avoir un impact considérable sur la formation de majorités. Le parti présidentiel a été le plus lourdement sanctionné, au profit des Républicains actuellement en passe de former un gouvernement.
Une fois que l’on replace l’Assemblée nationale dans le jeu institutionnel, le parti des Républicains se situe au centre de gravité politique par sa maîtrise du Sénat ainsi que son positionnement à la charnière du parti présidentiel et de la forte opposition d’extrême droite. A l’inverse, la gauche isolée se trouve mécaniquement marginalisée. Quel qu’ait pu être le succès de son offensive médiatique, la communication ne saurait se substituer à la politique. En revanche, elle n’est pas dépourvue d’effets : ces idées, auxquelles ne croient vraisemblablement pas leurs émetteurs, prennent racine chez une partie de leurs destinataires et attisent les frustrations. Nous assistons à une sorte de réédition du « coup de poignard dans le dos » diffusé à l’envie par l’armée et l’extrême droite au début de la République de Weimar. Un mythe populaire peut infléchir puissamment le devenir d’une démocratie fragilisée.
- Quelles missions pour le gouvernement Barnier ?
Dans la confusion ambiante, ce n’est pas uniquement la communication qui prend le pas sur l’action politique ; la gestion des affaires courantes fait office de vision pour le pays. Sans doute les choix budgétaires ont-ils une dimension politique, mais pour un gouvernement comme pour un épicier, bien tenir la caisse ne dit rien du projet que l’on porte. Ce problème d’intendance, pour déterminant qu’il soit dans la conduite des opérations, ne tient pas lieu de plan d’ensemble.
Quand on aborde les élections non pas comme un outil de légitimation plus ou moins artificiel de pouvoirs discrédités, mais comme un microscope permettant d’ausculter l’opinion publique, il apparaît que la crise de régime qui couve dans le pays depuis des décennies atteint désormais le sommet de l’Etat. Toutes sortes de dispositions institutionnelles permettaient de préserver la puissance législative en l’absence de plébiscite net. Ce n’est désormais plus possible. J. Fourquet a notoirement dépeint un « archipel français » qui se transcrit désormais dans l’éclatement des groupes parlementaires ; encore faut-il admettre que la vision qui s’en dégage est nettement édulcorée par rapport aux fractures du corps civique, de la base au sommet.
Durant les années 1790, la citoyenneté était chose nouvelle et se définissait dans chaque constitution. Nous l’avons déconstruite au fil de ces dernières décennies et sa refondation s’impose comme une étape nécessaire de la régénération d’une quelconque cohésion nationale. Ça, c’est une piste à suivre pour la base, qui peut être assortie de toutes sortes de mesures complémentaires et convergentes. Au sommet, la présidence de la République présente des dysfonctionnements allant des conditions d’élection aux modèles de gouvernance. Sans méconnaître que l’élection du président de la République au suffrage universel direct a permis, depuis 1962, de dépasser des conflits multiséculaires entre incarnation de l’Etat et représentation de la nation ; des ajustements sont inéluctables. L’expertise de plus de soixante ans d’histoire de pratiques présidentielles offre une base de réflexion collective solide.
L’entre-deux, les corps intermédiaires, questionne les rapports entre Etat et société civile, un vaste débat impossible à trancher ici. En revanche, qu’il s’agisse de la question présidentielle ou de la citoyenne, la législature 2024 offre une représentation assez large des divers courants d’opinion de la France. Ouvrir ce chantier avec une telle assemblée pourrait être le véritable défi historique du gouvernement qui prend actuellement forme sous l’autorité de M. Barnier. Même si les cultures partisanes sont porteuses de préférences institutionnelles, la constitution est un patrimoine commun et un outil puissant pour canaliser les forces vives du pays afin de restaurer l’influence internationale de la France.
C’était la conviction du général de Gaulle dès l’après-guerre, est-ce celle de ses héritiers auto-proclamés ?
- Morel.
[1] Les chiffres ici communiqués sont arrondis et simplifiés par souci de clarté et de fluidité. Ces valeurs s’appuient sur mon étude des législatives en libre accès : https://www.youtube.com/@jeremymorel3098
[2] Simon Leys, lors d’une émission de Bernard Pivot, « Apostrophes », à propos du livre d’une personnalité de l’intelligentsia maoïste de Paris. Cité dans F. Gardel et M. Weschler, « Simon Leys, l’homme qui a déshabillé Mao », produit par O. de Bannes pour O2B Films et Pulic Sénat, 2023, 41’50’’ à 44’22’’