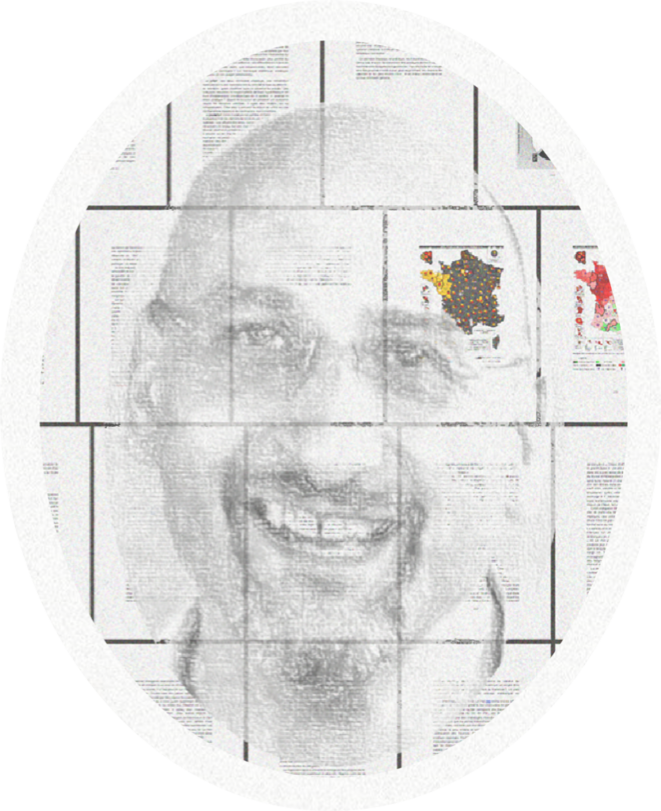J'ai déjà pointé les qualités du travail de Yann Bouvier pour authentifier les réalités historiques convoquées à la légère par notre personnel politico-médiatique ( inculte ? ). L'exercice auquel il s'est livré hier est plus difficile, car il ne s'agit pas d'histoire, mais d'historiographie. La manière d'écrire l'histoire engage la modélisation du réel. Il ne s'agit pas d'établir ce qui a existé ou n'a pas existé ponctuellement, mais d'interroger la manière de comprendre, de mettre en relation ces faits ponctuels du passé. C'est une autre base du travail d'historien, totalement ignorée du grand public, et pourtant la plus décisive.
L'historiographie est ce qui distingue le fait historique de la réalité du passé. En effet, beaucoup croient qu'un événement passé est un fait historique. C'est idiot. Exemple : 1789, Révolution française. Le premier historien de l'événement a été Barruel. Il l'a interprétée comme le résultat d'un complot maçonnique. Dès lors, pour employer un vocable à la mode à Paris, cela aurait été un fait complotiste. En revanche, depuis deux siècles et demi, les historiens ont enrichi la compréhension de l'événement 1789 pour en faire un fait historique, c'est-à-dire un événement compris dans une logique historienne, à l'appui d'une connaissance solide de l'historiographie ( sources, méthodes, problématiques et conclusions successives des chercheurs ).
La vidéo de Yann Bouvier est disponible ici : https://www.youtube.com/shorts/PAmIHBnbQNE?feature=share. C'est un premier dépoussiérage du sujet "communisme = nazisme ?", mais il appelle des approfondissements. Ci après, quelques pistes de réflexion à suivre, conclues par un petit jeu...
Commentaire de vidéo historiographique :
L'argument sur les contributions communistes à des gouvernements de coalition m'apparaît faiblard. En effet, l''exemple tchécoslovaque d'après-guerre montre que ces situations peuvent être comprises comme transitoires. Soit le rapport de force est favorable à une main-mise totale du parti, soit la rupture et la marginalisation politique sont inéluctables.
Dans le même ordre d'idées, invoquer les textes des vaincus de l'histoire pour signifier que des programmes communistes non violents ont existé, c'est négliger que les Mencheviks n'ont pas subi l'épreuve des responsabilités d'Etat. A quelles outrances la guerre civile russe les aurait-elle menés ? Nul ne le saura jamais : pure spéculation.
L'emploi du concept d'Etat policier est également maladroit. Les chiffres pourraient être à vérifier, mais je crois me souvenir d'une comparaison marquante : 30 000 agents de la Gestapo pour toute l'Europe hitlérienne, contre 200 000 agents de la Stasi à la fin de la petite RDA. Or, si je m'en tiens à la problématique soulevée, le problème n'est pas un contrôle policier des masses populaires, mais la systématisation de crimes de masse ( la "petite" Gestapo ayant été infiniment plus criminelle que la "grande" Stasi ).
Si je récapitule, en matière de crimes de masse, les communismes européens de l'après déstalinisation peuvent offrir des exemples pertinents de régimes répressifs sans verser dans les outrances sanguinaires. Les communismes asiatiques ont massivement été criminels ; et ils le restent en Chine et en Corée du Nord. Seul le Viêt Nam a nettement accordé la priorité à l'ennemi extérieur plutôt qu'à l'ennemi intérieur ; au début pour des raisons évidentes, ensuite pour des motifs à approfondir, joints à des inflexions profondes du régime au fil des décennies. Un autre Etat est ici négligé, pourtant important par le modèle particulier qu'il offre à tous égards : Cuba.
Une fois ce petit panorama exploré, la question qui surgit immanquablement est la suivante : si d'autres régimes d'inspiration hitlérienne avaient pris forme, tous auraient-ils atteints la même démesure criminelle, autant liée à l'idéologie qu'au contexte de Deuxième Guerre mondiale ? Le recyclage de cadres nazis dans les dictatures latino-américaines offre un début de réponse, mais aussi les premières nuances. Dois-je ajouter : à suivre ?
En résumé, ce débat et cette vidéo interrogent l'ensemble des déclinaisons possibles, plus ou moins violentes, d'idéologies potentiellement criminelles par leur représentation ultra-conflictuelle des sociétés ( lutte de classes sociales, lutte de classes raciales, et question sous-jacente de l'éradication de l'ennemi de classe ).
Vous l'avez compris : pour ma part, je considère que ces deux idéologies procèdent du même schéma, de la même structure conceptuelle : la lutte de classe. Même si les politiques publiques préconisées sont aux antipodes, leur logique commune favorise l'emploi de moyens analogues. Par conséquent, s'agissant des méthodes, ce sont moins, selon moi, les principes que les contextes qui tranchent.
C'est ainsi que je lis le débat historiographique ouvert au début des années 1980 par Ernst Nolte. Au lieu de chercher, avec l'auteur et ses contradicteurs, une sorte d'apprentissage direct des méthodes communistes par les nazis ( camps de concentration... ) ; je considère que des systèmes de représentations comparables dans leurs structures trouvent des solutions plus ou moins similaires selon leur contexte historique, même s'il s'agit d'atteindre des finalités différentes.
Petit jeu pour conclure... Parmi les idéologies de lutte de classes, je compte le féminisme post-Beauvoir comme lutte de classes sexuelles. Quels moyens ces féministes emploient-elles en France de nos jours pour éliminer leur ennemi de classe ?