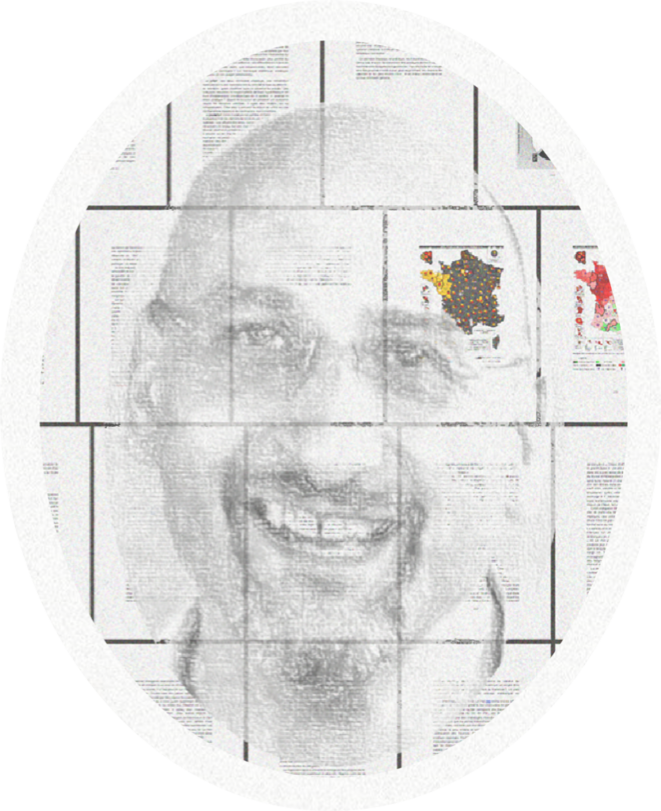Commentaire de vidéo d'actualité : https://www.youtube.com/watch?v=z7Dph4DNYx0
Vidéo dense, petit récapitulatif ( critique ) des notions :
- Journalisme d'opinion et politique partisane : le journalisme d'opinion est diabolisé de nos jours, mais hérite d'une tradition ancienne. S'agissant de la tradition, elle remonte au moins à la Révolution française, et son intérêt tient plus au talent des contradicteurs qui enrichissent le débat qu'à la volonté partagée de dominer les mentalités. Cela contribue au pluralisme des médias ( voir infra ). Concernant la mode actuelle, les journalistes se piquent de faire de l'information là où leurs rivaux, journalistes aussi, feraient de la désinformation. Ces querelles de basse cour sont indignes du moindre commentaire. Ici, l'intervenante, C. d'Ornellas, distingue le journalisme d'opinion, qu'elle assume, de l'activisme politique partisan. Dans les termes, cela est net : stratégies électorales... Cependant, dans les faits, les deux sont étroitement imbriqués. Il suffit de penser à un journal d'opinion comme l'Humanité, organe du PCF, pour comprendre que le journalisme d'opinion est fondamentalement partisan en dernière instance.
- Pluralisme des médias et neutralité du service public : sur ce point, les journalistes des médias publics auraient sans doute beaucoup à apprendre des fonctionnaires de terrain dans toutes les administrations. Lors des concours, une épreuve s'intitule "agir en fonctionnaire de l'Etat". La France hérite d'une tradition de grands serviteurs de l'Etat depuis, au moins, G. de Nogaret, et cette épreuve tente ( vainement ? ) d'en prolonger la portée. A cet égard, un média public devrait traiter l'actualité dans un esprit de neutralité ( ce qui tient compte des limites humaines de l'exercice ). Même si l'intervenant peut avoir des capacités limitées ( ils font parfois peine ces gens-là ), cela peut commencer par des garde-fous élémentaires : confronter les divers points de vue en présence, ne pas afficher ostensiblement sa préférence pour les uns ou les autres... Si l'animateur de média public est inculte ou niaisement militant, n'importe quel auditeur peut discerner son bord politique par les termes choisis, les invités privilégiés, les problématiques valorisées... En fait, dans un média public, le journaliste est théoriquement moins sanctionné pour son orientation politique que pour son absence de talent à la dissimuler. En l'occurrence, n'importe quel fonctionnaire de terrain ( mairie, hôpital, école... ) pourrait expliquer à de tels Narcisse comment faire : casser leur miroir.
En revanche, le pluralisme des médias engage l'ensemble de l'offre médiatique. Ainsi, considérer que le groupe Bolloré devrait être pluraliste est totalement absurde. A l'échelle de l'offre globale, ce groupe répond à d'autres qui sont tout aussi partisans. Sur ce point, que le meilleur gagne, c'est la libre concurrence... Ou presque. En effet, la presse écrite est libre, car elle atteint ses lecteurs par ses moyens propres, alors que l'audiovisuel se divise en trois catégories. Le public totalement dépendant de l'Etat, le privé sous contrat avec l'Etat pour l'accès gratuit à ses usagers, et le privé totalement indépendant et payant. On peut admettre ou rejeter pour des raisons partisanes la radiation de C8 de la TNT, mais sur le principe, l'Etat a vocation à contrôler le respect du cahier des charges par les médias qui atteignent leurs auditeurs à sa charge et à ses frais.
- Censure : parmi les tares de l'enseignement délivré par l'Education nationale, on peut compter ce concept. Avec l'étude des régimes totalitaires, on ancre dans les esprits l'idée simpliste selon laquelle une pensée serait exclusivement prohibée du débat public par l'intervention directe d'une institution ( mise à l'Index par l'Eglise, vérité officielle énoncée par le Duce, Vojd ou Führer... ). Cela n'est pas totalement faux, mais minimise complètement d'autres mécanismes aussi efficaces... A commencer par le conformisme intellectuel. Bien avant les pouvoirs institutionnalisés, les réflexes grégaires sont les tombeaux de la pensée réflexive et critique. D'ailleurs, sur ce point le statut protecteur du fonctionnariat peut favoriser le meilleur comme le pire, la protection des avant-gardistes qui choquent leurs contemporains mais portent une vérité ( figures de Galilée modernes ) vouée à triompher, et les malfaisants qui utilisent en toute impunité leur influence comme un pouvoir de nuisance. Là encore, ce n'est ni le statut, ni la cause qui tranche le jugement de l'histoire ; mais le talent, et les dynamiques collectives. Face au foisonnement de facteurs de succès et d'échec, les historiens ne se replient pas sur l'argument des théologiens ( "les voies de la Providence sont impénétrables" ), mais presque : "nécessité fait loi". La parole qui s'impose est celle qui a vocation à le faire. Cela ramène à une forme de modestie les porte-voix de chaque idéologie. Certes, leur talent compte pour les distinguer personnellement de ceux qui appartiennent aux mêmes mouvances. Cependant, leur succès ultime se trouve ailleurs : dans un contexte favorable.
- Les médias font-ils l'opinion, ou l'opinion fait-elle les médias ? C. Gaboriaux s'est penchée sur les contradictions des républicains des années 1870. En effet, ces derniers essuyaient des défaites électorales tout en se revendiquant du peuple. Dur... Elle détaille ensuite utilement leur conversion à un monde paysan et populaire, au lieu de s'obstiner à prêcher ( leur mépris ) dans le désert. Ce que j'en retiens, c'est que, pour l'impopulaire, reporter la responsabilité de son échec sur les médias, c'est une manière de déresponsabiliser le public courtisé, tout en expliquant qu'il détient la Vérité à laquelle se rallier. Dès lors qu'on admet, premièrement, qu'une Vérité existe indépendamment des observateurs, deuxièmement que l'expression des masses populaires peut transcrire cette Vérité, alors oui, le succès des médias tient plutôt aux observations et convictions des masses populaires qu'aux individus qui s'inventent un destin en projetant sur le monde leur sensibilité et leurs croyances. La dialectique média-opinion publique n'en est pas abolie pour autant, et le rapport de forces peut être tranché par des pouvoirs auxiliaires : police politique, capital... Dans un pays comme la France, où les pressions sur l'individu sont limitées, nous pouvons raisonnablement considérer que la population fait les médias plus que les médias ne font l'opinion publique ( même si le diable se cache dans les détails ).
En conclusion, un petit mot en contrepoint de l'appel ici formulé : j'aimerais plutôt que les médias commentent moins les sondages, qui globalement polluent le débat public, et se recentrent sur des sources plus sérieuses.