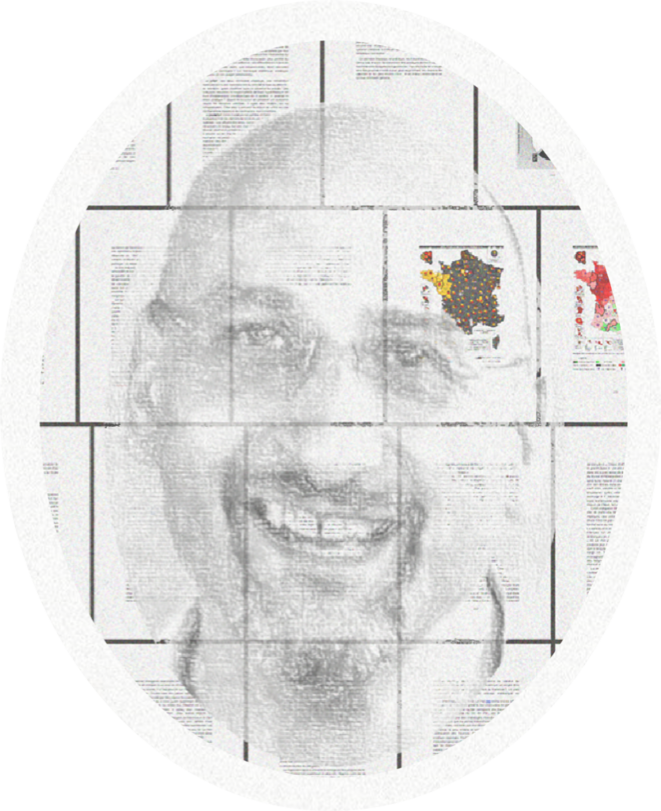- Mesurer l’inconsistance de l’histoire de France dans le grand public… Et les élites :
Mon propos ne s’appuie pas sur une étude exhaustive qui reste sans doute à entreprendre. Néanmoins, j’ai consacré un quart de siècle à la discipline historique et m’intéresse à divers titres à sa transmission comme à sa conception. La bibliographie sur l’historiographie est très abondante, et n’importe quel professionnel de l’histoire en maîtrise a minima un échantillon significatif : ouvrages généralistes comme le classique Delacroix, Dosse et Garcia ( 1999 ), articles de l’Encyclopedia Universalis, ou encore toutes sortes de livres dédiés à des thématiques précises, publiés à l’occasion des concours de l’enseignement.
A l’heure actuelle, à part un quelconque inventaire de perles historiques telles que les recensait Jean-Charles durant les années 1960, des sondages peuvent donner une idée de l’état des connaissances historiques dans la population française. Harris Interactive en a réalisé un pour la revue Historia en 2019[1], sur lequel je reviendrai selon les circonstances. Quant aux examens nationaux, ils ne concernent que des classes d’âge successives, dont les modalités et critères d’évaluation changent sans doute plus rapidement que leurs aptitudes intellectuelles. Même si les corps ont une histoire et si l’exposition des cerveaux à des environnements toxiques pourrait en affecter les capacités ; les cerveaux de nos jeunes générations devraient correspondre à peu près à ceux de leurs aïeux, sauf à reconnaître une dégénérescence physiologique collective.
Pendant des années, j’ai sondé un entourage de personnes diplômées, principalement entre bac +3 et bac +5, dans diverses spécialités. La question était simple : « Imaginez-vous en situation d’écrire une histoire de France. Vous commenceriez où, quand, pourquoi ? » Bien sûr, en lisant cet intitulé, les historiens détecteront instantanément le problème épistémologique de l’origine. Mais indépendamment de cela, sans se perdre dans une longue digression, il reste l’impératif pratique d’une première page blanche à noircir d’encre…
Au vu des réponses que j’ai obtenues pendant des années, je crois pouvoir affirmer que les Français méconnaissent totalement leur histoire telle qu’elle s’écrit de nos jours par les spécialistes. Les responsabilités sont nombreuses dans cet état de fait, et étroitement liées au repoussoir du roman national. Nous l’avons tant et si bien démantelé que l’histoire de France en est elle-même devenue incompréhensible pour les publics les plus instruits. A cet égard, il serait intéressant de sonder les hauts fonctionnaires de la rue de Grenelle pour déterminer quelle vision ils ont de l’histoire du pays et de l’Etat qu’ils sont sensés servir, et qu’ils semblent désarticuler en miroir de leur pensée éclatée entre toutes sortes de groupes de pression.
- Vercingétorix notre ancêtre : autopsie d’un succès pédagogique révolu.
Le nom de Vercingétorix fait souvent office de chiffon rouge pour des personnes qui chargent avant de réfléchir ; Bismarck s’est ainsi joué du taureau gaulois en matador patenté… Mon propos n’est pas de réécrire l’histoire comme on le faisait à la fin du XIXe siècle. Il s'agit de comprendre pourquoi cette vision de l’histoire a si bien imprégné la population française que, même dans sa contestation, elle reste La référence.
Sans trop s’étendre sur les présupposés politiques de l’après Sedan qui auraient motivé un retour aux sources du tumultus gallicus, E. Lavisse a été le maître d’œuvre de cet enseignement en tant que membre du conseil supérieur de l’Instruction publique à partir de 1896. Les lois Ferry démocratisant progressivement l’école ont alors un peu plus de 10 ans. E. Lavisse n’est pas un communicant à la façon des instituteurs nationaux que nous donne le paysage audiovisuel français de nos jours, mais un universitaire. Autrement dit, l’histoire de France qui entre au programme se caractérise, certes, par le militantisme du roman national qui nous obnubile de nos jours, mais aussi par une filiation forte avec l’histoire nationale qui fait autorité au même moment.
Le même Lavisse en entreprend la rédaction en laissant d’autres travaux en suspens, et cela devient l’œuvre de sa vie, introduite par le fameux Tableau de la géographie de la France légué par P. Vidal de la Blache à la nation et à la postérité ( 1903 ). Lavisse érige un monument de l’école méthodique, dérivée du positivisme ; cela à une époque où le mariage entre République et Raison incite à graver sur la tour Eiffel les noms des scientifiques qui transforment et modernisent de manière efficiente et évidente la nation ( non sans contestations ). Notre intelligentsia actuelle, pathologiquement « déconstructionniste » et stérilisante à tous égards, serait-elle par nature anti-républicaine ?
Toujours est-il qu’E. Lavisse bénéficie de plusieurs décennies de rationalisation du travail d’archives amorcé par J. Michelet. Son expertise des sources en sort consolidée. Dans le même temps, l’administration centrale préconise de manipuler des documents avec les élèves, afin de garantir leur intérêt ainsi que la scientificité de l’enseignement. Contrairement à ce que l’on peut s’imaginer de manière anachronique, le roman national s’impose dans un premier temps par sa rigueur méthodologique. En revanche, les historiens de ces générations peinent encore à modéliser le devenir d’une nation au-delà de ses incarnations. Voltaire le premier en avait proposé le programme. Il avait cependant fait tout le contraire faute d’outils performants dans l’observation des sociétés, durant un siècle d’intuitions intellectuelles confinant au génie, mais grevées par une grande immaturité des savoirs collectifs.
En résumé, avec E. Lavisse, nul ne conteste que son histoire post dix-neuvièmiste s’articule sur des figures édifiantes, car nul ne peut encore proposer mieux. Si par la même occasion cette généalogie nationale inculque l’amour de la patrie, la France du siècle naissant le considère favorablement. Les manuels de primaire et secondaire déclinés de l’histoire universitaire sont tant et si bien plébiscités qu’ils charpentent une politique éducative puissante et pérenne.
Il pourrait être tentant d’attribuer ce succès à une forme de mandarinat, l’œuvre du maître notabilisé ayant été relayée par ses disciples ( et fonctionnaires d’Etat ) jusqu’à atteindre, par capillarité, les couches sociales les plus profondes. Rapports de pouvoirs et diffusions des idées ne sauraient être dissociés, mais les propriétés desdites idées ne doivent pas pour autant être négligées. E. Lavisse renouvelle les généalogies nobiliaires en les élargissant au peuple entier. Avant lui, A. Thierry avait tenté de suivre un tiers-état unifié au travers des siècles. C’est une histoire collective qui s’écrit comme une saga familiale, et que tout un chacun peut facilement appréhender, sinon s’approprier. Autrement dit, cette vision de la France, scientifiquement désuète, pourrait s’être remarquablement enracinée dans la population par la conjonction entre histoires universitaires, scolaires et populaires.
En outre, il faut avoir présent à l’esprit que, pour les générations formées durant les dernières décennies de la IIIe République puis la IVe République, cette histoire de France s’étire du premier siècle avant notre ère au début du XXe siècle. Elle couvre alors moins de deux millénaires et est globalement centrée sur l’espace français. Cette cohérence n’est sans doute pas étrangère au succès pédagogique du roman national.
- De l’intérêt scientifique pour le temps long à la déconstruction des figures édifiantes de l’histoire nationale.
Lorsque F. Braudel publie sa thèse d’Etat sur la Méditerranée, en 1949, il modélise le cours du temps selon une tout autre logique. Le temps long relègue au second plan l’événement, les accidents de l’histoire, les figures auparavant jugées décisives. Le roman national subit donc un choc scientifique décisif. Son onde porte sur les décennies suivantes, en s’amplifiant avec la volonté politique de réviser une histoire par trop nationaliste.
En 1963 paraît un manuel imposant à destination des publics scolaires : Le monde actuel, histoire et civilisations ( collectif ). Il se trouve que j’en tiens un exemplaire alors usité en filière professionnelle, pour l’ensemble des deux années de BEP. Tous les établissements de France ne se sont pas forcément appuyés sur cet ouvrage, mais force est de constater qu’un tel choix impliquait une ambition pédagogique sans commune mesure avec ce qui s’observe dans les éditions scolaires actuelles. Nous reviendrons sur ce point, que chacun peut vérifier en consultant la Grammaire des civilisations de F. Braudel ( 1987 ), qui en est directement tirée.
Par son existence, ce manuel témoigne d’une relative convergence entre histoires universitaire et scolaire. Cependant, la population s’est-elle emparé de cette approche désincarnée ? Celle-ci est issue du courant des Annales qui avait pour vocation d’observer les masses plutôt que les Grands. Au-delà de monographies segmentaires de la population ( les mineurs, les paysans, les ouvriers, les femmes… ), elle ne semble pas interpeler aussi bien le corps civique dans son ensemble. Une préfiguration de la fragmentation singulariste ?
Autant l’histoire de France de Lavisse s’est imposée parmi les lieux de mémoire ( selon la formule de P. Nora ) majeurs hérités de la IIIe République ; autant l’Histoire économique et sociale de la France dirigée par F. Braudel et E. Labrousse ( 1970-1982 ) n’a vraisemblablement résonné dans la société française que de manière très diffuse et indirecte. Dans le champ scientifique, elle est la clef de voûte du courant historique des Annales, au moment même où émerge une Nouvelle histoire appelée à le supplanter. D’aucuns de relever cette coïncidence qui voudrait que les recherches novatrices engagées en ordre dispersé trouvent leur aboutissement dans une histoire de France assurant la transition vers d’autres champs d’exploration scientifique…
Toujours est-il que cette histoire de France a pour originalité de débuter au milieu du XVe siècle, faute de sources suffisantes pour appliquer aux siècles antérieurs les méthodes sérielles préconisées par l’école des Annales. Elle paraît précisément au moment où les responsables politiques s’inquiètent de la médiocrité du débat public en matière économique, alors que les oppositions politiques atteignent un paroxysme sur la lutte de classes. A ce titre, les apports de F. Braudel et E. Labrousse auraient pu s’avérer aussi inestimables pour façonner le corps social que pour infléchir les pratiques scientifiques. De fait, les approches statistiques et sociologiques foisonnent dans les ouvrages historiques, dont les manuels scolaires. De l’omniprésence de cet héritage des Annales ne résulte pourtant ni une vision d’ensemble de l’histoire de France, ni une claire conscience de ce moment fondateur de nos connaissances.
Là où J. Michelet et E. Lavisse ont sanctifié leurs œuvres pour la postérité, les auteurs des Annales n’interpellent guère que les érudits. Leur histoire de France se noie dans une profusion de publications moins pointues, qui reprennent la trame des romans nationaux sans l’esprit ni l’exigence. Depuis lors, les grandes histoires universitaires qui vont être mentionnées surclassent sans doute les œuvres de vulgarisation pour leur rigueur scientifique, mais aucunement pour leur notoriété, leur poids dans l’imaginaire collectif. Ce divorce entre histoires universitaire et populaire était consommé dès les années 1970-1980, et ses manifestations se sont multipliées jusqu’à la crétinisation actuelle du débat public en matière historique, laquelle confine à la pathologie déconstructiviste.
- Un déconstructivisme issu de la double illégitimité de l’histoire de France ?
Sans revenir sur la marginalisation des historiens dans l’opinion publique en matière d’histoire de France, deux autres dynamiques peuvent avoir conjointement délégitimé l’histoire nationale.
La première touche à la formation des professeurs d’histoire… Qui n’en sont pas. Faut-il rappeler que ces enseignants dédient une partie de leur temps à la géographie et à l’EMC ( ex-éducation civique ) ? Ainsi, à en croire les instructions officielles, ces professeurs du secondaire doivent consacrer autant de temps à l’histoire qu’à la géographie, et moitié moins que chacune à l’EMC. En d’autres termes, les 3 heures hebdomadaires dévolues au professeur d’histoire de la 6e à la 4e se partagent entre 2 x 2/5e + 1/5e. Sauf erreur, les 2/5e de 180 minutes équivalent à 72 minutes ; peu importe ici que les heures scolaires soient plutôt de 55 minutes…
L’enseignement de l’histoire est survalorisé dans les discours publics par toutes sortes de formules qui, dans ce contexte, deviennent obscènes : « il faut connaître les erreurs du passé pour ne pas les reproduire », « il faut savoir d’où l’on vient pour savoir qui l’on est et où l’on va »… Quand on accorde un volume horaire à peine supérieur à celui des arts plastiques et de la musique à l’enseignement d’une matière prétendument capitale pour la cohésion nationale, la décence proscrit tout commentaire et toute ambition. Or, à chaque crise de société comme lors des attentats de 2015, des ministres bien inspirés d’invoquer les missions des « professeurs d’histoire-géo », non plus hussards noirs de la République, mais croquemorts de la nation.
Même parmi ces professionnels la conscience de l’histoire nationale s’affaiblit. En effet, les concours de recrutement sont pensés de manière à accorder une subvention indirecte aux chercheurs de toutes périodes et tous domaines, par un système de rotation des questions au programme des concours. Cela partage entre tous une manne éditoriale qui leur est bien utile, au prix de l’intérêt général. Des candidats travaillent ainsi des thématiques qui, pour certaines, se répercutent sur à peine une heure d’enseignement durant les 7 années de scolarisation dans le secondaire : « Economie et société dans le monde byzantin »…
Le mauvais sort fait à l’histoire de France par les concours d’enseignement est d’autant plus criant que l’autre versant principal du concours, la géographie, est mieux pensé pour l’enseignement comme pour le service d’une éducation dite nationale. En effet, la géographie de la France en est une question fixe, étudiée par les candidats chaque année, et elle concerne les élèves pendant plus d’un an de leur scolarité tout cumulé. L’instauration d’une question fixe d’historiographie de la France garantirait au moins que les enseignants soient conscients des enjeux scientifiques de l’histoire de leur pays. Actuellement, ils peuvent devenir professeurs ou docteurs ès histoire sans jamais avoir ouvert une histoire de France ; problème heureusement rarissime du fait de l’intérêt qu’ils portent à leur discipline.
Alors même que les institutions de la République n’accordent aucun intérêt spécifique à l’histoire nationale, la nation se fragmente à partir des années 1960-1970. L’accueil de ressortissants des anciennes colonies porte en germe ce que les historiens nomment pudiquement des « conflits mémoriels ». Nous en venons ainsi à la seconde illégitimité de l’histoire de France. Pour une part grandissante de Français, c’est la France qui est combattue à travers son histoire. Comme souvent dans les logiques post-coloniales, le summum de conflictualité est atteint sur les questions franco-algériennes.
Dans son Histoire de France parue chez Odile Jacob en 2001 et rééditée en 2009, M. Ferro brosse les contours d’une « France au miroir [des autres] ». Cette curiosité historiographique est potentiellement féconde, même si elle s’appuie ici sur des anecdotes individuelles dont la représentativité laisse sceptique. Concernant « Le regard des Arabes », leur choix semble guidé par le titre d’un article antérieur à la guerre d’Algérie : « Deux peuples qui se haïssent et qui s’adorent… ». Le conflit mémoriel n’est qu’une dimension d’un conflit géopolitique mêlant des forces plus variées, dont les démographiques.
Les élites françaises actuelles s’alignent de plus en plus sur la mémoire FLN de la guerre d’Algérie, y compris au mépris des travaux d’historiens. Bien sûr, quand un article des actualités d’Orange parle de « manifestants pacifistes algériens »[2] réprimés et pour partie noyés dans la Seine le 17 octobre 1961, ce pourrait n’être le symptôme que d’un certain illettrisme journalistique. Cependant, le fait de considérer les criminels de guerre du FLN[3] comme des disciples de Gandhi est une absurdité procédant vraisemblablement d’une sujétion intellectuelle, voire politique.
Cette manifestation pacifique de 1961, orchestrée par le mouvement indépendantiste dans la capitale de l’ennemi colonisateur, a fait suite à des vagues d’attentats rappelées dans l’Histoire de France dirigée par J. Cornette. Celles-ci sont systématiquement ignorées dans les médias français, par complaisance ou par inculture. La France était pour le FLN la 7e wilaya, région militaire ; dans le champ mémoriel, elle l’est manifestement restée et le FLN y trouve encore de nos jours « ses porteurs de valises ».
L’aboutissement des ces défaillances des élites administratives et culturelles, c’est que les professeurs d’histoire sont doublement martyrs de la République.
D’abord et avant tout du fait de leur hiérarchie qui leur ôte les moyens de l’exercice de leur fonction. Non contents d’abolir ainsi leurs chances de transmettre une conscience éclairée de l’histoire de France, la conception des programmes est éclatée en quelques focales échelonnées de la paléontologie au XXIe siècle, tout en s’offrant le luxe d’une dispersion géographique au gré des modes multiculturelles. Autant il est indispensable de se décentrer au XXe siècle, avec le déclassement du pays qui l’a inféodé à d’autres pôles de puissance, autant les vagabondages historiques antérieurs sont dictés par des mobiles idéologiques.
Ensuite et enfin, les professeurs d’histoire deviennent des cibles. Ironiquement, ces porte-plumes sont décapités par des porteurs de couteaux dont les arguments pourraient avoir été aiguisés par l’Education nationale. Dans un article que je n’arrive plus à retrouver, un auteur avançait que l’enseignement des origines de l’islam ( par ailleurs méconnues ) pouvait malencontreusement nourrir un fondamentalisme religieux. Pour qui connaît les termes du sujet, le lien sémantique est évident. Quoi qu'il en soit, dans ce domaine comme dans tant d’autres, des programmes façon patchwork multiplient les thèmes sans leur accorder le temps nécessaire à la construction de savoirs distanciés. Résultat : des cours ni faits, ni à faire.
Le problème n’est pas seulement le volume horaire dérisoire au regard de l’ambition sociétale des programmes d’histoire dont l’architecture d’ensemble est croulante. Tout un contexte culturel se révèle préjudiciable à la formation d’une culture historique solide chez le plus grand nombre de Français.
- Les acteurs variés de l’appauvrissement des cultures historiques :
Si l’on considère les instructions officielles qui accompagnent les programmes d’histoire, l’exigence scolaire resterait forte. Cependant, elle requiert la maîtrise de prérequis concernant l’écriture et la lecture qui sont par ailleurs fragilisés. A cela s’ajoutent des doctrines pédagogiques élaborées sur la foi d’études appliquées de manière à en vider le sens. Les méthodes préconisées se révèlent mal-adaptées à la transmission de savoirs complexes en temps record. En bout de chaîne, au moment de l’examen, la certification obéit à des consignes de complaisance qui anéantissent toute exigence intellectuelle en matière historique. Mais qu'on se rassure ! Les sondages nous assurent de l'intérêt des Français pour la chose historique ; comme produit de consommation...
A en croire les programmes scolaires, en 4-5 heures évaluation et correction comprises, le professeur d’histoire doit faire découvrir un thème dont l’élève ignore souvent tout au préalable ( guerre froide, empire du Monomotapa… ), lui transmettre des « repères » ( dates, acteurs, notions… ), mettre en place des compétences ( rédaction, analyse de documents… ), atteindre des objectifs mi-pédagogiques, mi-civiques ( comprendre la complexité et l’intérêt du thème sans commettre telle ou telle confusion répandue chez les adultes ). Enfin, au moment de l’évaluation, l’élève n’est pas sensé réciter le cours de l’enseignant, mais proposer une réflexion personnelle sur le sujet.
Bref, mission impossible, sauf si l’élève dispose déjà d’une certaine culture historique et n’est pas dans la découverte totale au début du chapitre. A cela s’ajoutent des consignes de mise en œuvre chronophages, qui tendent à interdire toute approche magistrale. Les sciences de l’éducation auraient établi que l’on mémoriserait mieux ce que l’on fait, puis ce que l’on voit… Au détriment de ce que l’on entend, à savoir le professeur qui fait un cours magistral. Il s’ensuit une injonction à la « mise en activité » qui laisse effectivement des traces dans la mémoire des élèves ; mais en extraient-ils pour autant les conclusions, le sens ? Bien sûr, en cas d’échec, ce serait de la responsabilité de l’enseignant : ne lui donne-t-on pas le temps de développer et d’approfondir à satiété ? En fait, pour un cours magistral comme pour une activité quelconque, l’élève reste fondamentalement libre de se l’approprier au mieux de ses moyens, de manière superficielle ou intelligente. L’un dira qu’il a fait une carte sans savoir pourquoi, l’autre aura retenu ce que représente la carte, ou comment en réaliser une…
Le cours magistral est particulièrement adapté à l’enseignement de l’histoire, et constitue le bagage universitaire de tout professeur de cette discipline. Bien sûr, une telle densité d’apprentissage n’est pas appropriée aux plus jeunes élèves… Mais cette méthode tend désormais à être proscrite pour les lycéens. Là encore, un mythe urbain voudrait qu’un étudiant prenant des notes feraient passer les informations directement de l’oreille à la main, sans passer par le cerveau. J’en reviens à la liberté fondamentale de celui qui apprend… Quoi qu'en disent les vulgarisateurs pédagogistes des neurosciences, les professionnels de l’histoire ont tous su, pour accéder à leur poste, activer leurs neurones pendant l’audition et la transcription des cours reçus, puis réactiver les savoirs par des fiches et révisions variées.
En résumé, les méthodes pédagogiques en vogue nuisent à la transmission de savoirs à la fois denses et complexes en temps limité. Des élèves de moins en moins sollicités à l’écrit peuvent avoir les idées les plus géniales qui soient ; s’ils sont dans l’impossibilité de les transcrire rapidement faute d’entraînement au maniement du stylo, leur copie est inachevée ou superficielle. Quant à la culture livresque qui est indispensable à la formation d’une culture historique un minimum consistante, elle s’amenuise. La concurrence des écrans est souvent dénoncée, sans doute à juste titre. Cependant, les rééditions des œuvres d’E. Blyton à destination des jeunes publics montrent combien les marchands vont au plus facile pour vendre au plus grand nombre, quitte à déconstruire la lecture qu’ils prétendent vulgariser : suppression des passages descriptifs, des passés simples, réécriture pour placer l’intrigue dans un contexte modernisé… Les histoires de France publiées pour les enfants en bande dessinée ont suivi une évolution analogue, passant d'un trait réaliste à des figurés et mises en scène totalement puérils et régressifs.
Pourtant, les Français n’ont jamais été aussi diplômés que de nos jours ! Eux qui sont parfaitement incapables de savoir par où commencer une histoire de leur pays, dont les enfants seraient allergiques au passé simple… L’éducation nationale semble avoir rencontré plus de succès auprès des paysans et ouvriers des républiques antérieures qu’auprès d’une population de cadres affairés à obtenir des certificats médicaux de haut potentiel pour leurs enfants.
- Les gilets jaunes, citoyens ultimes d’une France anhistorique ?
Le mouvement des gilets jaunes doit encore livrer de nombreux enseignements… Ici, je me contenterai de l’aborder en conclusion de cette réflexion sur la déconstruction de l’histoire de France.
A bien des égards, les gilets jaunes apparaissent comme ce que l’Education nationale peut faire de mieux en matière de citoyenneté, à l’échelle des masses. En effet, ils savent où est Paris ; on valorise. Ils connaissent le nom du chef de l’Etat ; on valorise, même s’ils en font un monsieur Carnaval qu’ils incendient… Ils connaissent la Marseillaise, le bonnet phrygien et d’autres symboles hérités de la Révolution ; on valorise. Surtout, tous ont chevillée au corps la conscience qu’être citoyen est une dignité ; on valorise. Quant à savoir comment peut s’organiser et se vivre une citoyenneté en lien avec les pouvoirs publics, ce n’est pas vraiment au programme d’une world nation soucieuse de former des citoyens du monde. Avec tous ces points de valorisation, leur connaissance de l’histoire enseignée leur assurerait l’obtention d’un brevet de citoyenneté, s’il existait et était certifié conformément aux usages de l’Education nationale.
Le problème de déconstruire à outrance l’histoire nationale, c’est que nous arrivons à des générations d’adultes qui n’ont plus les outils pour comprendre comment se gère un pays comme la France à l’aube du XXIe siècle. Dès lors les urnes cèdent le pas au coup de force. Là encore, le devenir des gilets jaunes est assez parlant. Les uns ont appris les usages politiques traditionnels : organisation de manifestations, intégration du système partisan… Les autres se sont formés en accéléré au combat de rue. Certes, le poisson pourrit par la tête et nos élites médiatico-politiques se révèlent défaillantes à bien des égards. Pour autant, la réappropriation violente de la capitale ne saurait passer pour une action civique justifiable au regard des institutions démocratiques, ou plus basiquement pérenne.
L’intérêt de refonder une histoire nationale, ce n’est pas de forger des millions de nationalistes obtus qui effraieraient les biens pensants. Le but est de fournir des outils efficients de compréhension de notre société actuelle à une masse critique de citoyens, au lieu de transmettre des valeurs en apesanteur, fruits d’un papillonnage historique sans consistance. Par masse critique, il faut comprendre un nombre suffisant pour que ces acquis infusent au-delà des cercles initiés ; une masse critique est un gain quantitatif qui implique une mutation qualitative…
Lisant cela, les ignares hurleront roman national. C’est méconnaître les histoires de France qui synthétisent les acquis de la Nouvelle histoire. P. Boucheron en propose une qui tient de l’exercice de style, sélectionnant des événements pour les redécouvrir dans une perspective mondiale parfois pertinente, parfois artificielle. J. Cornette a réuni de prestigieuses signatures pour dresser l’état des recherches sur notre histoire nationale, cela en s’intéressant autant aux sources et méthodes qu’aux conclusions de chercheurs aguerris.
Arrivé au terme de cet article, à chacun de déterminer par où il commencerait la rédaction d’une histoire de France, si la question l’intéresse ou s’il s’en moque. Mais quelle que soit la réponse, au terme de plusieurs décennies de sabotage de la conscience collective de notre histoire, personne n'est légitime pour appeler à une énième déconstruction du roman national. Assurément, c’est un défi majeur que de restaurer un socle historique pour une nation dont l’atomisation est désormais entérinée dans les urnes.
Quant à T. Sisley et aux autres, que répondraient-ils à cette question de la page blanche ? Maintenant qu’ils connaissent les références des dernières histoires de France faisant autorité chez les spécialistes, prendront-ils la peine de se renseigner sérieusement ? Ou se contenteront-ils d’exploiter le filon d’une ignorance bien entretenue ?
J. Morel.
[1] https://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-francais-et-lhistoire/
[2] https://actu.orange.fr/france/jo-2024-la-delegation-algerienne-rend-hommage-aux-noyes-du-17-octobre-1961-en-jetant-des-roses-dans-la-seine-magic-CNT000002ezvc3.html
[3] Les crimes de guerre commis par le FLN ont surtout concerné le territoire algérien. Pour la métropole, un point est débattu, sans production de preuves comme le rappelle B. Stora : https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/2013/01/28/barrage-de-malpasset-189361.html