À peine sorti, l’ouvrage a déclenché une polémique, moins en raison de son contenu écrit, sur lequel les critiques portaient peu, que sur la violence de ses images1. De fait, l’ouvrage se présentait non comme un livre universitaire habituel, mais comme un livre au format imposant, affichant en couverture un titre racoleur fait de néons de sexshop, en quatrième de couverture, une femme nue de dos, et proposant un corpus de 1 200 images largement dominé par des photos de femmes et de jeunes filles colonisées dénudées. C’est bien ce contenu iconographique qui a déclenché et alimenté la polémique dans la presse en septembre et octobre 2018. Plus qu’à un livre d’histoire, on aurait à faire à un « beau livre2 » ou à un « livre porno3 » ; les éditeurs et l’éditrice n’auraient fait « que reconduire la violence coloniale en exposant sans aucune précaution
ces photos de femmes dénudées, racisées et violentées4 », « ces images ne se contentent pas de représenter des crimes coloniaux : elles en sont l’outil et le prolongement5 ». Pascal Blanchard, Nicolas Bancel et Gilles Boëstch reprochent à leurs contempteurs de ne pas avoir lu les textes, de n’avoir commenté que les images, et rappellent le caractère scientifique et historique de leur travail6. Ce compte rendu les prend aux mots. Avons-nous affaire à un livre d’histoire ou à autre chose ? Et chemin faisant, est-ce que ce projet respecte les fondements déontologiques du métier d’historien et, plus généralement, du chercheur en sciences sociales ?
Le contenu scientifique de l’ouvrage se veut ambitieux : rendre compte de six siècles d’une histoire de la domination coloniale sur les corps « indigènes » sur tous les continents (Japon et États-Unis compris). À première vue, la problématique est clairement historique : la mise à jour des formes de domination raciale et sexuelle se fait sur la longue durée ; le plan est chronologique ; la bibliographie est nourrie ; et de nombreux
historiens et historiennes, parmi les 97 contributeurs, ont participé à l’ouvrage. Mais ces apparences scientifiques, comme les justifications ex post des éditeurs, ne sauraient faire illusion. L’objectif de déconstruction n’est pas atteint, cette promesse scientifique est invalidée du fait de cinq travers fondamentaux.
1) Le premier est le manque de rigueur scientifique au regard du champ dans lequel le livre prétend se situer. On ne peut que s’étonner de l’extraordinaire hétérogénéité du contenu. De rares chapitres prennent au sérieux les bases du métier d’historien : à savoir un niveau de contextualisation suffisant, un usage critique des sources de première main, une densité suffisante d’informations empiriques sur un sujet et un
espace délimité, une prise en compte du contexte local dans ses formes particulières de domination sexuelle, l’évolution des rapports de sexe dans ce contexte. C’est notamment le cas du très bon chapitre d’Arlette Gautier, sur les femmes esclaves dans les Amériques aux XVIIe et XVIIIe siècles, ou de celui de Christelle Taraud sur l’économie politique de la sexualité coloniale et raciale, dans lequel elle montre comment la catégorie de la « ménagère » – ou femme autochtone d’Européen – s’impose au XIXe siècle et au début du XXe siècle avant de tomber en disgrâce. C’est aussi le cas du texte de Françoise Vergès et Dominic Thomas sur les couples mixtes dans les années 1950 et 1970, ou d’Alain Ruscio et Nicolas Bancel sur les violences sexuelles au temps des décolonisations. Notons enfin le dernier chapitre de Sylvie Chalaye sur la création artistique contemporaine, qui adopte un retour réflexif sur l’usage des images coloniales, un positionnement d’autant plus intéressant qu’il constitue une exception. Ces chapitres sont une minorité dans l’ouvrage (5 sur 17). Les 40 encarts ou notices, bien informés lorsqu’ils sont écrits par des spécialistes de la question (mais c’est loin d’être toujours le cas), sont de si petites tailles (1 200 signes) qu’ils ne peuvent compenser la platitude empirique de la majorité des chapitres généraux. Les spécialistes du monde colonial n’apprendront donc rien que l’on ne sache déjà sur l’esclavage, le contrôle des corps, l’hygiène coloniale, les dispositifs d’assujettissement, les formes de métissage. Il faut noter un écart substantiel entre une bibliographie très complète en fin d’ouvrage et un usage incomplet ou anecdotique des ouvrages majeurs sur la question dans la plupart des chapitres.
Si le livre n’est donc pas novateur, s’agit-il d’une bonne synthèse pour le grand public ?
Rien n’est moins sûr. Ce que le lecteur découvre, c’est une vision manichéenne et simpliste des réalités complexes de la domination coloniale, pourtant bien connues maintenant. La majorité des chapitres comme l’introduction font peu de travail sur la généalogie des mots du titre – sexe, race, colonies et domination – et les différents sens qu’ils ont pu recouvrir entre le XVIe siècle et le XXIe siècle, et donnent l’illusion d’une continuité dans les relations raciales et sexuelles entre les Blancs (Européens et Nord-Américains pour l’essentiel) et les populations colonisées.
Depuis trente ans, il y a pourtant un grand nombre de travaux sur les généalogies des racismes, dont les histoires sont d’ailleurs radicalement différentes entre États-Unis et Europe de l’Ouest (différences passées sous silence dans l’ouvrage, sans parler des différences entre pays européens), et une discussion non moins ancienne sur l’articulation entre la naissance du racisme et le développement d’un contrôle de la sexualité, aussi bien aux colonies que dans les métropoles, un développement également passé sous silence7. Plutôt que de tenter d’explorer ces articulations, l’objectif principal de déconstruction de la domination sexuelle consiste, pour l’essentiel des chapitres (11 sur 17), à décrypter le regard européen sur la sexualité des femmes colonisées. Celles-ci sont perçues comme lascives, perverses, disponibles, paresseuses, jouisseuses,
ce qui n’est pas contestable et sans doute pas complètement inutile pour un lectorat non averti, mais la répétition ad nauseam de ces clichés ne saurait être tenue pour une entreprise de déconstruction. Pour cela, il aurait fallu aller au-delà d’analyses qui restent (sauf exception pour les chapitres mentionnés ci-dessus) à la surface des « représentations coloniales » avec des sources certes variées (discours, lois, guides de bonne conduite, contenus littéraires, cinématographiques ou iconographiques), mais le plus souvent incapables de rendre compte des réalités concrètes de la domination sexuelle.
2) L’ouvrage revêt – comme les publications précédentes de l’ACHAC8 – les habits d’une mémoire anticoloniale qui, cela mérite d’être souligné, partage les méthodes d’une vieille histoire impériale qu’il entend pourtant dénoncer. L’ouvrage est ambitieux (six siècles de domination coloniale sur les corps colonisés), mais il est incapable de faire une synthèse claire et utile à un grand public : il produit à l’inverse des généralisations hâtives, des approximations historiques et des répétitions nombreuses – sans compter les nombreux points aveugles qu’une telle entreprise génère fatalement. La sexualité en situation coloniale modifie les rapports de genre, les formes de domination masculine, les codes de l’amour, l’organisation de la famille, ou participe de la moralisation des sociétés colonisées, mais ces questions sont absentes du livre alors qu’elles constituent un champ de recherche de plus en plus fécond en France et ailleurs9. Comme pour la vieille histoire impériale, la plupart des chapitres généraux n’évitent pas le piège de l’homogénéisation du projet colonial, celui d’une histoire vue depuis les métropoles
européennes elles-mêmes a-historicisées, le plus souvent incapable de rendre compte de l’hétérogénéité des histoires locales ou régionales. La grande majorité des chapitres est sous-tendue par une opposition schématique et simplificatrice entre colonisateurs et colonisés, les uns et les autres étant analysés comme des catégories étanches et homogènes et sans conflits de classe, à contre-courant de décennies d’histoire sociale et
culturelle des mondes colonisés qui montre combien, dans un contexte de discrimination raciale, les barrières entre ces deux catégories ont pu être plus ou moins rigides, parfois contournées, parfois ignorées, parfois exploitées, combien les assignations raciales ont été réfutées ou contestées et combien ces deux classifications englobantes étaient elles-mêmes divisées et en désaccord sur le projet colonial10. L’ouvrage se révèle incapable de montrer le détail, tout autant que la contingence, de la circulation des images, des mots ou des experts spécialistes des questions qui touchent aux pratiques sexuelles. Il est l’opposé exact de cette proposition faite il y a plus de dix ans par Ann-Laura Stoler, historienne et anthropologue pionnière de la question des intimités et des sexualités dans les empires et qui n’a pas participé à l’ouvrage : « Pour qu’une comparaison soit effective, l’historien de l’empire s’attache aux pratiques plutôt qu’aux rubriques, aux effets des politiques plutôt qu’à la manière dont celles-ci sont nommées11. » Comme le lecteur est laissé sans information sur ce que pensent les Autres des assignations raciales ou sexuelles, l’ouvrage donne cette impression d’un pouvoir colonial total et omniscient : l’introduction sur la période coloniale (signée de Pascal Blanchard et Christine de Gemeaux) indique que la colonisation en temps de paix consiste à assigner des populations colonisées dans des réserves, à les déporter dans des bagnes et à les parquer dans des ghettos à la périphérie des villes blanches, desquels elles ne peuvent sortir que sous certaines conditions (p. 153-156). Le caractère inabouti des politiques coloniales, jamais évoqué dans ces chapitres, a pourtant depuis longtemps été mis en évidence, y compris dans les pays les plus surveillés du monde colonial, comme en Afrique du Sud12. Mais ce propos, qui tendrait simplement à dire que les projets de domination n’ont pas pris les mêmes formes partout, ne cadre pas avec le projet d’entreprise mémorielle dont l’ACHAC s’est fait le porte-drapeau depuis 25 ans. Ainsi, en se positionnant aux marges de cette historiographie riche et renouvelée des mondes colonisés, ce livre participe d’une essentialisation du colonial qui oblige à rappeler quelques propos liminaires à toute histoire de la colonisation : non, toutes les sociétés coloniales n’ont pas subi de la même manière l’esclavage, l’exploitation capitaliste ou les
violences sexuelles. Rappeler cela ne revient en aucun cas à euphémiser les violences qui se sont exercées sous les colonisations, mais plutôt à dire qu’elles ont pris des formes plus hétérogènes que ne le laissent parfois penser certains discours à charge. L’un des paradoxes du livre est qu’il fragmente en maints chapitres chronologiques ou géographiques cette histoire de la domination sans pour autant parvenir à faire ressortir
des divergences, des spécificités, des nuances selon les régions ou les périodes.
3) Le livre entend dévoiler combien la colonisation s’impose dans une direction unilatérale depuis les capitales européennes ou les États-Unis vers le reste du monde colonisé, à l’inverse de ce que le renouveau des études coloniales suggère depuis les années 1980, qui ont montré combien les projets coloniaux en matière d’hygiénisme, de logement, d’urbanisme, de contrôle de la main-d’œuvre, de police, d’identification
individuelle ont autant circulé du Sud vers le Nord ou entre les domaines impériaux13. Alors que l’ACHAC dispose d’un fonds iconographique
exceptionnel, le lecteur n’apprend rien ni sur la position des colonisés face à ces images érotiques, violentes ou pornographiques, ni plus généralement sur la position des hommes et des femmes colonisés face à la domination sexuelle et coloniale. Ce silence participe aussi de cette
régression historiographique en raison de la volonté de ne pas incarner la situation coloniale ou la traite esclavagiste à travers des histoires individuelles ou collectives, comme l’ont abondamment montré des histoires qui disent les contradictions auxquelles sont confrontés les individus en situation coloniale ou d’esclavage14. Plus étrangement, les historiens et historiennes de l’art ou de la colonisation n’apprendront rien non plus sur les collections, les collectionneurs, les photographes, les peintres, les publicistes, les entreprises coloniales de marketing érotique ou pornographique, à rebours d’une histoire désormais incarnée et personnalisée de la production iconographique en Afrique ou ailleurs15. L’ouvrage n’est donc pas non plus un livre d’histoire de l’art car, en dépit d’une collection d’images impressionnantes, il passe à côté de cette histoire sociale, politique ou économique de la production iconographique.
4) L’ouvrage est un bon exemple de solipsisme intellectuel et affiche avant tout la capacité des éditeurs à isoler la question sexuelle des questions de genre, des questions sociales, politiques et économiques plus globales. Les transformations des rapports de genre et de classes sont ignorées au profit d’une surévaluation dé-historicisée de la question sexuelle dans les enjeux coloniaux. À première vue et étant donné la
quantité extraordinaire de matériaux érotiques et pornographiques rassemblée, on serait tenté de donner raison aux éditeurs. Tant d’images témoignent d’une véritable fascination sexuelle sur les sociétés colonisées, sans aucun doute. Mais l’absence de contextualisation de la production de ces images ne permet pas de comprendre les éventuelles transformations de cette fascination. Les éditeurs et l’éditrice affirment
que « les femmes et les hommes colonisés sont réduits à leur sexualité, principe fondateur de la doxa coloniale depuis l’origine » (p. 38). « La
grande question de la colonisation, ce n’est pas la conquête des territoires, c’est le partage des femmes », indiquait Christelle Taraud, lors
de la promotion de l’ouvrage16. Vraiment ? La sexualité des colonisés deviendrait l’enjeu majeur de la colonisation, évacuant au passage des décennies de recherche sur les acteurs et les actrices de la colonisation (militaires, milieux d’affaire, politiques revanchards, administrateurs, missionnaires, enseignantes et enseignants, urbanistes, experts en développement). Ou est-ce à dire que ceux-ci et celles-ci étaient principalement mus par des désirs sexuels inavoués ? Les éditeurs semblent à bien des égards prisonniers de et fascinés par leurs sources.
En témoigne bien la place accordée aux femmes européennes. Certaines conclusions entonnent une chanson bien connue de la vieille histoire impériale : l’installation des femmes européennes dans les colonies – entre la fin du XIXe siècle et les années 1940 – aurait exacerbé les tensions raciales, les hommes blancs s’autorisant moins de relations extraconjugales avec les femmes indigènes (p. 229 et suivantes). Pourtant, Ann-Laura Stoler et d’autres ont remis en question cette assertion qui tend à isoler la sexualité des colons et des colonisateurs d’un contexte plus global pour tenter de la réinscrire dans les formes d’anxiété raciale propres à certaines situations historiques17. Mais ces travaux antérieurs sont largement ignorés ou mal lus.
5) L’ouvrage est traversé de contradictions non assumées dans le sens où elles ne font pas l’objet d’une discussion scientifique. Donner la place à ces controverses aurait permis de stimuler le débat mais ce n’est pas le cas. Ainsi, lorsque les chapitres sont étayés, les principales conclusions viennent s’opposer à des propos simplificateurs énoncés ailleurs. La question des métis occupe une place centrale dans l’ouvrage, une centralité elle-même non discutée18 : les éditeurs et l’éditrice sont-ils prisonniers des mêmes interrogations que l’administration coloniale produisant une « expertise » démesurée sur cette minorité infime de la colonisation19 ? On ne le saura pas. Quant au fond, le lecteur devra choisir entre les conclusions, par exemple, de Violaine Tisseau sur l’ambivalence dans laquelle se trouvaient les métis à Madagascar aux XIXe et XXe siècles,
placés entre acceptation et rejet dans la société locale, et les affirmations générales de Pascal Blanchard pour qui « les métis portent le poids de la faute coloniale » ou pour qui « la société métissée est héritée de la violence coloniale » (p. 438 et 448). De même, alors que de nombreux encarts et certains chapitres viennent expliciter les nuances dans les formes de domination sexuelle dans les colonies, Blanchard affirme que « le viol colonial et le mépris du corps indigène ou du corps esclave marquent encore tout le présent de toutes les sociétés postcoloniales » (p. 146). Le « viol colonial », l’une des expressions par lequel l’ouvrage a été promu dans Libération, n’est ni défini ni expliqué20. Le viol n’est pas utilisé de manière métaphorique (la prise de possession violente de territoires par les Européens), mais dans son sens littéral : il s’agit de violences sexuelles non seulement perpétrées de manière systématique, mais encore prises en charge par les institutions coloniales21. Mais quelle est l’administration de la preuve de cette affirmation ? Et quelle est l’administration de la preuve que toutes les sociétés postcoloniales (pas seulement certaines d’entre elles, ni même seulement les victimes effectives) sont marquées par le viol colonial ? Il s’agit plus de formules chocs que de faits historiquement attestés, c’est-à-dire d’affirmations qui viendraient conclure une démarche fondée sur l’analyse critique d’un corpus de sources historiques bien identifiées. Ici encore, la dimension historique est escamotée par le caractère pamphlétaire de l’ouvrage assumé par certains de ses éditeurs.
Il ne faut pas se méprendre : insister sur le poids des violences et des formes de domination mises en œuvre par les acteurs du projet colonial est plus que jamais un impératif scientifique à l’heure des nostalgies coloniales et des concurrences mémorielles22. Mais cela passe par un travail au plus près des acteurs et des actrices de cette domination, et non pas par une vision désincarnée, essentialiste, peu sourcée, en un mot a-historique, de cette domination.
Voilà pour les textes. Restent les images, qui posent plus de questions encore. Les éditeurs réactivent, par l’exhibition de ces corps dénudés, des mémoires intimes de la colonisation que beaucoup voulaient certainement enfouir23. Ce projet vise aussi à sortir la France de ce qu’Ann-Laura Stoler appelle une aphasie coloniale, qui se traduit non pas par une perte de la mémoire mais par une occultation de son savoir, par exemple par la sous-estimation du fait colonial dans l’histoire du racisme en France, par l’oubli de la colonisation dans les lieux de mémoire de la nation française ou par la très forte disjonction entre l’historiographie métropolitaine et l’historiographie des mondes colonisés24. D’une certaine façon, en publiant des ouvrages académiques ou polémiques et des catalogues grand public, l’ACHAC a largement contribué à un retour de la question coloniale dans les débats historiographiques en France. Peut-on pour autant déconstruire la domination des colonisés à l’œuvre dans la sexualité coloniale tout en utilisant ses dispositifs iconographiques ? Blanchard et Bancel affirment que oui : « Il n’y avait que deux solutions : montrer ces images ou les cacher. Nous avons choisi de les montrer, en travaillant sur les liens intertextuels entre images et grands textes, en consacrant plus de 40 notices du livre à l’objectivation de ces représentations, en travaillant également à développer les légendes explicatives d’images emblématiques25. » À nouveau, prenons-les au mot.
Sans doute faut-il commencer le livre par la fin, par le chapitre de Sylvie Chalaye qui rappelle fort à propos : « Il est difficile de traiter de ces
exhibitions, des corps et des enjeux sexuels qui les traversent sans basculer, à nouveau dans le voyeurisme du dispositif colonial que l’on souhaite dénoncer » (p. 485). Les éditeurs et l’éditrice de l’ouvrage et de La Découverte auraient été bien avisés d’appliquer ces suggestions de bon sens à l’ensemble du projet éditorial. Car on ne peut que s’étonner de voir combien la dénonciation anticoloniale est associée à une exploitation voyeuriste d’un corpus iconographique colonial. Pour éviter ce travers, il aurait fallu a minima commenter, sinon chacune, au moins une partie des images reproduites. Il n’en est rien, ce qui n’est pas étonnant étant donné que de nombreux auteurs ont découvert, souvent avec effarement, ces images au moment de la publication, sans en avoir été informés au préalable26. Il faut garder à l’esprit ces procédés éditoriaux scandaleux pour mieux comprendre ce qui est présenté comme un travail réflexif sur le corpus iconographique. 1) Les images servent très rarement d’illustration à un propos du texte : c’est le cas des trois peintures de Jean-Léon Jérôme et de Benjamin Constant, et d’une partie du chapitre sur les couples métis dans le cinéma ou la littérature des années 1950 à 1970, où les images de films correspondent peu ou prou au texte des auteurs. Mais cela représente moins de 10 documents sur 1 20027. 2) Plus fréquemment, il y a une possible analogie entre le texte et l’image, mais c’est au lecteur de donner du sens à cette association, notamment dans les courtes notices. Contrairement aux assertions de Blanchard et Bancel, il ne s’agit pas d’une « objectivation » car les auteurs ne commentent jamais les images qui sont associées à leur texte pour la raison évoquée précédemment. C’est dommage car les éditeurs ont bien tenté de faire ce travail de correspondance. 3) Ce qui domine en réalité dans 9 images sur 10, c’est une association inexpliquée d’images livrées sans commentaires qui n’ont rien (ou si peu) à voir avec le propos des chapitres. Il en va ainsi de la vingtaine de cartes postales pornographiques qui parcourent le livre de manière énigmatique et qui échappent à toute logique explicative, ou encore des 340 images de femmes dénudées qui parsèment l’ouvrage. Ce silence sur la nature de ces images pose des problèmes épistémologiques et éthiques qui ont logiquement fait réagir journalistes et collectifs militants, et sur lesquels on est obligé de revenir pour finir.
Le problème épistémologique – ou la manière dont l’objet de recherche est découpé – renvoie à trois questions qui auraient dû constituer un
préalable et un exercice d’autant plus nécessaire que l’ouvrage prétend déconstruire les formes de domination à partir de ces images. Quelles
sont les logiques scientifiques qui ont prévalu à la sélection de ces 1 200 images parmi un corpus de 70 00028 ? Elles ne sont pas expliquées.
Quelles sont les démarches méthodologiques adoptées par les éditeurs pour analyser et décrypter ces images ? Rien n’est dit dans l’ouvrage. Quelle est la logique scientifique qui confronte – souvent sur une même page – des matériaux iconographiques totalement hétéroclites (cartes postales érotiques, toiles de maîtres, photos de scènes de viols ou de maison de passe, photos d’acteurs de cinémas, extraits de bandes dessinées, publicités…) et dont il n’est rien dit des usages si différents ? Faut-il rappeler que les photos de viol prises par la soldatesque n’ont pas les mêmes fonctions ni les mêmes effets que les publicités de Banania ? Quel est l’intérêt de confronter l’Olympia de Manet (1863) à une carte postale d’une danseuse dénudée de Guinée, un tableau d’un peintre français mineur d’une femme africaine et un portrait à l’aquarelle d’une femme (p. 22-23) ? Mettre ensemble ces peintures, c’est tenter de faire croire qu’il existe un projet culturel commun entre toutes ces images, en l’occurrence une supposée représentation occidentale de l’Orient. Mais le tableau de Manet fait scandale parce que l’Olympia est une courtisane
dont l’attitude et le regard cassent les canons antérieurs de la nudité tandis que la place de la servante en arrière-plan, et généralement des modèles noirs dans l’histoire de la peinture française, est bien plus ambivalente que ne le suggère ce livre29. Jamais le lecteur n’est informé des liens à faire entre ces images. Il n’en apprendra pas davantage sur leur inégale diffusion ni sur leur réception, à l’exception peut-être des images des expositions coloniales, qui constituent l’un des cœurs de cible des publications de l’ACHAC depuis son premier catalogue en 1992.
Ce silence assourdissant sur cette profusion d’images témoigne d’un manquement aux règles déontologiques du métier d’historien : à aucun moment n’est posée la question de savoir si tous les procédés sont bons pour diffuser ces images. Il a beaucoup été reproché aux éditeurs de faire preuve d’une grande violence en montrant ces images. Montrer pour déconstruire est une justification qui a été à plusieurs fois avancée, mais elle est un peu courte. La question n’est pas tant de montrer ou de ne pas montrer que de se donner les moyens d’analyser, de contextualiser, voire de transformer ces clichés pour leur faire perdre leur charge érotique. Or l’ouvrage ne dit rien des différents types de violence liés à cette iconographie. À cet égard, il en montre trop ou pas assez. Pas assez car ce qui est exhibé ici n’est pas tant la violence coloniale à l’état brut, mais plutôt un corpus situé entre érotisme et pornographie, dont la plupart des images, et les éditeurs le savent bien, sont plus vendables que les viols de l’armée coloniale, les bordels de campagne ou les marchés de femmes esclaves. Un ouvrage centré sur ces dernières images aurait en soi été un travail plus conforme à la dénonciation anticoloniale dont se targuent certains éditeurs, mais l’ouvrage aurait évidemment été beaucoup moins vendeur. Les quelques photos de violence sexuelle (20 en tout) sont ainsi noyées parmi les 340 cartes postales érotiques : les éditeurs de l’ouvrage et de La Découverte ont à l’évidence privilégié la commercialisation d’un érotisme exotique à l’exhibition des pires violences sexuelles en situation coloniale.
À beaucoup d’égards cependant, l’ouvrage en montre beaucoup trop. Il y a bien sûr une violence imposée aux lecteurs et lectrices à étaler des images aussi chargées politiquement sans les commenter. Pour décrypter et analyser de manière plus posée le caractère intrinsèquement violent de ces images, le collectif des Cases rebelles propose pourtant des alternatives : « Les victimes peuvent être anonymisées, floutées. Il est possible de masquer les parties génitales. Elles peuvent être dépornographiées, désexualisées. Mais il est certain que ces choix sont extrêmement moins vendeurs, moins choc, moins attractifs30. » Comme une ironie provocatrice, la seule photo floutée du livre est celle d’un homme occidental dans une boîte de nuit à Marrakech (p. 457). Il y a donc bien une « exhibition-reconduction de l’humiliation, la mise en lumière voyeuriste du crime, pensée sans les victimes31 ». Ce faisant, le projet éditorial, sous couvert de dénonciation, s’inscrit dans une logique coloniale en acceptant de publier des images de ces hommes et femmes sans tenter d’en restituer l’histoire, sans essayer de les sortir
de l’anonymat dans lequel l’entreprise coloniale les a plongés. Sur le millier d’images, non seulement aucun nom n’a été retrouvé, mais les éditeurs et l’éditrice n’ont pas pris la peine de tenter d’avancer une explication à cet anonymat. Pour sortir les individus de l’anonymat, il faut du temps, il faut faire un patient et minutieux travail d’archives ou de recueil de témoignages oraux. Ce silence réduit ainsi à nouveau ces individus à une vaste entreprise de déshumanisation, à une masse indifférenciée, interchangeable d’anonymes – le cœur du projet colonial –, et rejoue ainsi la partition de leur assujettissement.
Dans une tentative ex post de justification scientifique, Blanchard et Bancel comparent leur travail à des ouvrages comme celui dirigé par James Allen, Without Sanctuary, Lynching Photography in America, contenant des images souvent insoutenables de lynchages aux États-Unis32. La démarche de ces historiens américains est cependant opposée à celle de cet ouvrage : la contextualisation historique est claire et précise ; l’approche resitue chacune des images reproduites ; il y a un travail systématique sur les sources iconographiques qui permet pratiquement toujours de savoir quelle est la victime et dans quelles circonstances elle a été lynchée ; il y a un travail sur les usages des photos, les raisons de leur popularité et de leur déclin. Il s’agit en l’occurrence d’un véritable livre d’histoire. L’ouvrage de l’ACHAC ne s’adosse pas au travail requis. Au regard du champ scientifique dans lequel il prétend se situer, Sexe, race et colonies incarne les dérives d’une entreprise mémorielle : il n’y a aucune interrogation critique sur le corpus de sources, une imposition des images à des textes écrits par des auteurs sans les consulter au préalable et l’exploitation d’une iconographique coloniale sans en critiquer les dispositifs.
Laurent Fourchard
Centre de recherches internationales (Ceri), Sciences Po
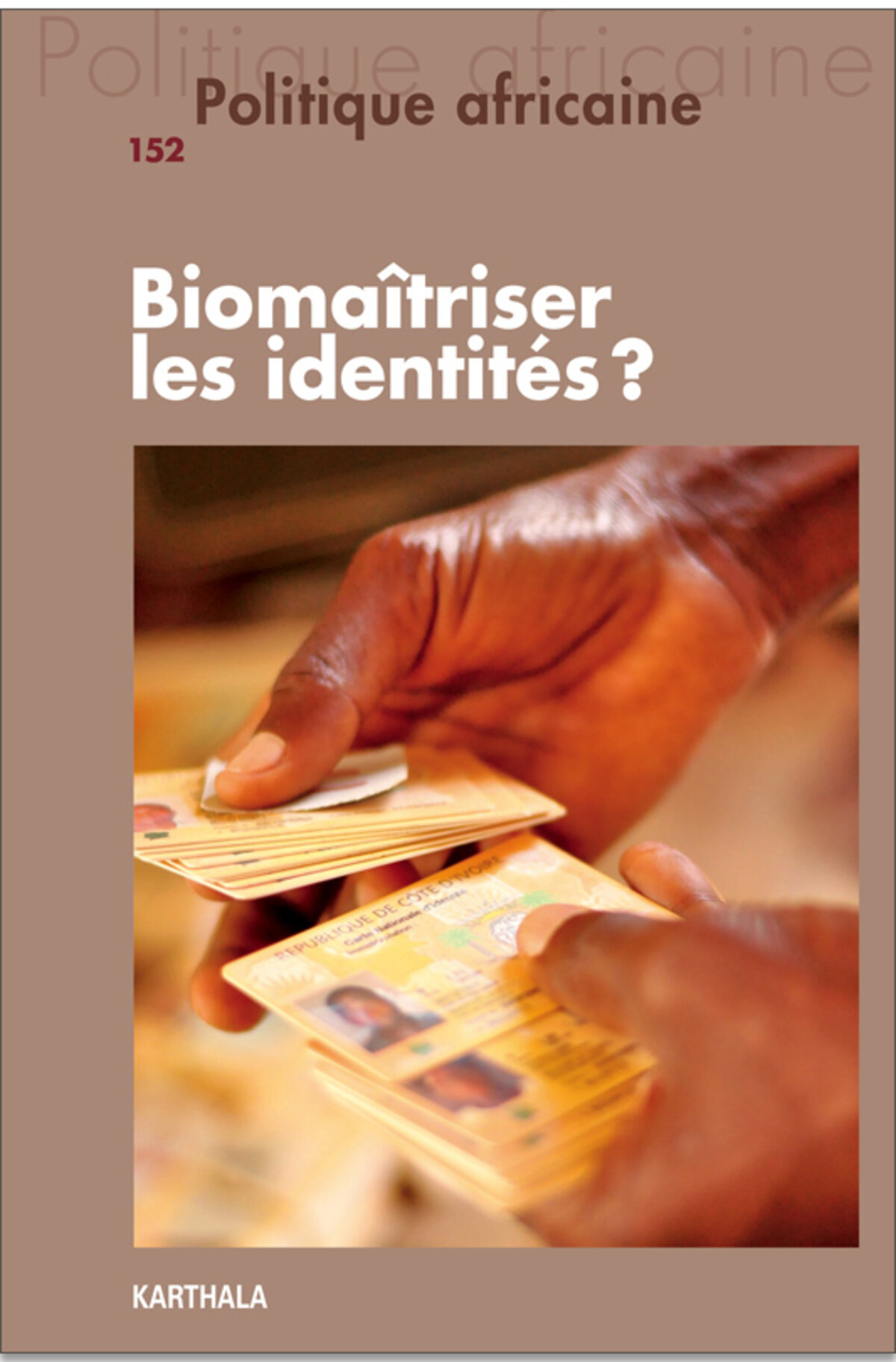
Agrandissement : Illustration 1
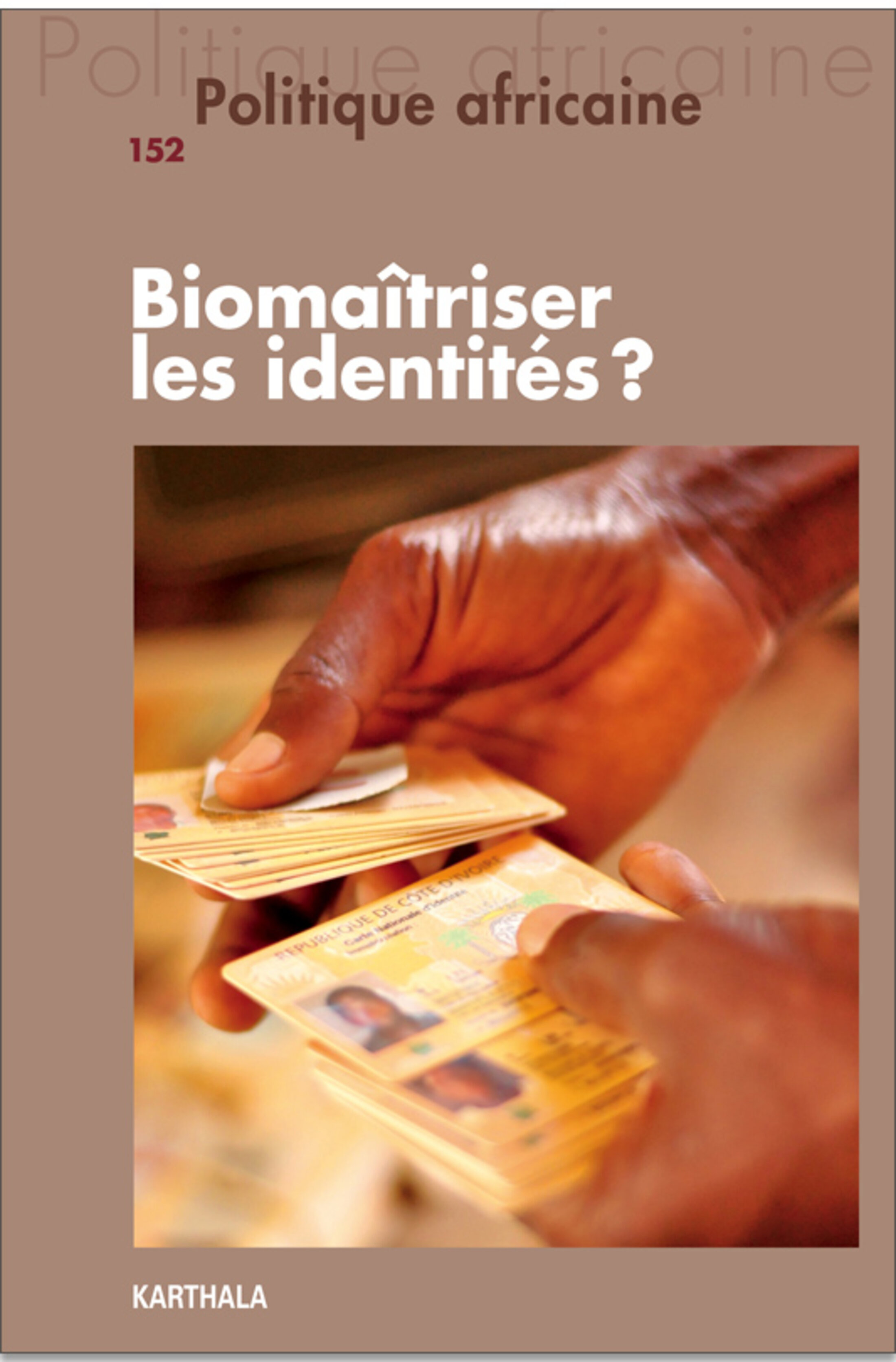
Politique africaine N-152. Biomaîtriser les identités ? coordonné par AWENENGO DALBERTO Séverine, BANEGAS Richard et CUTOLO Armando, Paris, Karthala, 2019
1. Une première version de ce texte a été présentée dans le cadre de la présentation de l’ouvrage lors des Jeudis de la Bibliothèque de la recherche africaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le 31 janvier 2019, avec Anne Hugon, Violaine Tisseau et Pascale Barthélémy. Je voudrais remercier Anne Hugon de m’avoir sollicité pour participer à ce séminaire. Je voudrais aussi remercier les chercheurs et chercheuses pour leurs commentaires qui ont permis d’améliorer considérablement la première version de cet article : Pascale Barthélémy, Vincent Bonnecase, Julien Brachet, Aurélien Gillier, Anne Hugon, Emmanuelle Spiesse et Ophélie Rillon.
2. P. Artières, « “Sexe, race et colonies” : livre d’histoire ou beau livre ? », Libération, 30 septembre 2018.
3. D. Schneidermann, « Un beau livre de viols coloniaux », Libération, 7 octobre 2018.
4. Cases rebelles, « Les corps épuisés du spectacle colonial » [en ligne], Cases rebelles, septembre 2018, <https://www.cases-rebelles.org/les-corps-epuises-du-spectacle-colonial>, consulté le 21 mars 2019
5. Mélusine, « Un ouvrage sans ambition scientifique », Libération, 30 septembre 2018.
6. P. Blanchard et N. Bancel, « Sexe, race et colonies, l’autre histoire des empires », AOC, 2 novembre 2018 ; G. Boëstch, « “Sexe, race et colonies” est bien un ouvrage d’histoire », Libération, 11 octobre 2018.
7. A.-L. Stoler, Race and the Education of Desire: Foucault’s History of Sexuality and the Colonial Order of Things, Durham/Londres, Duke University Press, 1995.
8. L’Association Connaissance de l’histoire de l’Afrique contemporaine, créée en 1992, travaille dans un premier temps moins sur l’histoire de l’Afrique que sur les représentations européennes de l’Afrique et des empires. Elle a depuis largement diversifié ses objets de recherche.
9. Voir le dossier « Colonisations » coordonné par Pascale Barthélémy, Luc Capdevila et Michelle Zancarini-Fournel dans la revue Clio, n° 33, 2011 ; A. McClintock, Imperial Leather: Race, Gender and Sexuality in the Colonial Contest, Londres, Routledge, 1995 ; R. Jean-Baptiste, Conjugal Rights: Marriage, Sexualiy, and Urban Life in Colonial Libreville, Gabon, Athens, Ohio University Press, 2014 ; A. Lauro,
Coloniaux, ménagères et prostituées. Au Congo belge (1885-1930), Bruxelles, Éditions Labor, 2005 ; Les politiques du mariage et de la sexualité au Congo belge (1908-1945) : genre, race, sexualité et pouvoir colonial, Thèse de doctorat en histoire, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, 2009.
10. F. Cooper, « Conflict and Connection: Rethinking Colonial African History », The American Historical Review, vol. 99, n° 5, 1994, p. 1516-1545.
11. A.-L. Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule, Berkeley, University of California Press, 2002, p. XV.
12. K. Breckenridge, Biometric State: The Global Politics of Identification and Surveillance in South Africa, 1850 to Present, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
13. A.-L. Stoler et F. Cooper, « Between Metropole and Colony: Rethinking a Research Agenda », in F. Cooper et A.-L. Stoler, Tensions of Empire: Colonial Culture in a Bourgeois World, Berkeley, University of California Press, 1997 ; T. Mitchell, Colonising Egypt, Berkeley, University of California Press, 1991 ; G. Wright, The Politics of Design in French Colonial Urbanism, Chicago, University of Chicago Press, 1991.
14. A. A. George, Making Modern Girls: A History of Girlhood, Labor, and Social Development in Colonial Lagos, Athens, Ohio University Press, 2014 ; L. A. Lindsay, Atlantic Bonds: A Nineteenth-Century Odyssey from America to Africa, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2017 ; S. F. Miescher, Making Men in Ghana, Bloomington, Indiana University Press, 2005 ; C. Van Onselen, The Seed Is Mine. The Life of Kas Maine, a South African Sharecropper, 1894-1985, New York, Hill and Wang, 1996.
15. A. Lafont, Une Africaine au Louvre en 1800. La place du modèle, Paris, Premières éditions, 2019 ; M. Nur Goni et E. Nimis, « Photographies contestataires, usages contestés », Cahiers d’études africaines, n° 230, 2018 ; P. Bijl, Emerging Memory: Photographs of Colonial Atrocity in Dutch Cultural Remembrance, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2015 ; Exposition « Papiers d’identités », Université de Dakar, présentée lors du colloque « Identités de papiers, papier d’identités en Afrique contemporaine (xixe-xxe siècle) », Dakar, 22-23 juin 2018 (dir. par S. Awenengo Dalberto).
16. S. Faure, « Colonies : les racines d’un racisme nommé désir », Libération, 21 septembre 2018.
17. A.-L. Stoler, Carnal Knowledge and Imperial Power…, op. cit., p. X. 75 % de la population européenne des Indes néerlandaises est métisse en 1900. En dépit de tentatives pour renforcer l’étanchéité des frontières raciales au XXe siècle, les relations sexuelles interraciales et la dimension créole de cette société perdurent jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Voir F. Gouda, « Genre, métissage et transactions coloniales aux Indes néerlandaises (1900-1942) », Clio, n° 33, 2011, p. 23-44. Sur les liens entre anxiété raciale, lutte contre le métissage et naissance d’un État providence racialisé, voir J. Seekings, « “Not a Single White Person Should Be Allowed to Go under”: Swartgevaar and the Origins of South Africa’s Welfare State, 1924–1929 », The Journal of African History, vol. 48, n° 3, 2007, p. 375-394.
18. Toute la dernière partie du livre, ainsi que trois chapitres dans les trois parties précédentes sont consacrés à la question du métissage.
19. E. Saada, Les enfants de la colonie. Les métis de l’Empire français entre sujétion et citoyenneté, Paris, La Découverte, 2007.
20. « Une autre histoire des empires : le viol colonial », Libération, 21 septembre 2018. C’est ce dossier qui lance la polémique.
21. Blanchard parle de « viol institutionnalisé » (p. 146).
22. R. Bertrand, Mémoires d’empire. La controverse autour du « fait colonial », Bellecombe-en-Bauges, Éditions du Croquant, 2006 ; C. Deslaurier et A. Roger, « Mémoires grises. Pratiques politiques du passé colonial entre Europe et Afrique », Politique africaine, n° 102, 2006, p. 5-27.
23. P. Blanchard et N. Bancel, « Sexe, race et colonies… », art. cité.
24. A.-L. Stoler, « L’aphasie coloniale française : l’histoire mutilée », in N. Bancel, F. Bernault, P. Blanchard, A. Boubeker, A. Mbembe et F. Vergès (dir.), Ruptures postcoloniales, Les nouveaux visages de la société française, Paris, La Découverte, 2010, p. 62-78.
25. P. Blanchard et N. Bancel, « Sexe, race et colonies… », art. cité.
26. D’après plusieurs contributrices de l’ouvrage.
27. Voir respectivement les pages 194-198 et 445-460.
28. Entretien de Pascal Blanchard avec Franz Vaillant, TV5 Monde, 13 octobre 2018.
29. Voir les transformations importantes de ces représentations au siècle des Lumières dans A. Lafont, L’art et la race. L’Africain (tout) contre l’oeil des Lumières, Paris, Les presses du réel, 2019.
30. Cases rebelles, « Les corps épuisés du spectacle colonial », art. cité.
31. Ibid.
32. P. Blanchard et N. Bancel, « Sexe, race et colonies… », art. cité, p. 5.



