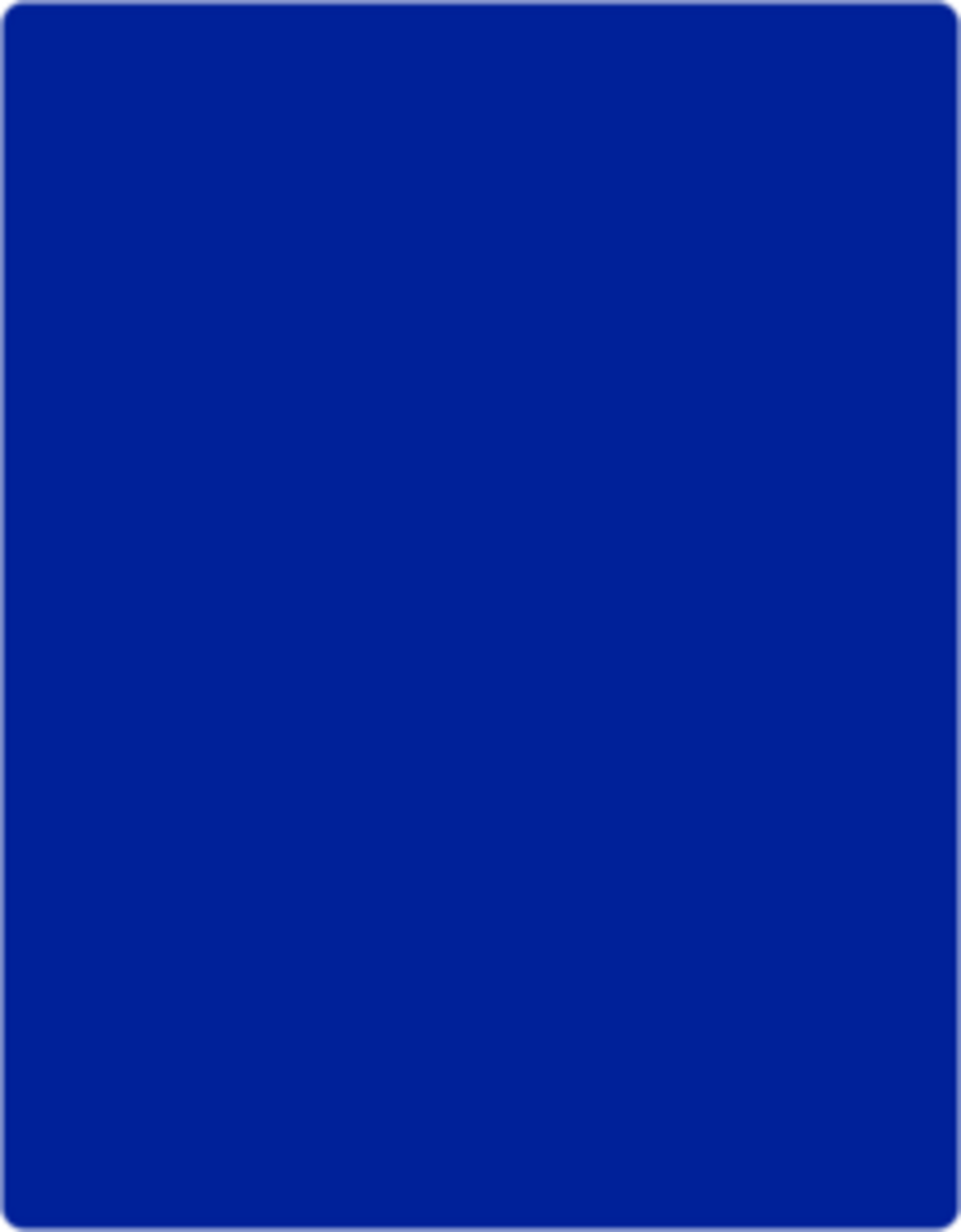
L'Indicible
Prendre la machine à remonter le temps.
Il faudrait que tu oublies les années mortes, toutes ces années qui te séparent de toi.
Il faudrait que tu oublies tout ce qui t’agresse du dehors. Que tu cesses de lire le journal, d’écouter le flux continu de la radio, de regarder les images que la télévision diffuse en boucle.
Il faudrait que ta mémoire efface tout ce qui l’encombre, la sature, l’éloigne de toi, qu’elle repousse hors de toi, de ton espace à toi, de ton intimité, les catastrophes naturelles, les guerres atroces, le feu des bombes, les villes en ruines, les marées humaines, les regards poignardés, les visages ravinés par la poussière et les pluies, les mains tendues vers le ciel noir, noir de la fumée âcre qui brûle les yeux et la chair broyée de ceux que les océans rougis de leur sang refoulent et que les murs égoïstes rejettent au bord de l’abîme, toutes les terres blessées, ouvertes sur leurs entrailles encore incandescentes et plus près de toi, à l’intérieur de toi, il faudrait que tu oublies tes larmes, tes colères, tes attentes fracassées, tes désespoirs solitaires, ta couche vide. Ton corps meurtri, fatigué. Dérisoire.
Il faudrait que tu abolisses les années, les années mortes qui te séparent des jours heureux, des jours anciens, si vieux, quand le ciel flambait encore et que la mer était bleue, immense et calme.
Il faudrait que tu te souviennes des jours heureux, ah comme tu étais heureuse, insouciante et dépouillée, tes rêves nus à pleines mains.
Il faudrait
que tu te souviennes des étés en pente douce où tu t’étalais sur la plage, les yeux grands ouverts sur la nuit tranquille en fourreau de suie qui tombait. Il faudrait que tu retrouves l’odeur épicée des pins dans la lande, la sensation de tes mains enfouies dans le sable qui glissait entre tes doigts, du vent qui ramenait les gouttelettes de mer dans tes yeux, du goût salé dans ta bouche sèche, de la peau des pêches qui éclataient au creux de tes paumes. Le temps était lisse, comme un silence blanc
.
Tu voudrais remonter la pente. Tu voudrais y revenir, immobiliser le souvenir pour qu’il ne t’échappe pas, le remodeler selon tes désirs, le transformer, le rendre encore plus beau, plus lumineux, qu’il n’en reste que le bruit incessant de la mer et le bleu partout, si beau, si lisse, si lumineux. Tu voudrais que les murs de ta maison deviennent bleus, que tes draps deviennent bleus, que le bois tranchant de tes meubles devienne bleu, que ta peau se fonde dans ce bleu tout autour de toi, un bleu liquide, tiède, mouvant où tu te sentirais bien, que tu ne voudrais plus quitter, qui te ferait oublier la dureté de l’écorce des jours et des nuits que tu passes à détricoter ta vie, ton histoire.
C’est un travail de longue haleine, qui te demande du temps. Le temps, tu n’as plus que ça, il se dilate devant toi, à l’infini, comme une boucle distendue qui s’enroulerait sur elle-même, en spirale, à l’infini, mais ce que tu ne sais pas, c’est combien de temps ça va durer, cette histoire-là, ce qui n’est pas visible, même à ton propre regard, ce dont tu ne peux parler car c’est une autre histoire qui ne se raconte pas avec des mots justes, précis, un langage chirurgical et tu ne sais pas comment elle va se terminer, si elle aura une fin et quelle fin elle aura, c’est une histoire insensée et anarchique qui se passe dans ton corps avec des cris aigus que tu es seule à entendre, des souffrances organiques que tu ne peux pas raconter, les gens n’aiment pas qu’on leur parle de ça, qu’on leur rappelle, ça les éloigne ou ça les gêne, comme une parole déplacée, étrangère, à côté des préoccupations futiles ou essentielles, alors une brève inquiétude un peu forcée teintée de culpabilité irrationnelle, un regard de honte et de compassion qui se dérobe, un je ne sais que te dire, ma pauvre, un silence qui circule entre les peaux et hop, on chasse le nuage noir devant les yeux qui obstrue la vue, on passe à autre chose, on change de sujet et toi, tu es là, dans ta grande solitude, immense et sans bord comme un précipice béant où tu as déjà sombré, où seul résonne l’écho de ta douleur, ta grande solitude que personne ne peut deviner, sinon dans un instant fugace, un souffle léger sur ta joue, où une main apitoyée se pose sur ton épaule et s’enfuit comme si elle avait touché une surface brûlante, trop brûlante, un instant fugace qui s’évanouit l’instant d’après.
Tes jambes sont lourdes, trop lourdes pour te porter encore, alors tu tombes. Hier, sur des marches à ciel ouvert, tu as glissé et personne pour t’aider à te relever et ton corps où suinte une douleur sourde qui te rappelle qu’il a vieilli d’un coup, comme s’il avait pris d’un coup dix ans d’âge, ton corps que tu traînes comme un poids informe, sans colonne vertébrale, qui menace à tout instant de te lâcher au bord du vide. Impossible de raconter cela de vive-voix, ni même de l’écrire, de le dissoudre dans un flux de mots qui lui donnerait une autre consistance, une autre réalité plus ou moins éloignée de ta vérité. Un jour, tu leur dirais ta vérité, tu aurais envie de la leur jeter en plein visage, tu trouverais les mots approximatifs qui ne peuvent la cerner tout entière, mais juste l’esquisser comme une caresse pour qu’ils n’aient pas peur et parce que tu ne saurais pas l’écrire autrement qu’avec des blancs entre les mots, entre les paragraphes, des silences entre les pages froissées, tu aurais fait de ton mieux pour qu’ils comprennent, mais tu l’aurais tenté une fois pour toutes, même si le mot fin te fait peur, comme s’il signait la fin de ton histoire à toi, comme s’il l’épinglait hors de toi et qu’elle ne t’appartenait plus. Définitivement.



