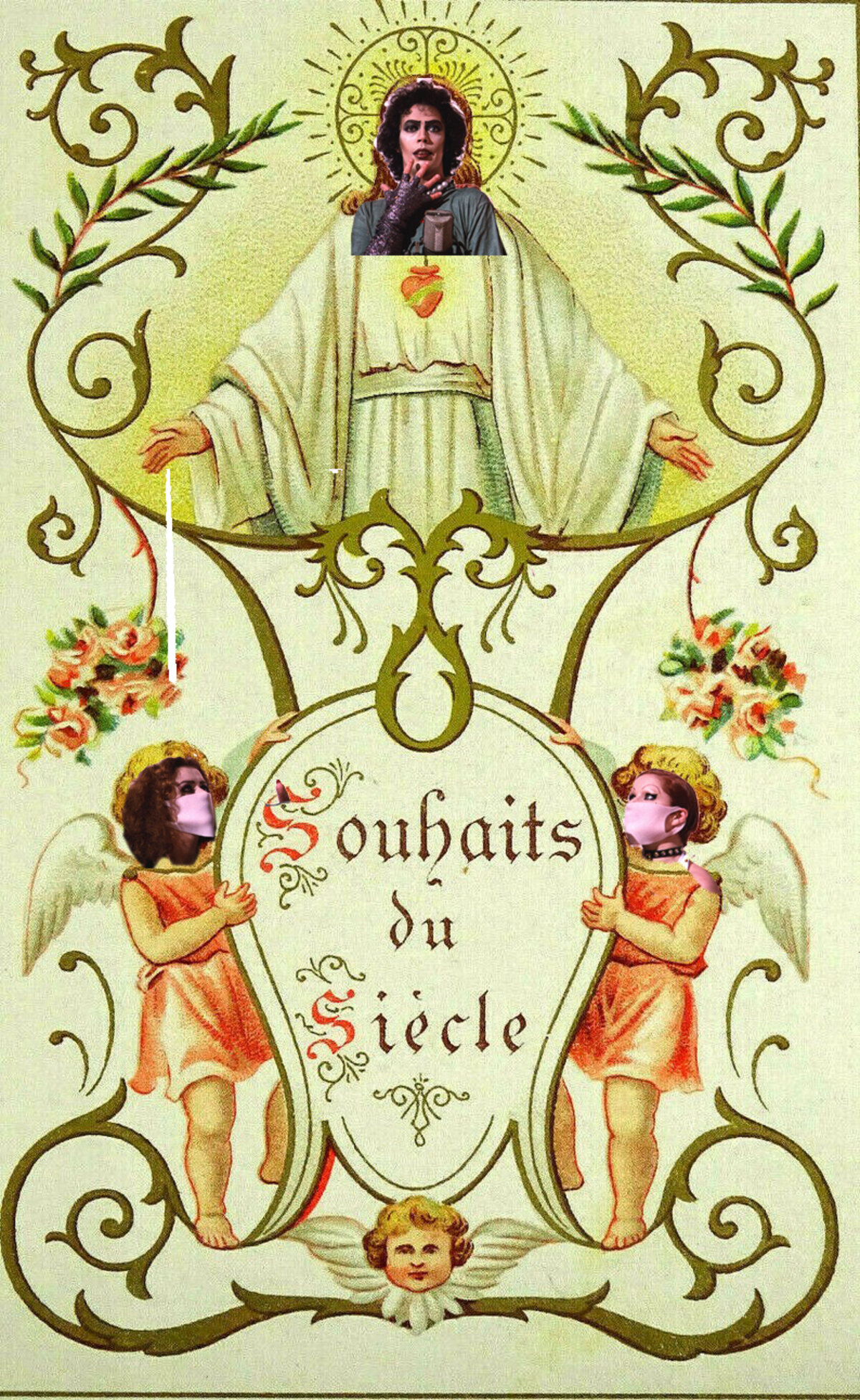
Agrandissement : Illustration 1
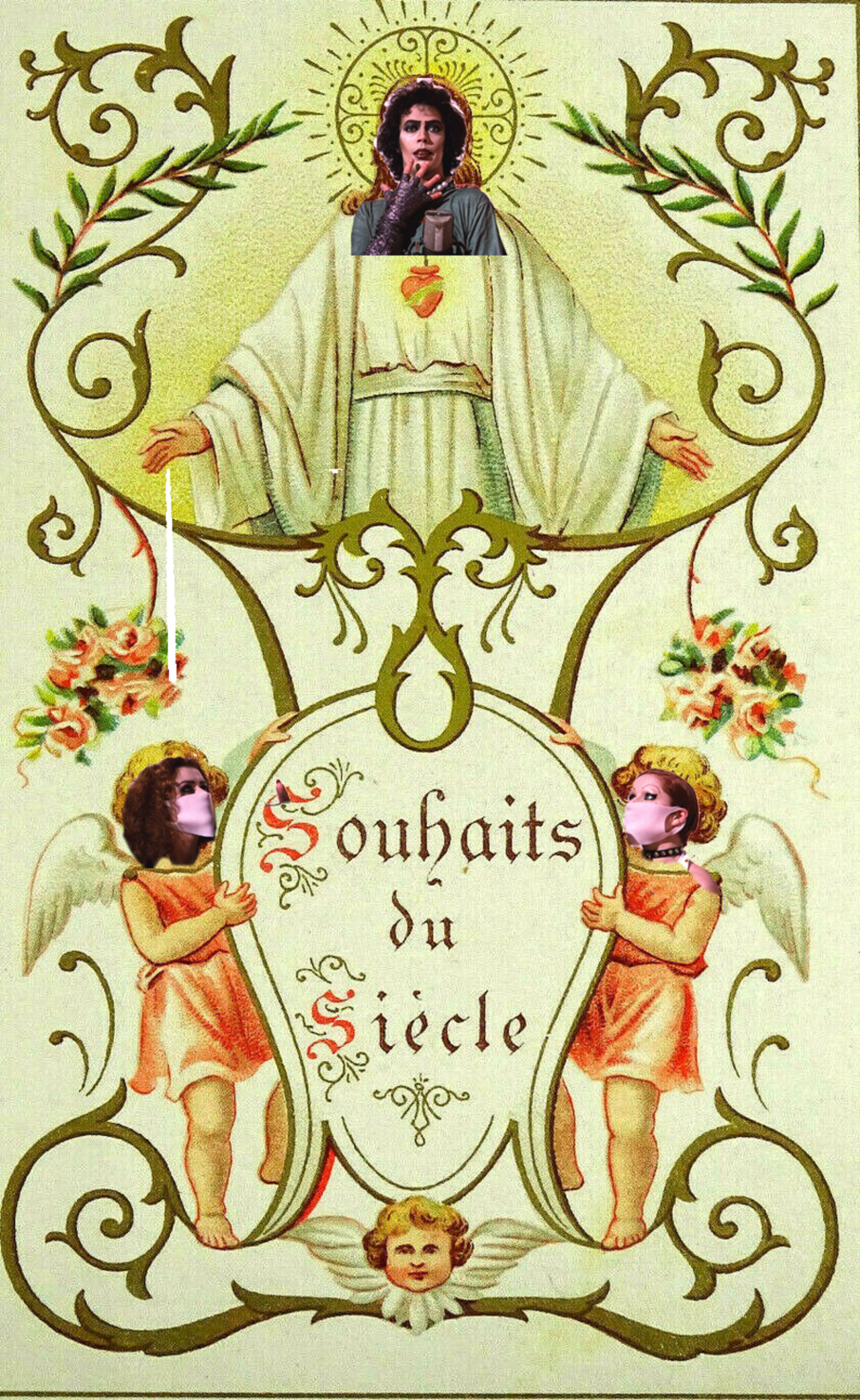
Le Rocky Horror Pitcture Show est un film culte.
Comme bon nombre de cérémonies sacrées, il rassemble en communion et en costumes (boa, jarretelle, talons de circonstance...), invite aux rituels processionnels (jeté d’eau et de riz du public), implique des chants liturgiquement grivois, scandés en choeur.
Mais si l’aspect cultuel de chaque séance n’a pas perdu de sa splendeur depuis 48 ans, quand est-il de sa dimension culturelle ? Quel a été son environnement de création, et qu’on cherchait à nous faire célébrer ses créateurices ? A quoi rime un cérémonial iconoclaste, si on refuse de rencontrer la contre-culture dans laquelle elle s’inscrit ?
Alors que j'appartiens à cette vénérable obédience, j’ai personnellement détesté ce film. Et puis, après avoir pris connaissance de son contexte de réalisation, j’ai détesté l’avoir détesté. Même si je ne renonce pas à certaines féroces critiques (concernant par exemple les biais validistes de l’époque, toujours aussi présents dans nos milieux), l’ignorance de ses circonstances historiques m’a fait passer à côté du second degré nécessaire à sa lecture. Alors, quand la Cinémathèque de Toulouse a proposé aux archives TPGBI d’animer une discussion à l’occasion d’une de ses projections, il nous a paru primordial d’y apporter un prisme contextuel avant son visionnage. Histoire de comprendre un peu sur quoi on se gausse. Quitte à, ma foi, péter l’ambiance.
Ces précieuses informations, ce ne sont pas nos recherches internet qui nous les ont apportées. Parce que notre culture est écrasée par le capitalisme, qui retient et diffuse uniquement ce qui lui est profitable, il peut être difficile d’avoir accès à certains pans d’Histoire. Non, c’est Camille Hebreard, qui, fort de ses recherches en cultures transPédéGouine et transféministe, nous a transmis ce savoir, après avoir patiemment écouté mes âpres critiques du film (disponible ici, dans l’intégralité du discours lors de l’événement Se défendre contre la transphobie et l'extrême droite - Analyser·Comprendre·Lutter contre les Terfs, organisé par l’ASQF*, et plus bas dans ce texte - extrait lu à la Cinémathèque).
Si Camille était venu me raconter que la représentation de notre communauté telle que la décrivent les Terfs (violente, abusive, assassine et tout le tintouin), et que je voyais s’incarner à travers cette œuvre pourtant estampillée camp/queer, était ici une manière de frontalement se réappoprier ce stigmate, j’aurai pu chausser des lunettes pour voir apparaître la vision initiale. Au lieu de ça, j’ai été sidéré par, certes, le narratif apparent du film, mais surtout par le fait d’imaginer un public de personnes non-concernées déguisées en « nous », se fendre la poire devant des scènes d’abus en tous genres, confortant leurs stéréotypes toxiques à notre encontre.
Bon. Alors. Je ne vous cache pas que c’est tout de même ce qui s’est passé ce 7 avril dernier à la Cinémathèque. Hum. Mais au moins, pendant 30 bonnes minutes, nous avons pu hacker le devant de la scène (« hacker » étant ici employé pour désigner le dérangement engendré… notre larcin ayant consisté à diffuser du savoir). Et c’est ce discours que nous allons ici transcrire.
Ces propos ont donc été tenus face à une salle pleine. Pleine, et pleine de maquillage, plumes, paillettes, pleine d’impatience à se faire divertir. Et que nous avons donc franchement contrariée en faisant obstacle à un puissant désir de marrades frivoles. Parce que, quant on injecte du savoir pas franchement pompidup à un produit prêt à être consommer par une bande de zozos qui se carre de nos réalités comme de leur première chaussette, on sort des sentiers du Clubmed du Queer, on entrave la confortable vautre du divertissement pentu. Et ça, c’est pas fun, c’est pénible, c’est ennuyeux.
C’est donc coiffé·e·s de cornets en carton turlututuchapeaupointu et l’oeil morne, torve ou terrifié que tout ce paquet d’individus nous a regardé dérouler nos propos... Et c’est le regard fuyant qu’ils ont glissé de leurs sièges à la porte pendant le générique de fin, pour éviter la discussion post-projection à la quelle nous les invitions. Des flaques d’angoisse guidées par une rigole d’ennui. Splouch. Un type s’est plaint. Il n’était pas « venu pour prendre un cours ». Ben oui, il était juste venu pomper de la poilade sur un blockbuster underground, pas apprendre quoi que ce soit sur les dégénéré·e·s qu'il était venu voir se trémousser en grand écran, des fois que ça le ferait débander. La salle s’est littéralement vidée sous nos yeux. Il en est restée 10 % (oui, on a compté). Peu ou prou des personnes concernées. Nous sommes resté·e·s le micro tendu et les pattes sciées.
Alors, ce « cours », nous avions envie de le rendre ici accessible. Parce que ces informations sont difficilement accessibles, parce que notre culture continue à être consommée comme on achète en promo un petit frisson passager, pour rendre visible le super travail bénévole de Camille, et pour espérer que ce film continuera à cliver les interprétations, mais avec des bases de savoirs communs.
Intervention d’un membre de La Grande Horizontale, lecture d'un extrait de l'intervention lors de l’événement Se défendre contre la transphobie et l'extrême droite - Analyser·Comprendre·Lutter contre les Terfs.
« Prenons un exemple concret pour travaux pratiques : Les Archives de Toulouse, dont je fais parti, présentent la semaine prochaine, (là maintenant, donc !!) une discussion autour du Rocky Horror Picture Show à la Cinémathèque… et nous y aurons l’occasion, je pense, d’y poser une question fondamentale : mais qu’est-ce que c’est que cette bouse ? Qu’est-ce qui s’est passé pour qu’on attribue à ce sinistre étron cinématographique la précieuse valeur d’un héritage esthétique aussi puissant ? Qu’est-ce qui s’est passé pour qu’on s’imagine célébrer une communauté de personnes persécutées à cause de leurs genres et/ou sexualités, en chantant à pleine plume sur des odes à la culture du viol, des scènes de torture non consenties, des persécutions de personnes handicapées ? Est-ce que le narratif d’une secte envahisseuse, avec à sa tête une femme trans menaçante, narcissique, agresseuse sexuelle, assassine, ce n’est pas pile poil l’histoire que tente de nous faire avaler les terfs aujourd’hui ? Est-ce que l’on peut s’appuyer sur ce « film culte » pour se confronter à l’effroyable essentialisation des hommes cis pédé et, surtout, des femmes trans et personnes transfemmes ? Est-ce que cette narration, articulée autour de l’empowerment des cishet face à une jarretelle émancipatrice, a été un tremplin à la sexualisation des inversions des codes de genre comme seule proposition de subversion ? Est-ce que les codes visuels camp que nous continuons encore à célébrer viendraient plutôt d’ailleurs alors, et que ce film aurait capitalisé sur leur beauté en les vidant de leur sens ? Ou est-ce qu’il a participé à la perpétuation des call-out abusifs des femmes trans, du racisme sans cesse minimisé, et du validisme délétère dans nos milieux ?
Collecter les données ne suffit pas, il faut les mettre en lien entre les cultures, et en écho avec le présent, sans complaisance. Parce que constituer des archives, ce n’est pas uniquement célébrer le beau, l’inspirant, s’émerveiller de l’architecture mouvante d’une classe sociale survivante, c’est repérer, aussi, dans les charpentes de nos pensées, les planches pourries sur lesquelles on s’appuie aujourd’hui. Parce que cette histoire monumentale, toute brinquebalante soit-elle, c’est celle qui constitue les coordonnées de nos positions face à nos ennemi·e·s. »
Intervention de Camille Hebreard.
« Confession d’un trans de la planète transsexuelle Transylvanie
Je m’appelle Camille Hebreard, je suis chercheur indépendant, spécialisé en art performance, en culture transPédéGouine et transféministe.
J’ai vu le Rocky quand j’avais 14 ans, j’ai pris une grosse claque, pour la première fois devant un écran et dans une chanson j’entendais de façon affirmative et positive les mot travesti et transsexuel. Slut-power, liens ténus à la culture BDSM, forte représentation bisexuelle et travesti, tout ça plus le script en lui-même, qui consiste en un projet de pervertissement et travestissement des personnages, font que j’ai depuis ce jour le film dans la peau. Moi aussi je suis un alien travesti ! Et bien sûr qu’une partie de moi aspire au pouvoir égocentrique, sexuel, créateur et destructeur de Frank’n’furter l’un des personnages principaux, et évidement mon rêve est de vivre dans un manoir d’horreur, un château hanté par une belle parade monstrueuse.
Je vais essayer pour vous de remettre le Rocky au centre de son contexte, pour vous faire comprendre qu’il est une version édulcorée d’un bouillonnement culturel trash et proto-punk et surtout pré-queer, qui se fait en réaction à un contexte socio-culturel spécifique.
D’abord le Rocky horror Picture Show, n’est pas un nanar ! On ne rit pas au dépend du film, c’est bien le film activement qui nous fait rire. Ce n’est pas même un navet, puisqu’il ne laisse pas indiffèrent. Certes les acteurices sont principalement mauvais·es et les décors en carton-pâte, mais ce n’est pas un film de série Z. En revanche, le film assume pleinement son hommage parodique au film de série B, tous genre confondus (comédie, musicale, science-fiction, gore, horreur) en faisant moultes références.
Dès les années 50, né le concept de midnight movie synonyme du film de série B. Il se développe à fond aux Etats-Unis, cheap, petit budget, diffusé aux alentours de minuit sur les chaines de TV locale. Il donne à voir des films souvent kitchs et provocants, pot pourrie de contre-culture hollywoodienne. Ce n’est au début pas un genre cinématographique, mais plutôt un processus de diffusion, sans pub et en marge des majors d’Hollywood de l’époque. Le Rocky s’inscrit dans cet héritage à la seule différence qu’il est le premier film de série B à être produit par une major ici la Twenty century fox, peut-être même qu’il marque l’époque où le film de série B commence à devenir un genre à par entière.
Pour rappel contextuel, de 1929 à 1966, le Code Hays aux Etats-Unis est mis en application, interdisant formellement à l’écran entre autres nudité et sexualité. Même si dés 1950, le code est moins rigoureusement appliqué, il n’est remplacé qu’en 1968 par un système de classement, tel que nous le connaissons plus ou moins aujourd’hui. Sans doute que les films de série B ont permis une certaine résistance à cette censure et avec elle le développement d’une contre-culture cinématographique populaire.
Mais avant le film il y a l’écriture de la pièce qui débute en Angleterre en 72, la première représentation a lieu en 73, en 74 elle traverse l’atlantique direction LA et en 75 elle sera adaptée à Broadway et fera une tournée mondiale. Cette même année, la pièce est adaptée en film, avec un budget de 1,4 million dollars. Le budget moyen de la major cette année là est de 4,8 millions de dollars, 13 millions pour la plus soutenue, donc finalement un très petit budget.
Et du côté des luttes et de la loi ? Avant 1969 où les mouvements LGBT rejoignent les mouvements pour les droits civiques et les droits des femmes, les organisations homosexuelles principalement bourgeoises et bienpensantes ont comme mission l’intégration. Je pense alors à tous les clubs homophiles plutôt moralistes, qui défendaient certes la dépénalisation et la fin des lois punitives, mais qui jouait la carte de l’assimilation, du « nous sommes comme vous », « nous sommes les bons homophiles bien habillé·es ». Evidemment c’est sans les trans et les trav. On connait l’histoire maintenant, ceux sont ces mêmes freaks qui débutent différentes émeutes dont celles de Stonewall, qui aboutissent à des marches pour les droits et dans leurs sillages un processus de dépénalisation massif. Dans les années 1970 et 1980 de nombreux états dépénalisent les relations homosexuelles entre adultes consentant·es, mais c’est qu’en 2003 que la Cour suprême des Etats-Unis dépénalise l’homosexualité. Et enfin ce n’est qu’en 1990 que l’Organisation mondiale de la santé raye l’homosexualité de la liste des maladies mentales.
Maintenant que tout cela est clair, revenons à l’esthétique. A la fin des années 60, émerge un style qui se diffusera dans différentes formes artistiques et notamment dans le cinéma : la sick comedy ou dark comedy. Il est question d’humour glaçant, cinglant et cynique, celui qui ne fait rire que peu de personne et met mal à l’aise les autres. On retrouve dans le camp, avec l’outrance et le second degré, cette tendance à rire de la mort, rire de l’agression, rire du drame, rire de tout. C’est comme un poison cathartique qui nous fait tenir le cap et malgré ce qu’on pourra lui reprocher, comme par exemple de réifier la violence, c’est tout de même une identité collective forte par laquelle nos communautés survivent ou ont survécu.
Toujours à la fin des années 60, à New York le théâtre underground et la scène expérimentale explose. Il est nourri par des apports de la danse moderne, de la musique expérimentale, du happening et de ce qui deviendra bientôt la performance. Aidé entre autres par la création de la Fabrique de Warhol, une nouvelle esthétique voit le jour, c’est le trash. Loin du pop art, c’est dans le tourbillon des squats d’artistes et même dans les délires psychédéliques d’une bande de queens/trans défoncées, que va naître de l’élégance et de la javel, de la misère se voulant star, le style trash glam. En 1970, la pièce Femme Fatal de Jackie Curtis, une des égéries trans de Warhorl, nous en montre un exemple. Posture de diva et écharpe en guirlande de noël, entourée de culs tout nus, elle entonne des chants repris en cœur en grande prêtresse blasphématrice trash glam.
Il s’agit de pervertir, agiter sous le né l’innommable, transformer l’art en anti-art, chercher les limites de l’acceptable, tout en rêvant de gloire et en s’entourant de l’aura de la star. Bref on est camp et à l’avant-garde du punk, dans une vibration anticonformiste, qui ne demande qu’à trouver des formes. Et cette nébuleuse/proto-mouvement est essentiellement portée par des gouines, des pédés, des trav et des trans.
Avec notamment l’émergence de la performance, l’époque est à l’exploration de la nudité, de la sexualité et de la violence dans l’art. Ici je pense à une figure majeure du punk et de la musique qui est aussi lié à l’art contemporain : une femmes trans pionnière du punk dont on n’a pas vraiment retenu le nom alors que de son temps nombre d’artiste cis pour la plupart des hommes hétéro blanc, ont su capter et recopier son style et ses attitudes outrancière : Jayne County.
Elle est à ma connaissance la première personne trans à parler de transitude dans ses textes. Elle est l’icone proto-punk, que l’histoire nous a cachée. Elle joue dans Pork d’Andy Warhol, dans Femme Fatal de Jackie Curtis aux côtés de Patti Smith, ou encore dans Jubilee de Derek Jarman. Elle inspirera David Bowie, qui globalement pompera tout son style aux queens. Bien plus tard dans les années 2000, elle inspirera l’énorme tignasse de Hedwig and the angry inch.
Je crois que c’est franchement plus à elle qu’on doit le glam rock qu’à tous les autres frontmen du rock et du hard. En fait, cette histoire c’est encore une histoire de pillage. Dans les années 60/70, à New York plusieurs restaurant/nightclub forment un écosystème dans lequel incube la scène punk. A l’époque les frontmen du glam sont bien insipides et c’est de leur rencontre avec les queens, trav et les trans que s’organise une mode du travestissement dans le rock et le hard rock. Eux-mêmes qui se venteront d’inventer le glam rock, dénigreront leurs inspirations. On va pas se mentir Kiss ou Bowie ils avaient rien de très révolutionnaires, surtout les premiers avec leur chanson sexistes ou le deuxième quand au bout de quelques années d’appropriation, il a juste décider d’arrêter de jouer l’homosexuel androgyne. En attendant les trans elles restaient trans et surtout elles ne vendaient toujours pas d’album, là où les mecs cis ont fait des carrières internationales, de la thune avec des majors et des stadium remplies de fan. Tiens tiens, à la manière de Warhol, c’est toujours les mêmes qui tirent profit des identités et des corps marginalisés.
Avec l’avènement du punk c’est la mode de la déviance, pourtant les punks, se sont montrés peu soutenant quand Jayne County a transitionné. Elle représentait en fait la marge de la marge. Même les punks la trouvaient trop intense, sur scène par exemple, se masturbant avec la vierge marie, ou avec le trident du diable, ou mangeant à quatre pattes de la bouffe pour chien et faisant à tour de bras des fuck à l’assemblée. L’incarnation de la Transsexual menace !
Si ça vous parle, alors je vous invite à aller lire la biographie de Jayne County : “man enough to be a woman”. Personnellement, j’ai envie de considérer, que dans cette partie du globe et dans ce contexte, le glam rock et l’esthétique trash sont des créations trans.
Bon mais si on revenait au Rocky ? Au côté de County dans Jubilee film manifeste punk de 1977 joue Richard O’Brien. On n’en a pas encore parlé, Richard O’brien est la personne qui a créé la pièce The Rocky Horror Show, les musiques puis le scénario du RHPS. C’est une personne non-binaire prenant des œstrogènes et se décrivant iel-même comme 70% homme et 30% femme. Dans le RHPS O’Brien joue Riff Raff le majordome, frère incestueux de Magenta.
Comment ne pas voir l’étonnante similitude entre le maquillage de Siouxsie Sioux et celui de Frank’n’furter ? Pour faire lien entre esthétique punk et le Rocky, on peut citer la dimension subversive du grotesque, voir du carnavalesque des personnages et de leurs attitudes. Et avec ça, la liberté sexuelle par laquelle iels s’expriment ainsi que les paroles des musiques.
Le Rocky s’inscrit pour moi dans un activisme culturel proto-punk, dans un contexte où la culture gay parait limitée, intégrationniste et bourgeoise. C’est aussi dans ce sens qu’il faut comprendre Pink Flamingo de John Waters qui sort juste avant en salle en 72 et qui créer l’indignation et la fascination général. Divine la Drag-queen la plus trash de l’histoire achève le film en mangeant une vraie merde de chien. Film plus punk que glam rock, on est d’accord.
Pour moi une œuvre queer, c’est avant tout une œuvre dont on peut tracer le processus de création comme faisant parti de la culture queer. C’est pourquoi le Rocky et ce qui l’entourent annonce en un sens, ce qui adviendra 10 ans plus tard avec le Queercore ou le homocore et les films de Bruce la bruce. Pornographie, blasphème, anarchie et sodomie. Objectif : Embraser les stéréotypes négatifs que la société a envers les homos et les trans, performer le monstre que tu dis que je suis. Dans cette idée, une culture queer forte c’est une contre-culture qui critique la culture dominante, qui la colle comme de la glue, qui témoigne de sa violence et de sa bêtise, mais qui ne peut pas être ravalée par elle. Et pour ne pas être ravalé, il faut être extrême.
Et c’est sans doute ça la faiblesse du Rocky. Sa capacité à être encore aujourd’hui adulé par plus ou moins n’importe qui, mérite de réfléchir aux compromis qui ont été fait durant sa création. Néanmoins ce film a réussi à prendre toutes les influences que je vous ai cité, pour en faire un film acceptable. Certes décrié à sa sortie, mais qui a su charmer les foules. Le Rocky est une trace vibrante d’une époque très riche pour la culture queer, et O’brien la rendu assez accessible pour que la gouine que j’étais le regarde en boucle avec ces amis pédales dans les couloirs du lycée. Nous avons autant besoin des marges extrêmes qui ne seront jamais ravalées, que des œuvres plus sympathisantes, du moment qu’on reste au centre de la création. C’est donc bien la force et la faiblesse de ce film.
Bien sûr, et c’est ce que j’ai essayé de mettre en lumière, il est marqué par son époque et ses influences punk, qui pensaient peut-être moins l’impact de la fiction sur le long terme et qui dépassaient les limites morales du mauvais et de l’injuste par provocation jubilatoire. Alors oui, aujourd’hui on doit faire mieux et analyser et comprendre qui et pourquoi encensent des œuvres aussi datées qui peuvent se révéler problématiques. Mais on doit aussi avant reconnaître l’importance de certaines œuvres emblématiques qui sont ancrées dans un contexte culturel précis qui a tendance à être occulté. »
*ASQF : Association pour le soin queer et féministe

Agrandissement : Illustration 2




