La loi Littoral - La côte en péril ?
La Geste, 2020
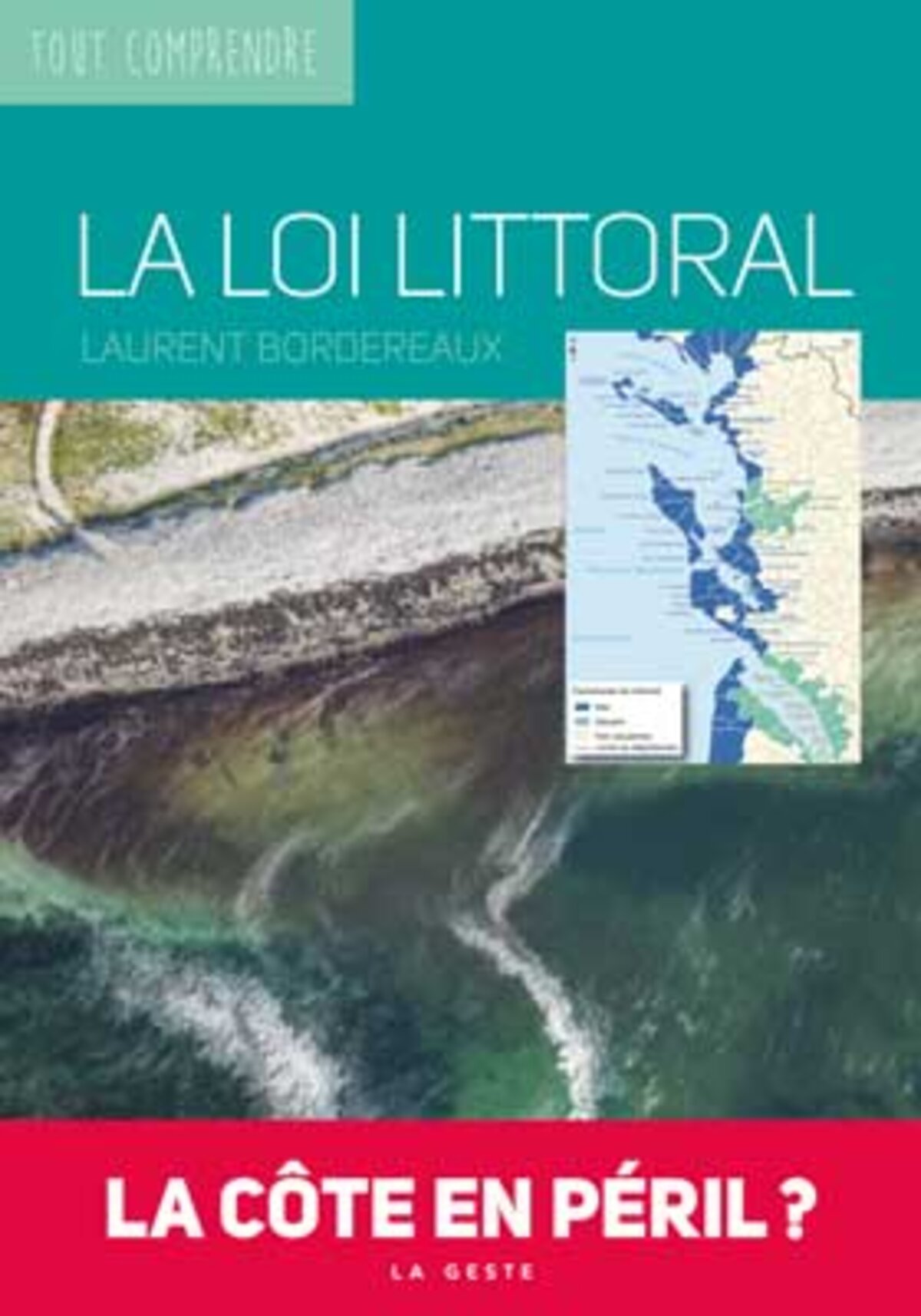
4ème de couverture :
LA LOI LITTORAL
La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite « loi Littoral », demeure depuis plus de trente ans la pierre angulaire et le texte emblématique du système français de préservation des espaces côtiers.
Grande loi d’équilibre, son domaine d’application est au cœur de l’écosystème terre-mer ; elle a toujours suscité des débats passionnés entre élus, aménageurs, associations de protection de l’environnement et habitants du bord de mer. La loi Littoral doit aujourd’hui répondre aux problématiques des risques naturels et des énergies renouvelables et cesser de faire l’objet d’assouplissements répétés qui la fragilise. Au-delà de la présentation des grandes règles de la loi (bande des 100 mètres…), ce livre se veut un guide citoyen de la loi Littoral.
Laurent Bordereaux est né en 1970 à la Roche-sur-Yon. Docteur en droit de l’Université de Nantes et professeur à l’Université de La Rochelle, il y enseigne le droit du littoral depuis vingt ans. Ses recherches portent sur le domaine public maritime ainsi que sur l’aménagement et la protection des zones côtières. Auteur de nombreuses publications, il est notamment co-auteur de "Droit du littoral" (Gualino, 2009) et des "écluses à poissons d’Oléron" (La Geste, 2009).
Sommaire du livre :
- Les grands enjeux de la loi Littoral
- Un noyau dur : les interdictions de construire dans l’espace littoral
- Les limitations à l’urbanisation du littoral
- L’importance de la territorialisation de la loi Littoral
Extrait :
LES GRANDS ENJEUX DE LA LOI LITTORAL
Un monument législatif en péril ?
La loi relative à l’aménagement, la protection et la mise valeur du littoral du 3 janvier 1986 -dite « loi Littoral »- est trentenaire. Votée à l’unanimité par le Parlement, elle représente dans l’opinion publique l’incarnation de la protection juridique des zones côtières en France. Malgré ses limites, c’est l’une des premières grandes lois de développement durable, symbolisant encore aujourd’hui un rempart contre une urbanisation anarchique et massive du littoral qui a trop longtemps sévie, particulièrement sur les côtes méditerranéennes.
Il y avait donc dans la loi Littoral une volonté de rompre avec l’ancien régime de l’urbanisme côtier. Ce grand objectif s’exprime techniquement par un ensemble de règles de droit, aujourd’hui très largement codifiées (essentiellement dans les codes de l’urbanisme, de l’environnement et de la propriété des personnes publiques). Les acteurs publics et privés de l’aménagement du territoire expriment régulièrement leur attachement aux grands principes de la loi. Toutefois, s’il ne semble pas question de la remettre frontalement en cause, force est de constater que la loi du 3 janvier 1986 a déjà fait l’objet de toute une série d’assouplissements, d’une nature et d’une portée variables, érodant l’édifice législatif originel. La loi Littoral, fragmentée, en partie réécrite et assouplie par d’autres lois ou par le juge au fil des nombreux contentieux, a-t-elle encore un avenir ? Les levées de boucliers qui ont agité le monde politique et associatif en juin 2018, lors de la discussion de la loi ELAN, témoignent de toute l’actualité du problème.
Les enjeux de protection n’ont pourtant pas faibli avec le temps, bien au contraire. Nul ne conteste les préoccupations majeures liées à la perte de biodiversité des zones côtières ou à la préservation des paysages exceptionnels du littoral métropolitain et ultra-marin. La France l’a d’ailleurs reconnu solennellement en ratifiant, par exemple, le protocole de Madrid du 21 janvier 2008 sur la gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée.
Par rapport à la moyenne nationale (métropolitaine), la densité de population des communes littorales est environ 2,5 fois supérieure, de même que le pourcentage de terres artificialisées (source : Observatoire National de la Mer et du Littoral).
Aussi importants soient-ils, ces enjeux de protection de l’environnement ne sont pas les seuls. D’autres facteurs doivent être pris en considération : culturels, géographiques, politiques et, plus généralement, sociétaux. Rappelons d’abord que la loi Littoral prend corps dans l’ambiguïté de la décentralisation à la française, où les rôles et compétences respectifs de l’Etat et des collectivités locales sont difficiles à cerner. Ainsi les faiblesses « politiques » de la loi Littoral sont-elles dues à l’existence de principes d’aménagement trop généraux au regard de la diversité géographique, imposés pour l’ensemble de la nation, ou aux lacunes des documents locaux d’urbanisme dans l’indispensable territorialisation de la loi ? C’est là une grande question de fond qui s’est très rapidement posée…
Ensuite, il faut composer avec le « désir de littoral », qui ne se dément pas, cumulé à des représentations contradictoires du littoral dans la société française, conduisant à une concentration croissante de personnes (aux attentes diverses) et d’activités (économiques et de loisirs) au sein d’un espace éminemment contraint. Dans cette perspective, la loi Littoral est-elle le bon outil pour régler les confits d’usages ? Doit-on renforcer encore la fonction normative des outils locaux de planification, au risque de multiplier les différences d’appréciation d’un littoral à l’autre ? Enfin, comment appréhender dans le discours juridique les enjeux grandissants du réchauffement climatique et de la montée des eaux ? Beaucoup d’enjeux, au final, pour un monument législatif des années 80 suscitant toujours autant d’approches et de débats contradictoires.
Un texte à l’équilibre complexe
Revenons à l’écriture de la loi du 3 janvier 1986, dont le titre, paru au journal officiel du 4 janvier, est tout sauf anodin. Il s’agit bien d’aménager, de protéger et de mettre en valeur. Contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit, si la loi Littoral met bien l’accent sur la protection, elle n’a jamais été pensée comme un texte de sanctuarisation des zones côtières. Il s’agit donc d’un texte d’équilibre, évolutif, cherchant à concilier plusieurs objectifs.
Laurent Bordereaux, La loi Littoral - La côte en péril, La Geste, 2020, 56 p., 5,50 € (à commander en librairie ou sur le site de l'éditeur : http://www.gesteditions.com/tout-comprendre/la-loi-littoral-la-cote-en-peril )
Presse (interview par L. Jabre, La Gazette.fr) : "Le PLUi devrait être le principal outil de territorialisation de la loi Littoral" (https://www.lagazettedescommunes.com/686540/le-plui-devrait-etre-le-principal-outil-de-territorialisation-de-la-loi-littoral/)



