C’est peu dire qu’en économie, la pensée unique a fait des ravages. Accompagnant la vague néo-libérale qui a submergé la planète depuis plus de deux décennies, elle a mis à mal ce qui constituait la première richesse de cette discipline, à savoir son pluralisme. C’est ce qu’établit une étude très intéressante réalisée par un jeune sociologue, Thomas Angeletti, à partir d’un échantillon intéressant, celui du Conseil d’analyse économique.
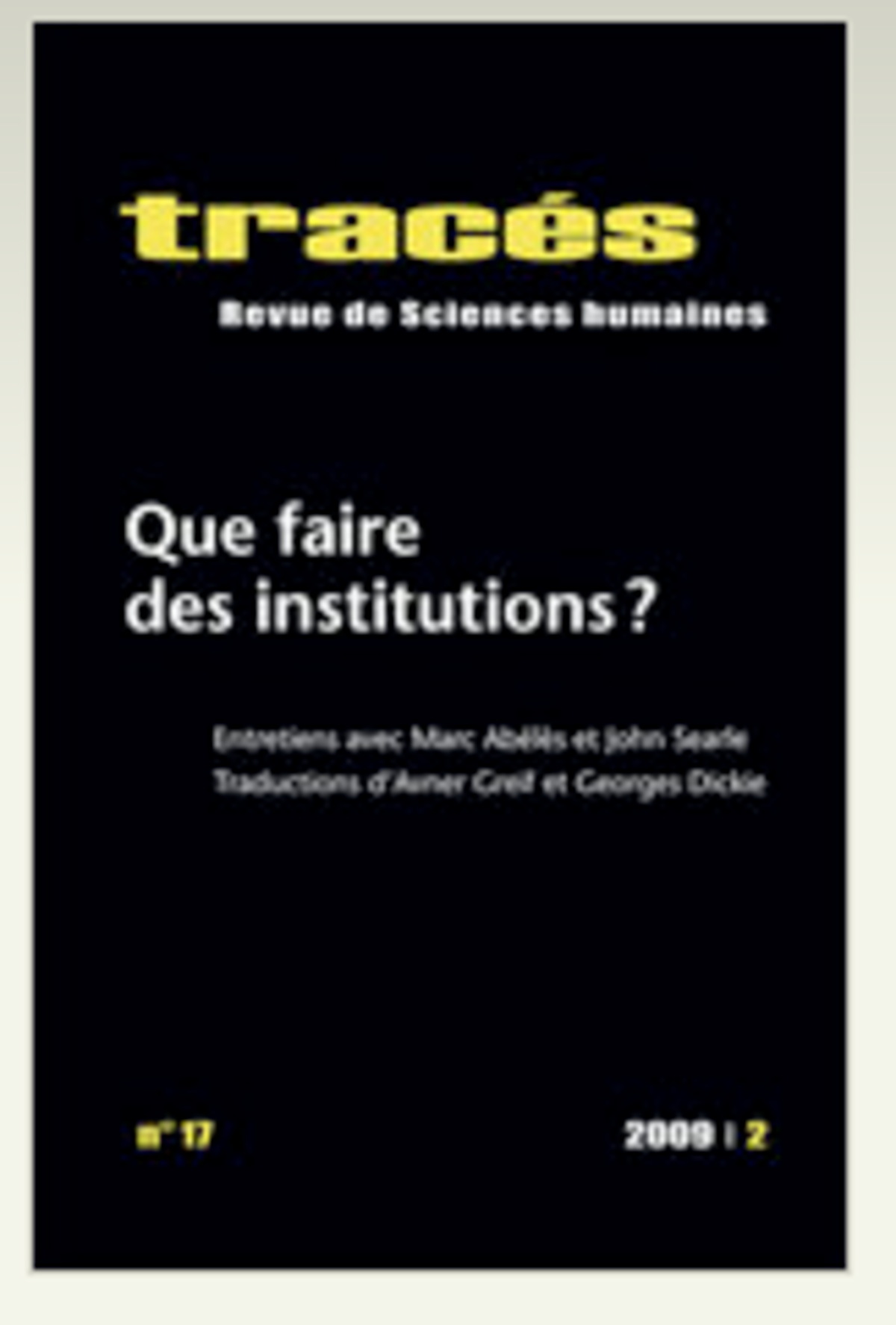
Intitulée « (Se) rendre conforme. Les limites de la critique au Conseil d’analyse économique », cette étude commence à dater puisqu’elle a été publiée en 2009 par Tracés, une revue de sciences humaines, dans son numéro 17 consacré à cette question « Que faire des institutions ? ». Mais je dois avouer qu’écrivant mon livre sur Les imposteurs de l'économie (Editions Gawsewitch), je n’avais pas connaissance de ce texte. Et je me rends compte que beaucoup d’économistes en ignorent l’existence. Or, dans le débat sur les mécanismes qui poussent à la pensée unique, ce texte apportent des éclairages très intéressants, qui compètent ma propre enquête.
Dans mon ouvrage, je me suis certes arrêté longtemps sur le Conseil d’analyse économique (CAE), qui regroupe une trentaine d’économistes français parmi les plus connus, et qui a pour fonction d’éclairer les choix du premier ministre. Décortiquant leurs conflits d’intérêt innombrables, j’ai établi que nombre d’eux se présentant officiellement comme des universitaires étaient en fait souvent appointés discrètement par la finance, quand ils n’étaient pas purement et simplement des économistes de banque. J’ai donc apporté de nombreux indices d’un dessèchement progressif de cet organisme, pourtant sensé être pluraliste et représentatif des différentes écoles de pensée en économie.
Thomas Angeletti, lui, va plus loin. Doctorant en sociologie au Groupe de sociologie politique et morale (CNRS, EHESS) à l’époque où il écrit ce texte, et auteur d’une thèse sous la direction de Luc Boltanski intitulée « Economistes et institutions dans la France des années 1970-2010 », le chercheur (ici sa biographie et ses travaux) montre de manière très méticuleuse par quels mécanismes le CAE a finalement abouti à l’inverse de ce à quoi il était destiné : « Le projet originel qui avait accompagné la création de l’organisme, visant à établir un espace pluraliste de discussions ne cherchant pas le rapprochement des points de vue, est mis à mal par un ensemble de dispositifs invitant à élever le niveau d’autocontrainte. Pour les membres regrettant l’absence de critique et de discussion, souvent ceux chargés d’incarner le « pluralisme » et la « diversité », confrontés à des difficultés rendant caduque toute tentative de débat contradictoire, c’est un engagement plus vif dans la transgression ou une fuite qui s’annoncent. »

Cette approche est, en vérité, partagée par un nombre croissant d’économistes. Dans un précédent billet de blog (Lire Plaidoyer pour une refonte du Conseil d’analyse économique), j’ai ainsi souligné que Romain Rancière, chercheur à l’Ecole des Ponts et professeur à l’Ecole d’économie de Paris, pour ne parler que de lui, défendait l’idée que le CAE ne remplissait plus le rôle pour lequel il avait été crée et pressait la gauche d’avancer vers un modèle alternatif, celui du «Council of Economic Advisors» (Conseil des conseillers économiques) qui existe aux Etats-Unis et qui est placé directement auprès du président des Etats-Unis.
Ce sont donc les enjeux de ce débat que Thomas Angeletti éclaire avec son étude, notamment en présentant les témoignages anonymes de deux membres du CAE –mais en vérité, les initiés devineront sans trop de peine leur identité. Pour tous ceux que ce débat intéresse, je m’autorise donc à souligner le grand intérêt de ce texte. Il peut être téléchargé ici ou consulté ci-dessous.



