La « Protestation adressée à Woodrow Wilson contre un État sioniste » fut présentée à Versailles le 4 mars 1919, après avoir été préparée par le rabbin Henry Berkowitz, Max Senior, et le professeur Morris Jastrow. Elle est publiée dans le New York Times le 5 mars 1919.
Si Julius Kahn, alors député fameux au Congrès américain, apparait comme le premier signataire de cette protestation, et parfois comme son auteur, il n’en est pourtant pas à l’origine.
Né dans le grand-duché de Bade (en Confédération germanique) en février 1861, Julius Kahn émigre aux États-Unis avec sa famille en 1886. Débutant sa carrière politique à l’âge de 31 ans par un diplôme d’avocat, il participe activement à l’organisation de l’effort de guerre pendant la 1ère Guerre mondiale, tout en s’engageant au sein de la communauté juive américaine. Membre de la Congrégation Emanu-el de San Francisco, il aide à établir la Jewish Educational Society of San Francisco. Sa renommée, son patriotisme sans faille, son engagement dans la guerre et un antisionisme partagé le firent sans doute approché par des membres éminents de la communauté juive américaine.
Dans un article publié en 1976, Alan Boxerman, sur la base d’archives de la correspondance entre Berkowitz et Kahn, rappelle dans quelles conditions le rabbin approcha le député, et la façon dont Kahn apporta son soutien à la pétition :
Au printemps 1919, Kahn programme une visite en Europe à l’invitation du général Pershing afin d’étudier la situation militaire et interviewer des militaires en vue de formuler une nouvelle politique militaire au Congrès. Avant son départ, l’un des principaux opposants à l’État juif de Palestine, le rabbin Henry Berkowitz de Philadelphie, envoie à Kahn une pétition contre le sionisme signée par plus de 150 juifs américains éminents [le 28 février 1919]. Berkowitz demande au député de la présenter au président Wilson à Versailles. Kahn, qui croyait également que la mission du peuple juif était religieuse plutôt que politique, informa le rabbin qu’il avait bien reçu le communiqué, mais que ses priorités étaient « d’observer les conditions dans les affaires militaires en prévision de me préparer au travail de la prochaine session du Congrès ».
À son grand regret, au printemps 1919 – moment crucial pour les négociations de paix –, Kahn se trouve à nouveau en désaccord avec le président Wilson, qui est favorable à un État juif indépendant. Dans une interview accordée au New York Times [le 6 février 1919], il déclare : « Ma principale objection est [...] le fait que les non-Juifs commenceront à considérer le Juif américain comme ayant un désir latent de toujours retourner dans la soi-disant patrie juive – que les non-Juifs accuseront les Juifs de n’être qu’un simple visiteur aux États-Unis ». (Boxerman 1976, p. 348)
La publication de la pétition dans le New York Times le 5 mars 1919 suscita des réactions positives de la part de la communauté juive américaine, majoritairement antisioniste. Ainsi, le Hebrew Standard, le 14 mars, publie un encart élogieux, considérant la pétition comme un « document important », dont les implications devraient être « considérables ». Le « premier journal familial juif d'Amérique », tel que se proclame le Hebrew Standard, considère la protestation publiée par Khan et consorts comme indispensable : pour révéler au monde l’opposition d’une majorité juive au sionisme et à la création d’un État juif en Palestine ; mais également parce que les sionistes font entendre une voix démesurée par rapport à leur importance :
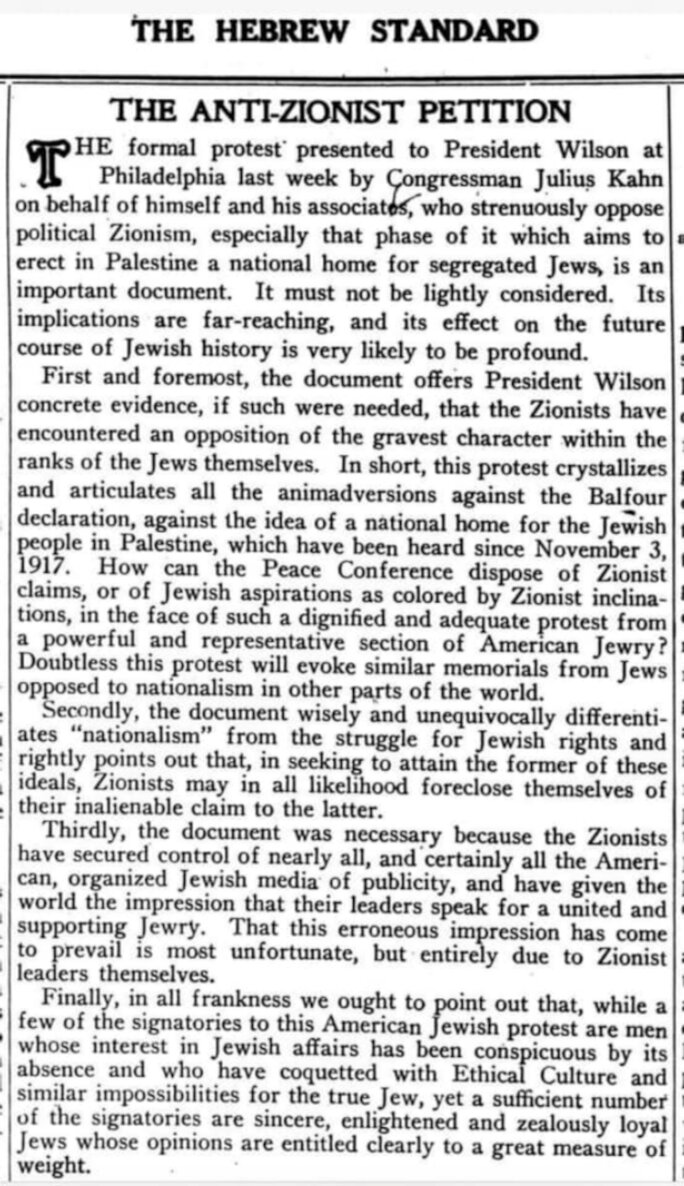
Agrandissement : Illustration 2
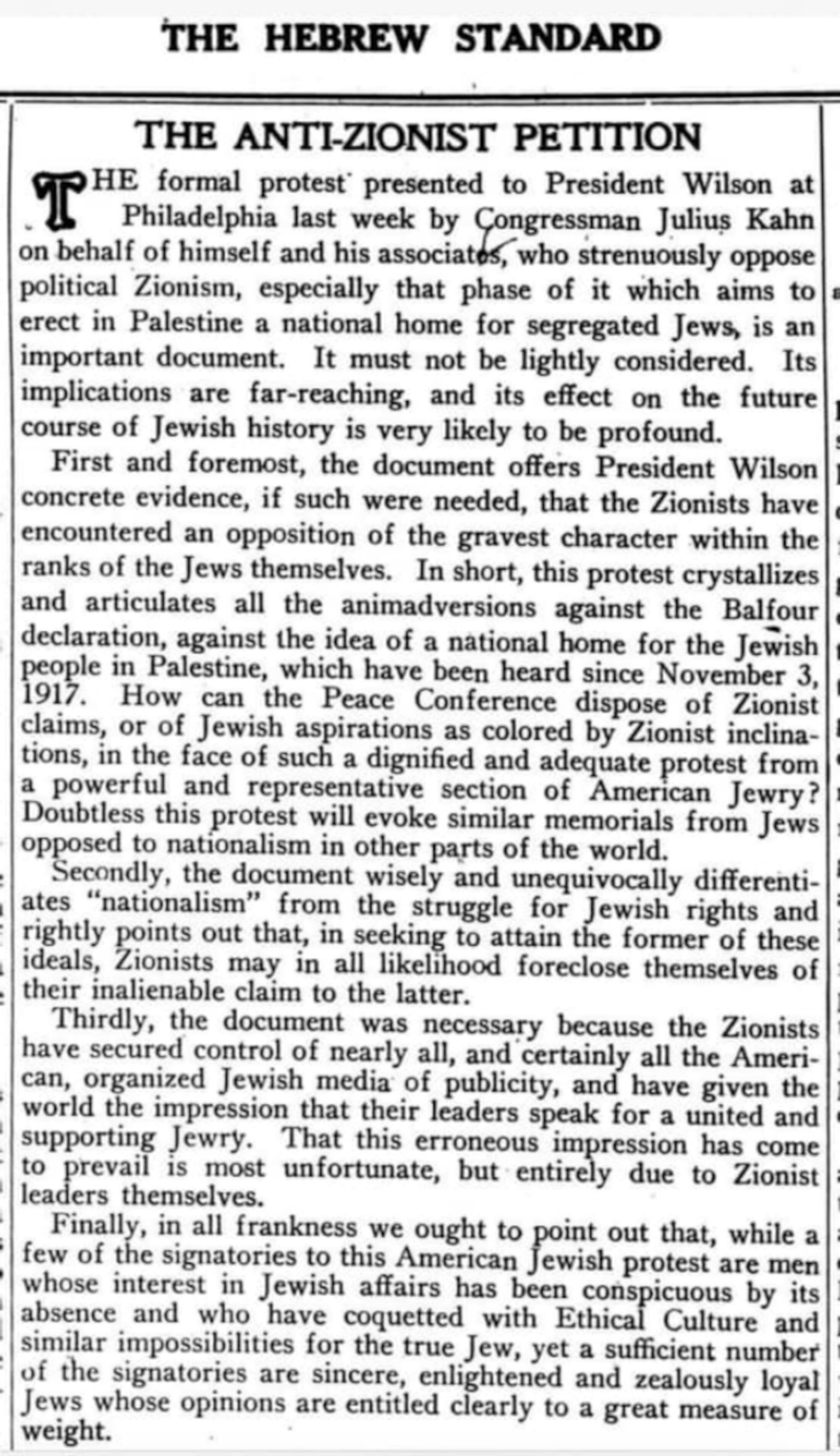
Le document était nécessaire parce que les sionistes ont pris le contrôle de presque tous les médias juifs organisés, et certainement de tous les médias américains, et ont donné au monde l'impression que leurs dirigeants parlent au nom d'une communauté juive unie et solidaire. Le fait que cette impression erronée ait fini par prévaloir est tout à fait regrettable, mais il est entièrement dû aux dirigeants sionistes eux-mêmes.
Cette affirmation serait impossible à faire entendre aujourd’hui, de peur d’être accusé d’antisémitisme. Et pourtant, n'est-elle pas encore d'une criante actualité ?
Achevons cette introduction par la conclusion du texte du rabbin Henry Berkowitz – puisque c’est sans doute lui qui en est en grande partie l’auteur – que je considère comme l’une des plus parfaites évocations de ce qu’aurait pu être la belle terre de Palestine, aujourd’hui souillée de tant de haine, de morts, d’hypocrisie et de désespoir :
S’agissant de l’avenir de la Palestine, nous avons le fervent espoir que ce qui était autrefois une « terre promise » pour les Juifs puisse devenir une « terre de promesse » pour toutes les races et tous les croyants, sous la sauvegarde de la Société des Nations qui, comme on l’espère, sera l’un des fruits de la Conférence de la paix dont le monde attend les délibérations si anxieusement et si plein d’espoir. Nous demandons que la Palestine soit constituée en un Etat libre et indépendant, gouverné sous une forme démocratique, sans distinction de croyance, de race ou d’origine ethnique, et avec un régime à même de protéger le pays contre toute oppression. Nous ne souhaitons pas voir la Palestine, ni maintenant ni à quelque moment que ce soit dans le futur, constitué en État juif.
C’est dit !
Pour aller plus loin :
Alem Jean Pierre, 1991, La Déclaration Balfour : aux sources de l’État d’Israël, Bruxelles, Ed. Complexe (coll. « La mémoire du siècle 1917 »), 151 p.
Boxerman Alan, 1976, « Kahn of California », California Historical Quarterly, 1976, vol. 55, no 4, p. 340‑351.
Gutwein Danny, 2016, « The politics of the Balfour Declaration: Nationalism, imperialism and the limits of Zionist-British cooperation », Journal of Israeli History, 2 juillet 2016, vol. 35, no 2, p. 117‑152.
Orès Béatrice, Sibony Michèle et Fayman Sonia, 2023, Antisionisme, une histoire juive, Paris, Éditions Syllepse, 368 p.
Perrin Dominique, 2000, Palestine : Une terre, deux peuples, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion (coll. « Histoire et civilisations »), 352 p.
Rabkin Yakov, 2017, La Déclaration Balfour : contexte et conséquences - Histoire Engagée, https://histoireengagee.ca/la-declaration-balfour-contexte-et-consequences/ , 2 novembre 2017, consulté le 31 mai 2024.
Schneiderman Harry, 1925, « Julius Kahn », The American Jewish Year Book, 1925, vol. 27, p. 238‑245.
***
Texte original tel que publié dans le New York TimesProtestation adressée à Woodrow Wilson
contre un État sioniste[1]
Protest to Wilson against Zionist State
–
JULIUS KAHN ET COL.
Texte publié dans le New York Times le 5 mars 1919.
Julius Kahn (Grand-duché de Bade, 1861 - États-Unis, 1924). Homme politique et membre républicain de la Chambre des représentants des États-Unis. Julius Kahn a émigré aux Etats-Unis avec ses parents en 1866. Le 4 mars 1919, il adresse avec le rabbin Henry Berkowitz de Philadelphie, Max Senior de Cincinnati et le professeur Morris Jastrow de l’université de Pennsylvanie une pétition au Président Wilson pour qu’il en donne connaissance à la Conférence de la paix de Paris. Cette pétition, signée par 31 membres éminents autant qu’antisionistes de la communauté juive (diplomates, rabbins, hommes d’affaires, juges, avocats, maires, professeurs d’université, journalistes), constitue la première opposition conséquente du judaïsme américain à la déclaration Balfour.
Alors que sera sans aucun doute examinée par la prochaine Conférence de la paix la forme que prendra un futur gouvernement de la Palestine, nous, citoyens des États-Unis soussignés, adoptons à l’unanimité cette déclaration qui recense nos objections à l’organisation d’un État juif en Palestine tel qu’il est proposé par les sociétés sionistes de ce pays comme d’Europe, de même qu’à la ségrégation des Juifs considérés comme entité nationale dans quelque pays que ce soit. Ce faisant, nous estimons exprimer l’opinion de la majorité des Juifs américains natifs comme de ceux qui, nés à l’étranger, ont vécu ici assez longtemps pour avoir pleinement assimilé l’ordre politique et social américain. Selon les plus récentes statistiques disponibles, les sionistes américains ne représentent qu’une petite partie des Juifs vivant dans ce pays : environ 150 000 sur 3 500 000 (Annuaire des Juifs américains, 1918, Philadelphie).
En préambule, nous souhaitons exprimer notre entière sympathie pour les efforts des sionistes qui se donnent pour but d’assurer aux Juifs vivant actuellement dans des pays d’oppression un refuge, en Palestine ou ailleurs, où ils puissent librement développer leurs capacités et se livrer à leurs activités en citoyens libres.
Rejet de l’idée d’un « foyer national »
Mais nous voulons faire entendre notre mise en garde et notre protestation contre la demande des sionistes de reconfigurer les Juifs en une entité nationale, à laquelle, maintenant ou à l’avenir, serait accordée une souveraineté territoriale en Palestine. Cette revendication non seulement va à rebours du mouvement historique des Juifs, qui ont cessé d’être une nation il y a deux mille ans, mais elle mène aussi à une limitation, voire à la possible fin de ce mouvement revendicatif plus large des Juifs pour une citoyenneté et des droits humains pleins et entiers dans tous les pays où ils ne leur sont pas encore garantis.
Parce que l’ère nouvelle dans laquelle entre le monde tend à ce que partout le gouvernement soit établi sur les principes de la démocratie authentique, nous rejetons le projet sioniste d’un « foyer national pour le peuple juif en Palestine ».
Le sionisme est apparu dans les conditions intolérables où les Juifs avaient été contraints de vivre en Russie et en Roumanie. Il est pourtant évident que pour la population juive de ces Pays, estimée entre 6 et 10 millions de personnes, la Palestine ne peut pas devenir une patrie. Même après avoir remédié à la condition d’abandon de ce pays, sa surface restreinte ne peut pas offrir une solution. La question juive en Russie et en Roumanie ne peut être réglée que dans ces pays eux-mêmes par la reconnaissance accordée aux Juifs d’une citoyenneté de plein droit.
Nous nous opposons d’autant plus aux sionistes qu’ils rejettent eux-mêmes explicitement tout projet qui se borne à améliorer les choses. Ils revendiquent et saluent avec joie la déclaration Balfour visant à établir « un foyer national pour le peuple juif en Palestine », c’est-à-dire un foyer non seulement pour les Juifs vivant dans des pays où ils subissent une oppression, mais pour les Juifs du monde entier. Aucun Juif, où qu’il vive, ne peut se considérer comme dégagé des implications d’un tel accord.
La volonté de Juifs sensibles au bien-être de leurs frères d’aider au renouveau d’une Palestine ruinée par des siècles de mauvais gouvernement turc, ne signifie pas l’acceptation du projet sioniste visant à réunir les Juifs en une entité politique séparée et à l’installer en Palestine ou ailleurs.
Dans la conjoncture actuelle des problèmes du monde, alors que des pays soumis jusque-là à une domination étrangère vont être reconnus en tant qu’États libres et indépendants, nous nous réjouissons de la déclaration publique de la Conférence de la paix appelant à mettre en œuvre les principes fondamentaux de la démocratie. Le principe démocratique accordant des droits égaux à tous les citoyens d’un État, quelles que soient leurs croyances ou leur origine ethnique, devrait être appliqué de façon à exclure toute ségrégation, nationaliste ou autre. Une telle ségrégation créera inévitablement des différences entre les diverses parties de la population. Un tel projet de ségrégation est d’orientation nécessairement réactionnaire, d’esprit antidémocratique, et totalement contraire aux pratiques de libre gouvernement, particulièrement à celles dont notre propre pays donne l’exemple. C’est pourquoi nous insistons fortement pour l’abandon d’une telle base de réorganisation pour quelque État que ce soit.
Contre la « ségrégation politique »
À une telle ségrégation des Juifs, en Palestine ou ailleurs, nous objectons :
1. Que les Juifs se dévouent corps et âme pour le bien-être de leurs pays de résidence quand ils y vivent dans des conditions de liberté. Tous les Juifs récusent le plus petit soupçon de double allégeance, mais nous pensons que celle-ci est nécessairement impliquée et ne peut être logiquement écartée de la création d’un État souverain pour les Juifs en Palestine.
Du fait de la large part qu’ils ont prise dans la Grande Guerre, les Juifs ont, une fois pour toutes, mis en pièces la calomnie des antisémites les désignant comme étrangers en tout pays, incapables d’un véritable patriotisme et uniquement animés de sombres motifs égoïstes. De plus, on peut affirmer en toute certitude que l’immense majorité des Juifs d’Amérique, d’Angleterre, de France, de Hollande, de Suisse, et d’autres terres de liberté n’envisagent aucunement de renoncer à leur citoyenneté dans leurs pays au bénéfice d’un « foyer juif en Palestine ». En règle générale, les partisans d’une telle restauration la soutiennent non pour eux-mêmes mais pour d’autres. Ceux qui le font tout en insistant sur leur attachement patriotique envers le pays dont ils sont citoyens s’abusent eux-mêmes sur leur sionisme, sous l’emprise d’un romantisme émotionnel ou d’un sentiment religieux favorisés par des siècles de ténèbres.
2. Que même vis-à-vis de ceux dont la profession de foi sioniste est sérieuse et ne vise pas seulement « les autres » mais eux-mêmes, la séparation politique des Juifs doit être contestée. Admettons que la création d’un État juif souverain en Palestine conduise nombre de Juifs à y émigrer ; les conditions politiques des millions se trouvant dans l’incapacité de le faire, et des générations futures, seront de loin encore plus précaires, si tant est que ce soit possible. La Roumanie, malgré les engagements du traité de Berlin, désigne juridiquement ses Juifs comme étrangers, bien que beaucoup d’entre eux soient issus de familles installées dans ce pays bien avant que la forme actuelle de gouvernement roumain n’existe. La création d’un État juif servira de toute évidence de justification supplémentaire aux dirigeants les plus brutaux de ce pays et d’autres pour l’adoption de législations répressives nouvelles. Les masses qui seront restées seront exposées à des dangers pires, s’il en existe, même si les quelques-uns qui auront pu s’échapper prospèrent en Palestine.
3. Que la séparation politique de ceux qui parviendraient à s’installer en Palestine n’est pas une chose souhaitable. Ce projet comporte des dangers qui, manifestement, n’ont pas été suffisamment pris en considération par ceux qui en sont les avocats si zélés. A ces dangers 1a mise en garde bienveillante de Sir George Adam Smith, assurément la plus éminente autorité au monde pour tout ce qui a rapport à la Palestine, passée ou présente, a donné un certain écho. Dans une publication récente, Syria and the Holy Land [George H. Doran Company, 1918], il fait ressortir que les frontières de la Palestine n’ont connu absolument aucune fixité. Elles ont varié considérablement au cours des siècles. Les revendications sur plusieurs parties de ce territoire mal défini soulèvent incontestablement de vives controverses. « Il n’est pas vrai, selon Sir George, que la Palestine soit le foyer national du peuple Juif ni d’un quelconque autre peuple. Il est incorrect d’appeler “Arabes” ses habitants non-Juifs, ou de dire qu’ils n’ont laissé aucune production de leur esprit et n’ont pas fait l’histoire, excepté par la Grande Mosquée. » On ne peut pas non plus éluder le fait que des communautés chrétiennes ont vécu là aussi longtemps que les Juifs. « Ce sont là des questions légitimes, écrit-il, que soulèvent les revendications des sionistes, mais les sionistes ne les ont pas encore affrontées pleinement. »
Soumettre les Juifs à la possible résurgence de ces conflits âpres et sanguinaires, qui surgiront inévitablement, serait un crime au regard des hauts faits de toute leur histoire passée et des nobles conceptions universelles de leurs grands prophètes et guides.
4. Que, malgré ces graves difficultés, l’auto-ségrégation politique des Juifs et la refondation en Palestine d’un État juif séparé sont absolument contraires aux principes de démocratie que la Conférence mondiale de la paix s’est donnée comme objectif d’établir.
Contraire aux idéaux démocratiques
Que les Juifs soient considérés comme une « race » ou une « religion », il est contraire aux principes démocratiques au nom desquels la guerre mondiale a été menée, de fonder une nation sur l’une de ces bases ou sur les deux. L’Amérique, l’Angleterre, la France, l’Italie, la Suisse, et toutes les nations du monde les plus avancées sont composées de représentants de plusieurs races et religions. Leur gloire réside dans la liberté de conscience et de culte, dans la liberté de pensée et de traditions qui lient les fidèles de fois diverses et de civilisations variées dans le nœud commun de l’union politique. Un État juif implique des délimitations fondamentales concernant la race et la religion, sans quoi le terme « Juif » ne signifie rien. Unir l’Église et l’État en quelque façon, comme sous l’antique hiérarchie hébraïque, constituerait un saut en arrière de 2000 ans.
« Les droits des autres croyances et races seront respectés sous le pouvoir juif », assurent les sionistes ; les critères de la démocratie ne sont cependant ni la condescendance ni la tolérance mais la justice et l’égalité. Tout ceci prend une force particulière dans un pays comme la Palestine. Ce pays est rempli de confréries sacrées aux yeux des fidèles de trois grandes religions et, résultat de mouvements migratoires de plusieurs siècles, il compte un nombre extraordinaire de groupes ethniques différents, sans proportion avec l’étendue restreinte du pays. Une telle situation impose clairement de penser la réorganisation de la Palestine sur la base la plus large possible.
L’auto-ségrégation politique des Juifs est dénuée de sens car il est faux d’affirmer que le lien qui les unit est de nature nationale. Ils sont liés par deux choses : tout d’abord un faisceau de croyances et d’espérances religieuses communes, et ensuite, un ensemble de traditions, de coutumes et d’expériences largement liées, malheureusement, à beaucoup d’épreuves et de souffrances. Rien, dans leur situation présente, ne suggère qu’ils forment réellement, en aucune façon, une entité nationale à part.
La réorganisation de la Palestine, pour autant qu’elle concerne les Juifs, s’inscrit d’abord dans une question beaucoup plus vaste, à savoir l’effort rationnel d’assurer l’émancipation des Juifs dans tous les pays où ils résident. Ce mouvement amorcé au 18e siècle, en progression constante dans les pays occidentaux, a été entravé par les mêmes courants réactionnaires en cause dans l’expulsion des Polonais de Prusse orientale et dans le massacre des Arméniens en Turquie. Tournés contre les Juifs, ces courants ont cristallisé en un mouvement politique nommé antisémitisme, dont le berceau a été l’Allemagne. Il s’est répandu avec virulence, particulièrement en Europe de l’Est, et a conduit à des déchaînements féroces en Roumanie et ailleurs, et aux pogromes de Russie avec leurs atroces conséquences.
Pour prévenir de tels maux à l’avenir, nous insistons pour que le grand mouvement positif, si tristement interrompu, reprenne son cours et que des mesures efficaces soient prises pour garantir la protection de la loi et le plein exercice de leurs droits civiques aux Juifs de tous les pays. La base de la réorganisation des gouvernements doit dorénavant être démocratique, et ne peut pas apparaître comme excluant une quelconque partie du peuple de la jouissance de la totalité de ses droits.
S’agissant de l’avenir de la Palestine, nous avons le fervent espoir que ce qui était autrefois une « terre promise » pour les Juifs puisse devenir une « terre de promesse » pour toutes les races et tous les croyants, sous la sauvegarde de la Société des Nations qui, comme on l’espère, sera l’un des fruits de la Conférence de la paix dont le monde attend les délibérations si anxieusement et si plein d’espoir. Nous demandons que la Palestine soit constituée en un Etat libre et indépendant, gouverné sous une forme démocratique, sans distinction de croyance, de race ou d’origine ethnique, et avec un régime à même de protéger le pays contre toute oppression. Nous ne souhaitons pas voir la Palestine, ni maintenant ni à quelque moment que ce soit dans le futur, constitué en État juif.
[1] Le texte original a été publié en page 7 du New York Times, le 5 mars 1919 ; il est ici traduit par Michel Bilis (traducteur de Shlomo Sand) pour l’Union Juive Française pour la Paix. Cette « protestation » de Julius Kahn a été publiée en français dans Béatrice Orès, Michèle Sibony et Sonia Fayman, Antisionisme, une histoire juive, Paris, Éditions Syllepse, 2023, p. 113‑118. Nous avons rajouté et modifié des intertitres pour les conformer au texte original. Nous remercions Béatrice Orès pour l’autorisation verbale qu’elle nous a faite de reproduire ce texte.
Le texte en anglais transcris est en accès libre sur http://tipiglen.co.uk/1919.html



