Bonjour, nous sommes pas mal à ne vouloir ni de la démagogie du "Grand Débat" ni de la médiocratie du "Vrai Débat".
À quelles conditions accepteriez-vous de créer dans les meilleurs délais les modalités d'une plateforme du même type que les deux précédentes – que nous récusons cependant dans l'état actuel de leur structure et de leur organisation – et qui permette cependant gratuitement aux participant.e.s de :
– 1. faire des propositions SÉRIEUSES de lois et d'abrogation de lois, “propositions sérieuses” ? c'est-à-dire à la fois fondées sur l'observation constatée et vérifiable, documentée, solide, et à la fois argumentées de manière chiffrée et juridique, avec notes à l'appui, comme le font certaines pétitions sur la base d'informations dont l'authenticité ne peut être remise en cause ;
– 2. poser les cadres pour une parole "vraie" que l'on caractérisera avec au moins l'un de ces trois critères impératifs :
- a) où l'on se s'arrêtera pas aux définitions expéditives, facteurs de clichés et d'étiquettes réductrices, voire infamantes ou stigmatisantes ;
- b) où l'intervenant.e s'exprimera avec toute l'autorité d'un savoir réel sur son sujet, ne se contentera pas d'a priori et se refusera à véhiculer quelque rumeur qui soit ;
- c) où l'on privilégiera les fonctionnements et les explications, les descriptions, les "attendus que –" et les "vu que –", de sorte que les causes et les conséquences apparaîtront à la lecture des propositions de décisions législatives qui seront portées à la connaissance des lecteurs et des lectrices.
– 3. empêcher ou signaler toute expression de type xénophobe, identitaire, souverainiste, nationaliste, raciste ou sexiste, surtout compte tenu du fait que leurs présupposés sont, sinon anti-constitutionnels, au moins porteurs de désinformations et de volontés discriminatoires.
Merci de nous faire savoir si ces exigences de décision pourraient correspondre au site actuel encore en cours sous le nom LE VRAI DÉBAT, ou s'il nécessiterait la création d'un 3e site de recueil de paroles citoyennes, plus avisées que les milliers de péroraisons qui se lisent de manière navrante au long du site mentionné.
Bonne soirée à vous.
Jean-Jacques M’U
Nota :
arguments tirés des réflexions de Christian Salmon, sa 5e et dernière page de l'article Médiapart du 5 février 2019 : Macron face à l'Insurrection par les signes
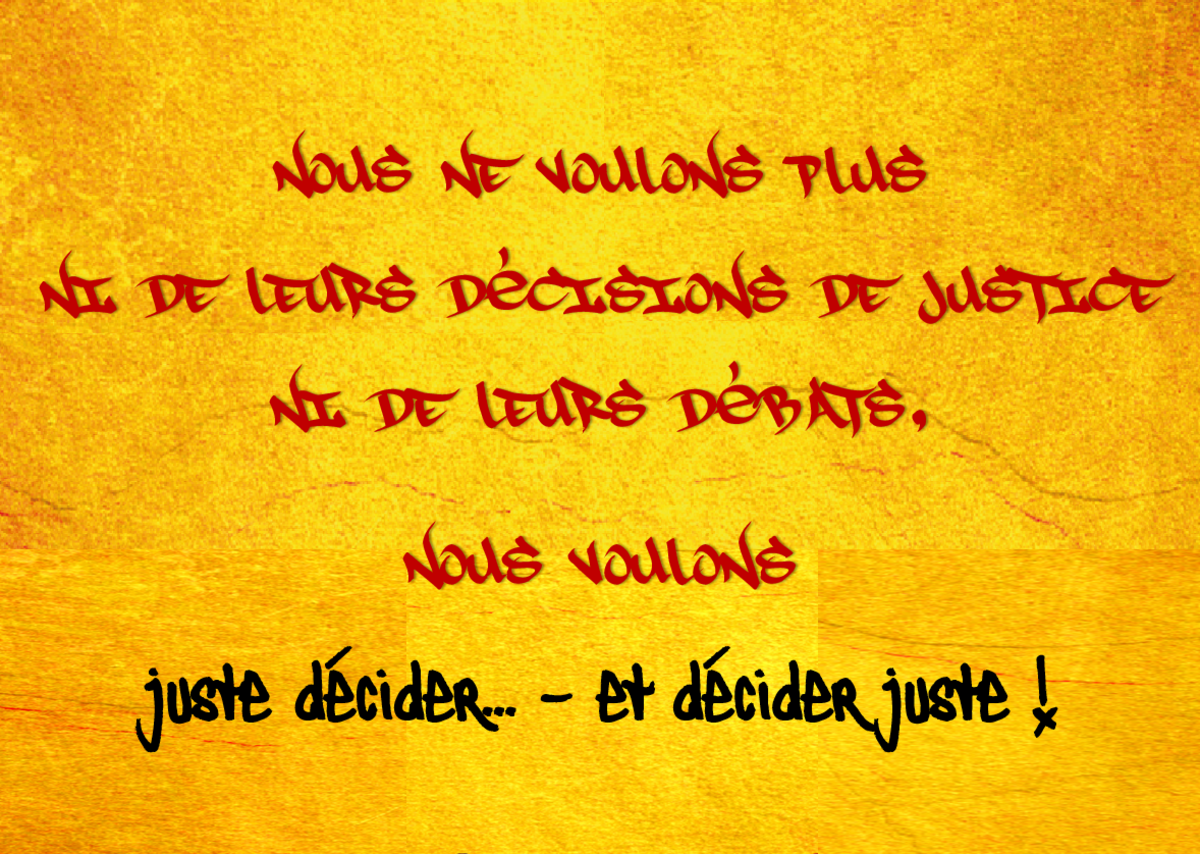
Agrandissement : Illustration 1
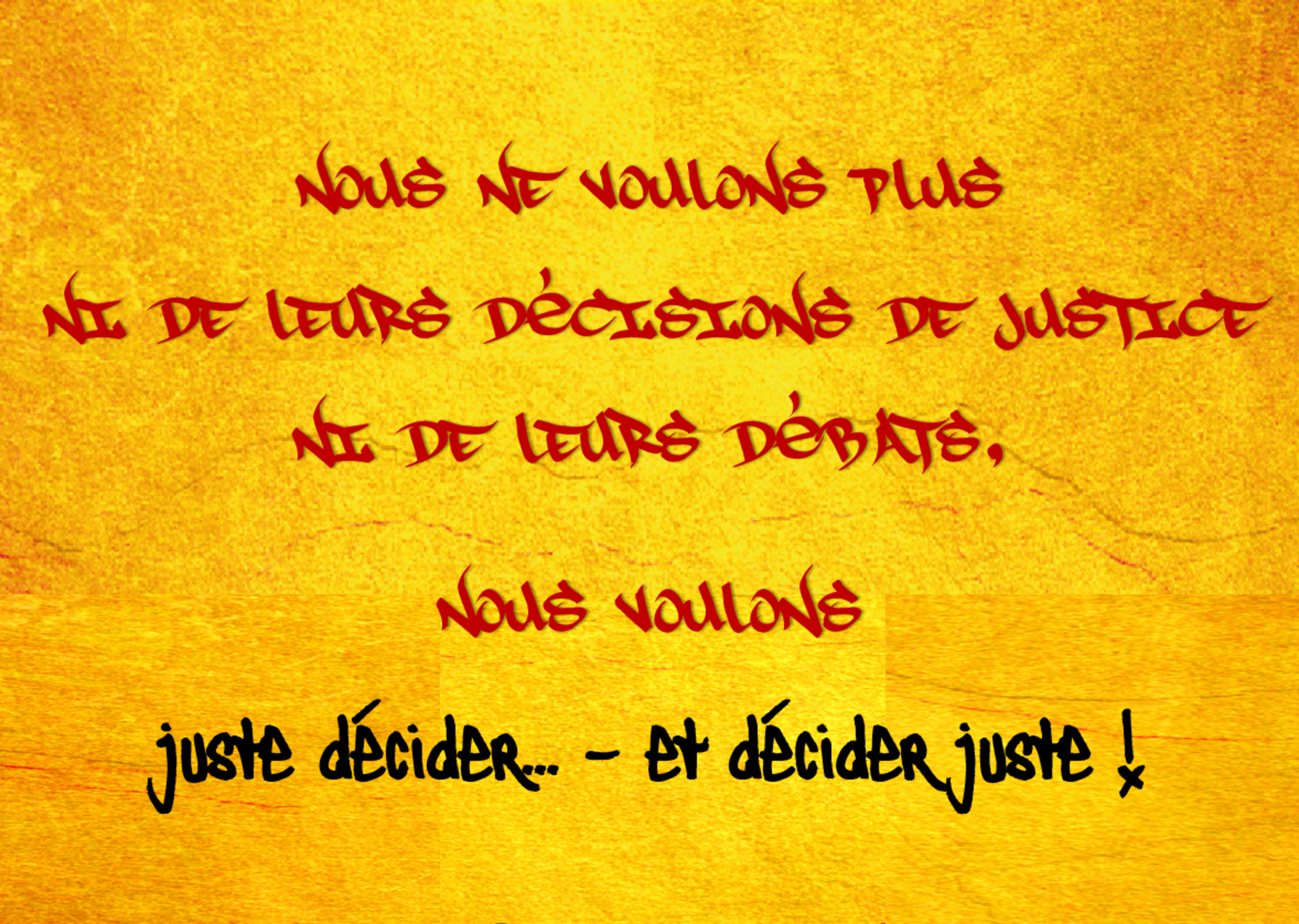
Comment parler avec sa propre voix ?
Platon affirmait que les régimes politiques ont une voix propre (phônè). « Tout État qui parle son propre langage vis-à-vis des dieux et des hommes et agit conformément à ce langage, prospère toujours et se conserve, mais en imite-t-il un autre, il périt. » Il ne s’agit pas seulement de cohérence politique ou de fidélité à la parole donnée ; un régime doit « parler juste », avec sa propre voix, et non pas avec une voix fausse ou déguisée. Mais comment parler avec sa propre voix ? Est-ce seulement une question de sincérité ?
Le « parler-vrai » en démocratie pose de redoutables problèmes et exige que soient réunies plusieurs conditions que Michel Foucault a problématisées dans son séminaire sur la parrêsia (le « franc-parler », le « parler-vrai »).
Des conditions juridiques, formelles – le droit pour tous les citoyens de parler, d’opiner –, mais aussi des compétences particulières de la part de ceux qui s’expriment et prennent l’ascendant sur les autres. Il faut aussi que le discours soit un « discours de vérité » ou à tout le moins inspiré par la quête de la vérité et non simplement par le désir de plaire ou de flatter l’auditoire. Enfin, un discours de vérité n’est possible dans une démocratie que sous la forme de la joute, de la rivalité, de l’affrontement, ce qui exige, dernière condition, du courage de la part des individus qui prennent la parole.
« – 1. Condition formelle : la démocratie. – 2. Condition de fait : l’ascendant et la supériorité de certains. – 3. Condition de vérité : c’est la nécessité d’un logos raisonnable. Et enfin – 4. condition morale : c’est le courage, le courage dans la lutte. C’est ce rectangle, résume Michel Foucault, qui constitue la parrêsia. »
Le rectangle de Foucault n’est évidemment qu’une figure qui permet de synchroniser idéalement les conditions d’un discours vrai, ce qu’il appelle la « bonne parrêsia ». Mais il y a aussi une « mauvaise parrêsia », que Foucault étudie au tournant du Ve et du IVe siècle à Athènes, lorsque les quatre côtés du rectangle ne s’ajustent plus. Que se passe-t-il ? La parrêsia est pervertie. N’importe qui peut parler. Les critères de cette parole ne sont plus la véracité, l’intention de dire vrai, mais le besoin d’exprimer l’opinion la plus courante, qui est celle de la majorité. La phôné dont parlait Platon n’est plus audible. Les dirigeants se mettent à parler une autre langue. « Le dire-vrai s’efface dans le jeu même de la démocratie. »
On peut citer trois exemples de cette mauvaise parrêsia dans l’histoire politique récente : le langage bureaucratique des staliniens ; la logorrhée et les vociférations fascistes de Hitler et de Mussolini ; la cacophonie et le tohu-bohu des démocraties médiatiques…
Mais si l’on voulait appliquer le rectangle de Foucault aux démocraties occidentales, il conviendrait de lui adjoindre un ou deux côtés supplémentaires, quitte à transformer le rectangle de la parrêsia en un pentagone, voire un hexagone. Aux quatre conditions énumérées on devrait ajouter une cinquième, celle qui articule la question de la phônè d’un régime à la scène du pouvoir, c’est-à-dire la question de l’acoustique d’un régime.
Depuis l’agora des Grecs jusqu’aux réseaux sociaux d’aujourd’hui, en passant par les chambres parlementaires et leur règlement, la démocratie dépend, pour se faire entendre, du dispositif concret d’énonciation, de transmission, de réception de la parole. Dans quel ordre les orateurs vont-ils s’exprimer ? Comment leur parole est-elle retransmise : grâce à l’acoustique du lieu ou par des moyens de retransmission comme la radio, la télévision ou Internet ? Quelle est la forme du droit de réponse utilisée par les citoyens ? S’effectue-t-il en direct, sous la forme de questions écrites, par l’intermédiaire des journalistes, ou par la voie d’une interpellation directe à la tribune, ou, comme c’est le cas aujourd’hui, au cours des débats à la télévision, par Twitter interposé ?
Enfin, une sixième condition devrait être prise en compte, c’est la question du timing, de l’« agenda ». Quels sont les sujets abordés ? Qui fixe l’ordre du jour ? Qui décide de la line of the day ou de la story of the day ? Le service d’information de la présidence, comme c’était le cas sous Reagan, ou sous Sarkozy ? Ou bien les médias qui créent le buzz et réussissent à imposer leurs propres priorités ? Qui du gouvernement et des médias conditionne l’agenda de l’autre ? Quel est le rôle que joue la nouvelle « agora » des internautes, qui peut imposer un autre agenda politique et parfois même renverser le régime et sa mauvaise parrêsia en s’assemblant sur les places publiques et en exprimant sa colère ?
Christian Salmon : Macron face à l'insurrection par les signes, 5e et dernière page de l'article Médiapart du 5 février 2019



