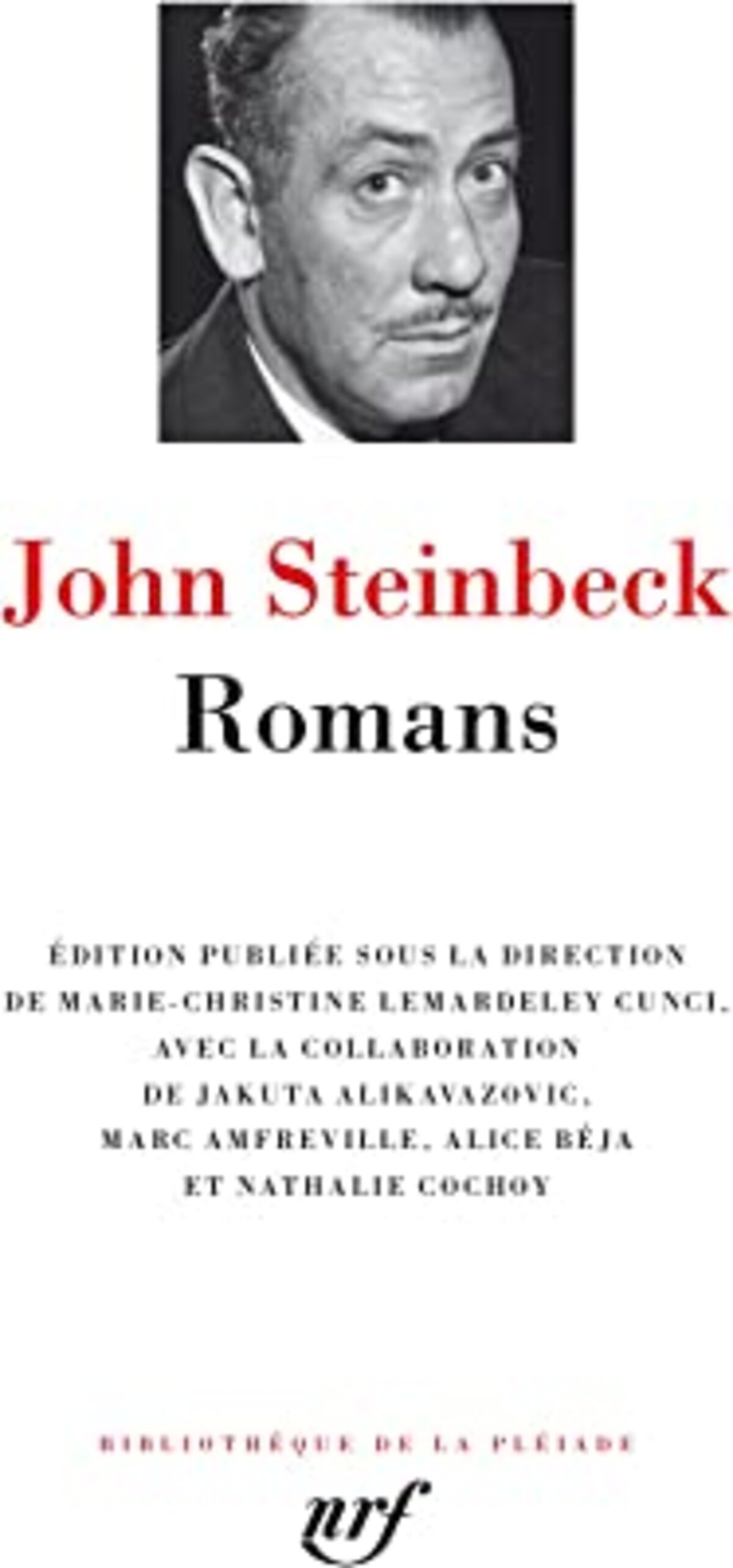
Conversations entre Georges Brassens et l’écrivain René Fallet dans l’émission Les Livres de ma vie de Michel Polac.
G.B -Y’a Steinbeck qu’on a beaucoup aimé. Évidemment on l’aime moins maintenant pour des raisons…
R.F – extra-littéraires…
G.B – Mais enfin, rappelle-toi Tortilla Flat. […] Tu te rappelles, on a parlé souvent de Steinbeck. Maintenant, Steinbeck a fait quelque chose qui ne nous plaît pas tellement, mais on ne doit pas le rejeter pour ça. […]
R.F – Tout ce qu’il pourra faire n’effacera jamais Tortilla Flat […]
G.B – C’est difficile de vivre […] Un homme est quand même un homme, très fragile […] Il écrit ce qu’il pense, ce qu’il sent et il change, il évolue. Il est évident qu’après ses admirateurs peuvent être déçus car ils ne savent pas nuancer. Il faut prendre un homme tel qu’il est.
Lire chronologiquement l’œuvre de Steinbeck c’est se confronter à la diversité des genres : roman d’aventures, roman social, reportage, mélodrame, roman naturaliste, journal de voyage, et même, aux origines du roman : un roman de chevalerie … Le lecteur que j’étais et qui se croyait plongé dans les affres étroites d’une littérature monomaniaque, découvrait une large palette.
En fait, monomaniaque, c’est moi qui l’étais devenu, en lecteur forcené du même auteur. La seule étroitesse discernable chez Steinbeck, vient de son amour quasi exclusif pour sa région natale. C’est en effet en Californie que se passent la plupart de ses histoires. Une étroitesse d’esprit de plus de 400 000 km2, excusez du peu. La California comme terra cognita. À force, cognita, elle la devient aussi pour le lecteur. Cette constante du paysage rend l’auteur attachant. L’impression de partager quelque chose, l’impression de revenir chez quelqu’un. Loin d’une flemme, loin du terroir-caisse en vigueur aujourd’hui, cette singularité tient de l’amour sincère. Les lecteurs français peuvent bien comprendre Steinbeck, eux qui aiment la Provence de Giono.
Après les secousses financières de 2008, la lecture de Steinbeck paraissait judicieuse, plus que jamais d’actualité.
Un fermier s’oppose au conducteur d’un tracteur chargé de détruire sa maison. Quand le fermier apprend que ce conducteur obéit à un banquier de l’Oklahoma qui lui-même obéit à un banquier de New York, il se retrouve tout bête avec son fusil et demande : Mais qui est-ce que je dois tuer ?
Les Raisins de la Colère comme étendard d’une littérature engagée du côté des exploités par un système financier. En un combat douteux comme une réflexion autour de ce qui transforme des protestations collectives en un mouvement de grève. Mais, à nouveau, Steinbeck s’échappait, se révélait romancier d’aventure quasi-stevensonnienne (La Coupe d’or), poète panthéiste (Un dieu inconnu), inventeur de pochades foutraques et libertaires (Tortilla Flat et Rue de la Sardine).
Une lecture exhaustive transforme, il me semble, n’importe quel lecteur amateur en défenseur acharné de l’auteur. L’injustice qui touchait Steinbeck était grande !
Des années que j’attendais son édition en Pléiade.
On ne trouve pas l’éventail attendu de biographies ou d’essais dignes de son statut : rien d’écrit, rien de traduit. Seules les Classes Prépa, les concours de l’enseignement l’intégraient parfois dans leur programme et vivifiaient la bibliographie de l’auteur…
Un seul livre était disponible : John Steinbeck, 2000, Lemardely-Cunci, dans l’excellente collection Voix américaines, chez Belin. C’est justement cette professeur d’université qui est la directrice d’édition des romans de Steinbeck dans la Pléiade. Il y aura dans ce volume : En un combat douteux, Des souris et des hommes, Les raisins de la colère et A l’est d’Eden.
En France, Steinbeck ressemblait à un pur esprit, au fantôme de l’écrivain social. Un «literary ghost» disait-on aux Etats-Unis (Newsweek, 5 novembre 1962, en raison de sa prétendue stérilité littéraire après 1945). Il plane. Il est là. Il est – comme d’autres, c’est vrai – plus connu par ses titres que par ses œuvres. C’est un génie tutélaire qui préside à la conception de slogans ou de titres de presse. Par exemple ses Raisins de la Colère, maintes fois recyclés. Idem pour En un combat douteux. Titre que l’on retrouve parfois dans des chroniques syndicales, ce qui fait sourire quand on connaît le portrait du syndicaliste cynique dans le roman. Cela dit les titres de Steinbeck sont eux-mêmes des citations : Des Souris et des Hommes (tiré d’un vers d’un poète écossais du XVIII, Robert Burns) En Un combat douteux (extrait du Paradis Perdu de Milton) ou les fameux Raisins de la Colère bibliques. Un titre qu’une traduction de Karin de Hatker en Belgique transforma en Grappes d’amertume…
Brassens, dans les propos cités plus haut, déclarait qu’un homme change et qu’il faut le prendre comme il est. L’évolution politique de Steinbeck est un sujet incontournable. Lui, qui se faisait la voix des sans-voix, du peuple opprimé, mêla sa voix d’intellectuel à celles des bellicistes. La guerre qu’il défendait (peut-être par anticommunisme) était celle du Vietnam. À l’époque, Lyndon Johnson était le président des États-Unis et il s’agissait d’une sale guerre.
Un choix dur à avaler pour ses admirateurs. Ce fut inacceptable pour la gauche, française en tout cas. D’autant plus qu’il fut même si proche de ce président américain qu’il exerça à ses côtés, dit-on, le rôle de conseiller.
Les années 60 eurent alors quelque chose de fatal pour la postérité de gauche de Steinbeck. Disons qu’il s’avéra corruptible.
Un élément rendait sa situation complexe : son propre fils se battait au Vietnam (On pense au livre de David Grossman, Une femme fuyant l’annonce, livre traitant de la guerre et qui fut écrit alors même que son propre fils allait mourir dans les derniers jours de la guerre du Liban).
Dr Wrath & Mister Vietnam ? N’oublions pas son Voyage avec Charley, road-book anti-raciste, témoignant de son opposition au Maccarthysme et de sa participation au mouvement des droits civiques.
Très intime de l’auteur, un ami fut l’auteur d’une biographie de Steinbeck. Intitulée Le chevalier errant, 1969. Il la publia sept ans après sa mort puisque Steinbeck lui avait refusé le droit d’en faire une de son vivant. Cet ami se nommait Nelson Valjean… Ça ne s’invente pas. De quoi donner aux Raisins de la Colère un petit air de Misérables.



