Dans la culture populaire caribéenne, les Zombies sont des revenants créés par les sorciers. Agressifs et dépourvus d’intelligence, ils se déplacent souvent en meute incontrôlable. Morts-vivants, ces Zombies ne peuvent être éliminés. Les joueurs de jeu vidéo le savent : quelle que soit l'arme que vous emploierez, un fusil d'assaut ou une poêle à frire, vous ne pourrez pas les stopper, seulement les ralentir.
Qu’est-ce qu’une idée zombie en économie ?
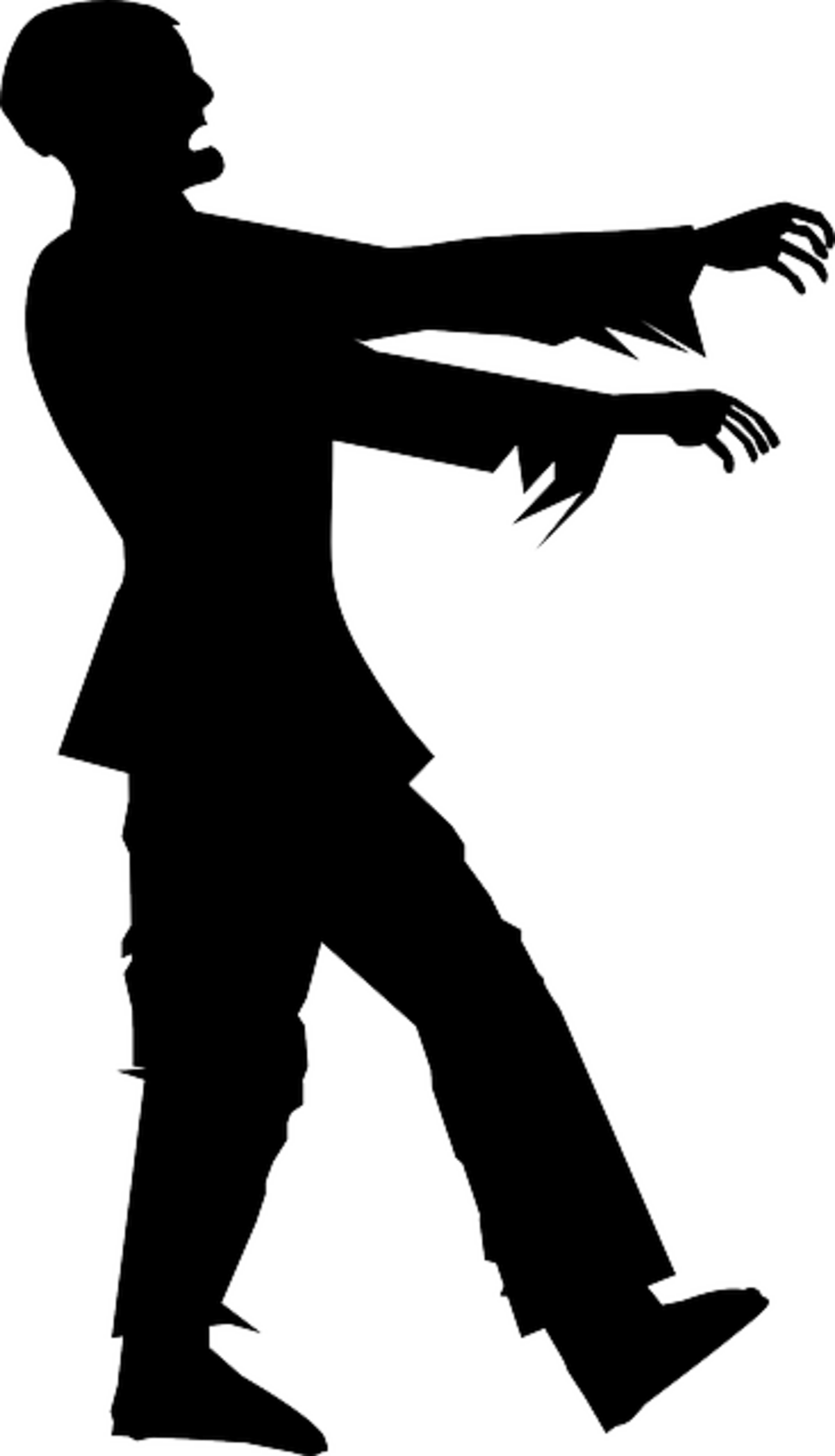
Agrandissement : Illustration 1
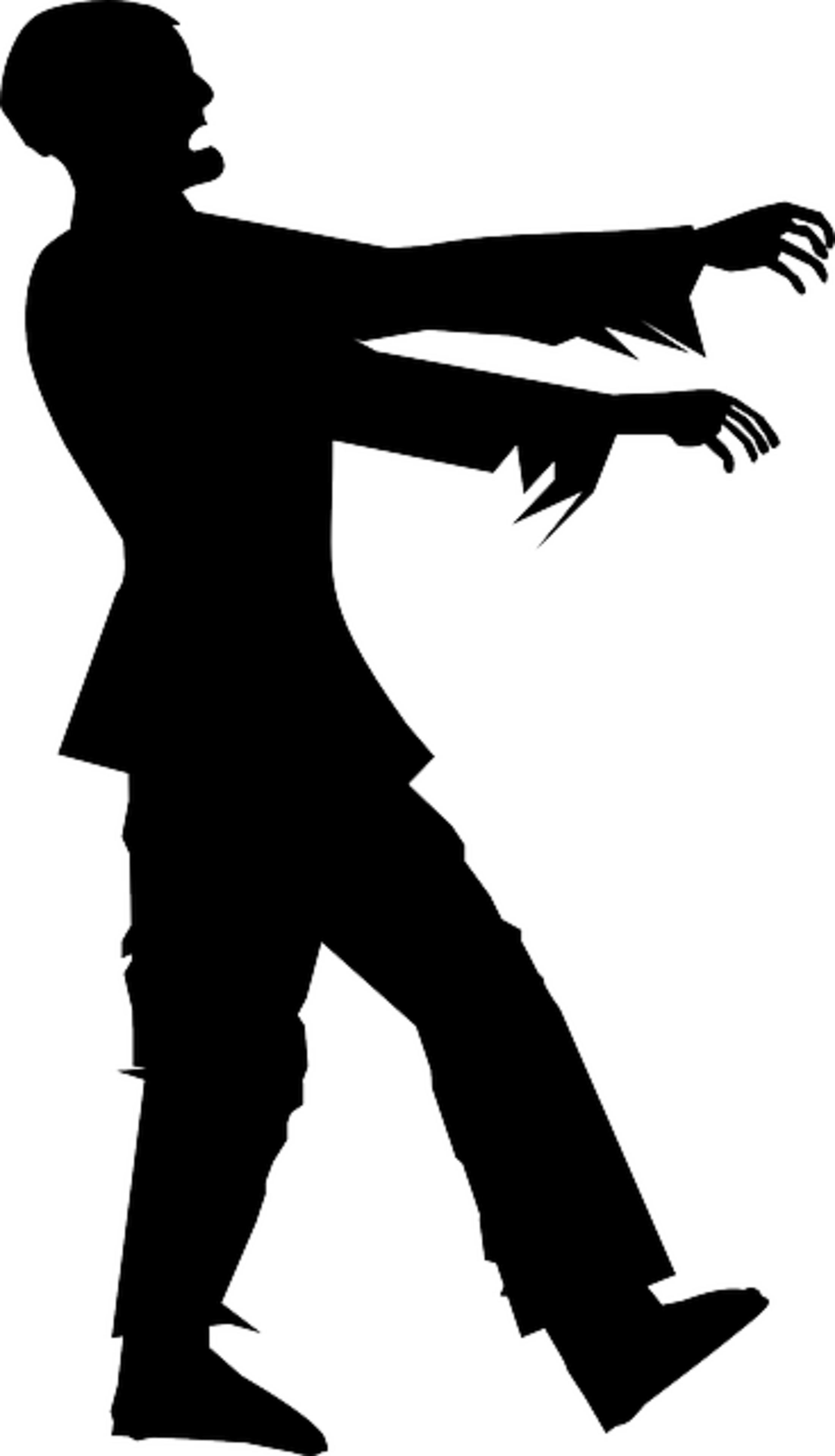
Un esprit rationnel ne devrait pas croire aux Zombies. Les économistes se définissant généralement comme des êtres rationnels, il est tout à fait paradoxal que nombre d’entre eux favorisent l’émergence d’idées zombies.
L’expression « Économie zombie » a été proposée par l’économiste australien John Quiggin dans un ouvrage publié en 2010 (traduit en français sous le titre « Économie zombie : pourquoi les mauvaises idées ont la vie dure ? », éd. Saint-Simon, 2013). Elle désigne différents concepts économiques défendus par les économistes standard, avant comme après la crise financière déclenchée en 2008. Les idées zombies, bien qu’elles aient été largement démenties par les faits ou que l’inefficacité de telle ou telle mesure ait déjà été démontrée, sont encore serinées et appliquées. Quiggin explore plusieurs de ces idées : « l’efficience des marchés financiers », l’existence d’un « taux de chômage naturel » ou encore l’efficacité systématique des privatisations pour suppléer la supposée inefficacité structurelle de l’État. En avril 2015, le concept est également mobilisé par P. Krugman sur son blog, afin d’éclairer le débat politique américain.
Tout cela rappelle ce que Keynes écrivait dans la Théorie générale : les idées développées par les économistes, qu’elles soient justes ou fausses, sont plus puissantes que ce qui est communément admis. Les idées zombies polluent la sphère académique, irriguent les débats politiques et favorisent la mise en place de politiques économiques inappropriées. Il en va ainsi de la thèse de la Grande modération : la politique monétaire est à elle seule en mesure de stabiliser l'économie, en garantissant une croissance saine et faiblement inflationniste. Alors que cette thèse a été battue en brèche par la crise des Subprimes et ses conséquences sur l’économie réelle, les pays européens continuent paradoxalement à n'attendre leur salut que de la seule politique monétaire, refusant de mettre en place une réelle politique de relance budgétaire...[1]
Si les Zombies sont sous le contrôle d'un sorcier, les idées zombies en économie émanent souvent d’économistes des institutions internationales (FMI, OCDE, Banque Mondiale, BCE…). Une fois créés, les Zombies s’autonomisent parfois et se cachent parmi la population. L'exemple précédent montre que la BCE, souvent en première ligne pour propager des idées zombies, peut aussi se révéler utile pour lutter contre d'autres idées zombies : la différence entre magie et magie noire est une question de point de vue... et d'objectifs !
Les idées zombies portées par les économistes des institutions internationales enfin affaiblies ?
Retenons trois exemples d’idées zombies encore vivaces dont les institutions internationales reconnaissent dorénavant qu’elles ne sont pas fondées, ou qu’il existe un manque de preuves empiriques pour les soutenir.
La rigidité du marché du travail comme cause du chômage
L’une des causes avancées de manière récurrente pour expliquer les hauts niveaux de chômage serait à chercher du côté des rigidités du marché du travail. Le plein emploi ne pourrait être assuré parce que les salaires seraient rigides (à la baisse, cela va de soi) ou que les rigidités contractuelles seraient telles que l’embauche serait découragée. Suivant cette idée, il faudrait pour mettre fin au chômage faciliter les licenciements, ajuster les salaires à la baisse ou encore encourager les accords décentralisés plutôt que la loi ou la négociation nationale. Cette idée zombie est particulièrement vivace aujourd’hui, notamment en France, propagée par les défenseurs de la loi « Travail ». L’argument est soutenu par des économistes célèbres, dont Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du FMI (voir ici une analyse récente et critique proposée par Michel Husson).
Le raisonnement est pourtant démenti par les données de l’OCDE et par bon nombre d’économistes qui mettent en avant la faiblesse de l’activité économique comme cause structurelle du chômage de masse actuellement observé en Europe. Idée zombie typique : bien que contredite par l’analyse, elle subsiste : dès 2004 l’OCDE admettait que les mécanismes de protection de l’emploi évitent à des emplois d’être détruits et que l’effet net sur le taux de chômage de la législation du travail est ambigu. Dans le World Economic Outlook d’avril 2015, l’analyse du FMI constate que les réformes de libéralisation du marché du travail ne provoquent pas d’amélioration de la productivité des facteurs. L’effet de ces réformes sur l’emploi ne peut donc pas être positif.
Si même les institutions internationales commencent à revenir sur ces prescriptions en termes de nécessaire flexibilisation du marché du travail pour obtenir la baisse du chômage, peut-être pourra-t-on enfin considérer que le plein emploi ne passe pas par les réformes de libéralisation du « marché du travail » ?
Le multiplicateur keynésien n’existe pas, ou sa valeur est négligeable
Après l’explosion de la crise financière en 2008, les gouvernements des pays touchés par le ralentissement économique étaient tous « keynésiens ». Mais rapidement, passé le consensus initial en faveur des mesures de soutien à l'économie par la dépense publique, ce type de politique a été remis en cause.
Le FMI défendait ardemment la mise en place de politiques de réduction des dépenses publiques afin de contrecarrer l’augmentation des ratios de dette publique / PIB. D'un point de vue keynésien, cette préconisation est dangereuse : la diminution des dépenses publiques peut engendrer une diminution plus importante de l’activité économique, en vertu du mécanisme du multiplicateur de dépense publique : une dépense supplémentaire effectuée dans l’économie va générer des revenus qui eux-mêmes provoqueront des dépenses. Ce cercle vertueux (ou vicieux en cas de baisse des dépenses) présente trois limites. En effet, les revenus obtenus ne sont jamais intégralement dépensés en biens produits sur le territoire national : ils peuvent être convertis en épargne, en importations, ou en paiement des impôts. Il y a donc un enjeu important à connaître la valeur des multiplicateurs. S’ils sont faibles, il n’y a aucune raison particulière de craindre une politique d’austérité budgétaire et il est possible de préconiser la baisse des dépenses publiques.[2] C’est ce qui a été proposé et mis en place par la Troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne et FMI) dans la zone euro, particulièrement dans les pays du Sud de l’Europe, comme la Grèce.
Mais les multiplicateurs budgétaires observés a posteriori se sont avérés beaucoup plus importants que ceux anticipés par le FMI ! Face à l’évidence, en janvier 2013, Blanchard et Leigh reconnaissent dans l’American Economic Review que le FMI avait sous-évalué la valeur des multiplicateurs budgétaires, provoquant une sous-estimation des effets négatifs sur l’activité des politiques dites de consolidation budgétaire. Depuis, devant l’absence de véritable rebond de l’activité, les institutions qui avaient préconisé les plans d’austérité encouragent les autorités à mettre en place des programmes de soutien à l’activité via les dépenses publiques, notamment en Europe (voir ici, Interim Economic Outlook, OCDE, février 2016 ou World Economic Outlook, FMI, septembre 2014, ici).
L’idée zombie selon laquelle on réactive l’activité économique et/ou qu’on diminue l’endettement public par une politique d’austérité recule… mais elle est encore largement présente dans les discours de politique économique. Il est pourtant grand temps de s’appuyer sur le principe du multiplicateur keynésien pour relancer la demande et l'emploi (voir ce lien) !
La dépense publique décourage l’investissement privé
Les économistes qui continuent de nier la capacité de la politique budgétaire à jouer un rôle contracyclique font souvent valoir un autre argument. La dépense publique en général et l’investissement public en particulier seraient contre-productifs, car ils évinceraient l’investissement privé. Les déficits publics générés ponctionneraient une part de l’épargne, qui n’est plus disponible pour les entreprises. De plus, l’ensemble des agents économiques (entreprises mais aussi ménages) anticiperait des augmentations futures de la fiscalité, réduisant leurs dépenses et donc l’activité dans son ensemble, limitant aussi l’investissement privé.
Ces arguments de l'effet d'éviction sont aussi une véritable idée zombie qui vise à discréditer toute velléité de dépense publique, quelle que soit la situation économique. Actuellement, les taux d’intérêt sont extrêmement bas malgré les niveaux élevés de dette publique, et il est délicat de soutenir la thèse d'un investissement privé qui serait freiné par la dépense publique.[3] Deux économistes du FMI (Hebous & Zimmerman, IMF Working Paper, n°16/60) indiquent que, loin d’être un handicap, les dépenses publiques aux États-Unis… soutiennent l’investissement privé. Leur raisonnement contredit l’idée zombie : grâce aux commandes publiques, les primes de risque exigées par les créanciers externes aux firmes sont réduites. Ce n’est plus un effet d’éviction qui est démontré, mais un effet d’accélérateur ! Selon cette étude du FMI, une augmentation des achats de biens et services par le Gouvernement provoque une augmentation de l’investissement en capital productif des firmes, particulièrement de la part des firmes qui subissent une contrainte de financement.
Comment en finir avec ces idées zombies ?
Les exemples d’idées zombies entrevus ici soulignent, pour filer la métaphore, que les sorciers ayant permis leur extraordinaire développement (les institutions internationales qui portent cette vision néolibérale de l’économie, que l’on appelait dans les années 1990 le Consensus de Washington) peuvent, face à l’évidence, les contredire. Mais les idées zombies s’affranchissent de leurs sorciers : si elles s’affaiblissent au sein des institutions qui les ont largement promues, elles ne disparaissent pas des discours politiques ou des décisions de politique économique mises en œuvre.
Le rôle des économistes est important dans la vie de la cité : ils devraient combattre la « zombification » des politiques économiques. Il ne suffit pas de faire des Mea Culpa[4] : il faut se défaire de préjugés idéologiques sur les effets attendus des politiques économiques et adopter des préconisations plus pragmatiques, en fonction d’objectifs qui peuvent évoluer selon les circonstances historiques.
Aujourd’hui, et particulièrement en Europe, il est temps de placer le plein emploi et la transition écologique comme priorités absolues de la politique économique : cela passe par une rupture dans les politiques menées, en particulier par une politique de relance budgétaire.
Sébastien Charles, Thomas Dallery et Jonathan Marie
[1] Au point que la Banque centrale européenne, fatiguée de ne pas être entendue par les États, envisage désormais de se doter d'une arme budgétaire déguisée avec le dispositif de « monnaie hélicoptère », issue des propositions d’un Quantitative easing for people.
[2] La faible valeur du multiplicateur serait aussi une condamnation des politiques budgétaires expansionnistes : à quoi bon augmenter les dépenses publiques si celles-ci n'entraînent pas de relance dans l'économie ?
[3] Ce qui empêche l’investissement d’être plus important, c’est uniquement la faiblesse de l’activité elle-même, qui induit l’absence de projets solvables.
[4] Voir un exemple éclatant ici : il s’agit d’un article de Glick et Rose ; ils reconnaissent, 14 ans après, que la création de l’Union monétaire européenne n’a pas généré des flux de commerce aussi intenses que ceux qu’ils avaient pronostiqués. Selon eux, c’était l’argument massue qui justifiait la construction de l’Euro.



