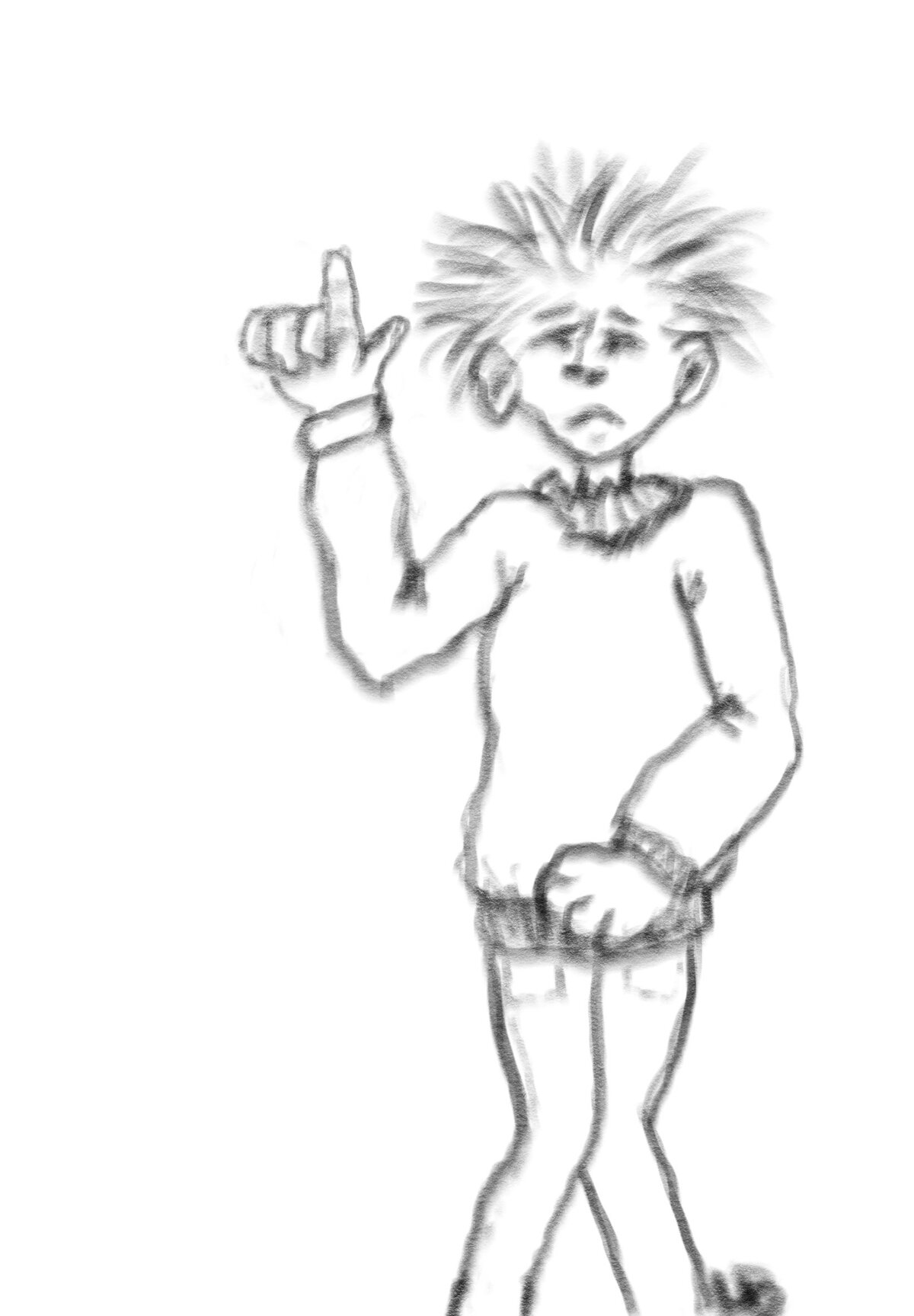
Agrandissement : Illustration 1

Bon, je reconnais qu'une certaine fantaisie peut se retrouver chez ceux qui, donc, ont envie de dire et nous le font savoir. En effet, la formule peut survenir en fin de phrase, nous sortant d'une écoute placide par cette annonce étonnante : « ...j'ai envie de dire ! ». Là, je mets un point d'exclamation, parce que dans cette expression, lorsqu'elle est placée en fin de phrase, l'intention de souligner le propos est plus manifeste.
Chez certains originaux, plus créatifs, donc, c'est en plein milieu de la phrase que la formule survient. Une façon de mettre sur pause de façon inopinée pour réveiller l'écoute, j'imagine...
Cela peut donner « Je ne sais pas quoi penser de ce gouvernement, j'ai envie de dire, ni même s'il va rester... ». Lunaire, non ?
J’ai vécu une partie de ma jeunesse en banlieue, dans le Sud-ouest de la France, dans une cité. La cité a ses rites, mais aussi son langage, d’ailleurs genré. Les phrases de mes copains étaient envahies de « mes couilles », « con » (la prononciation se rapprochant de « cang »), « putain » et, le must, « putain-con ». Ces mots parsemaient les échanges sans que cela ne revête aucun sens particulier, à part, peut-être, un signe de reconnaissance et, bien sûr, une façon de souligner l’importance du discours. Nous, les filles, nous évitions ces virgules vocales que l’on trouvait très vulgaires.
Plus tard, au lycée de centre ville et à l’université, j’ai trouvé un langage beaucoup plus châtié, mais il y avait aussi des expressions typiques qui faisaient signes de reconnaissance. Ainsi dans mon lycée, pour nommer une personne, on l’appelait « sujet » et, quand on voulait la dénigrer ou la provoquer « sujot ». C'était la honte assurée... Il s'agissait d'un particularisme local que je n’ai pas retrouvé ailleurs.
Mais il y avait aussi des « en fait », « toutes choses étant égales par ailleurs », « permets-moi de te dire... » (avec sa variante plus protocolaire « si je peux me permettre... ») qui servaient juste à garder la parole un peu plus longtemps et, toujours, à souligner. Il existe un nombre infini de ces formules : « A l'heure d'aujourd'hui », « Franchement... », « j'avoue... », « en même temps... » etc.
A l'heure des réseaux sociaux et des informations en continue, les modes se développent très vite, et très loin. Un soir, j'ai ainsi entendu la mairesse de Montréal nous informer plusieurs fois qu'elle avait envie de dire. Il n'y a pas que les capitaux qui s'échangent sur le marché international, les tics de langage aussi...
Dans le discours politique j’étais frappée depuis des années par la mollesse des déclarations des opposants de gauche qui commençaient presque toujours par « Il me semble que… », « On peut dire que... », « J’ai le sentiment que... ». Tout était de l’ordre du sentiment et de l’impression, laissant planer une atmosphère de doute. Pas d’affirmations ni de volontés exprimées, pas d'avantage d’actions planifiées décrites à l’indicatif (sans parler de l'impératif ! ) : c’est le conditionnel qui prenait le devant de la scène. Je m'imaginais amèrement les révolutionnaires de 1789 employant les mêmes circonvolutions verbales : on serait encore en royauté !
Désormais les actes de l’exécutif obligent la gauche à se ressaisir : celle-ci ne peut pas continuer dans le style impressionniste sans se décrédibiliser définitivement. Donc, terminés les « il me semble que... », on entend désormais un discours plus critique et même offensif.
C’est peut-être là que le « J’ai envie de dire... » prend toute sa place.
L'expression « j’ai envie de dire... » laisse entendre que c’est le seul désir qui nous pousse à parler : pas la colère, pas la nécessité, pas l’exaspération, ni la volonté avérée d’en découdre avec un système capitaliste néolibéral menteur et mortifère… non, juste l’envie.
Par le biais d’une formule qui laisse entendre une volonté, on passe subtilement en sous-main le message d’une pauvre subjectivité, individuelle et revendiquant son envie en lieu et place d’une volonté (ou d’une indignation) éventuellement collective.
De plus, on peut entendre dans la formule la demande d’être écouté, comme l’enfant qui lève la main en classe pour demander au maître l’autorisation de prendre la parole ou de répondre à la question.
Je modifie donc la formule. Cela donne : « Maître, j’ai envie de... ».
« C’est au bout du couloir à gauche, mais ne reste pas trop longtemps, et laisse le lieu aussi « propre » que tu l’as trouvé en entrant... ».
« Bref » (autre mot qui sert plus au tempo du discours ou du texte qu'au fait d'exprimer quelque chose) s'il est bien léger de discourir de l'emploi actuellement extensif d'une formule, celle-ci, en particulier, me paraît représentative de l'impasse où nous sommes. Nous constatons, impuissants, l'effondrement de notre monde, et je ne parle pas là que du dérèglement climatique et de la pollution ainsi que de leurs effets à terme désastreux, mais aussi et surtout de la revendication de l'amoralité d'un nombre de plus en plus grands de dirigeants, autant de pays que de grandes entreprises, comme si les différentes morales liées aux religions avaient été supplantées par une morale folle où un Dieu cruel promouvait la recherche absolue du profit comme valeur cardinale, et les coûts humains de ce projet comme un prix à payer nécessaire et à ne pas considérer. Pour cette nouvelle morale perverse, il est juste de mentir, d'attaquer les faibles, de les choisir comme boucs-émissaires, voire de les massacrer. Pour eux, les êtres humains ne sont pas égaux, il y a des gens qui réussissent, et d'autres qui ne sont rien. Les victimes des guerres n'ont pas la même valeur selon leur statut.
Alors suffira-t-il que les gentilles personnes qui ne partagent pas cette amoralité perverse et destructrice demandent gentiment la parole en disant « J'ai envie de dire... »?
Franchement, je ne le pense pas. Je suis persuadée au contraire qu'il va falloir gagner aussi la bataille des mots, mais pas seulement. Ainsi, se battre contre la notion de « submersion migratoire » c'est la moindre des choses, mais ce n'est aussi que le début de combats à venir qui vont devoir être autrement plus violents.
Voilà, j’avais, vraiment, « envie de le dire »...



