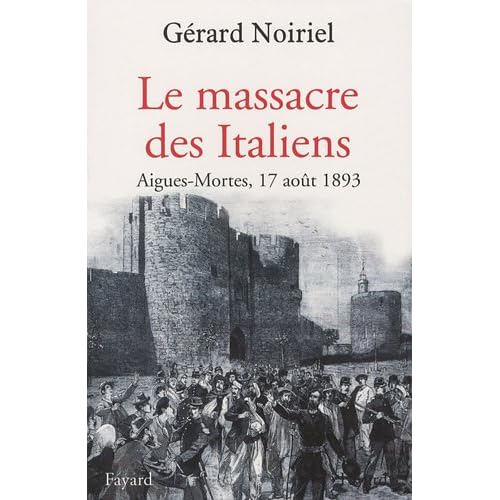Lors des rencontres de Bobigny (1), l’atelier « théâtre et histoire » a donné notamment l’occasion à Gérard Noiriel, historien et sociologue cofondateur du Comité de vigilance des usages publics de l’histoire, de plaider pour le rapprochement de l’Histoire, dont le discours porte sur un passé souvent tragique, avec le Théâtre, dont la représentation du passé prend parfois les accents de la tragédie. L’association de champs disciplinaires différents peut ainsi donner d’excellents résultats, à l’instar du clown Chocolat (2). Egalement cité comme méritant une mention spéciale : « le massacre des italiens – Aigues-Mortes, 17 août 1893 » (3), un évènement qui n’a pas fait mémoire malgré son importance, puisqu’il constitue l’un des plus grands massacres d’immigrés dans la France républicaine et pose la question du devoir d’histoire par opposition au soit-disant devoir de mémoire (comme si l’on pouvait choisir la mémoire des gens à leur place ?).
Ignorant du cas cité, je me suis donc reporté au travail que Gérard Noiriel lui a récemment consacré au terme d’une remarquable enquête au sens hérodotien du terme, puisque le mot « Historia » en grec signifie d’abord « enquête », puis : « récit à partir des documents rassemblés au cours de l’enquête ».
1) Les faits :
Un groupe de travailleurs saisonniers italiens embauchés pour la récolte du sel à l’été 1893 à Aigues-Mortes, Gard, est attaqué, d’abord par un groupe de travailleurs français embauchés pour les mêmes raisons, puis par la population locale toute entière, faisant, au terme d’une battue rappelant nos ratonnades contemporaines et désignée à l’époque sous le vocable de « chasse à l’ours », 8 tués au moins et de nombreux blessés, le nombre étant majoré par les autorités italiennes mais le nombre exact n’ayant jamais été établi.
2) L’analyse des faits :
- Un contexte géographique austère : Aigues-Mortes (ou « Aquae Mortae » pour les romains = « Eaux Mortes » en français) est une bourgade isolée, entourée de marais insalubres, de 7000 âmes aujourd’hui (la moitié à l’époque) et reliée à la mer par Le Grau du Roi (aujourd’hui grande station balnéaire). L’activité économique était alors concentrée autour de la récolte du sel, de la vigne (implantée grâce aux cépages américains après la crise languedocienne du phylloxéra) et les élevages de taureaux donnant lieu à des férias annuelles (d’où une propension à la « chasse à l’ours »).
- Un contexte historique isolant : la ville fut fortifiée par Saint-Louis qui voulait en faire une plaque tournante en Méditerranée pour organiser les croisades futures (la sienne s’arrêta tragiquement à Tunis en 1270). Il en reste d’impressionnants remparts coupant la ville des marais salants avoisinants.
- Un contexte social électrique : le travail du sel réclame à l'époque une main d’œuvre nombreuse, endurante et saisonnière (c’est au mois d’août que se récolte le sel et que la chaleur est à son comble, alors qu’il n’y a même pas l’eau courante). Celle-ci est composée d’ « ardêchois » (originaires de la campagne cévenole), de « trimards » (vagabonds de toutes sortes qui affluent à Aigues-Mortes en été) et de « piémontais » (montagnards italiens à qui l’on confie les tâches les plus pénibles et qui sont moins bien payés que leurs camarades en tant que main d’œuvre immigrée).
- Un effet papillon : le 16 août 1893, une rixe éclate dans une équipe mixte où les trimards refusent de suivre la cadence des piémontais qui cherchent ainsi à augmenter leur maigre salaire. On en vient aux mains et il y a des blessés du côté des trimards qui s’enfuient à Aigues-Mortes chercher du renfort pour se venger tandis que le chef d’équipe prévient les gendarmes. Un italien est arrêté, ce qui déclenche la colère de ses compatriotes. Le lendemain, la rumeur se répand à Aigues-Mortes que des italiens s’en sont pris à des français dans les marais salants. Une battue est organisée. Une cinquantaine d’entre eux est ainsi assiégée dans une boulangerie où la gendarmerie appelée sur les lieux par le maire ne parvient pas à contenir la foule. On déplore les premiers morts. Les italiens qui le peuvent se sauvent, poursuivis par des jets de pierre et des coups de bâtons. Poussés dans un fossé, certains sont achevés à coups de trique et leurs cadavres piétinés. Un régiment de cavalerie est enfin sur place dans la soirée pour rétablir la situation, et le maire décide d’escorter les italiens survivants jusqu’à la gare en direction de Nîmes et Marseille, ce qui crée un incident diplomatique avec le consulat italien. Le lendemain, la presse locale, nationale et internationale s’empare du sujet. Bernard Lazare, journaliste au Figaro et futur défenseur du capitaine Dreyfus, est envoyé sur place. Le New York Times, très sensibilisé par le phénomène du lynchage, considère que la France devra rendre des comptes. A Rome, l’ambassade de France est saccagée par des émeutiers et l’on parle de se déclarer la guerre des deux côtés de la frontière. Celle-ci sera évitée in extremis après une entente entre les deux gouvernements transalpins pour une instruction rapide de l’affaire (tous les criminels sont identifiés) et un jugement encore plus expéditif où les accusés seront innocentés et les autorités publiques des deux parties condamnées à verser des réparations financières réciproques, ce qui n’apaisera pas les rancoeurs puisqu’un an plus tard le président français Sadi Carnot sera assassiné par un anarchiste italien tandis que le capitaine Dreyfus sera pour sa part accusé de haute trahison au profit de l’Allemagne.
Le massacre d’Aigues-Mortes, sorte d’illustration paroxysmique des débats sur l’identité nationale, tombe alors dans l’oubli selon un processus d’occultation lié à un fort sentiment de culpabilité bien connu des psychosociologues. Il avait pourtant révélé dans la misère humaine ses lâches, comme ce notable refusant d'ouvrir les grilles de sa propriété aux malheureux piémontais pour les sauver du massacre, mais aussi ses "justes" comme cette boulangère qui préféra voir sa devanture voler en éclats plutôt que de céder aux injonctions de la foule haineuse (4).
Lincunable, 6 décembre 2010
___________
(1) http://cvuh.free.fr/spip.php?article257
(2) http://www.approches.fr/Chocolat
(3) http://www.amazon.fr/massacre-Italiens-Aigues-Mortes-ao%C3%BBt-1893/dp/2213636850
(4) voir aussi le billet précurseur de POJ : http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/poj/281209/identite-nationale-le-massacre-ditaliens-aigues-mortes