
Agrandissement : Illustration 1
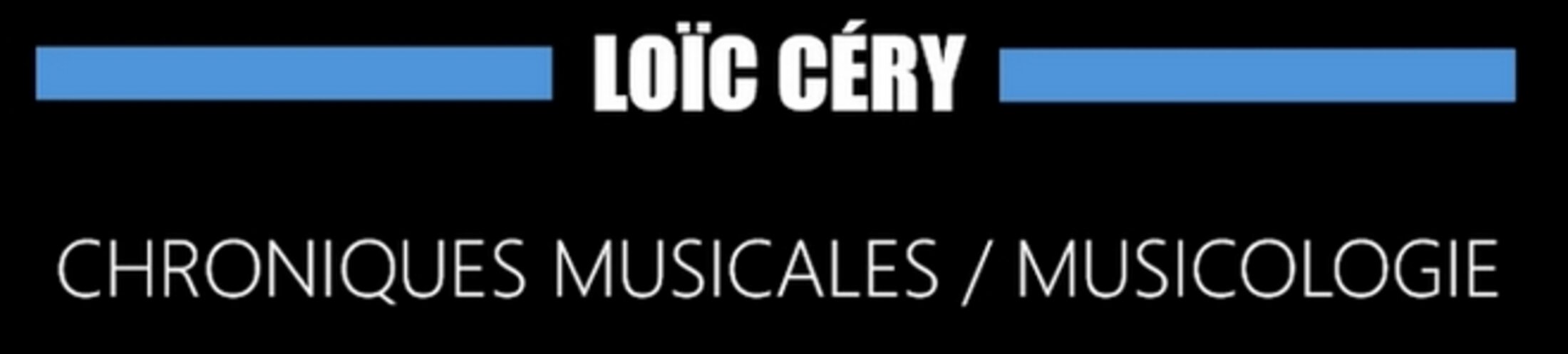
À l'image du présent billet, mes chroniques musicales seront dorénavant publiées à la fois ici et sur mon site spécifiquement musical, loiccery-musique.com qui regroupe dorénavant l'ensemble de mes chroniques de concerts, d'enregistrements et autres analyses musicologiques. Ainsi, la présente chronique est à retrouver sur le site, à cette adresse.
___________________________________________________________

Voilà maintenant quelques années de cela que dans le sillage du « Consort » (cette formation co-fondée par Théotime Langlois de Swarte et Justin Taylor), quelques-uns des plus impressionnants représentants de la jeune génération de la musique baroque en France déploient leurs talents à la fois dans des concerts à guichets fermés et dans une discographie fournie. J’ai déjà maintes fois eu l’occasion de saluer cette sorte d’explosion depuis longtemps sans égal sur la scène française, et cette admiration est sans cesse alimentée en quelque sorte par une actualité discographique en expansion constante. Mais il ne faudrait pas conclure là à un stakhanovisme à ressort commercial où opportuniste : à l’image de leurs glorieux aînés (William Christie, Ton Koopman et tous les autres), l’enregistrement est pour ces musiciens, le support tangible d’un sacerdoce de transmission qui s’exerce en concert certes, mais qui en l’espèce, entérine et incarne une démarche musicologique au sens fort du terme – qu’il s’agisse de mises en perspective pertinentes et thématiques, ou de découvertes au sens plein du terme, de parts de répertoire enfouies jusqu’alors, et enregistrées pour la première fois. En somme, une génération dont on n’a pas fini en France, de prendre la mesure de l’excellence.
Bénéficiant à intervalles réguliers, des apports déterminants et des talents de cette mouvance inespérée, nous avons appris au fil des concerts et des enregistrements (dans un mouvement débuté en 2019 avec leur premier album, Opus 1, chez Alpha), à connaître ces jeunes musiciens qui de toute évidence ne s’arrêtent jamais : de jouer, de découvrir, de transmettre. De les connaître dans le mouvement même des enregistrements de leurs formations (le Consort, mais aussi le Trio Dichter), mise au service d’albums collectifs, ou de certains d’entre eux, à tour de rôle en solistes accompagnés du collectif, ou encore d’enregistrements en duos, toutes les formules semblent possibles dans ce sillon. Ce fut l’occasion de découvrir et d’apprécier les talents aujourd’hui célébrés de Théotime Langlois de Swarte, Justin Taylor, Thomas Dunford, et plus récemment en solistes, de Sophie de Bardonnèche et Hanna Salzenstien, l’éminente violoncelliste du Consort. Je dis éminente, parce qu’à l’image de ses collègues, c’est bien d’excellence qu’il est ici question, continuellement et massivement. Et d’intelligence musicale aussi. Mais avant tout, voici ce qu’est le plaisir de « faire de la musique », simplement, avec souffle, jeunesse, enthousiasme et intelligence. Le Consort et Victor Julien-Lafferière en 2021, dans l’air de La Folia version Reali, pour l’album Spechio Veneziano (Reali / Vivaldi) de 2021 – avec l’envie irrépressible de les écouter et de découvrir désormais à leur invitation, les horizons qu’il parcourent :

Agrandissement : Illustration 4

En 2024, Hanna Salzenstein enregistrait son premier album soliste avec certains musiciens du Consort chez Mirare, E il Violoncello suonò (Et le violoncelle sonna), consacré en somme à l’apparition historique du violoncelle, dans l’héritage direct de la viole de gambe, en cette seconde moitié du XVIIe siècle essentiellement italien. Une focalisation sur ces premières années d’émergence de l’instrument, dans le sillage de l’album Spechio Veneziano et de recherches personnelles, comme elle l’expliquait, alors à Jean-Baptiste Urbain dans La Matinale de France Musique, le 13 février 2024 – confirmant qu’on est donc bien là dans le processus de découvertes musicologiques lui-même généré par les enregistrements (on est donc au cœur à la fois de la démarche et des réalisations de cette jeune génération, sur les traces de leurs aînés comme je le disais).
MUSICIENNE D’UNE TRANSMISSION ÉCLAIRÉE
Ce « berceau du violoncelle », émerge et se fait jour un « frémissement » italien accompagné par l’évolution organologique – c’est ce qu’explique la violoncelliste. Dans la démarche de cette exploration, on est dans la connaissance, dans l’heuristique musicale pourrait-on presque dire, car si on savait qu’en ces dernières années du XVIIe siècle et en ces premières années du XVIIIe siècle, une mutation profonde s’opérait en Italie en matière de musique instrumentale (et en concomitance avec la naissance de l’opéra), une chose est de le savoir, et une autre est la possibilité d’en éprouver les effets réels, autour d’un instrument qui naît sous nos yeux et à nos oreilles. En modifiant de fond en comble ses courbures et sa table d’harmonie, les luthistes italiens, entre Crémone et Bologne, vont sonner le glas de la viole de gambe et donner naissance au violoncelle. Cette naissance d’un instrument, qui n’est pas qu’une réforme de la viole mais sa transformation complète, ouvre immédiatement de nouvelles perspectives de composition et de jeu. C’est à Bologne que se joue la mutation dont héritera l’Europe entière, et que se déploie la première école du violoncelle proprement dit. On ne s’étonnera donc pas, dans l’enregistrement de 2024 d’Hanna Salzenstein – premier volet en somme d’un diptyque -, de la mise en lumière de compositeurs négligés comme Giulio Taglietti ou Gasparo Garavaglia, ou d’enregistrements de partitions anonymes découvertes à la BnF ou de manuscrits préalablement édités. Mise en lumière des nuances insoupçonnés de cette prime période d’émergence essentiellement autour de Bologne donc, fin du XVIIe siècle, là où le violoncelle est exploré comme un nouvel instrument avec sa nouvelle sonorité et ses nouvelles ressources expressives.
On pouvait y être frappé, à titre d’exemple particulièrement éloquent, par tel Caprice (N° 1 en l’occurrence, en do mineur, interprété ci-contre par Hanna Salzenstein lors de son premier cd de 2024) de Giuseppe Maria dall’Abaco (1710-1805), fils d’Evaristo Felice dall’Abaco (1675-1742, disciple de Corelli), lyrique à souhait dans sa ligne mélodique, alors qu’on ne peut s’empêcher de penser aux Six Suites pour violoncelle de Bach, contemporaines à peu de choses près, mais d’une inspiration harmonique si différente : deux voies distinctes en somme, d’exploration des potentialités d’un nouvel instrument. Et contrairement à ce qu’on a longtemps dit, c’est en fait dès la première moitié du XVIIIe siècle que se répand le violoncelle, d’abord via cette école de Bologne puis dans le reste de l’Europe, sur les cendres de la viole de gambe, qui tombe en désuétude plus vite aussi qu’on ne l’a dit.
Pour ce nouvel album publié en février 2025, on est dans le prolongement de cette prime émergence, et en l’espèce dans la veine du concerto commençant, comme genre et comme esthétique balbutiante : Gabrielli, Vivaldi évidemment et éminemment, mais aussi Giuseppe Maria dall’Abaco (1710-1805, fils d’Evaristo Felice dall’Abaco, 1675-1742), Giorgio Antoniotto, Niccolo Sanguinazzo, Giovanni Benedetto Platti, Giuseppe Maria Jacchini.
Et c’est avec une même et profonde intelligence musicale que la violoncelliste parvient dans cet album, à l’instar de son premier enregistrement de 2024, à transmettre cette musique avec la sensibilité mais aussi l’énergie qui s’imposent dans ce répertoire rare. Hanna Salzenstein est au sens plein du terme, une musicienne de caractère – et il faut entendre le terme ici autant au singulier qu’au pluriel. Car ce à quoi elle parvient immanquablement, c’est à respecter la prodigieuse diversité (et donc les caractères variés) de ce tournant choisi comme période à la fois de transition et de foisonnement : Hanna Salzenstein, musicienne d’un singulier pluriel.
DIVERSITÉ ET CHATOIEMENTS D’UN TOURNANT
Ce que permet au centuple cet album miraculeux (dans le sillage et dans la continuité de celui de 2024), c’est de se confronter donc avec l’étonnante variété de ce moment d’intense mutation à la fois organologique et esthétique. Car spécifiquement, ce que donne à apprécier le choix spécifique de cet album de 2025, c’est donc cette diversité de la production liée à l’autre émergence, celle du concerto. Comme le suggère Olivier Fourés (musicologue français – mais aussi violoniste et danseur – aujourd’hui l’un des meilleurs spécialistes de Vivaldi dans le monde), la mutation là encore, est rapide : en supplantant quelque peu le concerto grosso sur le modèle de Corelli (avec son discret concertino, ensemble d’instruments mis en avant), Torelli et Albinoni vont encore préparer la voie à un nouveau franchissement des seuils effectué par un dénommé Vivaldi, le bondissant vénitien qui définitivement va faire émerger le concerto dans la forme qu’on lui connaîtra dorénavant, celle du dialogue entre un instrument soliste et un ensemble orchestral. À tout seigneur tout honneur, en retraçant quelques aspects de cette mutations, Hanna Salzentein et Le Consort ménagent la place qui lui revient au Prêtre roux, avec trois concertos de choix, dont l’unique et sublimissime concerto pour deux violoncelles RV 531 (le seul de sa production – abondante pour le violoncelle : une quarantaine d’œuvres – et du répertoire tout entier). Et dont également ce concerto en do mineur RV 401, dont voici l’allegro ma non molto final – par la violoncelliste et ses collègue du Consort :
Mais hormis les chefs-d’œuvre eux-mêmes si variés « dell’inventione » propres aux apports centraux de Vivaldi, ce sont donc d’autres chatoiements encore que donne à apprécier Hanna Salzenstein, avec son violoncelle au timbre à la fois si profond et comme en état de relief sonore. C’est le concerto en sol mineur d’un certain Giorgio Antoniotto (1681-1766), le milanais théoricien et violoncelliste d’inspiration vivaldienne et dont la partition dormait à la Library of Congress (premier enregistrement mondial, donc). C’est encore le concerto en ré majeur tout aussi inédit d’un certain Giovanni Benedetto Platti (1697-1763) au style si original empruntant à la séguédille. Ou encore l’inventivité sonore du concerto pour violoncelle obligé op. 4 d’un certain Giuseppe Maria Jacchini (1667-1727).
Quelques-unes de ces merveilles lors du concert d’Hanna Salzenstein avec Le Consort le 31 janvier 2025 lors de la dernière édition en date du festival La Folle Journée de Nantes (concert enregistré et retransmis par France Musique).
En somme le « Grave » de la sonate en sol majeur de Domenico Gabrielli (1659-1690) tient toutes ses promesses de lever de rideau quelque peu théâtral sur lequel débute cet enregistrement enchanté, deuxième album où Hanna Salzenstein confirme après son cd de 2024, qu’elle compte désormais dans l’élite du violoncelle baroque : musicienne sensible, passeuse de connaissance, héroïne d’émergences, éveilleuse d’émerveillement.



