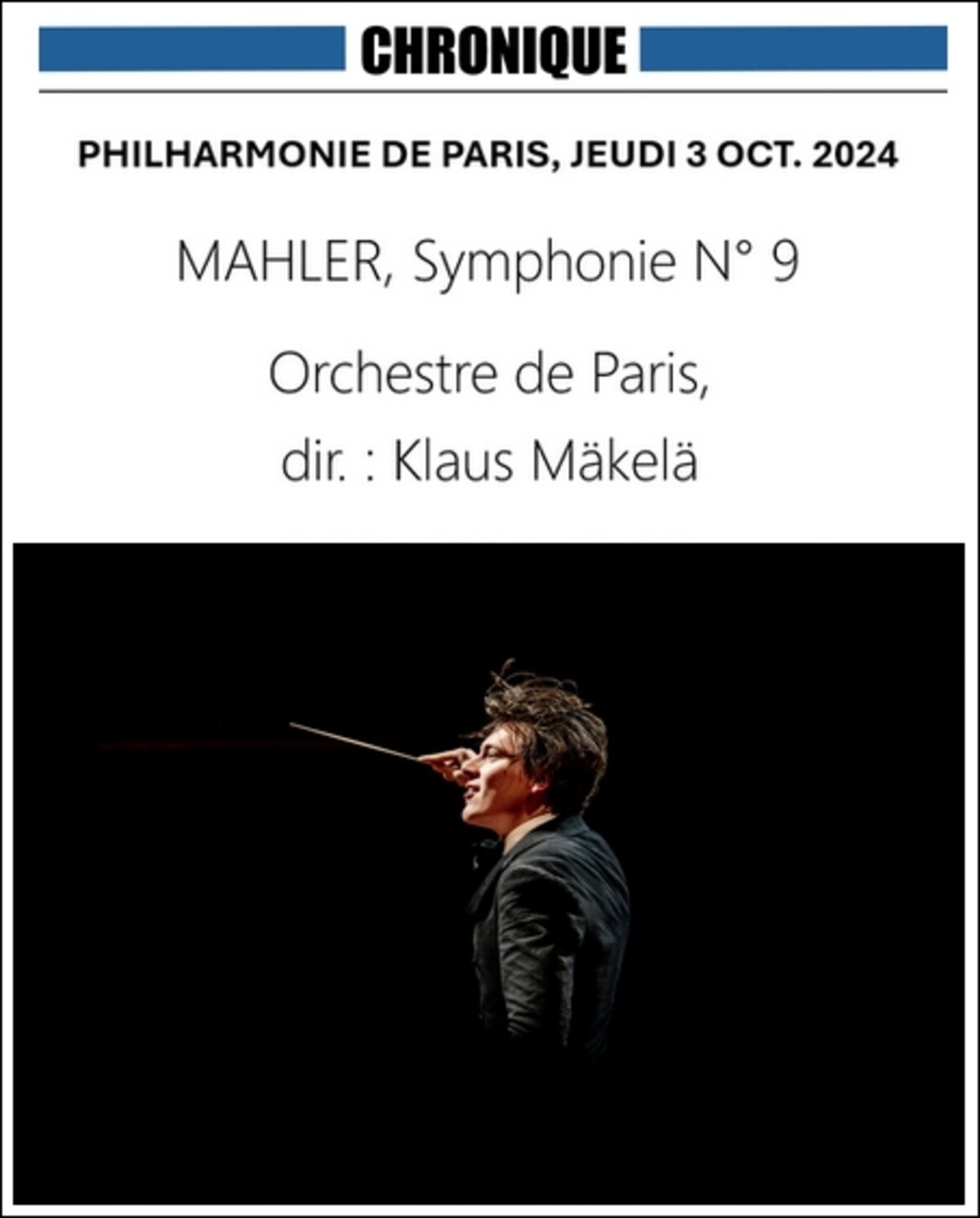
On savait sa prédilection pour Mahler, ses lumières et ses ombres, son abîme métaphysique qui innerve de part en part un corpus symphonique de tous les superlatifs : que ce soit avec le Philharmonique d’Oslo ou l’orchestre de Paris, à la Philharmonie ou à Verbier, le tropisme mahlérien de Klaus Mäkelä n’est plus à démontrer – lui qui n’a encore enregistré aucune des symphonies de celui qui renonça devant Freud à apaiser ses névroses autrement que par son art. Quatre ans après une première occurrence en 2020, à la proue du vaisseau amiral de La Villette (un an avant sa nomination en 2021au poste de directeur musical de l’orchestre de Paris), le jeune chef finlandais redonnait cette Neuvième symphonie testamentaire et spiritualiste, toujours à la Philharmonie de Paris, à la tête de la phalange parisienne qu’il mène à ses sommets depuis maintenant trois ans (mercredi 2 et jeudi 3 octobre 2024). Concert époustouflant, presque sidérant de beauté et de profondeur, confirmation pour ceux qui le savaient déjà qu’outre ses multiples talents, Mäkelä est déjà un grand chef mahlérien. Mais voilà. Avant d’en dire plus parce que j’y tiens, et parce qu’à mes yeux un tel accomplissement n’est certainement pas conçu pour « les bulbes du narcisse ni les gencives de l’esthète » dont parlait Saint-John Perse, parce qu’aussi de tels moments engagent autant les artistes que le public… il faut prévenir : le regard porté sur les réalisations de Klaus Mäkelä, regard critique s’entend, qui mérite donc d’être sérieusement argumenté et ne pas succomber à des réflexes convenus, ce regard donc, n’est pas loin de relever aujourd’hui d’un certain engagement. Car en seule considération de sa jeunesse et de sa fulgurante ascension ces dernières années (je rappelle qu’actuellement, il est à la fois chef et directeur musical de l’orchestre de Paris, chef de l’orchestre d’Oslo, directeur musical de l’orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam avec qui il commencera son contrat en 2026, et il a été nommé par ailleurs chef de l’orchestre philharmonique de Chicago), Mäkelä est maintenant confronté à certaines idées reçues, pavloviennes en diable, dessinant à bas bruit ce que, paraît-il, on nomme aujourd’hui un « bashing » (à bas bruit cela dit, comme les grincements disgracieux qui répondent aux dithyrambes). Je tiens à y revenir, après ma recension. Parce qu’en dehors de justes compte rendus admiratifs (voir par exemple celui d’André Peyrègne dans Classiquenews), certaines critiques me laissent personnellement pantois, surtout parce qu’elles révèlent à mes yeux une sorte de surplomb qu’on se permet à l’endroit de ce chef, avec à la clé nombre de lieux communs, fadaises et clichés qu’il est temps de pourfendre. Je dois avouer (car on le constatera aisément) que j’ai été assez révulsé à la fois par le ton désinvolte et les erreurs factuelles, de la part de deux critiques qui ont cru bon, le lendemain du premier des deux concerts de ce programme (celui du 2 octobre) de se fendre de papiers aigre-doux à l’endroit du chef, tout en tissant des lauriers d’apparat à l’orchestre (ces deux critiques : « Une claudicante Neuvième de Mahler par Klaus Mäkelä », par Erwan Gentric sur le site de Diapason, et « Klaus Mäkelä, la Neuvième de Mahler comme une obsession…Bis repetita », par Patrice Imbaud sur le site de ResMusica). J’essaierai de nommer là une absurdité. N’ayant aucun fil à la patte dans ce milieu, il me sera d’autant plus facile de le dire librement : si la critique est libre, la « critique de la critique » l’est d’autant plus, et j’entends exercer là cette liberté sans volonté de polémique, mais sans édulcorer ce que je pense vraiment de ce type de « papier ». Ce sera sans faux-fuyant que je le dirai, car j’avoue avoir été consterné par les présupposés de ces deux critiques frappées de surdité et de parti-pris.
Élévation, énergie, esprit : Mäkelä mahlérien de corps et d’âme
Ce concert fut à vrai dire une démonstration de maestria proprement mahlérienne, pour qui connaîtrait pour de bon les repères des approches potentielles de ce langage symphonique qui, dès la Symphonie « Titan », N° 1, n’a jamais varié dans son tréfonds, mais a connu des refontes d’ordonnancement au cours des décennies de son édification entêtée, de la part d’un compositeur qui était aussi la gloire des chefs de son époque. On en sait la valeur quasiment de « bilan » à la fois du langage musical utilisé (avec ses séquences, presque ses paradigmes) et de l’imaginaire déployé – dominé ici non seulement par l’approche de la mort pressentie après le diagnostic cardiaque révélé à Mahler peu de temps auparavant, mais aussi par une recherche effrénée de l’apaisement, de la sérénité devant le sentiment puissant de l’amor fati, pour ce nietzschéen de cœur et d’esprit.
Seuls le savent ceux qui ont longtemps fréquenté autant les « intégrales » que les astres solitaires (telles les interprétations de Karajan de la Cinquième, de la Sixième et de la Neuvième, lui qui jamais ne consentit à approcher le massif dans son intégralité) : deux grandes écoles, deux options générales se détachent des approches de Mahler par la face sud ou le pic nord, telles qu’elles apparaissent dans leur diversité même. Et sans schématiser à outrance : d’un côté les approches « architecturales », attachées à la structure quasiment narrative de ces symphonies, au déploiement de leurs accents cycliques – voir à la fois Abbado ou justement Karajan même dans ses uniques enregistrements, et bien d’autres (j’évoque ici les deux cas vraiment représentatifs de cette veine). De l’autre, l’insistance sur le relief interne de l’énonciation, pas seulement du timbre orchestral, matière infiniment riche, mouvante et hétérogène chez Mahler – et sur ce versant des dimensions de « sections » instrumentales recréant une dialectique singulière de l’écriture (sans laquelle, au fait, on n’entend pas, littéralement, la réécriture du contrepoint dans le rondo de cette Neuvième) :

Agrandissement : Illustration 3
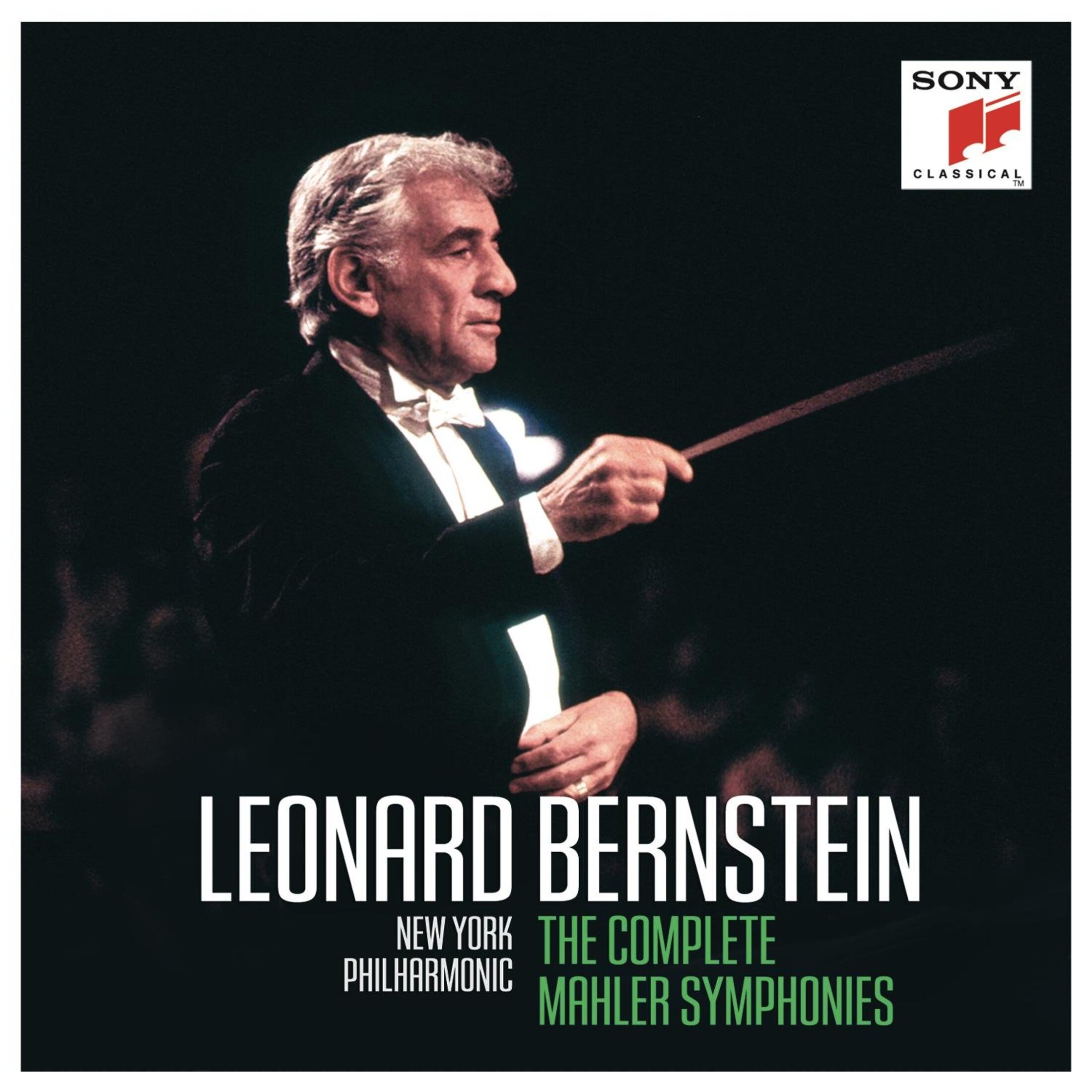
Rafael Kubelik mais surtout celui que j’ai toujours considéré au pinacle mahlérien, à la faveur de ses deux intégrales aussi excellentes l’une que l’autre, Leonard Bernstein avec le New York Philharmonic dans les années soixante, et celle qu’il réenregistra au soir de sa vie pour DG à la tête du Philharmonique de Vienne.
Sans conteste, Klaus Mäkelä se situe résolument sur ce versant délié des masses et des enjambements, et où l’orchestre même aux moments fougueux, résonne plus qu’il ne rugit, tinte plus qu’il ne gronde. Conformément à sa pente naturelle, qui est la limpidité des pupitres d’orchestre envisagés comme autant de voix et travaillés chacun d’entre eux dans une intention d’idiosyncrasie manifeste et dynamique. Et on aura beau me dire que son maître Jorma Panula n’a jamais formé ses élèves dans une visée uniforme, je note cette option commune, à des niveaux différents, de tous ses « disciples » : voir, dans un style certes différents, la même clarté des lignes et comme une sorte de polyphonie orchestrale appuyée, chez Mikko Franck. Chez Mahler, j’ose prétendre que ces qualités sont non pas sine qua non (l’autre versant, celui de la masse orchestrale dominante use d’un idiome certainement recevable et qui a donné de grands moments) mais qu’en tous cas elles permettent de se tenir de plain-pied avec ce langage de claire profondeur que manie l’orchestre mahlérien, aucunement aux prises de la moindre brume. C’est pour cette raison que comme beaucoup d’autres, personnellement je considère Bernstein comme celui qui a le mieux réussi à entrer en intime connivence avec ce dernier grand massif symphonique du XIXe, en fait à cheval (d’arçon) avec un XXe siècle où bientôt Chostakovitch va entrer en scène, en 1926, avec le premier jalon d’un cycle symphonique unique en son genre et qui doit d’ailleurs tant à Mahler.
Dans l'œuvre de Mahler, la Neuvième est une symphonie-monde, ou plutôt des mondes à la fois juxtaposés et liés en une même symphonie où, en près d’une heure trente, en des proportions considérables donc, se déploient des paysages aussi contrastés que puissamment cohérents, enserrés dans une structure qui dit pour autant un cheminement, celui de cette quête de l’apaisement, d’une ataraxie qui n’est pas illusoire quand on se fie à l’achèvement du voyage que marque l’adagio final. Je m’interroge : faut-il n’avoir vraiment rien à dire et être agi par d’autres soubassements rhétoriques pour trouver dans l’approche de l’Andante comodo initial par Mäkelä, une « lecture analytique […] hélas ! truffée de fantaisies ». Vraiment… on n’est plus dans le sérieux d’une écoute attentive quand on écrit de telles choses, car rien de fantaisiste dans les accents envisagés par Mäkelä : avez-vous déjà écouté Bernstein dans la même page ? Vous critiqueriez alors la fanfreluche. Soyons sérieux par conséquent, essayons, efforçons-nous de le rester, car tout cela engage une écoute réelle, si on en est capable. Lesdits « accents » et autres « nuances » ne relèvent aucunement de la moindre « sophistication » : il faut lire une partition de Mahler dans le souci de la vouer au relief que ne cessait d’exiger le compositeur lui-même de la part des musiciens, à la tête des orchestres dont il eut la charge ou qu’il dirigea ponctuellement dans ses propres symphonies, à Vienne ou aux États-Unis (avec une réputation autocratique qui paraît-il n’était pas usurpée).

Agrandissement : Illustration 5


C’est ce qu’on apprend en lisant Henry-Louis de la Grange, vous excuserez du peu (ses ouvrages et surtout sa monumentale biographie en trois volumes, constituent un peu le maître-étalon par excellence pour toute spécialisation autour de Mahler, de son itinéraire et de son esthétique). Dans ce monde en soi qu’est cet Andante dont on avait dit qu’il était un « adieu » à la vie, en se fondant sur les propres mots programmatiques du compositeur (« « Ô monde ! Adieu ! » - une veine amplifiée dans les commentaires de Zweig ou d’Adorno) alors qu’il déplie (et déploie) une amertume qui cherche son havre, Mäkelä a su progressivement et très concrètement dessiner les contours de cette ligne mélodique qui, née d’un épuisement, a du mal à sortir de sa gangue de résignation. Et si vous ne l’entendez décidément pas, bon sang regardez-le !

Agrandissement : Illustration 7

On le voit littéralement sculpter le son en le faisant advenir des profondeurs des cordes, en allant chercher ce que vous nommez des « accents » quand il s’agit d’une énonciation, presque une élocution de la musique… en allant donc chercher cette matière sonore des tréfonds de la tension des instrumentistes. Vous êtes-vous réellement posé la question de savoir pourquoi les musiciens de l’orchestre de Paris ne cessent de dire combien ils aiment travailler avec ce chef ? Eh bien vous en aviez la réponse la plus convaincante en regardant cette opération de maïeutique musicale donnée en direct. Et détrompez-vous, il ne s’agit pas là de spectacle complaisant, ce sont les traces manifestes de ce qui s’est joué en répétitions, là où ce jeune chef aime à construire de manière presque artisanale les sonorités et les impulsions, avec les musiciens et jamais en surplomb. Ce surplomb, l’orchestre de Paris l’a connu par le passé, pour le meilleur (voir Christoph Eschenbach) et parfois pour le pire (Semyon Bychkov). Ici, c’est tout autre chose : Mäkelä pavoise les couleurs de l’orchestre en puisant le meilleur et le plus accompli des musiciens. Comment ne pas réaliser ce qui se passe alors, dans cette fusion d’un musicien parmi les autres (le fait d’être l’excellent violoncelliste qu’il est, ça aide, croyez-moi), dans cette intense marche commune où, penché vers le pupitre concerné ou tendu vers les vents, il tire la substance, aimante la substantifique moelle des élans et du son. Cela, quand vous dirigez, vous pouvez l’obtenir de deux manières : à la schlague, moyennant une terreur noire (rappelez-vous des séances filmées des répétitions de l’ouverture de Tannhäuser par Karajan à la tête de l’orchestre du Festival de Salzbourg, quand il épuisait les violons par l’exigence de trémolos soutenus, rapides et fortissimo, reprenant cent fois avec cette pointe de sadisme dans le regard), du temps où diriger un orchestre voulait dire le tyranniser – ou alors en dialoguant, ce dont Abbado fut sans doute l’exemple canonique, d’autant plus apprécié par le Philharmonique de Berlin qu’il sortait de la férule de Karajan. Mäkelä d’emblée dans cet Andante douloureux, collaborait avec les musiciens, dans une version fondée sur l’intelligence de ce qui s’entendait là, la musique d’une âme aux abois, dans une « paresse de la vie » qui dit la détresse, quand le regain lui-même est livré aux menaces (mon dieu ces cuivres rendus si justement inquiétants dans leurs interventions). Et pourtant, « Try again » aurait dit Leonard Cohen : cette énergie du désespoir et ce Sisyphe au cœur de la condition humaine dépeinte par cette musique habitée d’âme, lestée de vie – au point qu’elle ne sera comprise in fine par ceux qui sauront reconnaître ce qu’elle ceint de tragédie. Et pourtant, jamais l’approche donnée ici ne se perd dans le pathos : l’expression est juste, elle provient d’une lecture attentive de la partition.
J’ai aimé, dans les deux critiques qui m’insupportent, cette dichotomie dans ces lignes étranges : Mäkelä non, mais l’eau ferrugineuse, oui, l’eau en question étant le mérite et la beauté sonore de l’orchestre de Paris. Eh bien figurez-vous messieurs que l’orchestre tenait en ces deux concerts, son élan et son allant de ce chef obsédé par le détail comme par l’énergie bien tempérée. C’est cela, être un inspirateur, un initiateur, un mobilisateur, un chef dans le sens le plus ouvert et le plus constructif qui soit. Un orchestre à l’aise dans sa sonorité et tendu dans son expression, n’est pas un canard sans tête : il est guidé par ce petit monsieur qui semble vous déplaire tant, parce qu’il s’agite trop à votre guise. Là encore, Bernstein vous aurait semblé bien vulgaire, lui qui dansait littéralement sur scène, sautait, éructait parfois. Le petit monsieur en l’occurrence, chef exalté certes, communique de manière volontairement démonstrative son énergie et l’intelligence de ses approches à un orchestre à l’unisson de son aura. Voilà. Ce n’est certainement pas le nihilisme où vous errez qui saurait assurer la moindre seconde de ce déferlement généreux, juste, large et pour tout dire admirable.
Après le paysage amer de l’Andante (la structure symphonique est comme on le sait réorganisée ici en un porche dont les deux colonnes d’encadrement sont des mouvements lents, les deux mouvements rapides complétant le péristyle en son milieu, du rappel faussement enjoué du monde tel qu’il va). Avec avant tout la scène champêtre mais problématique où la joie paysanne se trouve brusquement obscurcie par une sorte de confusion savamment mise en sons (« Im Tempo eines gemächlichen Ländlers », « Au rythme d’un paysan tranquille »). Et c’est encore et toujours le sens des pupitres « individualisés » qui permet à Mäkelä d’inquiéter l’élan, d’une intranquillité qui s’entend dans sa matérialité de timbres : le vrai Mahler est aussi dans le mordant de ces grimaces, de cette ironie désabusée qu’il faut savoir vouer à une mise en scène très théâtralisée, de phrases aigres à souhait. Tout comme l’intention ouvertement « burlesque » du Rondo – Allegro assai, qui aggrave les déséquilibres, se dit très puissamment sous la baguette de Mäkelä, par la dislocation de l’écriture fuguée, qu’on entend tout comme on l’entendrait dans l’opus 130 de Beethoven et sa « Grande Fugue ». Mäkelä, pour sculpter les timbres, n’en est pas moins architecte, dans cette vaste déconstruction du contrepoint où sa science des dosages des différentes voix, là encore et pour le redire volontairement, s’entendait à qui voulait l’écouter.
Mais arrivé au seuil du sommet, l’Adago final qui est sans conteste l’une des plus grandes pages de l’histoire de l’écriture symphonique, arrivé donc devant ce qui peut paraître comme un monolithe intimidant, Klaus Mäkelä, chef d’aujourd’hui vingt-huit ans, s’est mué en vieux moine bonze. Car il en faut, de la sagesse, pour construire avec un orchestre une version aussi accomplie de cet adagio-chef-d’œuvre absolu de la musique, qu’on cite souvent comme le lieu et la formule d’une expression en musique du sentiment d’acceptation et d’apaisement devant la mort. Alors oui, voici donc ce jeune chef avec un orchestre révélant la même sagesse, qui nous mène incontestablement sur les cimes d’une musique muée en métaphysique des sons, pas moins. L’unité de l’être atteint, par la musique et en l’occurrence, en un concert : on doit réclamer dorénavant l’enregistrement, pour un chef dont la très récente discographie est en train de s’étoffer à son rythme. Mäkelä à la tête de l’orchestre de Paris dans la Neuvième de Mahler, ce sont donc in fine les scories du monde qui peu à peu disparaissent, s’évanouissent pour qu’en effet ne demeure que la quintessence de l’être, audible à la faveur et par la grâce de ces grands aplats de l’âme, points d’orgue généralisés à une méditation. Rien que ça. Quand vous parvenez à réussir ça, c’est qu’en effet – et quel que soit votre âge (j’y reviendrai, ô que oui) – vous êtes définitivement un grand, un très grand chef parmi les grands, et que non, le monde de la musique ne s’est pas trompé en vous plaçant là où vous êtes désormais. Le chef a franchi incontestablement un seuil à l’aune de ces deux concerts, et le public l’a bien compris. Que deux critiques ne l’aient pas compris quant à eux, on ne peut que les plaindre. Mais il faut s’interroger sur les raisons qui motivent une telle surdité.
Les Désarrois de l’élève Törless / Mäkelä
J’ai volontairement choisi de placer mon propos dans les pas de l’un des fleurons du Bildungsroman, la tradition du roman d’apprentissage, et en l’espèce celui de Robert Musil de 1906, Les Désarrois de l’élève Törless, pour en venir, avec le secours de l’ironie, à ce qui me paraît illustrer, dans les deux critiques que j’ai lues avec consternation à propos du concert du 2 octobre, ce que je nommerais un « préjugé d’âge », par ailleurs nommé « âgisme ». À savoir, comme je l’avais dit plus haut, ce qui me paraît être l’enveloppe la plus évidente du propos parfois tenu sur Klaus Mäkelä mais qui m’intéresse même au-delà de son cas, parce qu’il est également tenu aujourd’hui sur beaucoup de jeunes musiciens dans le milieu de la musique dite « classique ». La chose me semble désigner une réalité sociologique intéressante (en termes de comportement répandu), dont il faut prendre conscience, et j’y viendrai. Mais je profite justement de ces deux critiques et des inepties qu’elles propagent, pour partir du constat. En lisant les deux critiques de Diapason et de ResMusica, j’ai eu la singulière sensation de lire un carnet de notes. Oui, de notes, ou d’appréciations apportées dans le « carnet de correspondance » d’un collégien. Je ne sais pas si au collège on pratique encore ça, mais en mon temps les appréciations, remontrances, « avertissements » ou autres qui étaient adressées à un collégien et destinées à ses parents en guise de communication, étaient donc consignés dans un carnet de correspondance, où les enseignants exerçaient ce qu’ils pensaient être leur prérogative d’autorité. Eh bien je vous assure que c’est très exactement le ton que j’ai retrouvé dans ces deux courts textes. Il ne s’agit pas d’une critique adressée à un chef d’orchestre, mais des appréciations données à un élève. Dans ResMusica, c’est finalement un encourageant mais sévère « Peut mieux faire » qui lui est adressé. J’ai été attentif à des formulations comme : « Pas plus aujourd'hui qu'hier, l'Andante commodo [sic] ne parvient-il à dégager une véritable ligne directrice, Mäkelä échouant à rassembler dans un tout cohérent ce qui est épars au sein de ce poudroiement de timbres » ; « se confinant dans une lecture très appliquée »: l’élève a donc échoué, sur le chemin pourtant prometteur de son application. Mais surtout : « De l'audace, Klaus Mäkelä n'en manque pas assurément, du talent et du charisme, c'est également un fait acquis, mais sa maturité semble encore insuffisante pour aborder une telle œuvre où le non-dit est aussi important que les notes ». Merveilleux, vraiment. Voilà donc un critique musical juge de la « maturité » d’un chef, « encore insuffisante » à ses yeux pour se hisser au niveau des adultes accomplis si je comprends bien, ceux qui accèdent au « non-dit » de Mahler. J’aimerais qu’on m’explique comment en musique, on entend la maturité : moi, je peux entendre un travail sur les timbres, les articulations, les couleurs éventuellement, toutes choses déjà compliquées à percevoir, à condition qu’on soit attentif pour de bon. Mais entendre la maturité, j’avoue ne pas savoir de quoi il retourne. Juger des performances d’un artiste, c’est se fonder sur ce qu’on entend pour de bon lors d’un concert ou dans un enregistrement, ce n’est pas s’ériger en psychologue scolaire pour juger de la « maturité » d’un interprète considéré comme un élève. Or de toute évidence, Klaus Mäkelä est devenu bon an mal an, au détour des critiques qui lui sont aujourd’hui adressées par quelques-uns, un peu l’« élève » dont on s’autorise à juger des réalisations avec le ton ouvertement paternaliste d’une sorte de vague droit d’aînesse au gré duquel le jeunot est au mieux mis à l’épreuve. Et je n’exagère pas, croyez-moi. Dans Diapason, il nous est précisé que fort heureusement, grâce à l’excellence de l’orchestre de Paris, le concert aura tout de même offert « quelque motif de réconfort », le jeune Mäkelä étant fort heureusement secondé par des adultes qui, eux connaissent leur métier. On croit rêver. Mais si éventuellement vous pensez que je fais une fixation sur ces deux critiques lamentables, renseignez-vous, lisez à droite et à gauche et dans le monde, ce que sont certaines critiques adressées au chef, et vous en comprendrez la nature commune. À titre d’exemple parmi tant d’autres, le propos ouvertement vulgaire porté par le musicologue américain David Hurwitz, que je vous laisse apprécier ci-dessous, en guise de critique unilatérale des enregistrements de Stravinsky et des Symphonies de Sibelius par Mäkelä.
Ici, on n’est plus dans la critique normale, mais dans quelque chose d’autre, qu’il faut décrypter et dénoncer. L’« âgisme », à plein régime. Et donc ce qui m’intéresse là-dedans, c’est ce que cela révèle vis-à-vis de nombreux jeunes musiciens aujourd’hui, qui peu ou prou se voient affublés du même type de considérations. « De quoi Mäkelä est-il le nom ? », oserais-je pour faire snob… Eh bien son cas, soyons-en sûrs, tout cela reflète un profond, durable et pathologique problème concernant le statut même des jeunes musiciens dans le milieu du classique. Ainsi, voilà un milieu qui, aux dires et au constat de tous, ne cesse de vieillir : il suffit de se pointer au moindre concert pour parcourir d’un coup d’œil la moyenne d’âge du public, et se retrouver soi-même à scruter les quelques jeunes (il y en a) qui s’aventurent dans ce vaste biotope de gérontocratie culturelle. Peut-être, moyennant les mécanismes d’« identification » aujourd’hui à l’œuvre dans notre monde d’apparences, auront-il franchi le pas de la salle de concert généralement fréquentée par leurs grands-parents, parce que justement, « l’un des leurs » est à l’affiche : la curiosité identificatoire est, j’en suis sûr, souvent à l’origine de ces brusques regains parfois sans lendemain, parfois oui. En tout cas, pour en revenir au constat dans son intégralité : voilà donc un milieu caractérisé le vieillissement de son public et pourtant représenté, plus que jamais (bien que ce fut toujours le cas) par l’étonnant renouvellement générationnel des interprètes. C’est-à-dire, pour être précis, que ceux qui servent cette musique sont des jeunes et que majoritairement leur public est fait de vieux (je me permets la caricature, qui n’est pas loin de refléter la réalité). Croyez-vous que la chose puisse n’avoir aucune conséquence dans la perception même de la musique ? Ce serait mal connaître l’être humain et ses instincts grégaires : en exacte réaction inversement proportionnelle à la communication effrénée des grands majors du disques ou des labels élitistes misant, reconnaissons-le, sur une surenchère hystérique sur la plastique juvénile de leurs poulains (voir les pochettes qui rivalisent en la matière), de sourires en coin en applaudissements convenus, les jeunes musiciens sont souvent pris au mieux pour des « stagiaires » dans leur domaines. Et quand le piège de leur enfermement dans la conception du « jeune prodige » leur revient en boomerang, c’est l’autre face de l’adulation qui se manifeste alors : c’est le temps de déferler, pour un regard en surplomb, celui où on s’autorisera sans vergogne à évaluer leur « maturité ». Surtout si vous avez été adulé, vous serez alors considéré au nombre de boutons d’acné qu’il vous reste (vous serez ramené à votre jeunesse, et finalement nié par cette réduction même). Certes, lorsque j'ai assisté au premier concert de Klaus Mäkelä à la tête de l'orchestre de Paris (était-ce en 2019 ou en 2020, je ne me souviens pas trop), en le voyant entrer sur scène, j'ai cru l'espace d'une seconde, qu'un stagiaire de Troisième s'était égaré sur scène, mais à aucun moment je n'ai profité de cet étonnement pour le réduire, dans ma perception, à son âge. C’est aussi l’autre piège de ceux qui auront volontiers épousé au début de leur carrière, le lamentable et émollient système des concours au gré duquel vous êtes jugé, votre jeu disséqué dans le mécanisme de la compétition avec toujours plus jeune, plus prodige que vous. Accepter ce système, c’est aussi dans une certaine mesure devoir assumer au début de votre carrière, être ramené à votre âge, votre apparence physique et votre… maturité, évaluée selon les règles de l’art. Dans le monde du classique, le système des concours, si souvent vilipendé mais qui se survit à lui-même comme sempiternel pourvoyeur de cartes de visites, préfigure bien le regard porté sur les jeunes musiciens.
Aujourd’hui, où le surplomb se confirme, au-delà du cas Mäkelä, pour nombre de ses collègues, il faut considérer me semble-t-il, ce que signifie cette attitude, et ce paradoxe d’une haute tradition qui repose sur les épaules d’une jeunesse formée au plus haut niveau, pour qu’ensuite cette transmission soit offerte à un public « acclimaté », désabusé et blasé. Savoir être surpris par une interprétation, sa qualité, sa justesse ou son originalité légitime, c’est savoir sortir des habitudes, des assoupissements du déjà-entendu, et je me plais à m’imaginer dans une salle de concert lambda, que ceux qui seront le plus capables de cet éveil indispensable, ce seront justement les plus jeunes. La transmission la plus importante, se fera vers eux, et vers les happy few qui auront su se déshabituer de leurs propres réflexes – et ce n’est pas nier la valeur des références pour autant, car le jeunesse ne saurait constituer un critère a priori dans ce domaine ou aucun autre : ce serait demeurer de l’âgisme, mais dans l’autre sens. Klaus Mäkelä quant à lui, semble souffrir pour ce qui est de ses enregistrements déjà publiés, de jugements hâtifs, face à des options souvent sophistiquées mais pourtant très convaincantes à mes yeux – que ce soit dans ses Sibelius ou ses Chostakovitch (j’aurai l’occasion d’y revenir ailleurs). Finalement, et en cela, il illustre à merveille la formule de Musset que je ne suis pas loin d’adopter pour qualifier cette position caractéristique du jeune musicien aujourd’hui dans le monde du classique : « Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux ».
Par eux pourtant, par ces talents jeunes, c’est la vie des partitions endormies qui renaît : par leur vigueur, leur passion souvent incoercible, par leur sagesse aussi, étonnante et n’attendant pas le nombre des années. Alors, avec un front serein, je me les représente poursuivant leur parcours, insoucieux déjà de leur jardin imparfait, et faisait fi des aigres et chétifs murmures d’envie, de jalousie – toutes moisissures qui, finalement comme sur les fromages de bon cru, sauront sur leur réputation accentuer les fragrances de nouveauté, de renouvellement, au service des œuvres qui viennent de si loin et qui revivent par eux. Depuis toujours et encore maintenant, moi qui balance entre deux âges pour pasticher Brassens, je dirais volontiers aux doctes critiques qui s’acharnent sur Klaus Mäkelä : le temps ne fait rien à l’affaire... quand on est doué, on est doué.
Sur ce, dans les semaines qui viennent, je me coltinerai à une petite série de quinze portraits de ces jeunes musiciens qui aujourd’hui dans le monde du classique, renouvellent les présences des œuvres. Volontairement, je nommerai cette série par le vocable de « Jeunes Maestros », défense et illustration de leur sacerdoce, rendu compliqué par les paradoxes d’un milieu qui oscille entre un déclin annoncé, et la renaissance qu’ils incarnent. Et devinez par qui commencera cette série...



