
Si certaines des qualités si brillamment illustrées par Carlo Maria Giulini dans ses intégrales des symphonies de Brahms le rapprochent souvent des versions de Karajan, il faut reconnaître que ce qui différencie radicalement les deux chefs repose surtout sur le choix des tempi - et la comparaison ne peut s'effectuer qu'au détriment de Giulini. Car il est en effet une limite où le choix du tempo touche à la fidélité aux indications laissées par le compositeur lui-même, et pour s'en être affranchi dans certains cas, Giulini a laissé à raison le souvenir d'un chef qui souvent prenait des libertés plus que discutables en la matière, en faveur de tempi lents voire très lents. Un réel problème pour Brahms, où le souffle est inséparable de l'impulsion - ce qui ne retire rien à la grandeur des versions de Giulini, je m'empresse de le dire.
Je l'ai dit, six chefs me paraissent avoir côtoyé les cimes dans les symphonies de Brahms, j'en répète la liste imparable selon moi : Bruno Walter, Otto Klemperer, Leonard Bernstein, Claudio Abbado, Carlo Maria Giulini et... Herbert von Karajan. Et étant donné que toute intention d'intégrale manifeste des réussites plus ou moins inégales, si je devais choisir entre ces six-là, celui d'entre eux qui, dans une intégrale, a su tenir toutes les promesses des qualités les plus enviables, je retiendrais sans hésiter Karajan.
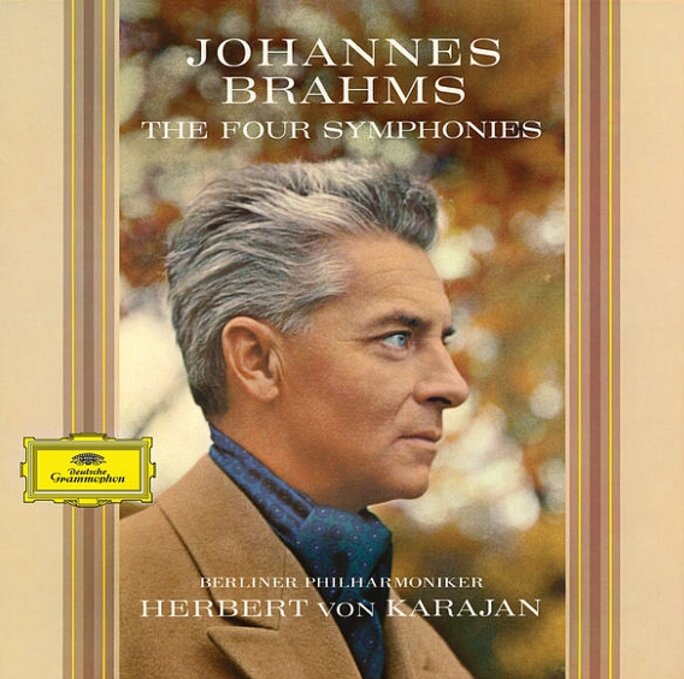
Je précise : dans sa deuxième intégrale, celle qu'il a enregistrée en 1977-1978 avec le Philharmonique de Berlin. Les deux autres également enregistrées avec le Philharmonique de Berlin (1964 et 1988) ne sauraient pourtant être considérées en retrait de celle-ci. La première intégrale, dont les choix interprétatifs sont proche de la version de 1978, bénéficie d'une prise de son parfois plus « sèche » qu'en 1978, haute époque de la DG et de ses chefs-d'œuvre stéréo. La troisième intégrale, gravée quelques mois avant la mort de Karajan, est parfois considérée à tort comme plus grandiloquente, pour ma part je n'y vois pas d'ajout notable par rapport à la merveille d'équilibre de 1978.
L'osmose du chef autrichien avec « son » orchestre de Berlin dont il avait été nommé chef à vie en 1955 est, en ces années soixante-dix, porteuse de réalisations assez inouïes, restées sans équivalent dans l'histoire discographique, pour ce qui est de la continuité et de l'unité d'enregistrements tous superlatifs. C'est de cette époque stéréophonique que naît la réputation et à vrai dire la confusion entretenue autour d'un Karajan qui aurait été unilatéralement obsédé par la beauté sonore. Réputation fondée en effet selon moi sur une confusion, car s'il est vrai que la recherche de profondeur et d'ampleur sonores menée par le chef est tout à fait décelable dans les enregistrements de cette époque et tous ceux qui suivent, je ne vois pas où ni comment on pourrait légitimement voir là un critère qui aurait été mis au-dessus des autres, et notamment au détriment des articulations. Archi-faux. On se rend compte fort heureusement maintenant, que cette réputation reposait surtout sur un préjugé, et sur l'ampleur d'une sorte d'« anti-karajanisme » latent ou virulent que certains se sont complu à diffuser dès lors. C'était se focaliser sur l'accessoire, sans être attentif à la minutie bien réelle du travail des masses orchestrales qui caractérisera toujours Karajan. Découper le son par sections instrumentales pour mieux appréhender la masse de l'orchestre comme un tout dynamique mais jamais indistinct : voici, pour essayer de le dire de manière synthétique, ce qui fonde la profonde empreinte de Karajan sur le direction au XXe siècle. Et en ces années, ses intégrales de Beethoven et de Brahms sont là pour le démontrer. Il faut savoir y être attentif sur le strict plan musical, en faisant fi des polémiques qui dès cette période n'ont cessé de faire rage autour de la figure controversée de Karajan - et celle d'être le chef d'orchestre « jet-set » ne fut pas des moindres, sans oublier bien sûr les raccourcis diffusés autour de son adhésion au parti nazi durant la guerre, pour des motivations carriéristes. On est revenu je crois de ces antiennes, surtout depuis que les meilleures biographies ont su mettre en perspective le parcours d'un artiste pour qui la musique était une religion, sans rien au-dessus (absolument rien), tout comme d'ailleurs son rival de toujours Wilhelm Furtwängler, qui nourrissait à son endroit une détestation chronique et ne parlait de lui que par le sobriquet de « Herr K ». Si le personnage savait être cassant, si certainement le modèle du chef omnipotent et omniscient qu'il a incarné ne pourrait plus être supporté aujourd'hui (lui dont un battement de paupière était instantanément compris par les musiciens du Philarmonique de Berlin), demeure un legs immense, que ces enregistrements Brahms représentent au plus haut niveau d'accomplissement.

Agrandissement : Illustration 3

Le sommet de la symphonie brahmsienne, la Quatrième en mi mineur op. 98, celle par laquelle se clôt en 1885 le grand cycle symphonique commencé en 1876, connaît ici son écrin d'énergie et de pulsation rythmique. On comprend, en écoutant ça, que cette musique ne peut uniquement s'envisager par sa grandeur, mais que tout non « nerf » fait appel à des qualités d'énergie dans la battue, que Karajan incarnait physiquement aussi, lui qui mit son dos en marmelade à force de tension, celle qu'on retrouve fidèlement dans les captations elles aussi légendaires d'UNITEL pour la ZDF dans les années 1973-1974 (captations dont Karajan contrôlait le moindre plan comme on le sait). Ici, la Quatrième, sa puissance d'ordonnancement, sa force énonciatrice, son bouillonnement même, rival des vagues de l'océan qu'il s'agit de savoir affronter par gros temps. Personne je crois, ne peut passer à côté de la substance de ce qui demeure le chef-d'œuvre symphonique de Brahms, quand il est servi avec une telle élévation et une telle force :
Dès la Première symphonie en ut mineur op. 68, cette force expressive semble désigner quelque chose, une esthétique, qui est au cœur de cette musique. Et si on a dit l'héritage beethovénien (inhibant au début, puis libérateur) de Brahms symphoniste, il faut savoir déceler ce qui, dans cette Première symphonie de 1876, l'un des tributs les plus marquants à Beethoven justement, dans cette imprégnation de l'écriture par un élément qui, en musique, apparaît avec lui avant d'être repris par les plus grands. Cet élément, que Karajan parvient à souligner à merveille par l'ampleur de sa battue pourtant toujours très rigoureuse, cet élément que Beethoven avait gravé dans l'art symphonique dans sa Septième, cet élément qui libère en nous l'endorphine d'une certaine euphorie physique (avant que de passer par l'esprit), c'est la sensation de l'espace. Quelque chose a été déposé dans cette écriture, qui toujours cherche à excéder le cadre de la mesure musicale, et fraie dans des chemins jusqu'alors inédits, une démesure proprement « spatiale » de la musique. Sans doute y a-t-il là cette marque d'un romantisme très particulier : un romantisme qui refuse que les règles soient bouleversées (ce qui fait de Brahms le plus « classique » des Romantiques), mais qui dans les règles elles-mêmes, parvient à instiller ce que la tradition n'avait pas encore parcouru - pas encore, jusqu'à Beethoven, s'entend. On a ainsi tant glosé sur la pulsation effectivement « cardiaque » du rythme impulsé par les timbales dans cette introduction marquante du premier mouvement, qu'on en a peut-être oublié l'essentiel, qui est l'alliance, pour filer la métaphore, entre ce battement cardiaque et le flux sanguin, incarné quant à lui par le tutti des cordes : une intériorisation émotionnelle du flux du monde, en somme tout Brahms. ce Romantique qui se voulait classique a peut-être incarné là la puissance de l'une des postulations essentielles du romantisme : le monde est en moi - mais le moi n'est pas le monde, au contraire de ses contemporains. Le monde bat dans notre poitrine, et l'art restitue ce battement lui-même. Et pour Brahms en 1976, l'élan et le flux du monde, c'est aussi celui de l'idylle à jamais platonique avec Clara Schumann, après le chagrin de l'internement puis la mort de Schumann. C'est tout cela, ce flux de la vie elle-même, son effroi et sa grandeur, que Karajan projette avec son orchestre, en 1973 :
Parvenir à tirer tout cela d'un orchestre peut causer chez le spectateur lambda une illusion. Car à défaut d'être soi-même musicien, et d'avoir fait de l'orchestre en particulier, on ne se représente pas en général ce qu'un tel résultat implique comme labeur. Il existe bien des captations de séances de répétition menées par Karajan, mais une d'entre elles (qui n'existe pas en intégralité sur Internet) illustre ce niveau d'exigence à peine imaginable dont il faisait preuve avec les orchestres qu'il dirigeait : en 1987, il avait été filmé lors du Festival de Salzbourg, en train de littéralement épuiser les cordes lors d'une répétition de l'Ouverture de « Tannhäuser » de Wagner, en recherchant coûte que coûte l'intensité de trémolos fortissimo. Le chef (déjà diminué à l'époque) est conscient de la tension musculaire que cela implique dans un orchestre au moment d'une intensité sonore à son maximum, sur plusieurs dizaines de mesures ; et pourtant, même face au Philharmonique de Vienne, l'exigence est intacte, de la part d'un chef vieillissant et malade, une exigence totale, qui ne se satisfait en aucun cas de l'à-peu-près. Sans doute a-t-on aussi cassé le moule de ce profil de musicien aujourd'hui. Dans l'extrait qui suit de ce documentaire dont est issue cette séquence, c'est avec les vents qu'il commence sa quête du timbre juste : https://www.youtube.com/watch?v=TNuzV_3Q4So
Il faut conserver à l'esprit cet aspect d'un travail acharné, mené en amont avec les musiciens de l'orchestre, quand on est charmé par une extrême beauté qui semble aller de soi, cette beauté par exemple du célèbre 3e mvt. Poco allegretto de la Troisième Symphonie en fa majeur op. 90 :
L'œuvre dans son intégralité, Karajan à la tête du Philharmonique de Berlin, en 1973, et le lyrisme spécifique de cette Troisième symphonie, incontestablement la plus sensuelle des quatre :
Repoussant les limites de la douleur physique causée par de multiples opérations à la moelle épinière, usé par les antalgiques et bravant l'interdiction de ses médecins, Karajan continua de diriger durant les quatre dernières années de sa vie, ce qui n'arrangea pas son état de santé. En 1985, avant qu'une rampe ne soit installé à son usage sur la scène de la Philharmonie de Berlin pour soutenir son dos (puisqu'il refusa toujours de diriger assis), Karajan dirigeait l'Ouverture tragique op. 81 de Brahms, contemporaine de sa Troisième symphonie, et où encore la sensation toute beethovénienne d'un espace sonore qui s'élargit à mesure de l'avancée de l'œuvre :

En 1988, suivant en cela le souhait qu'il avait exprimé dans les toutes dernières années de sa vie, Karajan enregistra donc une troisième intégrale pour Deutsche Grammophon, selon les dernières avancées technologiques de restitution sonore, lui qui se montra si enthousiaste dans la transition vers le numérique. Il voulait graver cette fois-ci les versions définitives qu'il lèguerait ainsi à la postérité. Mais il faut croire qu'après avoir tant marqué la discographie, le chef avait déjà laissé derrière lui un héritage artistique incomparable.
Tenant des formes classiques en un temps où il défendait la « musique pure » contre la musique à programme et le wagnérisme triomphant, Brahms symphoniste a pu représenter aux yeux de certains de ses contemporains un courant traditionnaliste, tout en repoussant les limites de l'expression musicale. Il a légué à ce titre quatre chefs-d'œuvre symphoniques empreints d'un équilibre rare, qui méritaient un engagement complet et une abnégation dont seuls quelques-uns ont su témoigner. Avec Walter, Klemperer, Bernstein, Giulini, Abbado, Herbert von Karajan fut sans doute l'un des plus purs représentants de cette lignée de chefs « brahmsiens » ayant su se hisser à un très haut niveau où l'amplitude sonore rejoint la puissance et la clarté de l'énonciation. Avec eux, grâce à eux, nous pouvons à notre tour nous hisser vers un univers musical de beauté accomplie qui est là, invulnérable par leurs enregistrements.



