
À l'image du présent billet, mes chroniques musicales seront dorénavant publiées à la fois ici et sur mon site spécifiquement musical, loiccery-musique.com qui regroupe désormais l'ensemble de mes chroniques de concerts, d'enregistrements et autres analyses musicologiques. Ainsi, la présente chronique est à retrouver sur le site, à cette adresse.
_____________________________
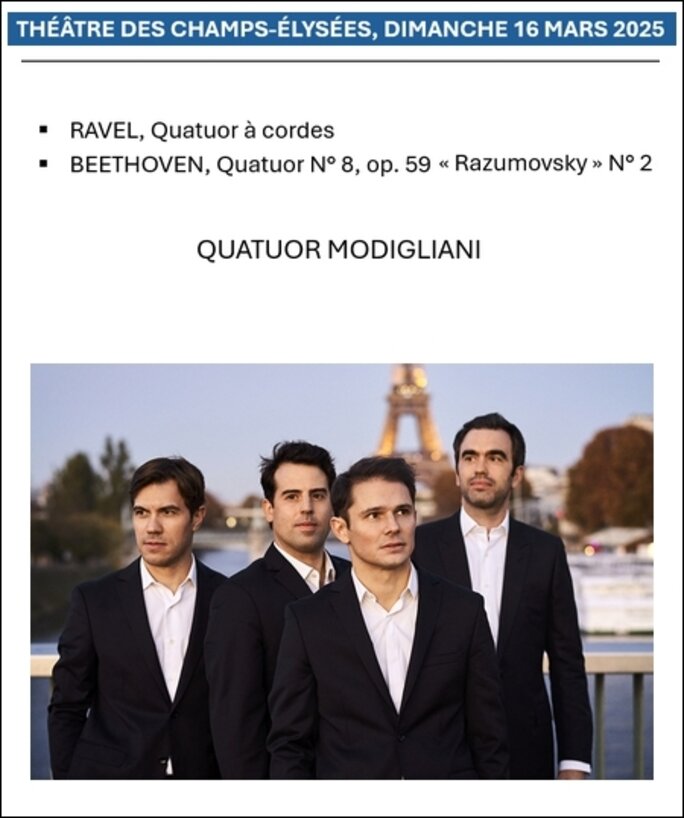
Théâtre des Champs-Élysées, dimanche matin 11h : après cinquante ans d’une tradition bien établie, la productrice Jeanine Roze a annoncé qu’elle arrêtait les « Concerts du dimanche matin », ce rendez-vous devenu incontournable de la vie musicale parisienne. Pas par renoncement (ce n’est pas son genre) ou problèmes financiers, mais simplement parce qu’à 82 ans, elle désire légitimement limiter ses activités de production. Alors on ne sait pas encore si son successeur reconduira la formule (on le souhaite ardemment), en tout cas ce concert du 16 mars dernier avait un goût de madeleine, comme tous ceux qui seront menés jusqu’à juin prochain. Et la madeleine en question, nous était offerte par la formation qui est à mes yeux le quatuor le plus marquant aujourd’hui en France (avec les Ébène), ce Quatuor Modigliani dont le seul nom réjouit et émeut d’avance, quand on a à l’esprit les sommets discographiques qu’ils ne cessent de laisser dans leur sillage, en nous gratifiant de cette élégance seigneuriale et inimitable de leur service de la musique qui est un sacerdoce, et de leur profondeur expressive, qui est un privilège. Le programme de cette matinée était à l’image du spectre d’excellence de ce quatuor d’exception, de la puissance du cycle des Razumovsky de Beethoven aux teintes pointillistes du Quatuor de Ravel. Une matinée d’enchantement, avec un TCE à guichet fermé pour l’un de ces ultimes rendez-vous matutinaux pour lesquels la formation, fidèle de la tradition, a tenu à remercier avec ferveur Jeanine Roze, à qui le public parisien est si reconnaissant lui aussi.
LES MODIGLIANI, MAGICIENS DES TEMPORALITÉS
Le miracle a opéré, encore. Le Quatuor à cordes en fa majeur de Ravel avait ce charme qu’on ne connaît qu’aux meilleures approches de l’œuvre et confirmait ce qui fait selon moi l’une des particularités du Quatuor Modigliani, je veux parler de cette texture sonore à la fois chaleureuse et ample, qui permet à certaines partitions de trouver leur juste respiration. Le quatuor de ce Ravel de vingt-sept ans trouvait là cette succession très debussyste de fluidité mélodique et de moments irisés, qui frappe dès l’Allegro moderato. Alors, lorsque, annoncés par une tonalité de questionnement et une sorte de filet tendu par le violoncelle de François Kieffer et le violon de Loïc Rio, Amaury Coeytaux s’élance dans le second thème du mouvement, on est littéralement sur les ailes d’une grande beauté de timbres. Les Modigliani font manifestement partie de ces quatuors attentifs à une certaine grâce de l’énonciation qui rend possible une lecture limpide des œuvres, et les emmêlements harmoniques de Ravel sont ici exposés avec clarté et quasiment une manière de transparence.

Agrandissement : Illustration 3

Ritournelles ou jeux de mémoires thématiques, on est en tout cas dans ce Ravel, face à une certaine maestria du déroulement des temporalités, et on comprend chemin faisant que cette formation, comme elle l’a illustré au centuple dans son intégrale Schubert de 2021 tant saluée par la critique (sans doute l’acmé de leur discographie à ce jour, chef-d’œuvre d’accomplissement), est à même d’exposer pour l’auditeur, la substance d’une écriture. Cela fait penser, mutatis mutandis, à ces formations baroques capables de faire entendre l’intelligence du contrepoint, sans jamais renier la grâce d’un flux – rare capacité d’être à la fois architecte et poète. Dans cette veine si rare, ce « chemin étroit » comme dirait Gide, nul besoin d’accentuer les effets ou de forcer le trait : les Modigliani vous donnent accès à la fois à l’intimité de la musique mais aussi à la subtilité de son organisation ; ils ont à ce titre ce « cœur intelligent » qui vous fait conscient d’une esthétique et témoin de la beauté. En ce 150e anniversaire de Ravel, c’est aussi livrer à tout un chacun les bonnes raisons d’admirer, avant même de commémorer.
Quand venait le deuxième mouvement et sa cascade de pizzicati, on n’avait aucun mal à se glisser dans cette chambre d’échos sonores et d’ondulations, où se confirmait que ce quatuor joue selon un relief consommé où les accentuations sont elles-mêmes ceintes charme. Le troisième mouvement, entre suspension, secousses et irisation, trouvait par ces musiciens un horizon d’élévation méditative mais inquiète de soubresauts. Jouer ainsi permet de tout ressentir de ces atmosphères changeantes, d’incarner cette sorte d’instabilité ontologique. L’écriture de Ravel est ici interrogative, et les musiciens savaient se mettre au diapason d’une attente. Le dernier mouvement, tout en empressements et fureurs, trouvait dans la vélocité elle-même des accents d’un affolement quelque peu théâtralisé que les quatre instrumentistes savaient exposer dans une course effrénée et haletante qui, loin de laisser le public exsangue, achevait de conquérir son enthousiasme.
FORCE APOLLINIENNE
Je vois encore les qualités d’expression des temporalités propres aux œuvres, se déployer assez miraculeusement dans l’approche bouleversante et puissante du N° 2 des Quatuors Razumovsky op. 59 de Beethoven. À tel point que, dans ma propre logique généralement si influencée par les versions tout en force, je suis d’autant plus admiratif de cette approche tout en équilibre, et où la puissance expressive est comme sertie dans une intelligence de la structure (on retrouve cette marque déjà présente dans le Ravel). Ce pourquoi j’ai tendance à ne jurer que part l’intégrale des Berg qui, sans faire l’unanimité, a su habiter en un certain sens ce que je nomme la « force apollinienne » d’une lecture où domine l’équilibre. Les Modigliani excellent dans ce registre si crucial pour un compositeur qui toujours a approché le quatuor dans la science de l’architecte, le souci de la structure d’ensemble et pour le redire, un génie du temps des déploiements. On ne s’étonnera donc pas que dans la diversité des versions, ce soit encore vers celle du Quatuor Alban Berg que j’en retournerai, pour donner une idée de cette force apollinienne qui, plus que jamais, permet de conférer à la structure de l’œuvre, tout sa cohérence. Car au milieu des quatuors Razumovsky, ce deuxième en mi mineur est sans conteste une incandescente terre de contrastes, entre un Allegro initial particulièrement signifiant de la deuxième période héroïque, tout en lutte et en affirmation, et un Adagio qui constitue l’un des sommets méditatifs du corpus beethovénien. Ci-dessous donc, le quatuor en mi mineur N° 8 op. 59 « Razumovsky » N° 2 par le Quatuor Alban Berg filmé à Vienne en 1989.
Ici, le Quatuor Modigliani est un modèle d’équilibre, à tel point qu’il pourrait aujourd’hui être considéré en exemple, c’est là une conviction personnelle. Équilibre général entre justement un sens de la structure et une expressivité que rien n’obère, et équilibre interne dans le savant dosage de cette expressivité elle-même, où rien n’est outré parce que rien dans leur approche ne confond la force et sa caricature, tout est parfaitement en place et ne transige jamais avec une juste distribution de la puissance. Ici Amaury Coeytaux est simplement admirable dans ce sens d’une énonciation dense, à l’instar de ses trois collègues qui, à l’avenant de ce registre d’équilibre, livrent dès l’Allegro une puissance qui sait se transmettre. Qu’on me comprenne bien : « équilibre » à mon sens et pour désigner ce qui se joue ici, ne veut pas dire « medium » ou compromis, il s’agit bien d’un dosage parfait, et qui ne peut être pris en défaut sur aucun paramètre des enjeux expressifs.
L’Adagio, où comme on le sait Czerny avait vu « une méditation sur l’harmonie des sphères, devant le ciel étoilé dans le silence de la nuit », et qui n’est même pas selon moi inscrit dans un mouvement dialectique avec le reste de l’œuvre, mais dans une intégralité de la pensée (la plus haute élévation métaphysique nullement obérée par la lutte initiale), prend dans l’interprétation des Modigliani, sa densité stratosphérique. Ces musiciens ont je crois, tout compris d’un langage des cimes qui est la plénitude, le tout, l’accomplissement, la sagesse, l’intensité, la pureté, la beauté. Le génie à son plus haut degré en somme, et tout cela rendu en son architecture et en sa force humaine. Les Modigliani vont loin, très loin dans la compréhension et la transmission de cette musique qui va au-delà du temps, qui vient d’être écrite pour chacun d’entre nous. J’ai toujours su que le Quatuor Modigliani est, fondamentalement, un quatuor beethovénien, et là j’en avais le frisson d’une confirmation éclatante, évidente et bouleversante. « Je vous ferai pleurer de grâce » (Saint-John Perse).
Sur la scène du TCE, ces musiciens déployaient encore les flambeaux intranquilles de l’Allegretto, haletant dans la quête d’un espace suffisant. On remarquait ces staccatos énergiques certes mais surtout soigneusement pensés, ces échappées dans les traits enjoués, eux-mêmes savamment agencés dans cette science cette fois-ci éminemment dialectique par laquelle Beethoven a le génie de développer une cellule de départ en un univers de développements, de transformations. Quant une formation de chambre vous fait comprendre cela même tout en jouant, c’est qu’elle a atteint les sommets.
L’ironie et la gaîté du Presto final rejoignait ici la plénitude, car on se comprenait que rien n’est jamais gratuit dans la joie beethovénienne, elle est l’expression d’une totalité et en son sein, le tout parle encore de chacun de ses aspects. Un retour cyclique quasiment nietzschéen avant l’heure et où les Modigliani savaient faire circuler l’énergie d’une marche en avant, toujours en avant, vers le soulèvement final. Le public éclate en applaudissements et en bravos, et c’est d’avoir vécu là un moment rare d’une science beethovénienne absolue, d’une transmission pure de la musique.
Toujours sculptant l’émotion sans jamais la diluer ni la trahir, les musiciens, en guise de bis, ont encore gratifié un public qui mesurait sa chance, et en saluant le sacerdoce de Jeanine Roze, de l’Adagio du quatuor op. 18 N° 1 de Beethoven, à savoir de l’un des autres sommets de l’élévation Beethoven. Chaque ondoiement donnait alors la sensation d’une offrande très humaine. Irremplaçable, et forcément ineffable.
Le Quatuor Modigliani est sans doute le plus intelligent des quatuors français. Intelligent dans le sens d’une pensée de la musique qui va au bout de son accomplissement. Mais ces quatre là sont aussi, et chacun dans le sens plein de sa maîtrise, des poètes des vibrations spirituelles de la musique. Un Quatuor qui est en soi un Dichter de la musique, à l’instar de Beethoven en sa quintessence. Il faut savoir remercier de tels serviteurs de la musique.
____________________________________



