
Agrandissement : Illustration 1

Je commence par un aveu, pour évacuer d'emblée une scorie : de tous mes violonistes préférés, Gidon Kremer est celui qui m'a toujours posé le plus de problèmes, par son jeu trop souvent maniéré à mon goût, dans le sens d'une recherche souvent trop expérimentale à mes yeux, de sophistications excessives en général. Il est à éviter soigneusement selon moi dans ses concertos de Mozart par exemple, où il se fourvoie en un malentendu fait d'un byzantinisme forcené, si éloigné de la simplicité ontologique à Mozart. Mais. Car il y a un mais, qui en fait un très grand. Et c'est sur ce « mais » que je voudrais me focaliser aujourd'hui, pour dire mon admiration de cet immense violoniste, déjà immortel dans des enregistrements de référence.
Son Beethoven est un prodige et son approche très intuitive dans le bon sens et le sens justement « beethovénien », interprétation par là puissante en expressivité dans sa version de référence enregistrée en 1982 avec l'Academy of St Martin-in-the-fields, qui souffre peut-être d'une direction honnête mais parfois plate de Neville Marriner (n'est pas Giulini qui veut, mais que voulez-vous). Mais quoi qu'il en soit cet enregistrement demeure à mes yeux l'une des versions de référence du Beethoven, incontestablement. Et on y a certainement l'essentiel du RELIEF qui caractérise l'art de Kremer, cette façon de sculpter le son en trois dimensions et dans les lieux névralgiques, de vous faire frissonner en vous racontant l'histoire même qui se joue dans la partition - celle-là en l'occurrence : l'éternelle lutte entre la lumière et l'ombre. Pourtant, pourquoi a-t-il cru bon de remplacer les si belles cadences de Kreisler par quelque errement pour le moins discutable, auquel il mêle de surcroît les timbales de l'orchestre ? Encore son maniérisme, sans aucun doute : souvent Kremer dessert Kremer par ce type d'excès ; si j'osais : souvent, c'est Kremer contre Kremer. Sans obérer pour autant la beauté de cet enregistrement d'anthologie, car quand il en revient à Beethoven lui-même, il est dans le juste, fondamentalement, et au plus haut de l'émotion.
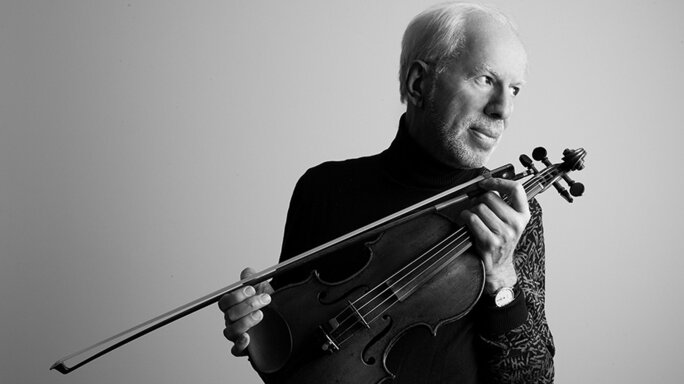
Agrandissement : Illustration 3
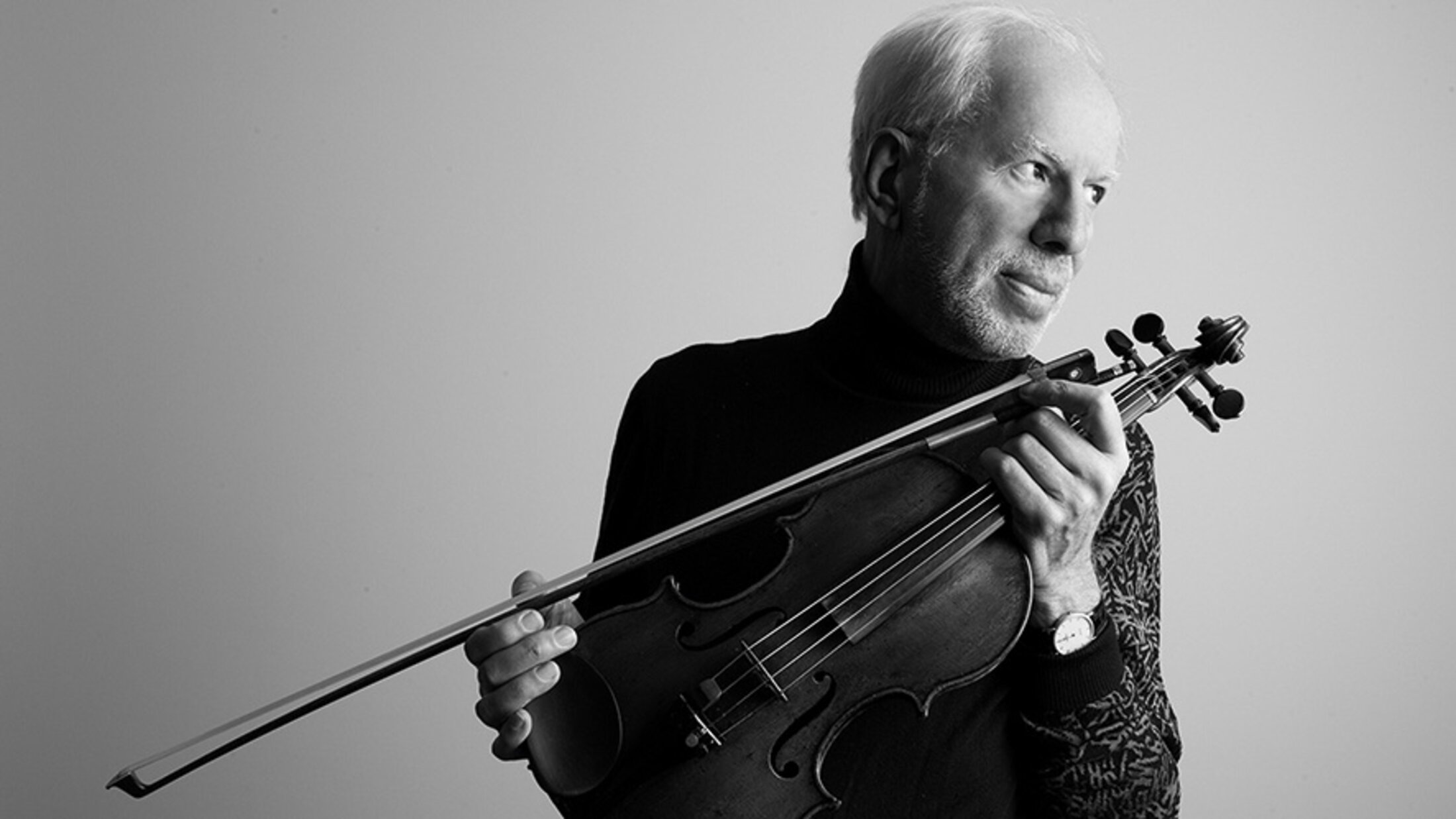
Alors que le jeu de Kremer peut très bien verser hélas dans des excès de surenchère, je l'ai dit, dans certains cas le mordant de ses attaques et surtout l'âpreté de son phrasé se marient à merveille à certaines œuvres et en livrent comme une quintessence brute. C'est le cas par excellence des sonates pour violon et piano de Beethoven qu'il enregistra avec Martha Argerich en 1983 et 1994. Une version parfois décriée, pour les raisons mêmes qui me la font considérer comme l'une des meilleures intégrales : violence, puissance, énergie pure et sauvage - les qualités à mes yeux essentielles pour faire ressortir l'esprit même de ces sonates et surtout de la Kreutzer. Le même esprit qui caractérisait la version Anne-Sophie Mutter / Lambert Orkis.
- 1-3 :
- 4-5 :
Et la Kreutzer, Mesdames Messieurs, par ces deux immenses musiciens, écorchés vifs de leurs instruments respectifs, artistes authentiques, passeurs irremplaçables ; c'est le moment de relire la nouvelle de Tolstoï, car la violence est là, l'animalité indomptable aussi. Franchement effrayant de puissance (et même dangereux aurait dit le romancier russe), on est saisi, pétrifié et on en reste durablement intranquille :
Autre prodige, son Brahms dans la version live de 1982 dirigée par Bernstein à la tête du Philarmonique de Vienne (à préférer de loin à l'enregistrement studio qu'il en fit avec le Philharmonique de Berlin sous la direction de Karajan). Là (encore), dans cet enregistrement sur le vif saisissant qui doit tant à un Bernstein jaillissant, Kremer est incontestablement l'un des plus grands, et il est plus que jamais le digne élève d'Oistrakh. Dans la plus pure tradition de l'école russe (ou plus exactement l'école d'Odessa, dont le conservatoire avait été récemment bombardé par l'aviation russe), Kremer est un grand fauve du violon, les pusillanimes passeront donc leur chemin. Rien de dilué ici, ni la puissance ni l'énergie brute. Encore un Brahms tout en relief, en accents, en éructations au besoin, mais c'est pour la bonne cause. Très rares sont les violonistes qui ont su tirer de ce concerto de génie tous les escarpements d'un paysage si riche (à vrai dire, mes deux références pour le concerto de Brahms demeurent Kremer et Perlman, dans l'enregistrement que ce dernier en fit avec Giulini à la tête du Chicago Symphony Orchestra en 1977).
Et dans le Double concerto de Brahms, c'est encore dans un concert de légende de 1982 avec le même Bernstein au Musikverein qu'il livrait, avec Misha Maisky, l'une des plus saisissantes, des plus phénoménales et des plus puissantes versions de ce chef-d'œuvre. Maisky-Kremer : deux versants d'un même creuset de jaillissement, car ces deux-là sont incontestablement de la même espèce de musiciens sur-intuitifs, ennemis du tiède et vecteurs de l'éclat. Peut-on être davantage dans la corde, dans le bois, dans l'âme du violoncelle et du violon ? Impossible. Évidemment, tout cela servi par un Bernstein des meilleures années, à la tête d'un Philharmonique de Vienne survolté. Terrifiant de beauté.
Et dans la Bible des violonistes, les Sonates et Partitas de Bach, ce moderne, ce chercheur en énonciation, excelle en demeurant dans sa ligne de sculpteur et de violoniste félin : https://www.youtube.com/watch?v=PWX_mohRkQ4
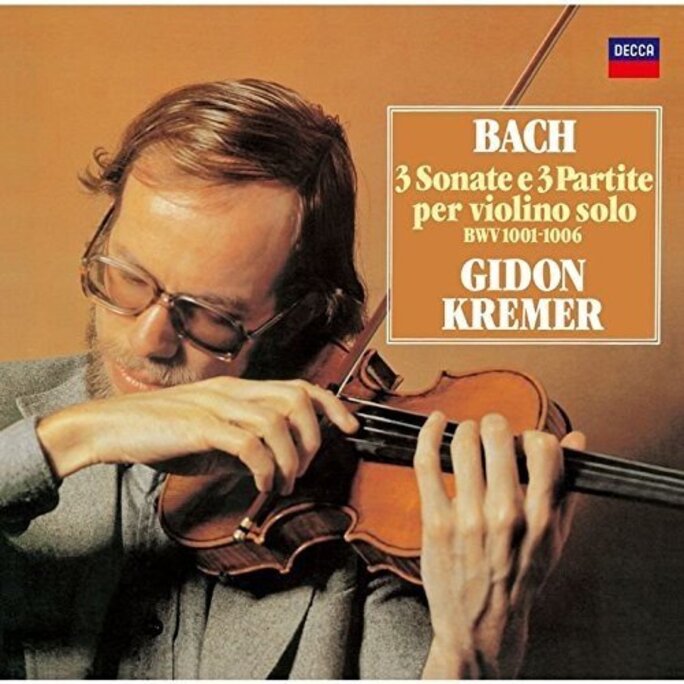
Gidon Kremer était à Paris il y a quelques jours. À cette occasion, rediffusion d'un grand entretien de 2018 sur France Musique, indispensable :
https://www.radiofrance.fr/francemusique/podcasts/serie-gidon-kremer-violoniste-grand-entretien



