
Agrandissement : Illustration 1
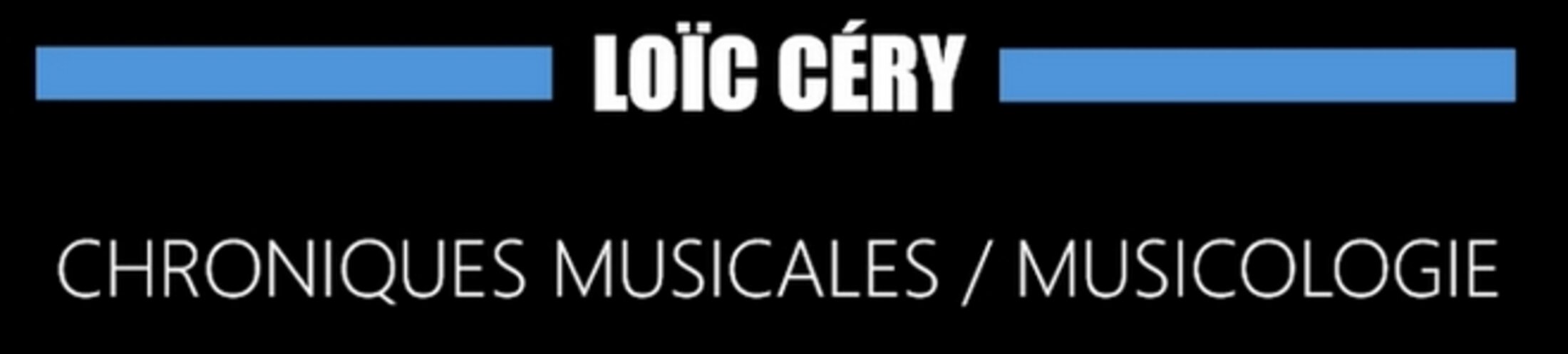
À l'image du présent billet, mes chroniques musicales seront dorénavant publiées à la fois ici et sur mon site spécifiquement musical, loiccery-musique.com qui regroupe dorénavant l'ensemble de mes chroniques de concerts, d'enregistrements et autres analyses musicologiques. Ainsi, la présente chronique est à retrouver sur le site, à cette adresse.
_____________________________________________________________
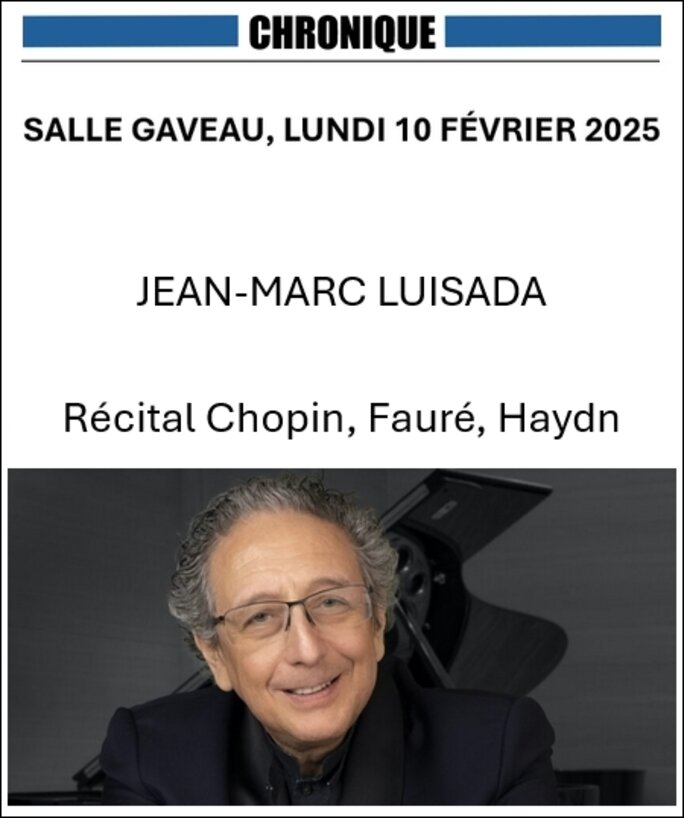
En s’apprêtant à en établir la chronique, il est de ces concerts, très rares, qui vous incitent finalement, à revenir sur la raison initiale que l’on se donne, d’établir justement de telles chroniques – la raison de fond, quand il ne s’agit pas d’une motivation professionnelle. Et devant le concert donné par Jean-Marc Luisada le 10 février dernier à la Salle Gaveau, je me sens irrémédiablement voué à pareille nécessité. Avant même de décrire combien tel Scherzo fut exécuté avec une telle délicatesse, pourquoi tel Scherzo rarement fut abordé avec une telle intelligence, dire pourquoi se prêter à cet exercice somme toute étrange qui consiste à parler d’un événement musical que les mots ne peuvent pas dire lorsqu’il atteint la plénitude – un exercice qui finalement peut paraître dérisoire s’il n’est sous-tendu ou justifié par une raison de fond. Et devant ce concert, comme devant tout grand concert, la raison d’être de la chronique me semble à la fois aller de soi et sortir de l’ordinaire : il s’agit de témoigner. Pas comme on le ferait devant un tribunal, mais au sens quasiment religieux du terme : témoigner de la beauté qui en une soirée a éclot, et le dire à tous ceux qui n’ont pas eu le privilège d’y assister et dans un certain sens et pour encore emprunter au registre religieux, pour « porter la Bonne Nouvelle » – de quelle épiphanie ? Eh bien de cet événement que je ne parviens toujours à aborder qu’au prix d’un mystère : celui de la transmission de la musique à son plus haut degré à un public privilégié.
Dans une certaine mesure, la parole devient dès lors à son tour un partage et une transmission : on dira à qui voudra bien y être attentif, que ce qui s’est produit tel soir est simplement de l’ordre de l’exceptionnel, et on essaiera de détailler pourquoi. Cette chose que finalement on guette en traînant ses guêtres dans les salles de concert : le moment suspendu qui littéralement vous fait décoller, vous place dans ce rare état d’extase musicale qui d’ailleurs a été identifié par les neurologues comme l’un des états limites du cerveau. Quand on est concerné, quotidiennement, par cet effet de la musique, on peut y reconnaître une addiction elle aussi décrite par ces mêmes neurologues comme une attente des neurotransmetteurs, d’une certaine catégorie de dopamine, mais dont l’intensité en ce qui concerne le contact à la musique, est également reconnue par les scientifiques, comme unique en son genre. Je suis ce qu’on pourrait nommer un « fan » de ce pianiste, mais ce mot même ne me convient pas. Je ne me reconnais pas en tout cas dans cette fixité lénifiante et cette position complaisante, et si un nombre très limité de musiciens ne m’a jamais déçu, c’est que dans les faits, ceux-là ont toujours su demeurer dans cet état de grâce et d’éclat qui a su les faire remarquer et qui a marqué leur réputation à jamais. De Jean-Marc Luisada, je suis aisément prosélyte, comme pour un certain nombre de musiciens (Perlman, Oistrakh, Kissin, Richter…) à propos desquels j’aime exercer cette sorte de diffusion, de persuasion et d’argumentation auprès de qui veut l’entendre. Enregistrements à l’appui, je dis : « trouvez-moi une approche aussi convaincante des Goyescas de Granados, une version aussi vertigineuse du concerto de Schumann, une interprétation telle des Valses de Chopin, ou de Schumann… » et je me prends à récapituler l’ensemble de la discographie existante, pour attester que quelque chose de très rare et qui est de l’ordre de la quintessence de la musique, se joue au gré de cette carrière, de ces enregistrements considérés comme points de repère. Et puis j’en arrive toujours à cette chose inouïe que fut l’album Schubert de 2023, chez Dolce Volta. Et là, péremptoire et même dogmatique, je prétends : « là vous êtes arrivé justement à la quintessence ». Pour moi, et pour le redire, il s’agit de la plus grande version jamais enregistrée des dernières sonates si bouleversantes et si tragiques de Schubert, mais il s’agit surtout de cela : la preuve irréfutable de l’accomplissement d’une quête de l’épure. Ce en quoi j’ai finalement trouvé pour quelle raison Luisada fait partie de mes références intégrales en matière d’interprétation : comme quelques autres qui sont donc à mes yeux les références absolus, ce musicien à mon sens a effectué une quête au cours de son parcours, et la fleur de sel de cette quête, tangible avec cet album Schubert de 2023, indique bien que le pianiste est parvenu à la quintessence de son art.
J’en reviens à la raison de parler, de dire, d’écrire à propos de cette quintessence. Celui qui admire, même pour les raisons précises qu’il s’est ingénié à détailler, à consigner, pour lui-même avant tout (histoire de ne pas se restreindre, justement, à cette position par définition captive et assez débile du fan) est souvent menacé malgré tout par un certain solipsisme. On peut très bien être enfermé dans une admiration musicale parce qu’après tout l’approche d’une œuvre par un interprète correspond à l’idée que vous vous en faites, ou même à cette idiosyncrasie qui fait votre goût personnel, mais finalement se retrouver seul à ressentir cet enthousiasme sans être sûr de pouvoir en faire apprécier les fondements. Et en l’espèce, il est un secours tout à fait tangible, que fournit un concert, car rien ne remplace en la matière l’attention qu’il faut aussi marquer après un événement de cet ordre : écoutez et regardez les réactions du public, elles peuvent souvent être surprenantes et parfois révélatrices. Après le concert Schubert de 2022 de Jean-Marc Luisada au festival La Folle Journée de Nantes, je n’ai personnellement jamais vu un public en pareil état après un concert : pas du tout sur le coup des applaudissements abondamment exprimés, mais à la sortie du concert, un public étonnamment silencieux, comme sonné par le vertige métaphysique procuré par ces dernières sonates de Schubert qui ne sont pas vraiment une musique de comique troupier : un public qui de toute évidence avait absorbé la gravité et la teneur spirituelle de cette musique, transmise alors sans intermédiaire, comme si le musicien se faisait psychopompe, officiant d’un dialogue de métempsychose entre un compositeur, une âme souffrante et presque martyre, et un public qui deux-cent ans après, entendrait des sons d’outre-tombe. Je n’ai pas rêvé : je n’ai pas donc été le seul après ce concert, à me retrouver en pareille lévitation, je ne délire donc pas en constatant un moment exceptionnel. Et pour le concert du 10 février 2025, ce bonheur fugace, cette sorte d’« aisance d’être » laissée par ce moment rare, fut aussi à l’avenant des commentaires que j’ai retrouvés sur les « réseaux » que je n’ose dire sociaux : « Je ne sais pas ce qui me touche autant dans les concerts de Jean-Marc Luisada » ou « Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis comblée »… Je ne suis pas donc le fan de service : les bienfaits des concerts de ce pianiste sont concrets et unanimes – j’ai dit un jour qu’il devraient être remboursés par la sécurité sociale.
Et en ce préambule (oui, j’en suis encore au préambule, je sais que j’en fais et même de très longs, et alors ?), j’aimerais encore non pas évacuer un élément, mais dire ceci, en termes de considération cette fois-ci extra-musicale au sens strict du terme : les concerts de Jean-Marc Luisada sont marqués par une atmosphère que je ne saurais pas définir au juste, sinon par la présence physique du musicien, son style de présence en somme, certains diront l’aura qui est la sienne et qu’il dégage dès son entrée en scène, saluant sa tourneuse de page avec la déférence d’un bonze. Chose particulièrement indéfinissable et pourtant palpable : une humanité, une humilité non feinte, une élégance (cette démarche à la Clark Gable parfois), un regard qui remercie le public quand c’est le public qui s’évertue à applaudir. Je le précise : mes applaudissements en pareil cas sont sonores, je prétends rivaliser avec n’importe quelle machine infernale ; je peux causer des lésions auditives à qui est placé à mes côtés car au moment adéquat, j’applaudis à m’en esquinter les mains, à m’en rompre des ligaments, je crée souvent les rappels par une insistance de forcené qui s’entend. Surtout que cette fois-ci, j’étais eu premier rang (à ma gauche une femme très élégante mais qui gigotait bien trop, à ma droite un pianiste qui reproduisait les doigtés sur son manteau posé sur ses genoux). Et face à moi, presque aux pieds du Steinway, quel spectacle se déployait alors ? Certes des bis généreux en fin de concert, mais surtout cette même attitude d’intense générosité, avec même cette pointe de nostalgie au moment de se retirer de la scène, comme la conscience d’un charme qui se rompt – ou plutôt qui plie mais ne rompt pas. Alors oui, on comprend que c’est aussi cela, les concerts de Jean-Marc Luisada : des moments humains autant que purement musicaux ; la trace d’une transmission où un enchanteur vous a accueilli dans son antre – et je l’ai déjà dit par le passé : cet antre est infiniment narratif, car Luisada est autant un conteur qu’un musicien, ou plutôt il s’agit d’un pianiste qui pratique la musique comme on raconte des histoires, tristes ou enjouées, avec toujours au fond de son décor un écran de cinéma. Il ne faut donc pas s’étonner si ses concerts suscitent aisément une imagerie qui vient à l’esprit pendant l’écoute. La dominante Chopin de ce programme m’a quant à moi transporté à Nohant, au crépuscule et devant la grande maison, au début de l’une des soirées mémorables. Et c’est dans l’évocation de trois films fameux que je me plais au souvenir du concert de Gaveau.
CRIS ET CHUCHOTEMENTS : CHOPIN DANS LA FRATERNITÉ DE FAURÉ
La première partie du programme permettait d’alterner certains Nocturnes de Chopin et de Fauré, en une cohésion elle-même intelligente, et une succession elle-même pertinente. On pouvait croire, en cela, que semblait s’instaurer là un dialogue imaginaire, un peu dans le registre de confessions croisées. L’impression aussi de poursuivre un idéal d’équilibre, dans cette forme si paradoxale du Nocturne, mêlant un chant volontiers élégiaque à une scansion rythmique évolutive voire intranquille. Traces poignantes d’une nostalgie palpable dans les Nocturnes de Chopin, et dès le N° 17 (N° 1 de l’op. 62), le pianiste suggère les couleurs automnales d’une sourde mélancolie qui prend les traits d’un apaisement de retrait du monde. On admire d’emblée ce sens consommé du rubato qui confère aux concerts de Luisada la valeur de masterclasses irremplaçables pour tout aspirant à ce répertoire : voici en effet quelle hauteur de vue réclame cette musique, celle de l’« autre Chopin », celui du soir et du clair-obscur, celui des teintes moirées, après le mordoré des années tempétueuses. Et on perçoit dans cette adéquation rare, cette quintessence que je disais, celle qui provient d’un parcours et qui justement, avait pu donner l’album Schubert en 2023 : il y a aujourd’hui de la métaphysique dans le jeu poignant de Jean-Marc Luisada, dans ces pages à la gorge serrée et à la sagesse consommée, pour lui qui n’a pas son pareil pour vous mener vers cette lumière tamisée des confidences apaisées. On y admire un toucher à peine croyable, et je ne connais que Evgeny Kissin pour disposer d’une telle palette de nuances : une technique qu’on ne parvient pas à s’expliquer avec les règles traditionnelles ou le jeu de tension/détente, car ici l’inexplicable vient de l’esprit plus que des mains, en un degré d’intériorité phénoménal en soi. Tout cela, au service de ce Chopin philosophe de l’être, poète en sons, Tondichter comme on le disait de Beethoven. Ici en 2024, au Festival International de Musique Classique de Puget-sur-Durance, à La Mélodieuse :
La Nocturne de Fauré qui suit (N° 2 en si majeur, op. 33 N° 2) émerge comme un prolongement, dans le ton d’un balancier rythmique qui va céder la place à une accélération ténébreuse à laquelle Luisada voue des accents – mieux, des reliefs d’inconfort ou du pressentiment de l’ombre. Quand le balancier revient pour apaiser, le même toucher miraculeux amène les miroitements conclusifs comme un offrande, c’est dire que la technique du pianiste a encore partie liée avec un cheminement expressif.
Le Nocturne de Chopin N° 8 en ré bémol majeur op. 27 N° 2 souligne à nouveau le ton d’une mélancolie aux accents plus lyriques que dans l’opus 62, mais à la distanciation tout autant tendue vers un idéal d’apaisement (quelque peu contredit par une main gauche au rythme obsédant qui communique l’inquiétude réitérée à la main droite d’une mélodie amère). La clarté du jeu de Jean-Marc Luisada permet d’accéder à l’intimité de cette dialectique caractéristique du Nocturne, et qui va pour autant s’évanouir pareillement (« Sois sage ô ma Douleur et tiens-toi plus tranquille » aurait dit Baudelaire, mais Chopin, lui, dépasse la posture). Il y a, dans l’approche proposée ici, un tribut souverain (et souverainement humble) au Chopin des alexitères (des remèdes) à l’intranquillité, et ces Nocturnes nous en donnent la clé dans une lecture si éminente.
Car il faut justement avoir longuement médité cette musique, pour y juxtaposer le célèbre Nocturne N° 6 de Fauré (en ré bémol majeur, op. 63) qui semble faire écho à la lancinance de cette instabilité, encadrée par un sacerdoce de la méditation. Atmosphères changeantes en une même page, tempi évoluant au gré d’une narrativité qui transforme le flux en une succession d’épisodes où souvent se manifeste une passion, voire un cri qui n’est même plus étouffé. Ce cri pourtant trouvera lui aussi son havre – c’est peut-être cela même, qui constitue l’unité du Nocturne, cette résolution des tensions exposées ou suggérées. À nouveau, l’intelligence musicale de l’interprète est ici cardinale, pour transmettre ce langage précis, et cette rhétorique du sentiment.
Alors quand vient la grande Fantaisie en fa mineur op. 49, cette sorte de Hammerklavier de Chopin (toutes proportions gardées – on peut aussi y entendre le dernier Schubert), on a déjà cheminé, pour accueillir les accents quasiment martiaux de l’amorce aux allures tragiques au gré desquels le pianiste nous mène en des lieux vertigineux d’oscillations. L’expression retenue ou subsumée dans les Nocturnes se fait ici péremptoire, déclamative et impérieuse. Accords en grands aplats et rythmes de marche alternent avec des phases méditatives et des élans passionnés où Luisada, de tout temps romantique dans l’âme, excelle à nous mener vers des promontoires très lisztiens et qui soudain rencontrent non pas l’évanescence, mais une sagesse conquise. On sait, on se rappelle, après avoir entendu une telle version, qu’on est en présence d’un très grand spécialiste de Chopin, sans doute l’un des meilleurs, et qui aura su forer loin dans l’expression d’une intériorité souffrante, l’ultime manière du compositeur.
L’ADIEU AUX ARMES : VERS UN HAYDN VISIONNAIRE
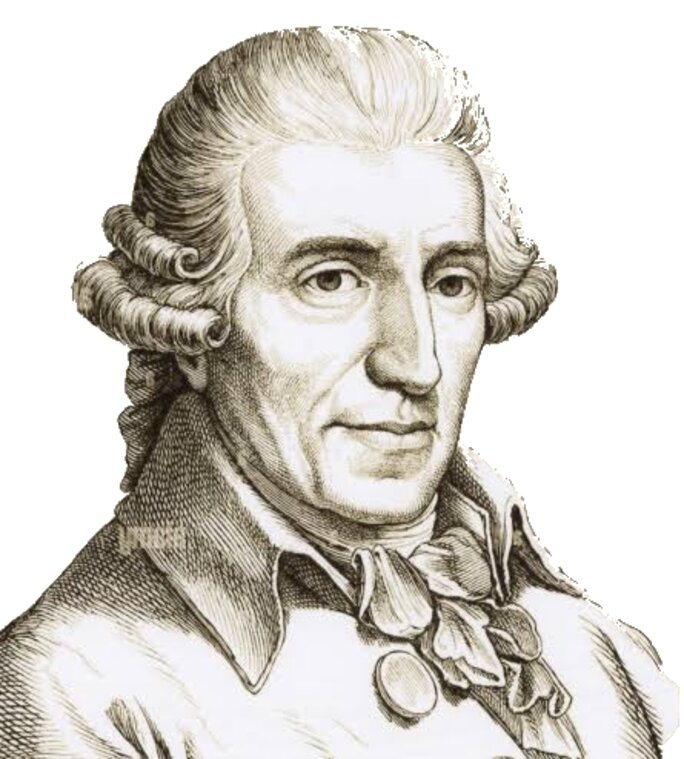
Seul l’imprudent qui aurait nourri au fil du temps le cliché d’un Haydn tenant unilatéral du style galant serait décontenancé devant le chef-d’œuvre de ces Variations en fa mineur (« Sonate, un piccolo divertimento », Hob XVII: 6) où se confirme le souffle visionnaire de ce compositeur qui, en maints lieux de son œuvre, fut imprégné du « Sturm und Drang », le courant esthétique qui prépare très clairement le romantisme allemand. Cette ébauche de sonate, en manière d’Andante, est pourtant unique en son genre dans la production haydnienne si abondante comme chacun sait. On frissonne en pensant que ce Haydn de 1793 a commencé à donner ses cours de contrepoint à un jeune pianiste au tempérament indomptable en provenance de Bonn, un certain Ludwig van Beethoven, venu à Vienne recevoir « avec une application incessante, des mains de Haydn, l’esprit de Mozart », selon la recommandation du compte Waldstein. La quasi-sonate faisait lors du concert du 10 février, la transition entre la première partie des Nocturnes et la deuxième partie, intégralement Chopin. Un choix qui confirme l’intelligence du programme, puisqu’à la pointe extrême du lyrisme personnel avec le romantisme (Chopin) et le post-romantisme (Fauré), ces Variations apportaient une jonction inattendue certes, mais pourtant bien réelle. Car en amont des turbulences et épanchements, Haydn incarnait ici le chaînon manquant entre le classicisme et les prémisses romantiques.
Toute argumentation en la matière est superflue, quand justement un jeu si éclairé manifeste de façon assez éloquente et bouleversante en soi ce qui relève de cette vertigineuse émergence de l’expression du moi en musique, de son intériorité et de ses tourments, non inféodés à un style qui doit rendre des comptes, à l’Église ou à l’aristocratie. Quelques années avant, Mozart allait dans le même sens dans ses ultimes symphonies ou ses concertos pour piano entre autres (sans parler de ses opéras), et ce moment de transition (plus large qu’on ne se le représente généralement, et auquel il faut aussi joindre CPE Bach) constitue finalement l’un des événements esthétiques les plus colossaux pour la fin du XVIIIe siècle musical, c’est dire combien ces Variations valent bien leur pesant de tournant historique, en une sorte d’adieu aux armes factices d’un style plaisant – auquel pourtant le bon vieux « papa Haydn » devait recommander à son ténébreux élève, de donner encore des gages dans les premiers opus de sa musique de chambre. Quelque chose se passe en musique en ces années 1790, une mutation profonde qui à jamais modifiera le statut et la fonction de l’expression musicale. Revenant à la source du lyrisme personnel, Jean-Marc Luisada marquait en somme son programme d’une cohérence induite, où on pouvait voir les aventures esthétiques des expressions d’un moi désenchanté ou marqué par les affres du doute et plus tard, du mal-être. Haydn annonciateur du romantisme, au moment même où il devient le professeur de Beethoven : on est là indéniablement à un carrefour de l’histoire de la musique, et le rôle d’un musicien en un programme de concert qui allait de merveilles en merveilles, est aussi, il faut bien le croire, celui d’une intelligibilité esthétique et historique de la musique transmise. Jean-Marc Luisada pédagogue donc, au sens plein du terme.
Son interprétation de ces Variations (ci-dessous, celle d’András Schiff), devait emprunter, je le redis, cette narrativité qui est l’une de ses signatures, faisant ressortir ici une certaine sophistication de l’écriture, les variations proprement dite venant après non pas un mais deux thèmes (mineur/majeur), chacun d’entre eux recevant ses variantes. Originalité voulue, et qui va sous les doigts de ce pianiste des temporalités, se déliter brutalement en un orage, des accents particulièrement pathétiques et sombres (le lyrisme naturel du pianiste donne à ces moments un relief tout particulier, une ampleur sonore impressionnante). On imagine sans effort le retentissement que durent avoir ces Variations d’un genre si nouveau, sur l’esprit du jeune Beethoven, et dont on peut presque deviner l’empreinte plus tard pour ses dernières sonates pour piano, de cette écriture du chaos. Et puis in fine, le délitement, encore, vers ce même recueillement final, ce secours dans la distanciation, qu’on avait entendu chez Chopin et Fauré : on croit plus que jamais ici, deviner une virtualité anticipatrice prononcée de ce Haydn hanté par la mort (celle de Mozart deux ans auparavant, entre autres).
Cette musique, on le sait maintenant, essaimera dans son inspiration, bien plus loin que ne pouvait l’imaginer Haydn lui-même lorsqu’il la composa. On peut donc parler à son endroit, d’une réelle intuition visionnaire. En donnant à apprécier concrètement les données des mutations à venir de la musique en tant que langage, Jean-Marc Luisada vouait son programme à un efficace panorama de ses potentialités de transformation – et c’est là une touche de grande clairvoyance pour un programme de concert, éminemment pertinent.
L’ANNÉE DERNIÈRE À MARIENBAD : CHOPIN EN NOSTALGIE ET EN ORAGES
Une nostalgie fondamentale habite encore l’oscillation caractéristique de la Mazurka en ut mineur, op. 56 N° 3, qui nous était livrée en cette soirée avançant, dans l’écrin d’une fausse nonchalance qui est la marque du Chopin de la douce mélancolie que l’on sait, à l’image aussi de cette Berceuse en ré bémol majeur op. 57, de variations serties dans cette douceur perlée de vague à l’âme. Dans ce registre encore Jean-Marc Luisada illustre cette longue et ancienne fréquentation de Chopin, qui lui permet de transmettre tous ses registres expressifs avec tant de facilité.
La succession des Scherzos N° 4 et N° 2 ménageait une ascension finale, savamment agencée par le maître des horloges. Le N° 4 en mi majeur op. 54, le plus « sage » des quatre, gardait le caractère d’une tension vers la vélocité, et les perles de la Berceuse se faisaient ici pressantes. Et quand le pianiste s’élançait dans le Scherzo N° 2 en si bémol mineur op. 31, sans doute des quatre le plus impressionnant (et qui demeure l’une des pages les plus « tourmentées » de Chopin pour le dire de manière schématique), on assistait encore à ce déploiement narratif propre au style du pianiste-conteur : ici les fameux triolets et leurs réponses variées tenaient un relief qui donne toute son intelligence structurelle à cette page splendide qui n’est pas un morceau de bravoure mais justement, un moment où la structure donne tout son sens à l’élan et à la fureur. Ici un estuaire cherche son delta, et un maître de navigation est appelé à la barre d’un esquif balloté par les vagues. Luisada connaît en expert les embûches et les passes, là où le courant est favorable au passage des récifs, il sait mieux que quiconque que « nos barques sont ouvertes, pour tous nous les naviguons » (Édouard Glissant) et que le « Maître d’astres et de navigation » (Saint-John Perse) tire sa force d’une science souveraine : la vision de ce qui s’énonce. En l’absence de cette boussole, la virtuosité serait vaine et tournerait à vide. En présence et dans l’usage de la boussole, le voyage est vertigineux et inoubliable.
a marque des concerts de Jean-Marc Luisada : les bis généreux et variés. Ici, en quatre étapes, Nino Rota (évidemment, pourrait-on presque dire) côtoyait un Intermezzo de Brahms, une pièce d’Elgar et… « un petit Chopin », rien de moins que la Grande Valse brillante op. 18 (ci-dessous à gauche, masterclass pour le magazine Pianiste et à droite, interprétation), pour le coup, morceau de bravoure s’il en est, virevoltant à souhait, là où le tournoiement est l’idiome du charme, et là où l’acteur-pianiste déploie une élégance qui vous donne déjà la nostalgie d’un si grand moment de musique, un concert d’intelligence et de vertiges, là où la quintessence acquise par les bienfaits d’un long cheminement, se traduit pour tous en enchantements de chaque instant.



